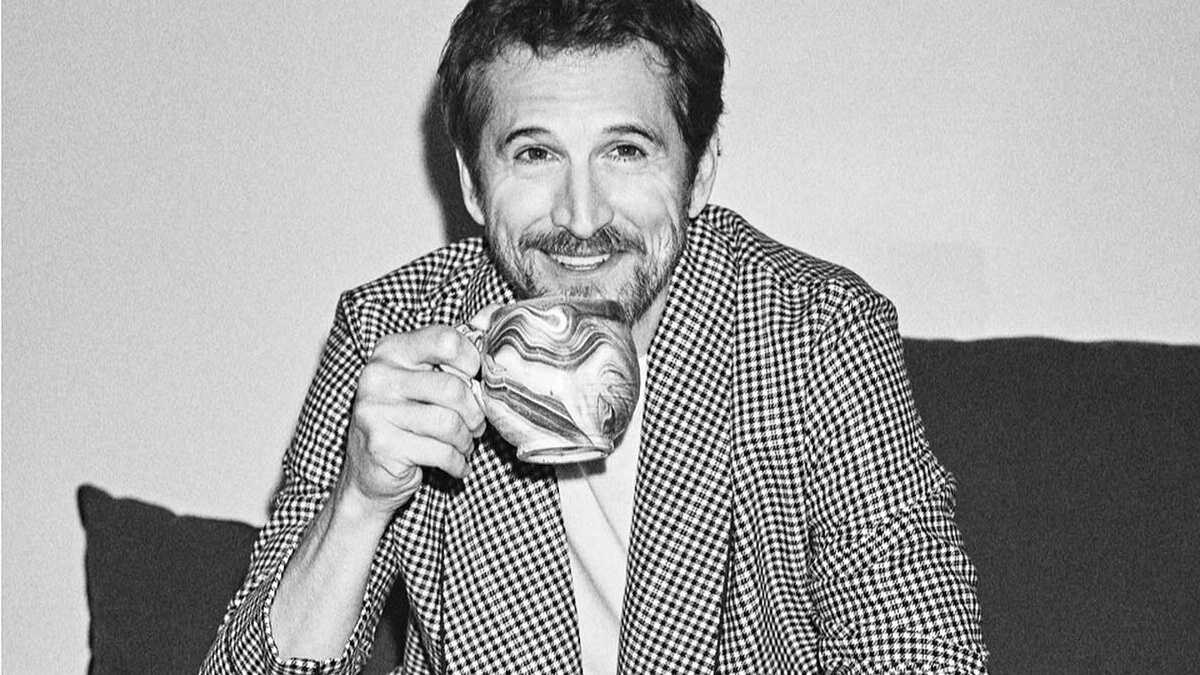Comment intégrer les réfugiés en France ?
Une étude analyse trois trajectoires d'intégration de réfugiés en France : l'ajustement, l'enrichissement et le détachement. Avec quels apprentissages ?


Une étude analyse trois trajectoires d'intégration de réfugiés en France : l'ajustement en assimilant les normes de la société d'accueil, l'enrichissement en renversant les discriminations à leurs avantages et le détachement en rejetant la culture du pays d'accueil. Avec quels apprentissages ?
Depuis 2015, la France accueille un grand nombre de réfugiés fuyant conflits et persécutions. Derrière l'urgence humanitaire, se pose la question de leur intégration socio-professionnelle : comment trouver un emploi dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue ? Comment se reconstruire et forger une nouvelle identité professionnelle, alors que pèsent les discriminations et la perte de statut ?
Dans notre étude, nous avons mis en évidence trois trajectoires – l’ajustement (Adjusting), l’enrichissement (Enhancing) et le détachement (Detaching). Il ne s'agit toutefois pas de catégories figées : les individus peuvent passer de l'une à l'autre au fil de leur parcours, selon le soutien dont ils bénéficient ou les obstacles qu'ils rencontrent. Les trajectoires décrivent des tendances et des dynamiques identitaires, qui évoluent avec le temps. Avec quels apprentissages ?
Ajustement : s'adapter aux codes locaux
Dans cette première trajectoire, les réfugiés cherchent d'abord à minimiser leur perception de la discrimination et à assimiler les normes de la société d'accueil. Ils investissent énormément dans l'apprentissage du français et des usages professionnels, voire taisent une partie de leur identité d'origine au travail.
« Je suis resté six mois dans la rue. Ils n'emploient pas ceux qui ne parlent pas bien français, alors j'ai tout fait pour m'adapter. » (Alisan, 28 ans, Afghan)
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
L'objectif est d'être reconnu avant tout comme un professionnel compétent et de gommer autant que possible la stigmatisation liée à leur statut de réfugié. Ces personnes privilégient l'effort individuel et comptent beaucoup sur des dispositifs de formation, des cours de langue et des conseils pour s'insérer rapidement.
« En France, après la Turquie, la Grèce… je voulais absolument rester. Apprendre la langue était vital. Un ami m'a emmené à Français Langue d'Accueil (FLA). Sur la porte était écrit : “inscriptions closes”. J'ai insisté, et c'est comme ça que j'ai pu commencer à apprendre le français ! » (Ahmad, 30 ans, Afghan)
Enrichissement : valoriser son parcours
Dans la seconde trajectoire, les réfugiés prennent acte des discriminations vécues et de la perte de statut, mais tentent de retourner la situation à leur avantage. Plutôt que d'occulter leur passé, ils mettent en avant leurs compétences acquises à l'étranger et leur capacité d'adaptation pour montrer que l'étiquette « réfugié » peut être un atout.
« J'avais un poste important en Iran. Arrivé ici, je suis devenu “personne”. Mais j'ai voulu prouver qu'avoir une autre vision, un réseau différent, c'était précieux. » (Tahir, 32 ans, Iranien)
Ces réfugiés optent pour l'intégration, selon la typologie de John W. Berry, maintenant des éléments de leur culture d'origine tout en empruntant ceux du pays d'accueil. Ils n'hésitent pas à revendiquer le statut de réfugié pour déstigmatiser cette identité et la transformer en levier de reconnaissance ou de créativité.
« L'association Singa m'a encouragée à assumer mon statut de réfugiée. Ils m'ont envoyée sur des événements professionnels pour casser les stéréotypes. J'ai compris que je pouvais dire : “oui, je suis réfugiée, et alors ?” » (Jana, 27 ans, Russe)
Détachement : se couper de la société d'accueil
La troisième trajectoire concerne des réfugiés qui, confrontés à un fort sentiment de discrimination et d'isolement, finissent par rejeter la culture locale et s'enfermer dans leur communauté d'origine. Ils se sentent étrangers, incompris, et s'emploient peu à apprendre la langue ou à bénéficier des dispositifs d'aide.
« Je ne me sens pas connecté à la France. Je n'ai pas d'histoire ici, je n'ai pas d'avenir ici. Je me sens étranger partout. » (Majid, 32 ans, Iranien)
Ce repli identitaire limite leur recours aux programmes de soutien. Sur le plan professionnel, ils stagnent parfois dans des emplois précaires ou sous-qualifiés, faute d'opportunités et de volonté de s'intégrer davantage. Pour ces personnes, le soutien des ONG serait pourtant encore plus essentiel, car il pourrait les aider à sortir du cercle vicieux de la défiance et du repli sur soi.
« Soit on est pauvres, soit on est dangereux. Je me suis épuisée à me justifier. Alors maintenant, je ne parle plus de mon statut. » (Sonia, 31 ans, Rwandaise)
Rôle clé des ONG au-delà de l'aide administrative
Si chaque réfugié réagit de façon singulière, notre étude montre combien les acteurs de la société civile peuvent aider à déstigmatiser l'étiquette « réfugié » en offrant un espace de revalorisation identitaire. Les associations participantes, telles que Each One (ex-Wintegreat), Français Langue d'Accueil (FLA) ou encore Singa, offrent de multiples ressources. Par exemple : cours de langue et formations pour maîtriser rapidement les codes locaux, accompagnement moral et psychologique pour valoriser le statut de réfugié, opportunités de socialisation afin de briser l'isolement, d'élargir le réseau et d'inverser les stéréotypes.
« Avoir des amis français, des mentors, ça m'a permis de comprendre la culture, de m'ouvrir… L'association m'a donné les clés pour décrocher un stage, puis un vrai job. Sans ça, je n'aurais pas pu avancer. » (Amir, 35 ans, Iranien)
Ces dispositifs peuvent renforcer l'ajustement, en facilitant l'assimilation, et l'enrichissement, en faisant du « label réfugié » un atout. Pour celles et ceux engagés dans la trajectoire de détachement, un accompagnement individualisé pourrait être déterminant pour retisser la confiance et renouer avec la société d'accueil.
Vers un engagement conjoint des ONG et des entreprises
L'intégration socio-professionnelle des réfugiés ne peut reposer uniquement sur la persévérance individuelle ou sur la seule action des associations et Organisations non gouvernementales (ONG). Les entreprises, notamment celles affichant une forte responsabilité sociétale et environnementale (RSE), ont un rôle majeur à jouer. Elles peuvent adopter leurs processus de recrutement pour éviter les biais, en définissant des programmes de mentorat ou de formation en interne et, enfin, en encourageant la diversité comme levier d'innovation.
« Je veux montrer qu'on peut réussir en tant que réfugié. Je ne suis pas un monstre. J'ai juste une autre histoire, et je peux apporter mes compétences. » (Aliya, 33 ans, Syrienne)
Des plates-formes et associations comme Kodiko ou Action Emploi Réfugiés facilitent le lien direct entre employeurs et réfugiés, en misant sur l'accompagnement personnalisé. Une intégration durable suppose une alliance entre les ONG, pour lutter contre la stigmatisation et apporter un soutien global, et les entreprises, pour ouvrir des opportunités professionnelles et reconnaître la valeur des parcours d'exil.
Car au-delà de la seule insertion économique, il y a un enjeu de reconnaissance et de construction identitaire qui concerne la société tout entière…![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.


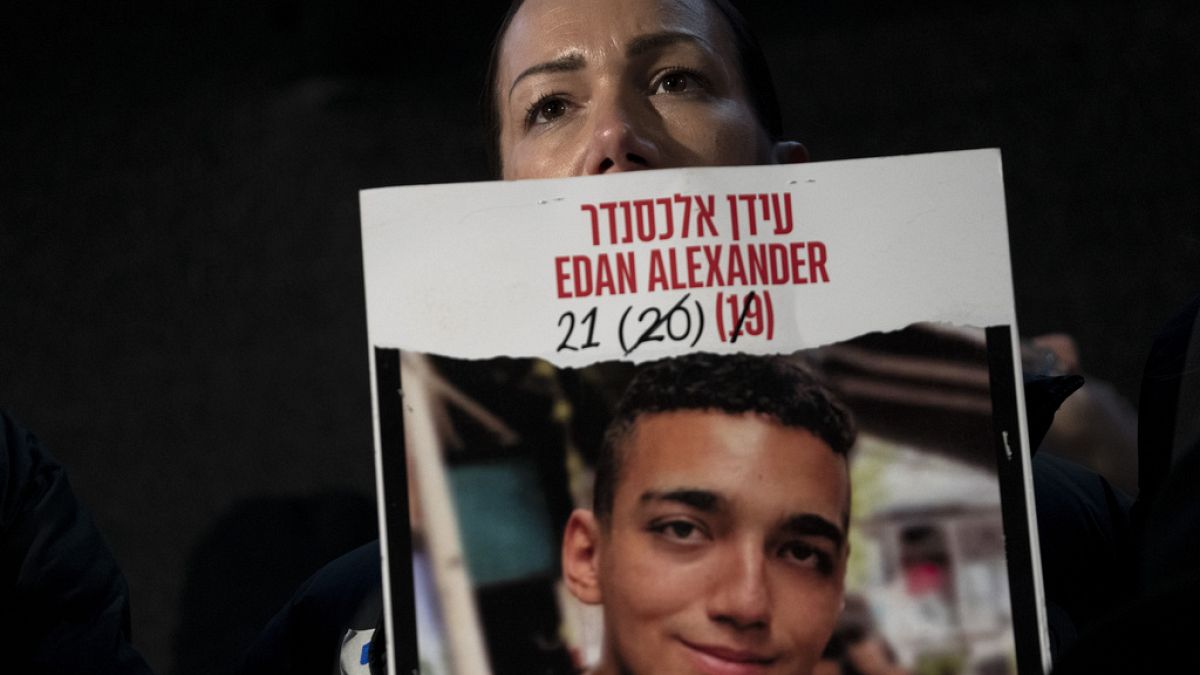





![[MEDIAS] Gaza, « c’est Auschwitz » : Thierry Ardisson dérape sur France 2](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/capture-decran-1524-616x347.png?#)









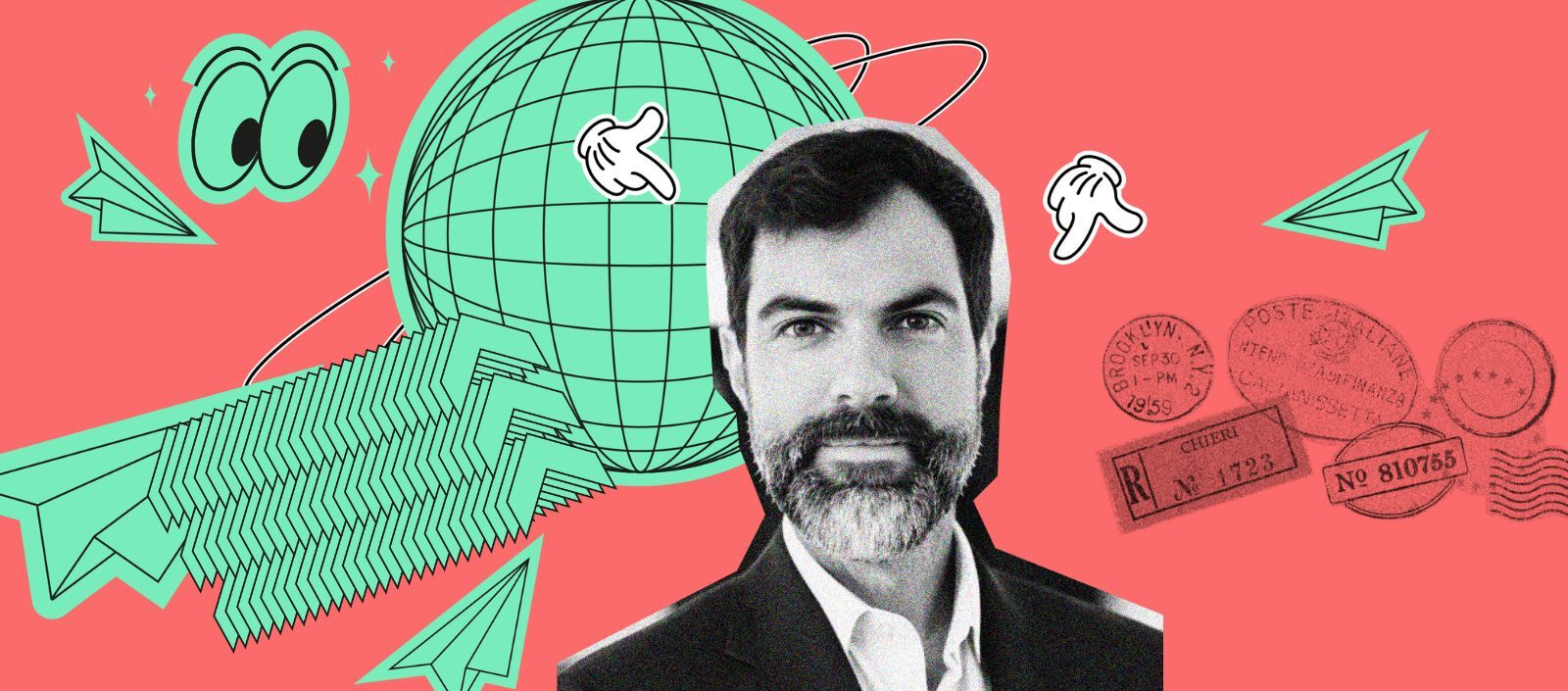





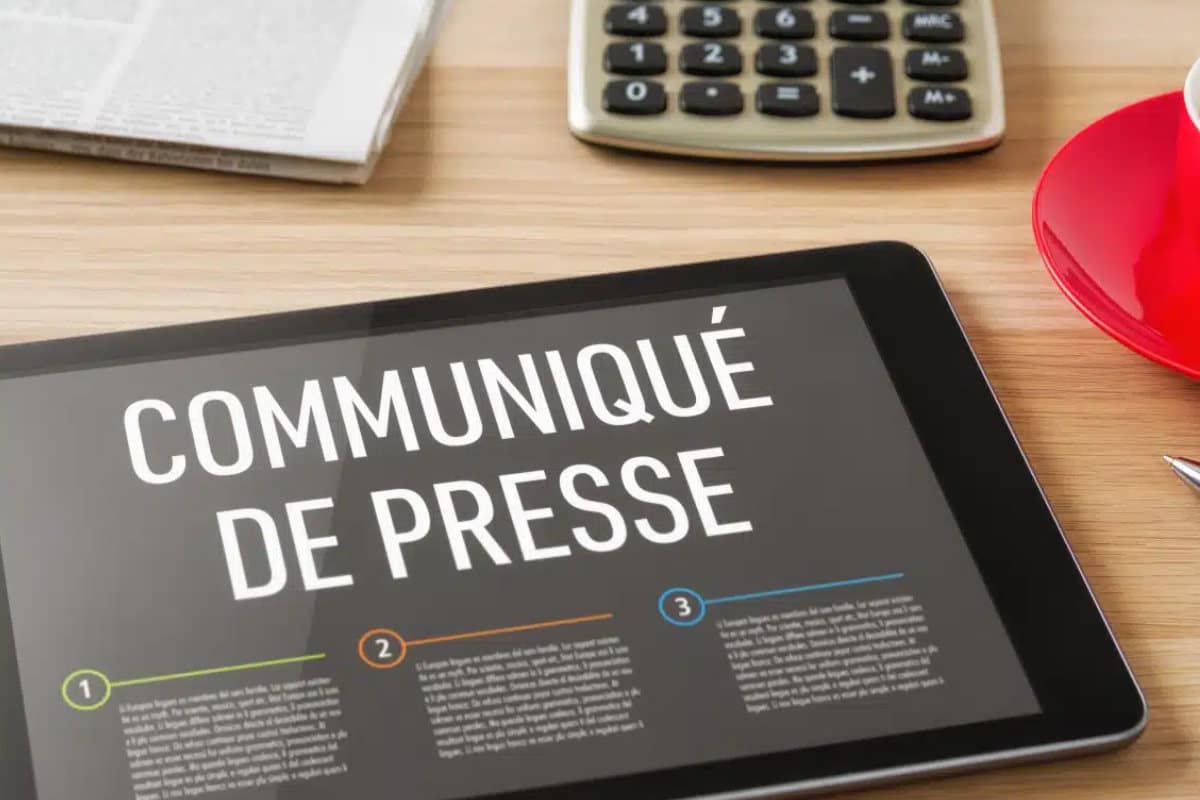



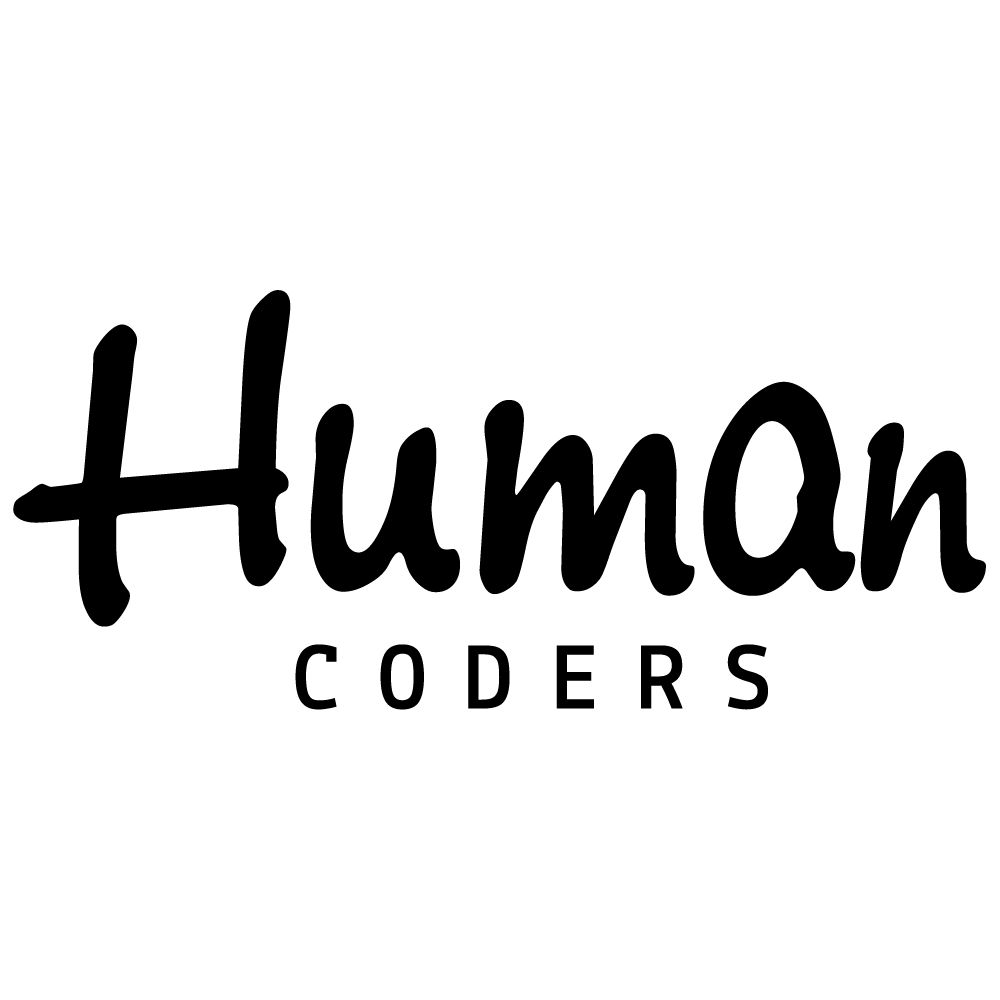



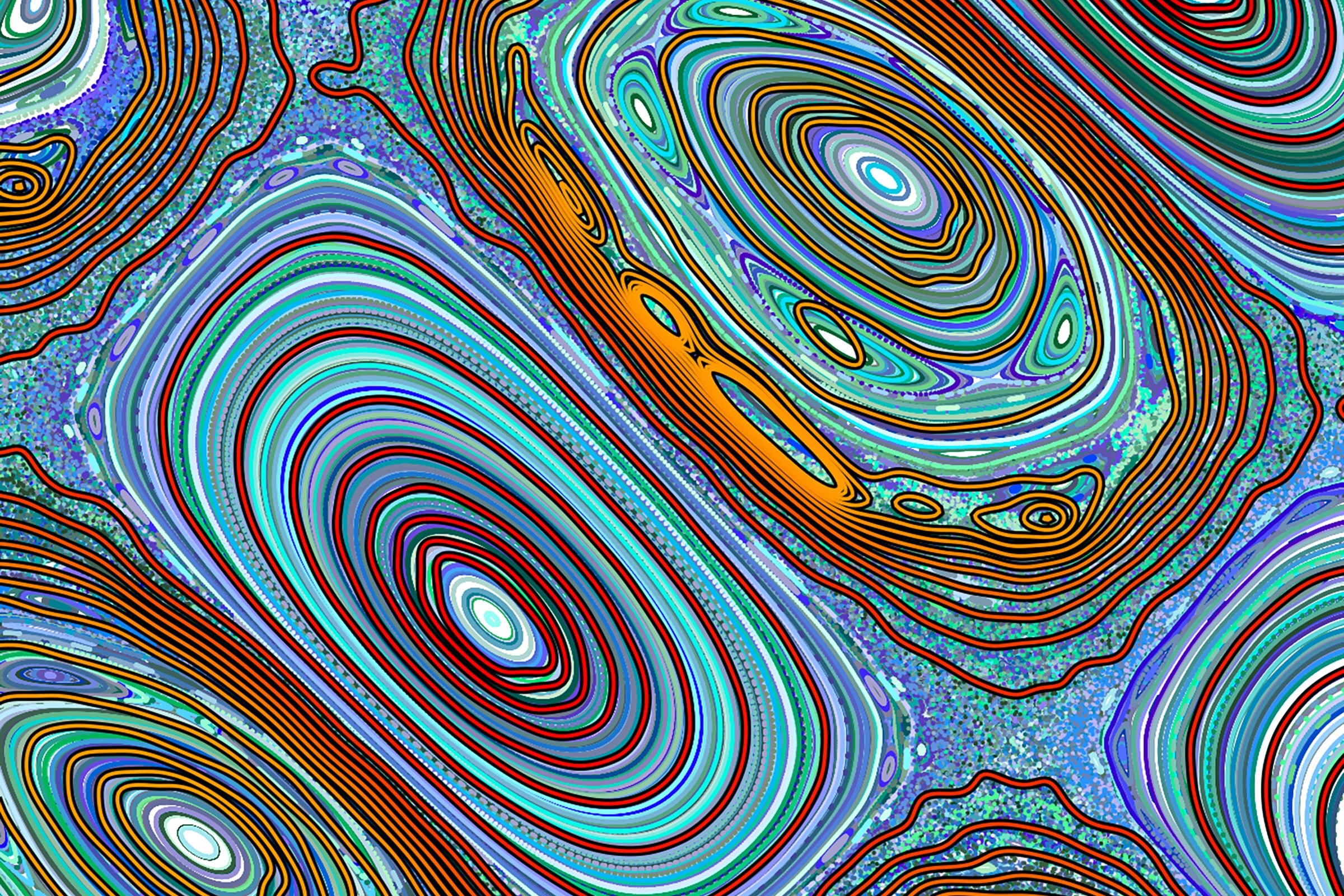



/2023/04/17/643d14e41a080_043-465257877.jpg?#)
/2025/05/12/video-21-68220116c5956419354780.jpg?#)

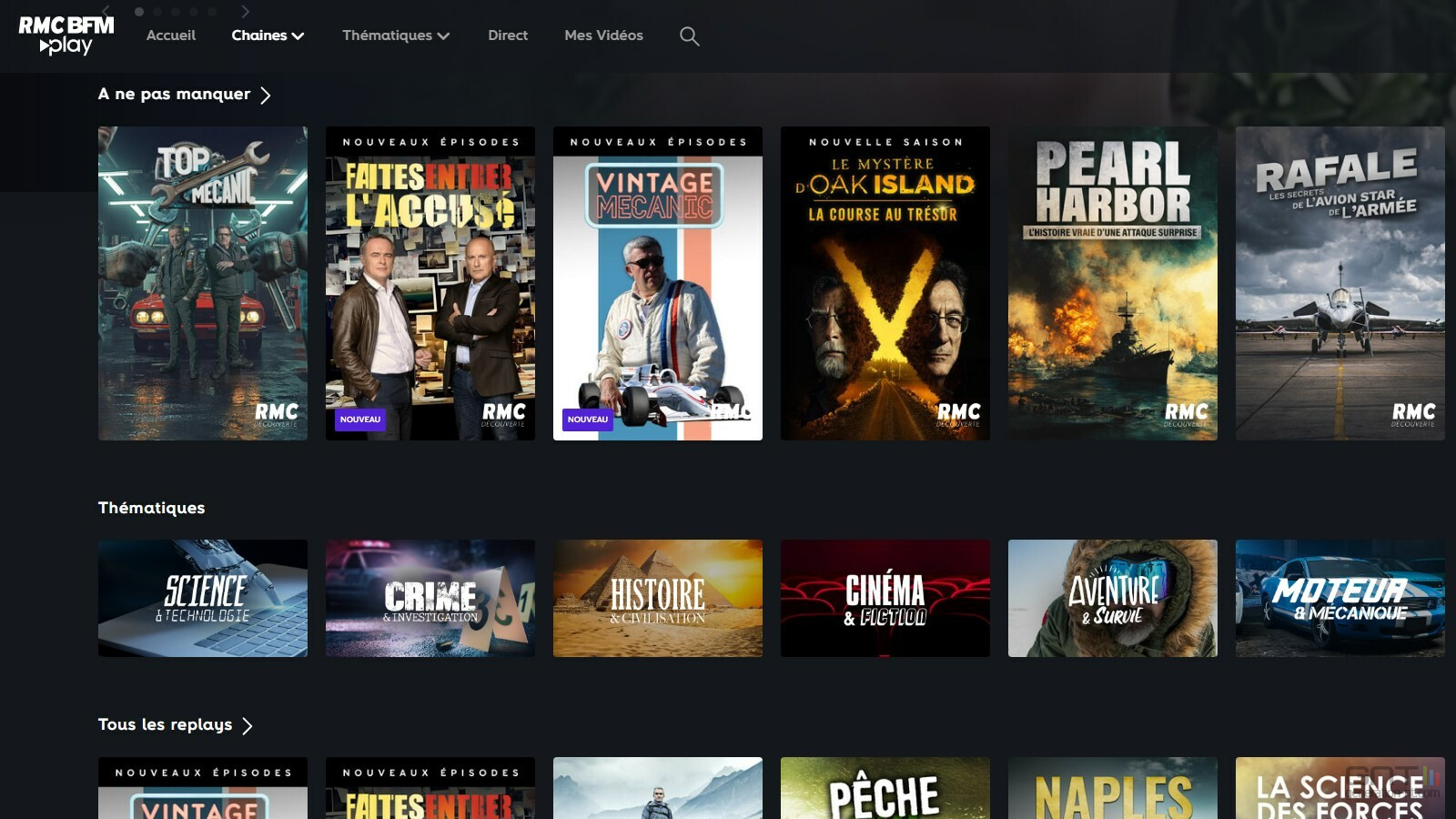
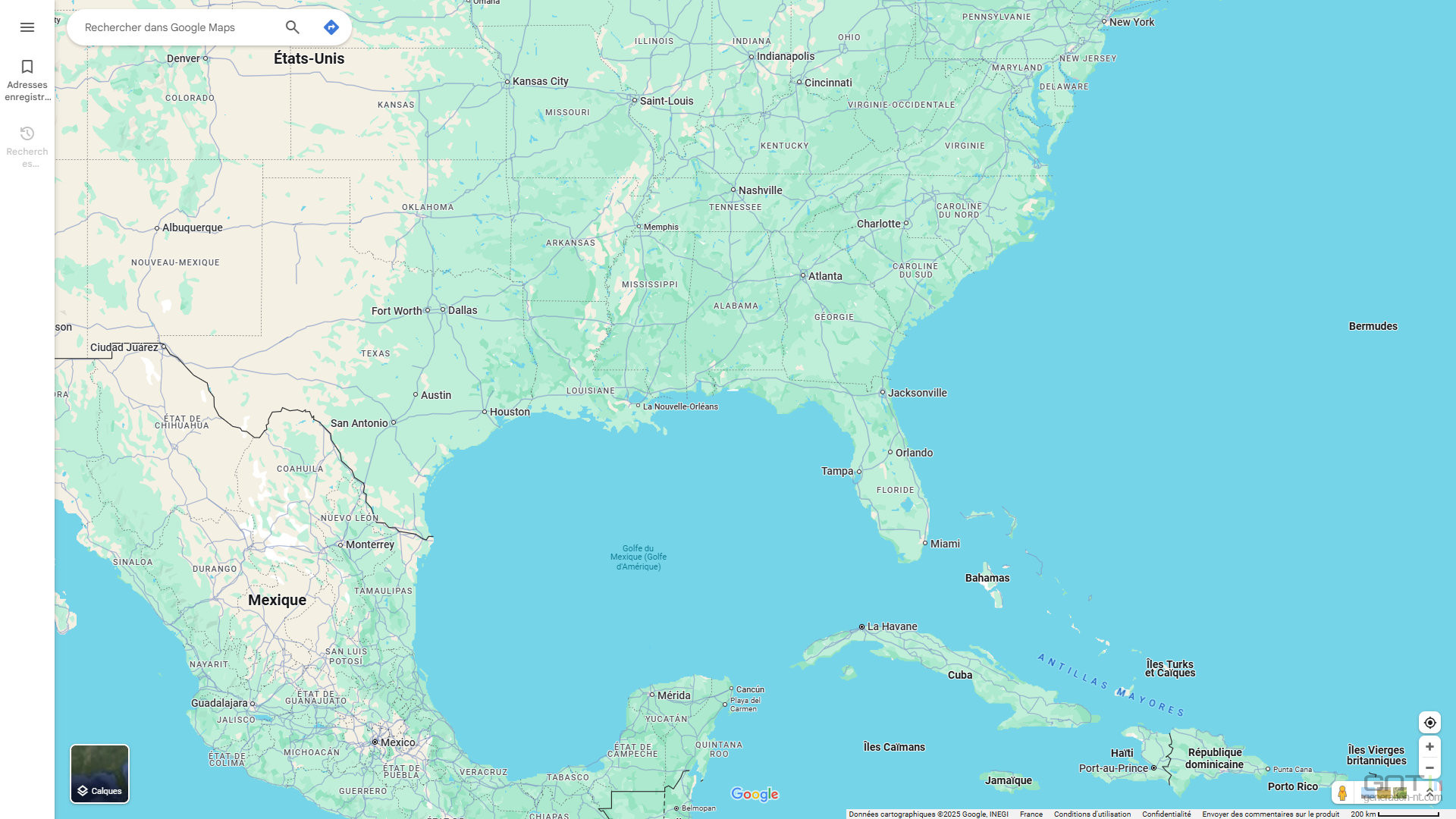





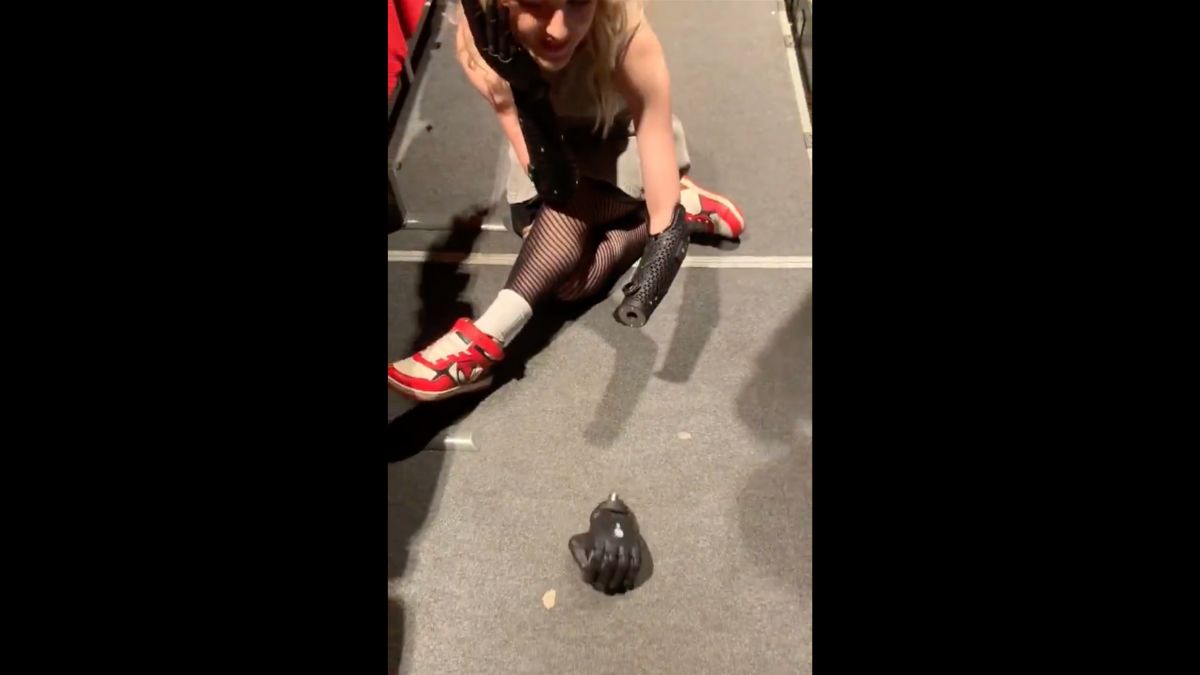



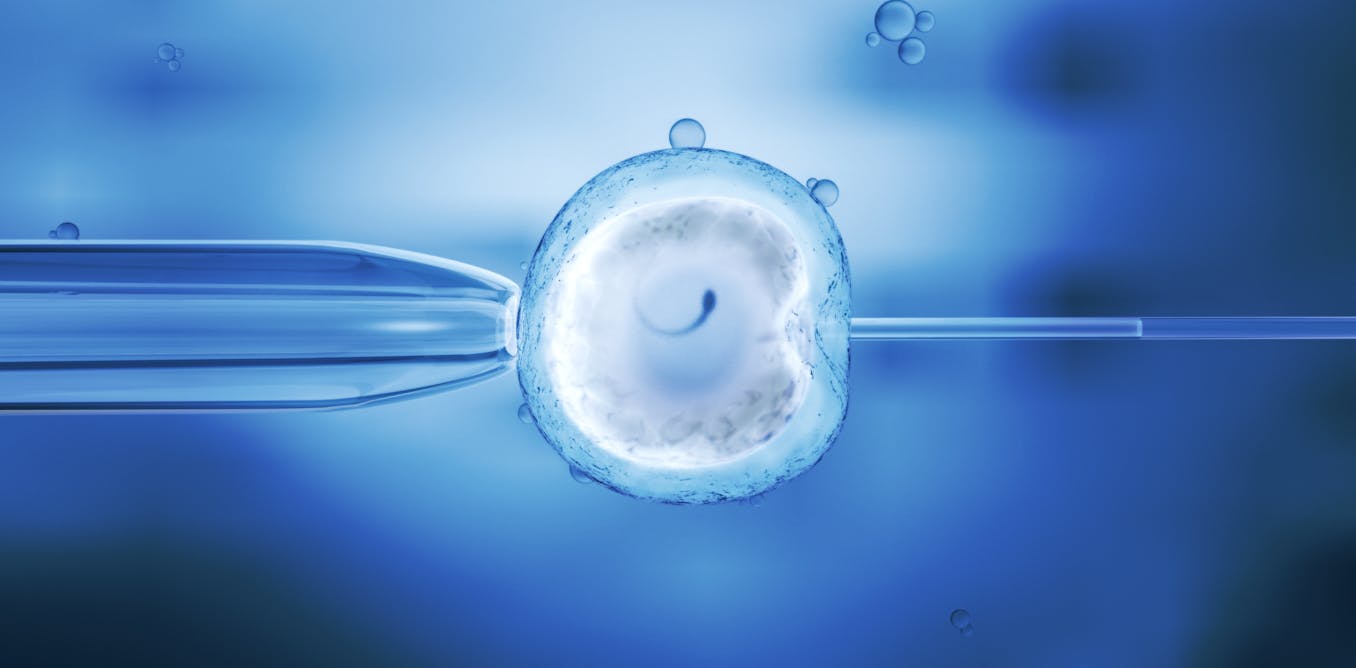





/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FL9nDWF6uqMcjvaLjlJyyoBEAViPLOyOP5IN2YFjp.jpeg)
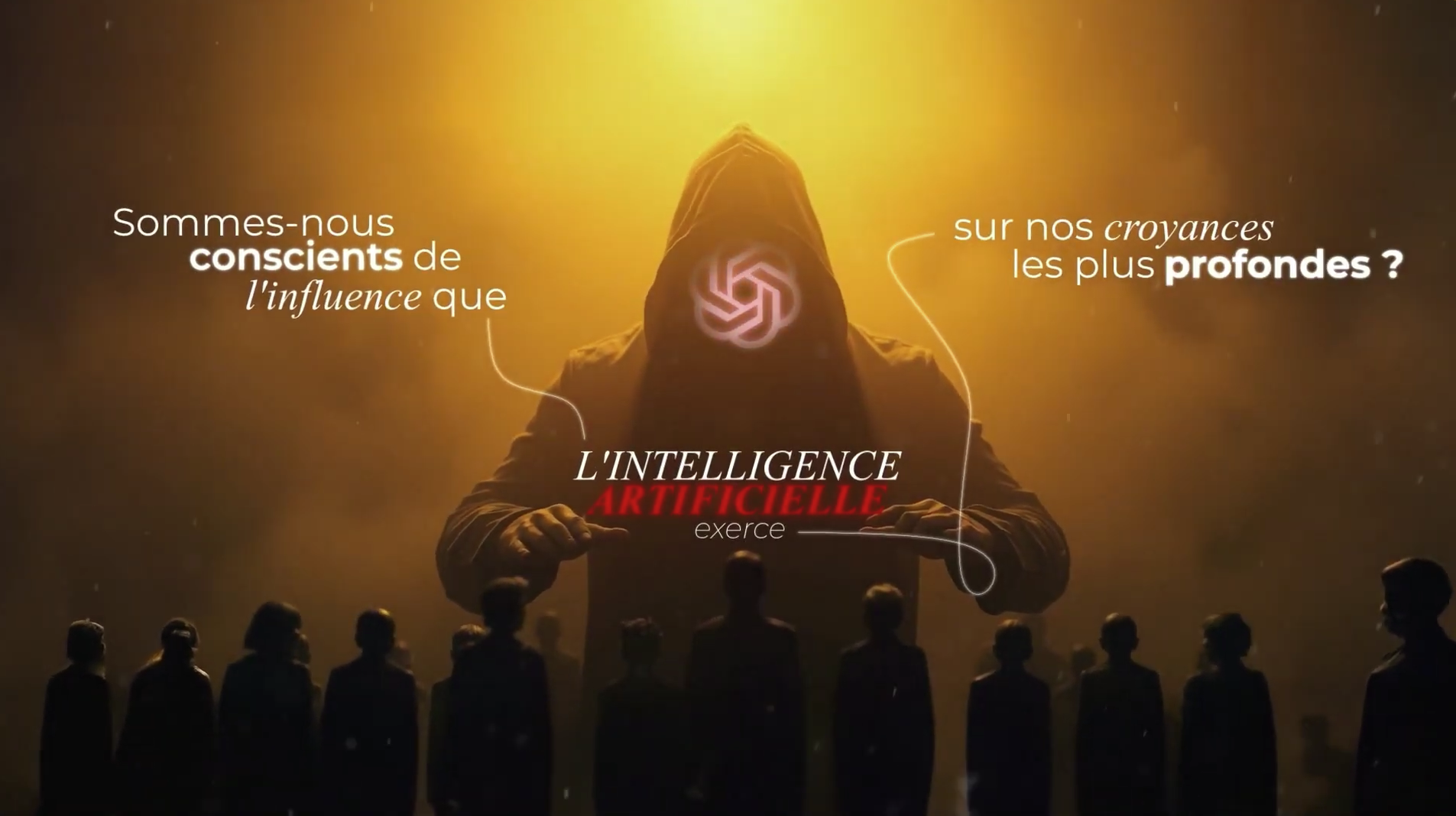

![[TEST] The Talos Principle: Reawakened : sympa à découvrir, mais presque impossible à finir](https://s3.nofrag.com/2025/05/The-Talos-Principle-Reawakened-01.jpg)