Nouvelle-Calédonie : l’impasse et l’inquiétude, un an après les émeutes
Un an après les émeutes du 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, les négociations politiques sur l’avenir institutionnel de l’archipel ont échoué et l’économie est durement touchée.

Dans les semaines qui ont suivi le 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a connu une flambée de violence conduisant à la mort de 14 personnes (12 civils et deux gendarmes), à la destruction de 500 entreprises et à une chute de 10 à 15 % du PIB. Ces émeutes ont suivi les manifestations des indépendantistes contestant la réforme visant à élargir le corps électoral, voulue par Emmanuel Macron. Un an après, l’économie est en berne et le processus de dialogue politique est à l’arrêt, malgré les récentes tentatives du ministre des outre-mer Manuel Valls. Une nouvelle flambée de violences est-elle à craindre ?
Un an après les violentes exactions qui ont durement touché la Nouvelle-Calédonie, le constat ne souffre d’aucune contestation : une économie en berne, des centaines d’entreprises pillées ou brûlées, entre 10 000 et 15 000 personnes au chômage (pour une population totale estimée à 279 000), un endettement public record, une inflation galopante, etc.. Alors que la date anniversaire du 13 mai fait craindre une nouvelle flambée de violences, les Calédoniens fondaient beaucoup d’espoir dans les négociations qui ont finalement échoué la semaine dernière entre l’État, les indépendantistes et les non-indépendantistes.
Cet espoir qui reposait sur des signaux encourageants : le ministre des outre-mer Manuel Valls est venu dans l’archipel trois fois depuis le mois de février et avait réussi le « tour de force » de remettre les responsables politiques calédoniens autour de la table des discussions après quatre ans de rupture. Face à une classe politique en partie recomposée, mais plus que jamais divisée, Manuel Valls a d’abord été le catalyseur de cette reprise des discussions qui ont prospéré entre février et avril. Puis en amont de sa dernière visite (30 avril-8 mai 2025), l’ancien premier ministre a esquissé une forme d’ultimatum afin de mettre les responsables politiques calédoniens face à leur responsabilité en prévenant, ce sera « un accord ou le chaos ».
Finalement, après trois jours de « conclave » et d’échanges à huis clos, « aucun projet n’a pu recueillir de consensus », Manuel Valls échouant à s’inscrire dans la continuité de Michel Rocard et de l’accord de Matignon en 1988. Dans un archipel où les responsables politiques locaux jouent la prolongation, cette impasse alimente une défiance populaire croissante face à des élus incapables de sortir la Nouvelle-Calédonie de l’ornière.
Depuis les émeutes du 13 mai 2024, cette impasse se décline autour de trois paradoxes majeurs.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Premier paradoxe : quête d’indépendance et dépendance accrue
En effet, depuis trente ans, grâce aux transferts financiers de l’État et portée par ses ressources minières importantes et son industrie métallurgique, la Nouvelle-Calédonie avait acquis un niveau de développement nettement supérieur à ses voisins de l’Océanie insulaire, malgré la persistance d’importantes inégalités sociales et ethniques. Ce sont d’ailleurs ces inégalités et le climat de violence chronique qui ont constitué le creuset favorable des émeutes du 13 mai 2024.
Sans revenir davantage sur les déterminants et les causes de ces exactions (le terme pour désigner ces « évènements » est d’ailleurs sujet à débat), les conséquences directes et indirectes de ces émeutes ont réduit en cendres trente années de rééquilibrage économique et de relative paix sociale, malgré la préexistence de difficultés socioéconomiques (crise du secteur du nickel, affaiblissement des comptes sociaux, endettement lié aux conséquences du Covid, etc.). Les émeutes ont porté l’estocade à une situation déjà dégradée. Outre les indicateurs évoqués précédemment, les récentes statistiques économiques de l’archipel nous ont confirmé cet état de fait avec un recul inédit du PIB en 2024, entre 10 % et 15 %.
Inéluctablement, pour tenter de répondre à l’effondrement économique, la survie de l’archipel relève essentiellement du recours à l’aide de l’État malgré une incertitude politique et financière à l’échelle nationale. Selon Manuel Valls, « plus de trois milliards d’euros ont été engagés pour la Nouvelle-Calédonie en 2024 ». Malgré cette aide, la Nouvelle-Calédonie a été contrainte de contracter plusieurs prêts, contribuant à un endettement record de 500 %, suscitant localement de vifs débats.
En effet, après vingt-cinq ans de prise d’autonomie (la plus importante de l’outre-mer), ces émeutes ont conduit l’archipel dans une ultradépendance notamment financière vis-à-vis de l’État, déséquilibrant sans doute la conduite des dernières négociations politiques. À la suite de leur échec, M. Valls a d’ailleurs rappelé aux partenaires des « engagements structurants » notamment en matière de consolidation des finances publiques :
« Il ne peut pas y avoir ce soutien de l’État sans qu’il y ait des réformes, il est temps qu’elles soient mises en œuvre. »
Second paradoxe : des indépendantistes en perte d’influence
Comme une corrélation des émeutes, l’année 2024 a également été le symbole d’une profonde recomposition du paysage politique. Si les indépendantistes ont connu le climax de leur représentation institutionnelle en 2024 et s’ils ont été majoritaires lors de l’élection législative de juin 2024, ils ont revanche perdu successivement la présidence du Congrès puis du gouvernement néo-calédonien – les institutions législatives et exécutives du Territoire. En sus, le camp indépendantiste apparaît désormais divisé avec la scission des deux principales branches : l’Union calédonienne (UC) et l’Union nationale pour l’indépendance (UNI), dans une guerre fratricide pour le pouvoir au sein du FLNKS.
Même si l’accession à la souveraineté demeure l’objectif commun, d’importantes divergences en termes de stratégie se font jour entre ces deux blocs, et notamment sur la condamnation des émeutes, qui ne fait toujours pas l’unanimité. Si l’UNI presse pour négocier (notamment pour une indépendance-association), l’UC (et l’ensemble des autres composantes du FLNKS) joue la montre et semble particulièrement critique vis-à-vis de l’État. De manière comparable, la situation du camp non indépendantiste montre une fragmentation semblable avec une scission durable, notamment vis-à-vis des partis centristes ou modérés (Calédonie ensemble et l’Éveil océanien).
D’ailleurs, le communiqué de presse des partis politiques Les Loyalistes et le Rassemblement-LR, au lendemain de l’échec des négociations, dit très explicitement qu’ils sont la seule délégation à avoir refusé la proposition institutionnelle de M. Valls, qu’ils jugent comme une forme « d’indépendance-association » laissant sous-entendre que Calédonie ensemble et l’Éveil océanien y seraient eux favorables.
Face à cette double division, la perspective d’une vague migratoire sortante – difficilement quantifiable pour l’heure – pourrait finalement rebattre les cartes d’un rapport de force démographique qui pourrait a priori favoriser le camp indépendantiste revendiquant le maintien d’un droit inaliénable (et mobilisable à tout moment) à l’autodétermination.
Troisième paradoxe : reprise du dialogue et persistance d’une impasse
La reprise des discussions trilatérales (État, non-indépendantistes et indépendantistes) à partir du mois de février a été considérée légitimement comme un motif d’espoir après quatre ans de rupture des fils du dialogue. En donnant du temps au temps, en multipliant les allers-retours entre Paris et Nouméa sur une courte période (bien plus qu’à tous les autres territoires d’outre-mer), en acceptant des bilatérales puis des plénières à huis clos, Manuel Valls a tenté de réconcilier ce qui semblait irréconciliable.
Il n’aura finalement pas réussi à aboutir à un accord politique, suscitant l’ire et l’opposition d’une partie des non-indépendantistes l’accusant de vouloir imposer l’indépendance-association. Ce fidèle disciple de Michel Rocard pensait pourtant parvenir à mettre ses pas dans ceux de son mentor lorsqu’il avait arraché un accord de paix historique entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, en les enfermant à l’hôtel de Matignon, en 1988.
Face aux urgences sociales (chômage), économiques (financement public, secteur du nickel) et sanitaires (creusement des déserts médicaux, exode du corps médical), et face à la persistance d’escarmouches ponctuelles d’émeutiers isolés, le statu quo pourrait plonger l’archipel dans une incertitude délétère, Manuel Valls déclarant d’ailleurs : « Je crois sincèrement que le vide laissé par l’absence d’un compromis est lourd de menaces. »
Cet échec avalise l’organisation des prochaines élections provinciales avant la fin du mois de novembre 2025, après un an et demi de report, avec l’épineuse question du corps électoral toujours en suspens. Dans un archipel androcrate et gérontocrate, le renouvellement de la classe politique pourrait rebattre les cartes de cette impasse, même s’il ne résoudra probablement pas tous les maux de la société calédonienne.
Depuis trente ans, cet échec répété des responsables politiques à imaginer la suite au pari sur l’intelligence, alimente la défiance de la société calédonienne qui pourrait se laisser tenter par des alternatives citoyennes, à l’image de l’étude sur un projet de préfiguration d’une instance de démocratie participative au sein du Congrès.![]()
Pierre-Christophe Pantz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.





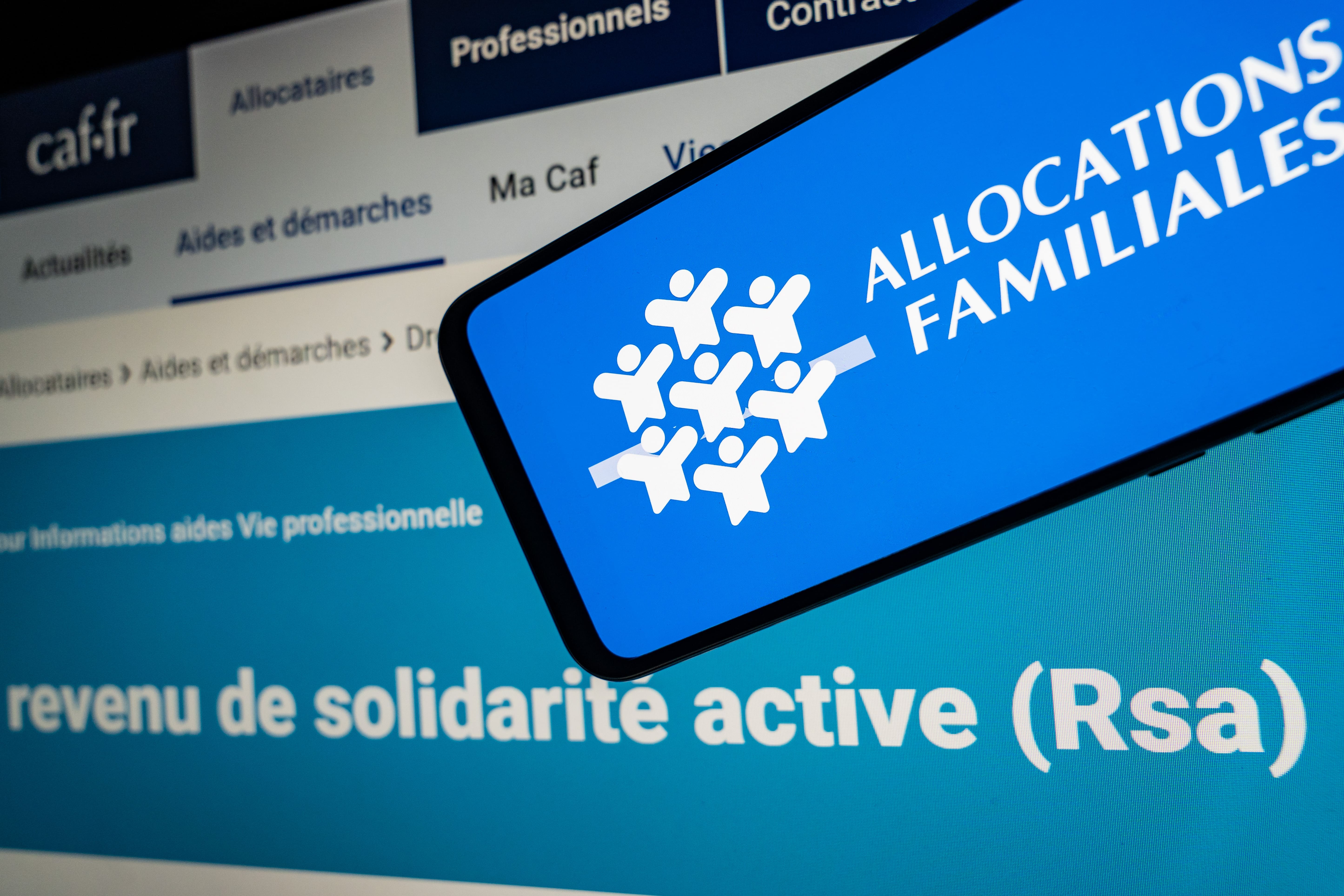


![[MEDIAS] Gaza, « c’est Auschwitz » : Thierry Ardisson dérape, sur France 2](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/capture-decran-1524-616x347.png?#)















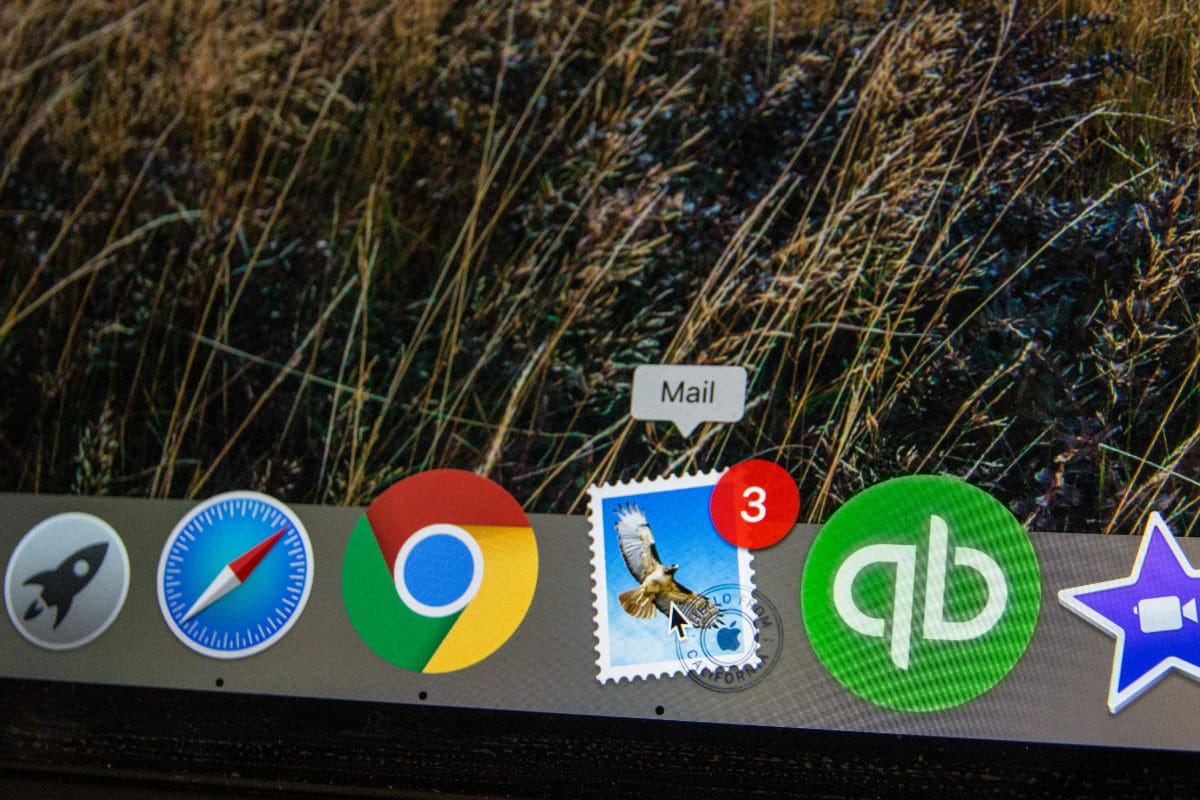



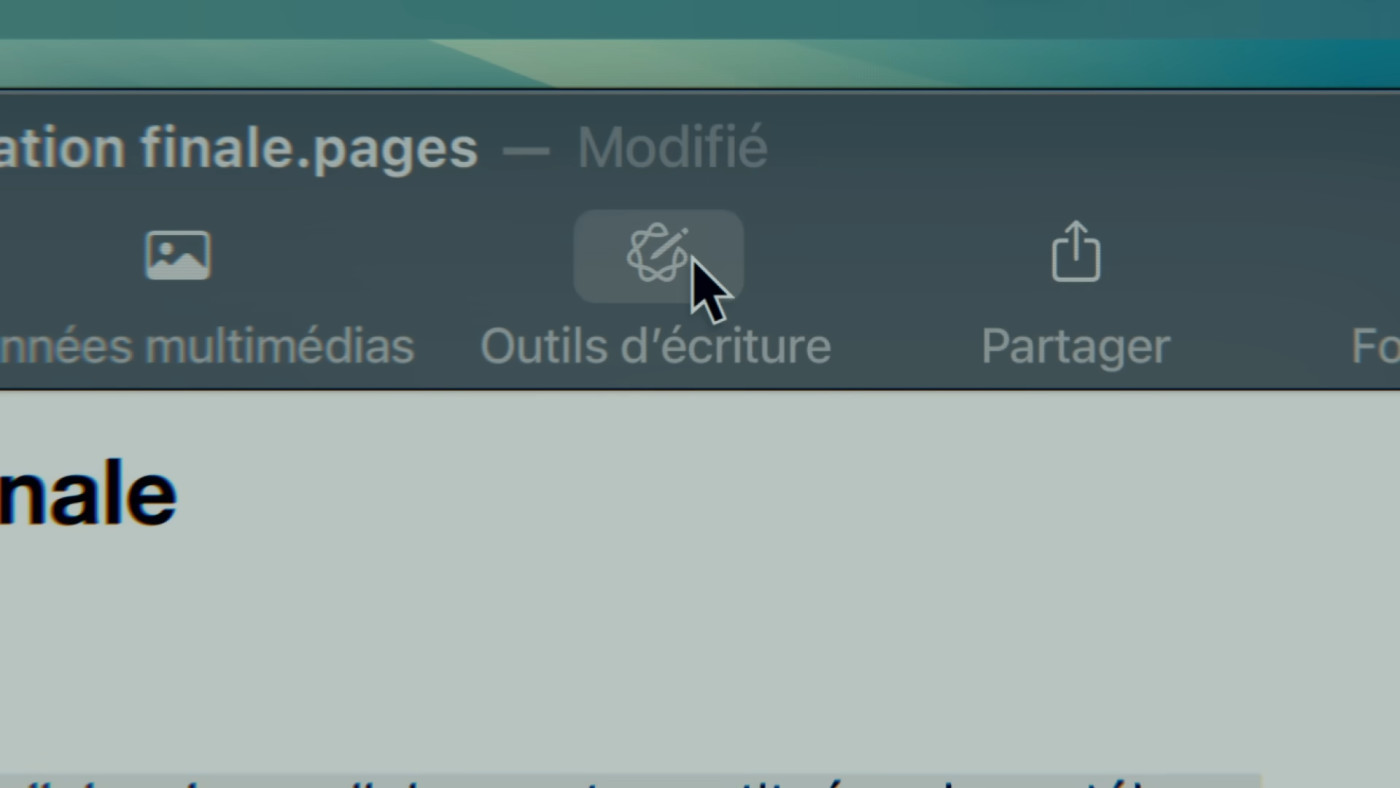


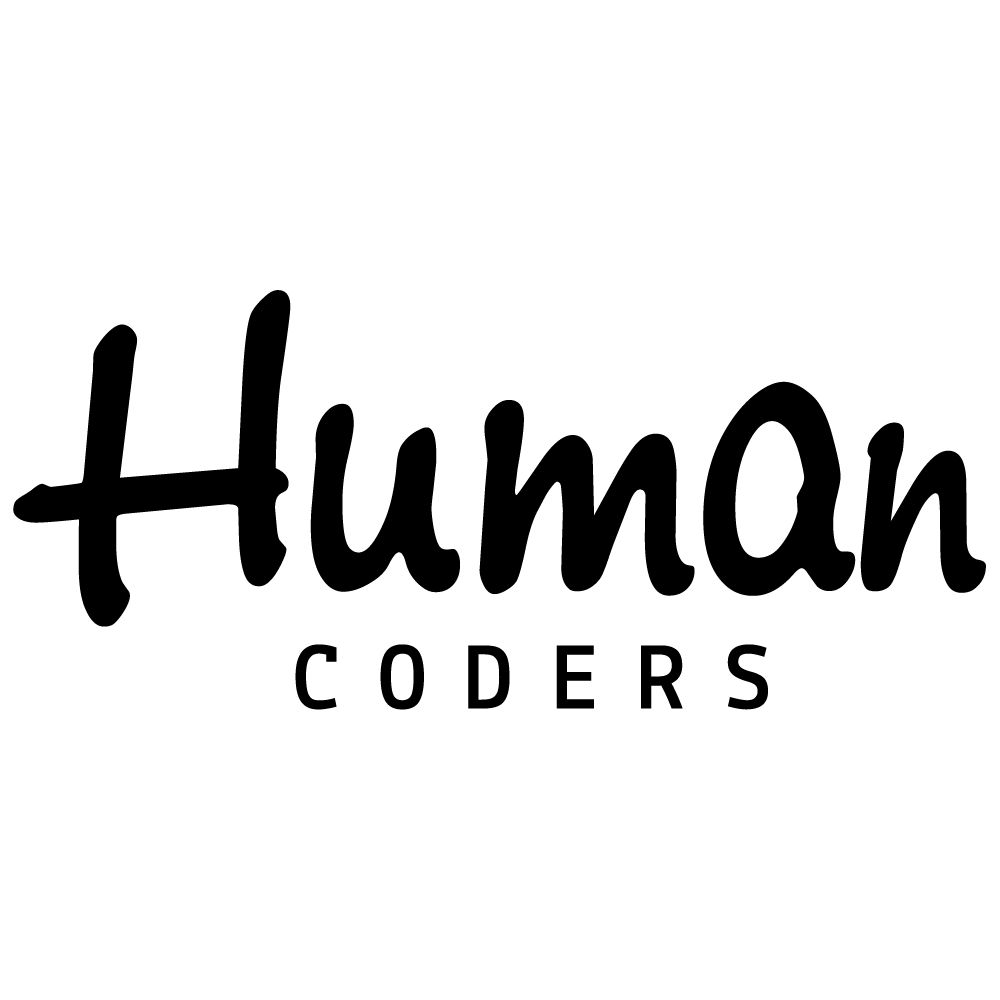






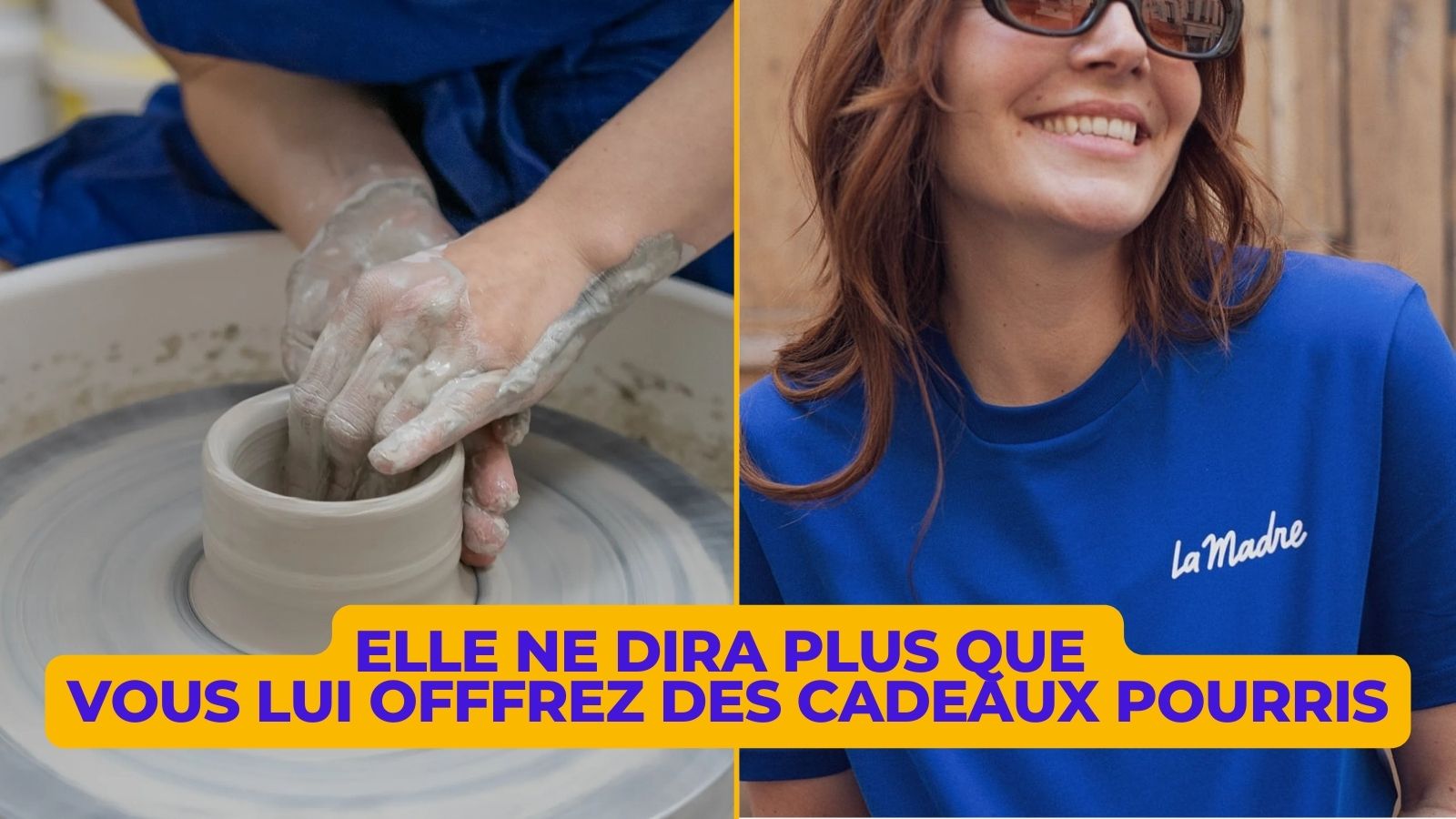
/2025/05/12/le-stress-commence-a-bien-monter-a-avoue-laurent-lafitte-maitre-de-ceremonie-du-78e-festival-de-cannes-68220da655000666749156.jpg?#)
/2025/05/12/000-44gh6rg-6821f64cd4f16793667924.jpg?#)
/2025/05/12/000-46cd39d-6822022b1a444882053953.jpg?#)
/2025/05/12/cannes-68221a99def98059338905.jpg?#)

















/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FL9nDWF6uqMcjvaLjlJyyoBEAViPLOyOP5IN2YFjp.jpeg)
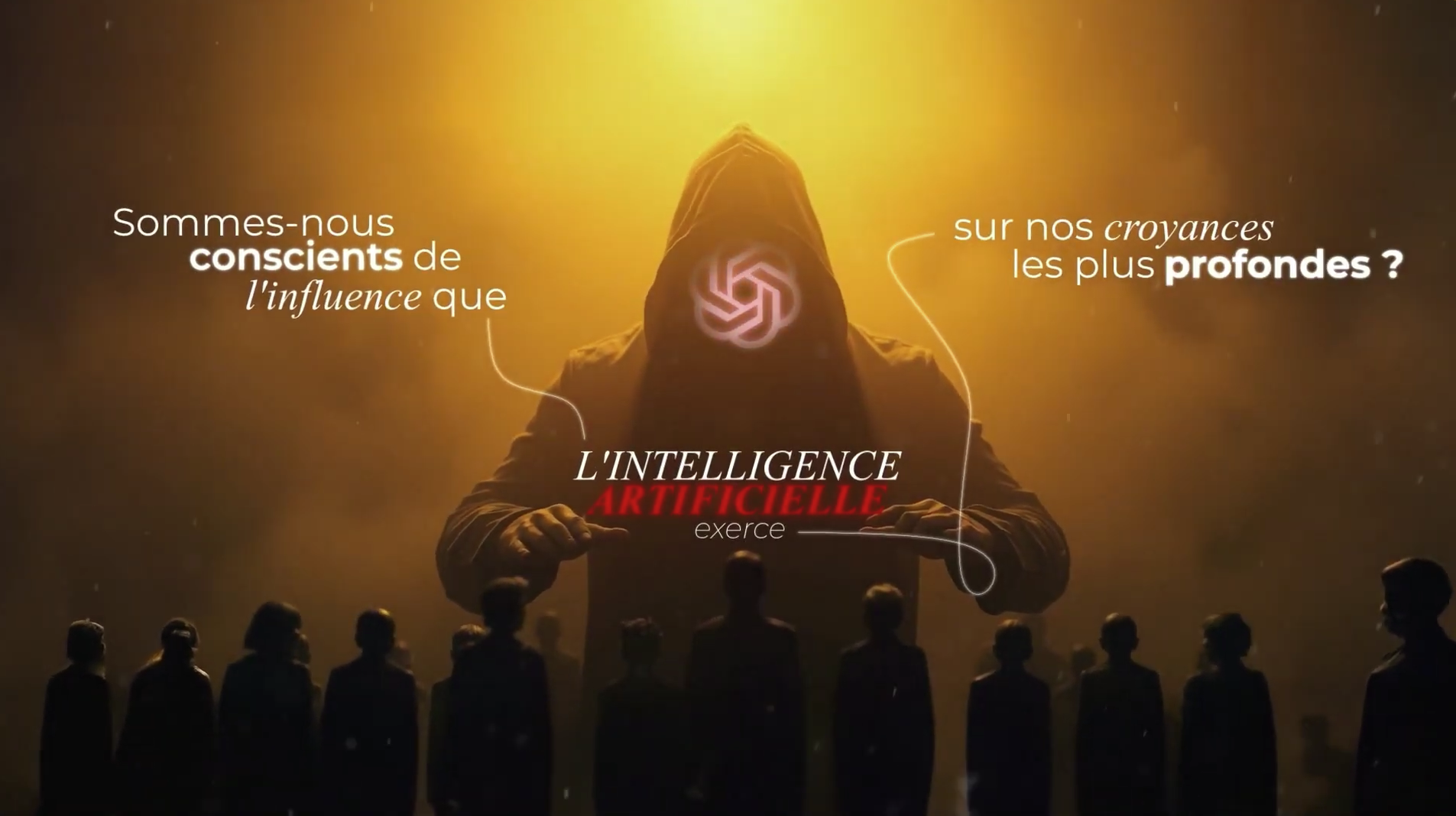




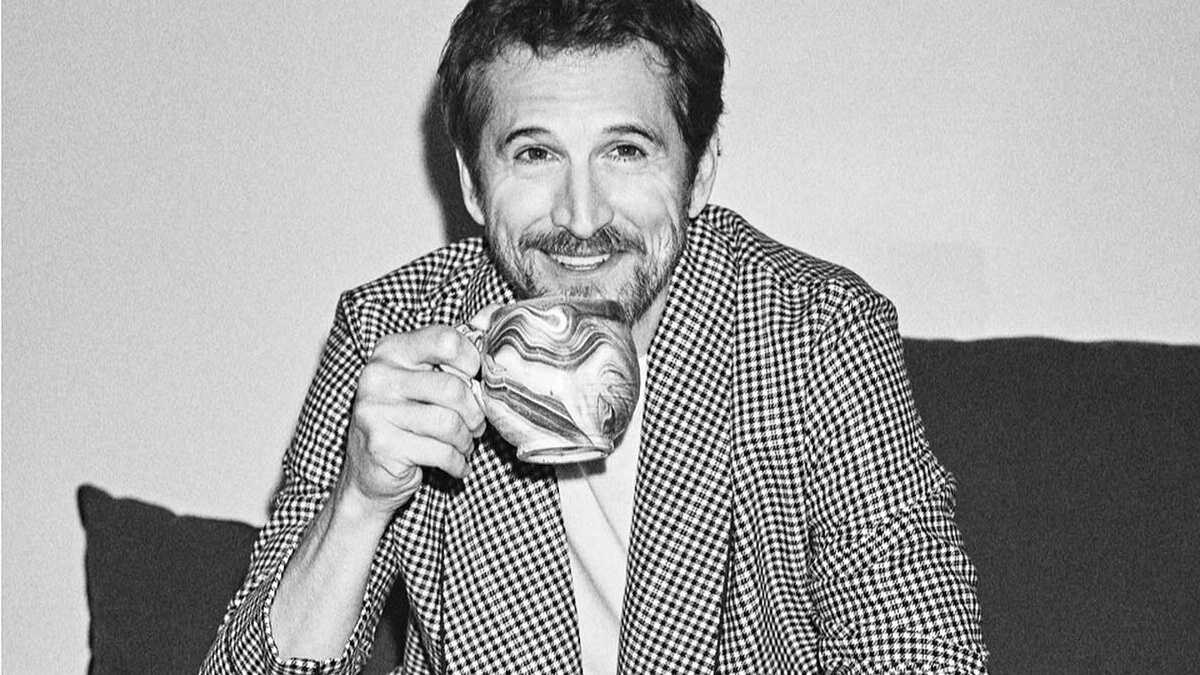



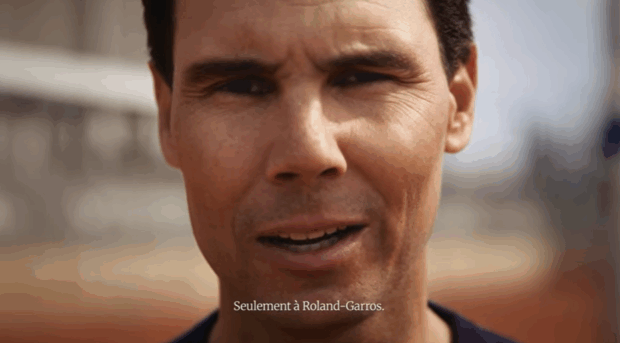





/2025/05/06/000-9d297k-6819998d58862605449041.jpg?#)
/2025/05/05/recherche-la-france-future-terre-d-accueil-de-chercheurs-americains-6818cd6269d14101452261.jpg?#)
