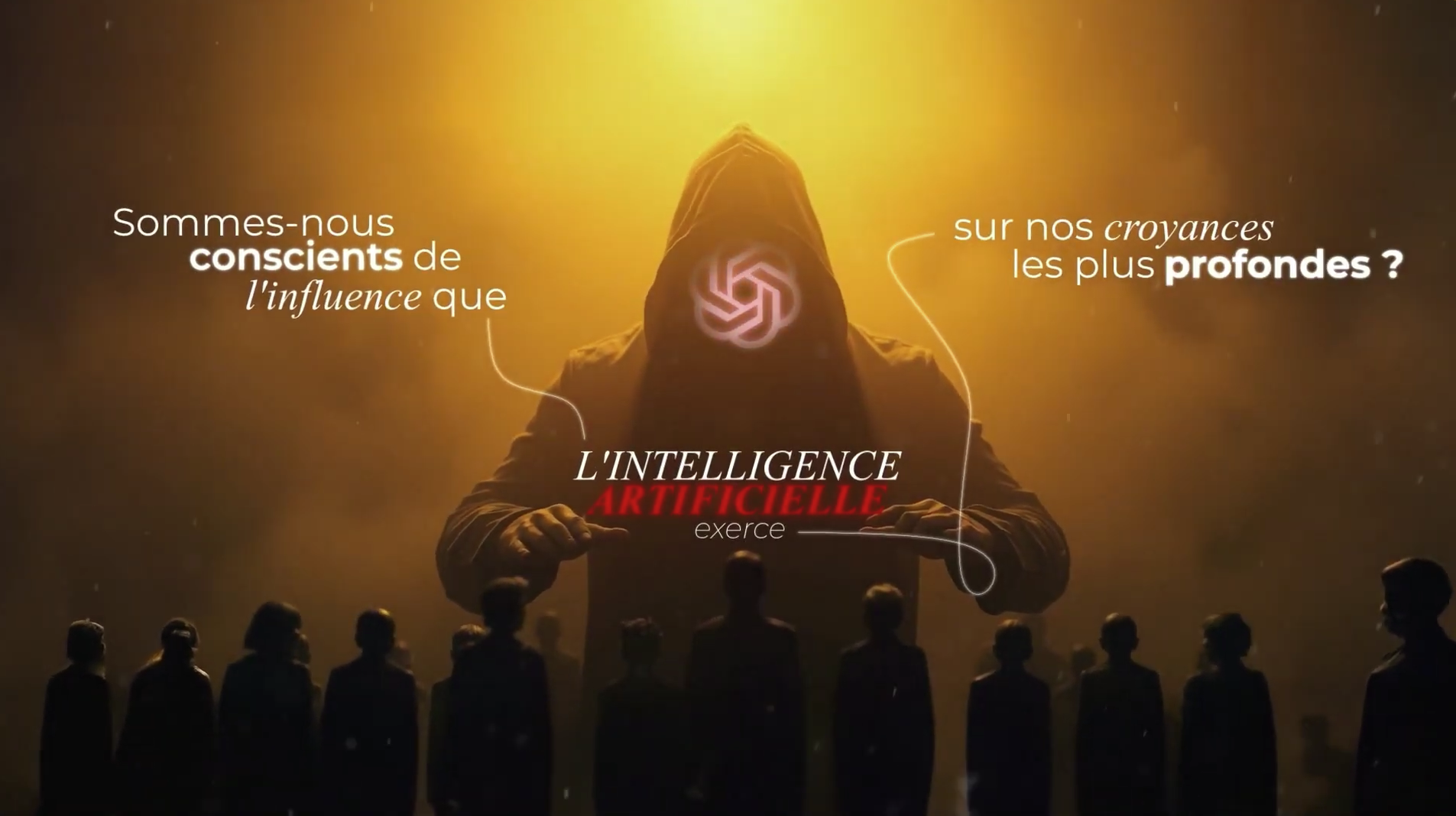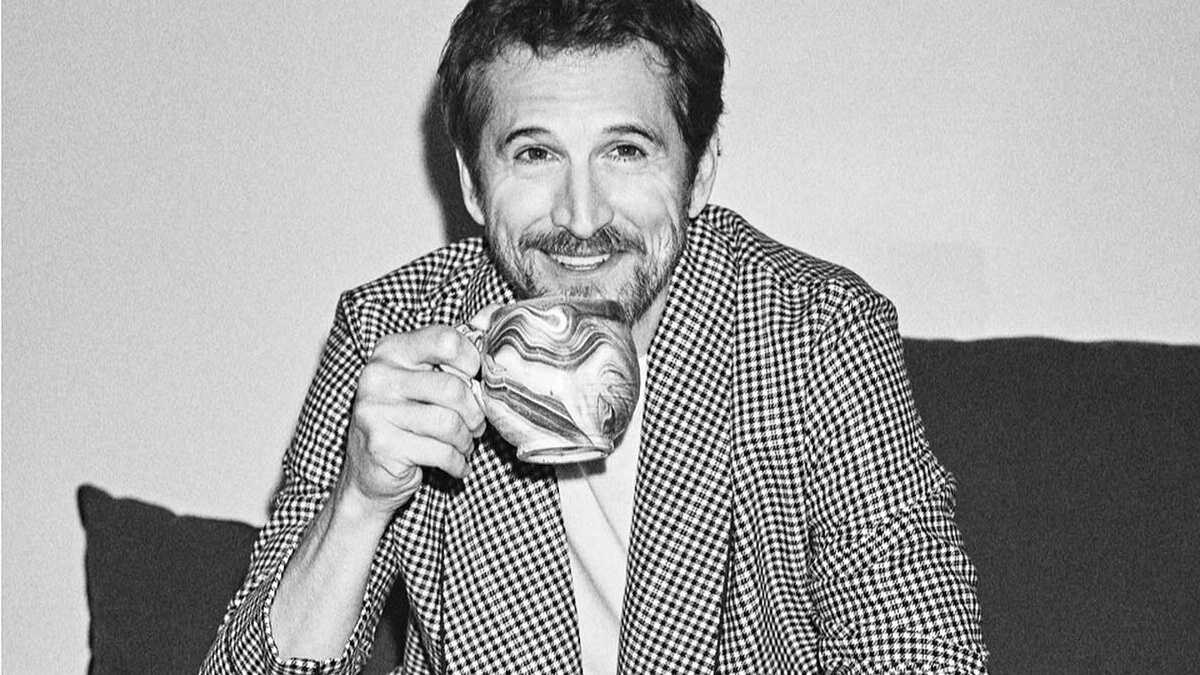Installation des médecins généralistes : des territoires sur-dotés, mais pas forcément bien dotés
La régulation de l’installation des médecins revient régulièrement dans le débat public dès lors qu’il est question de lutte contre les déserts médicaux. Mais encore faut-il identifier ces derniers correctement.

Mercredi 7 mai, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à réguler l’installation des médecins, afin de lutter contre les déserts médicaux. Mais l’identification des territoires sur- et sous-dotés en médecins n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser…
La question de la régulation à l’installation des médecins, véritable arlésienne des débats liés à la réforme du système de santé, est une nouvelle fois au centre des discussions. Mercredi 7 mai, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi allant dans ce sens, contre l’avis du gouvernement.
Qu’il s’agisse de conditionner toute nouvelle installation au départ d’un confrère (zones « sur-dotées ») ou d’imposer deux jours par mois d’exercice dans les déserts médicaux (zones « sous-dotées »), les propositions actuellement examinées ne doivent pas être réduites à la question de la liberté d’installation.
Pourquoi la référence à la dotation en médecins questionne-t-elle ? Par rapport à quelle norme les sur- ou sous-dotations sont-elles évaluées ? Explications.
L’APL, un indicateur pour repérer les disparités territoriales de l’accès aux soins
Le premier article du projet de loi adopté en première lecture le mercredi 7 mai 2025 à l’Assemblée nationale prévoit de flécher l’installation des médecins dans les zones sous-dotées. Cette mesure est conditionnée à l’identification des zones sur- et sous-dotées en médecins.
Pour comprendre les enjeux de ce débat, il est utile de décrypter le processus d’identification des territoires sous-dotés, généralement basé sur l’indicateur de l’APL (pour « Accessibilité Potentielle Localisée »). C’est l’indicateur de référence. Il évalue le niveau d’accessibilité de la population aux professionnels de santé à l’échelle de la commune en croisant plusieurs variables. Si sa construction est complexe, son interprétation est assez simple et ouvre des pistes intéressantes pour mieux comprendre les enjeux autour de l’utilisation du concept de zones sur- et sous-dotées.
Construit par les chercheurs de l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé) et de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) l’APL est un indicateur statistique robuste, plus précis qu’un calcul de densité. La richesse de l’APL réside en effet dans les trois critères pris en compte dans le calcul de l’accès aux soins :
- la disponibilité de l’offre (évaluée en nombre de consultations réalisées) ;
- la différenciation de la demande (en fonction de l’âge) ;
- la proximité de la demande (prise en compte de la distance en termes de temps de transport motorisé : plus le temps de trajet motorisé augmente, plus l’accessibilité est faible).
La valeur prise par l’APL indique le nombre de consultations potentielles annuelles par individu à une certaine spécialité médicale. En France, en 2023, l’APL à la médecine générale est de 3,3, ce qui signifie que chaque individu peut accéder en moyenne à 3,3 consultations de médecine générale.

Territoires sur- et sous-dotés
L’APL permet de classer les territoires relativement à la moyenne nationale (code couleur de la carte ci-dessus). D’autres seuils, définis de manière plus ou moins arbitraire, servent à identifier les situations les plus critiques.
Les territoires dont l’APL est supérieure à la moyenne (3,3) sont ainsi ceux qui peuvent être qualifiés de « sur-dotés ». Réciproquement, ceux dont l’APL est inférieure sont les territoires « sous-dotés ». Parmi eux, les « déserts médicaux » désignent (au sens de la DREES) ceux qui cumulent une APL inférieure à 2,5 avec un service de pharmacie situé à plus de 10 min de trajet motorisé et un service d’urgence à plus de 30 minutes.
Ces éléments de diagnostic sont nécessaires à l’action publique. Par exemple, les incitations financières accordées à l’installation des médecins généralistes (loi de modernisation du système de santé français du 26 janvier 2016) ont ainsi été déployées sur des territoires jugés en déprise au regard de la faiblesse de leur APL (les ZIP, Zones d’Intervention Prioritaire, et les ZAC, Zones d’Action Complémentaire). Le nombre total de territoires classés comme ZIP ou ZAC dépend de contraintes budgétaires. L’évaluation reste ainsi relative, et non normative.
« Sur doté » ne signifie pas « trop doté »
Les termes de sur et sous dotés signifient que l’accessibilité de la population aux médecins généralistes est respectivement supérieure et inférieure à la moyenne nationale. C’est tout.
Faisons un parallèle avec les moyennes scolaires, qui parlent à tout un chacun. Imaginons que dans une classe où la moyenne est de 3/20, vous obtenez celle de 6/20. Vous êtes très au-delà de la moyenne, vous êtes donc un très bon élève. C’est absurde, car tout ce que l’on peut en conclure est que vous êtes un cancre dans une classe de cancres. Nous pouvons le faire parce qu’il existe une norme, un niveau jugé moyen, dont on sait qu’il se situe à 10/20.
Étant donné qu’aucune norme n’est fixée pour définir ce qu’est « un niveau de soins satisfaisant » (c’est-à-dire répondant aux besoins de la population), il est délicat d’établir un parallèle entre « sur-doté » et « trop doté ». En effet, les deux expressions ne sont pas synonymes.
Si la moyenne de l’APL représentait effectivement le niveau satisfaisant d’accessibilité aux médecins, le rééquilibrage proposé par la loi actuellement débattue pourrait être suffisant. Mais ce n’est pas le cas.
Car cela reviendrait à dire que le niveau national de médecins est suffisant pour répondre aux besoins de la population. La comparaison des niveaux nationaux de densité médicale en Europe permet d’apporter des nuances à ce raisonnement et de questionner un éventuel manque de médecins à l’échelle nationale. En 2021, la densité médicale en France était de 3,2 pour 1 000 habitants. En Europe, elle était en moyenne de 4.
L’exemple de Marmande
Avec plusieurs écoles primaires et maternelles, 3 collèges, 1 lycée, de nombreux commerces et grandes surfaces, un dynamisme économique certain, une connexion ferroviaire conséquente… Située à 40 minutes de train de la métropole bordelaise, Marmande, commune du Val de Garonne Agglomération, n’évoque en rien l’image que l’on se fait d’un désert médical.
Son APL était d’ailleurs de 3,6 en 2023, c’est-à-dire légèrement supérieure à la moyenne nationale. Et pourtant… Une enquête (représentative au seuil de 5 % avec une marge d’erreur de 3 % selon le genre, le code postal et l’âge), menée auprès de plus de 1300 habitants du Val de Garonne Agglomération entre octobre 2021 et juin 2022, a révélé des difficultés d’accès aux soins pour la population du territoire.
Une analyse des résultats est présentée dans le rapport d’études. Nous ne les détaillerons pas ici, mais sélectionnons, à titre illustratif, deux résultats qui nous semblent marquants : la moitié des interrogés indique rencontrer des difficultés pour obtenir un rendez-vous médical dans un délai satisfaisant. Face à cela, ils sont 19 % à renoncer à la consultation.
Ces difficultés se creusent encore pour l’accès à la médecine spécialisée.
Renoncement aux soins
Le nombre de consultations utilisé dans le calcul de l’APL, et donc pour identifier les territoires sur- et sous dotés, ne reflète pas parfaitement les besoins médicaux. On fait comme si la demande de soins pouvait se mesurer en comptant le nombre de consultations médicales réalisées.
Mais ce chiffre peut sous-estimer les besoins de la population, parce que la demande est limitée par l’offre disponible. Autrement dit, si les rendez-vous sont rares ou difficiles d’accès, beaucoup de gens renoncent à consulter, même s’ils en auraient besoin. Cela s’appelle le renoncement aux soins.
Résultat, le nombre de consultations enregistrées reflète ce que les gens ont réussi à obtenir, pas forcément ce qu’ils auraient eu besoin d’obtenir ! Imaginons un restaurant avec seulement 10 places. Même si 100 personnes ont faim, seules 10 pourront manger. Dire que « seules 10 personnes avaient faim » ne refléterait pas la réalité : en fait, les 90 autres affamés ont renoncé à manger, faute de place.
De la même façon, compter uniquement les consultations médicales revient à ne compter que ceux qui ont réussi à franchir la porte du cabinet. Pour évaluer correctement les besoins de santé, il faut aussi tenir compte de ceux qui sont restés dehors…
Autre limitation : les zonages existants reposent sur une vision partielle du problème, car elles ne considèrent que le recours à la médecine générale. Or, même si l’APL est calculée pour chaque type de professionnel de santé, à chaque fois on ne considère qu’une seule facette d’un problème plus général, celui des parcours de soins.
L’intention d’établir un diagnostic est bonne, pour répondre au « désespoir » de certains élus locaux qui soutiennent toute forme de régulation, seule option envisageable face à l’échec des politiques de zonage. Mais les conséquences de ces deux propositions - conditionnement au départ d’un confrère en zone « sur-dotée » ou contrainte d’exercice, deux jours par mois, en zone « sous-dotée » pourraient générer un effet de report des difficultés entre territoires. Ce qui reviendrait à déshabiller Pierre pour habiller Paul, au risque que tous deux se retrouvent mal vêtus…![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.









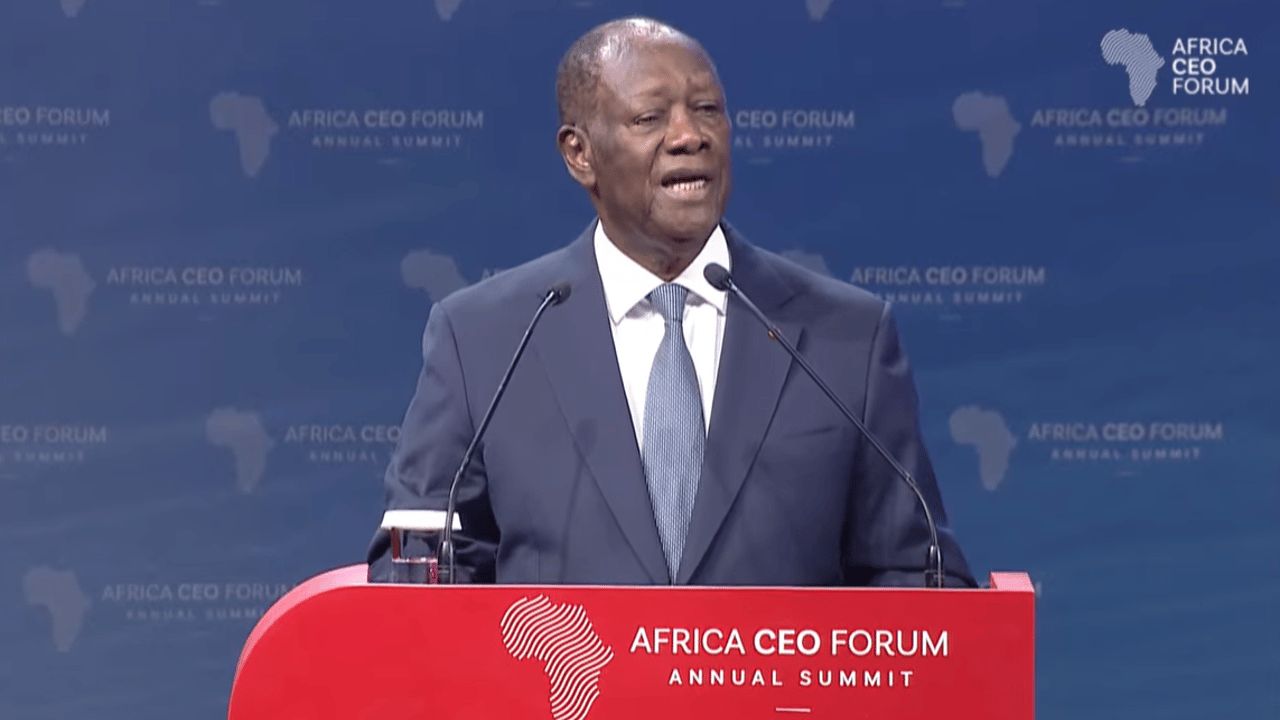








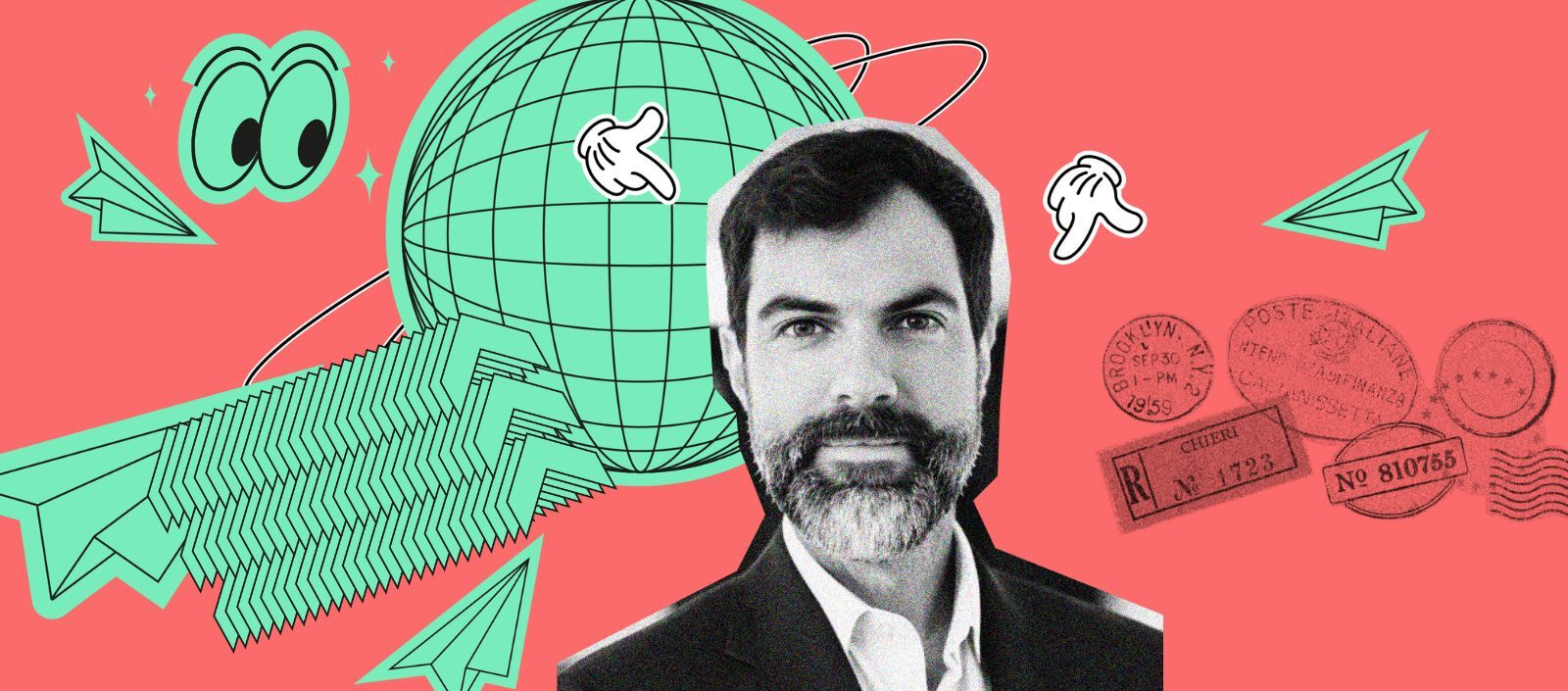




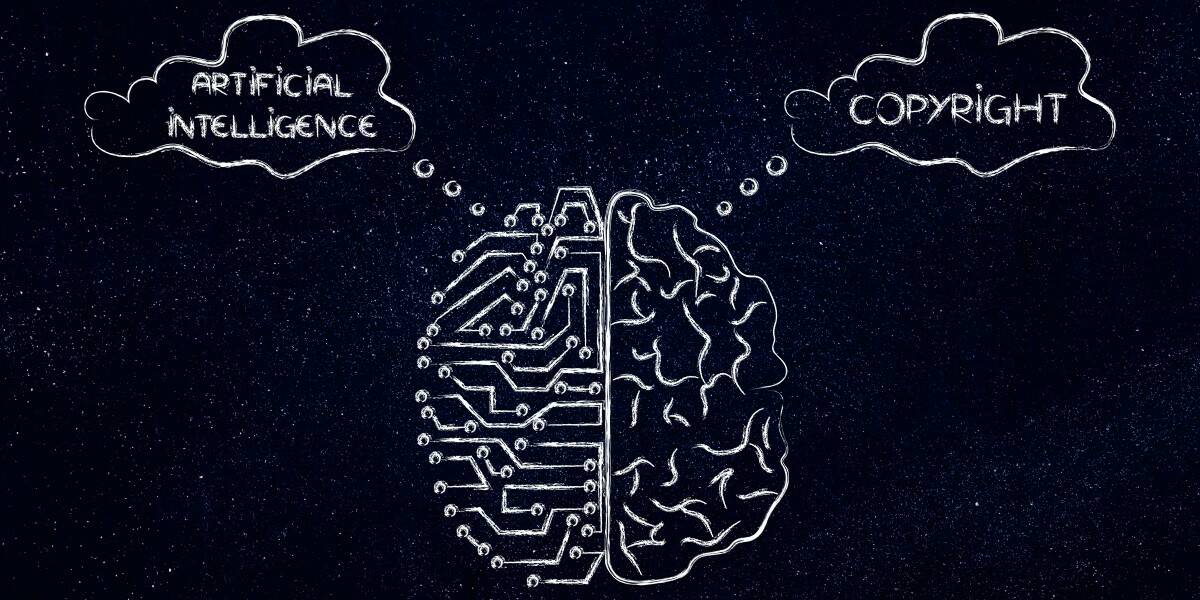







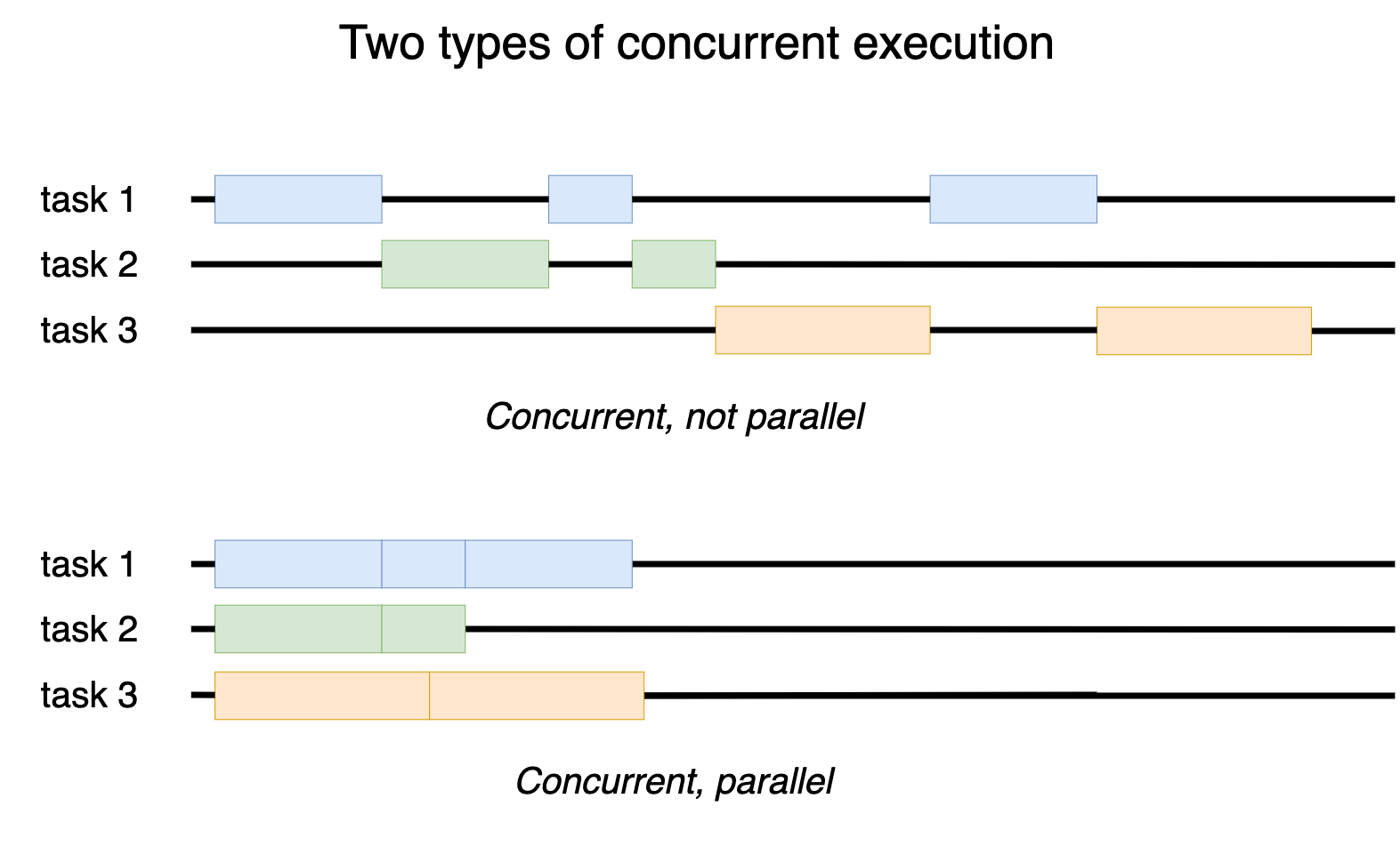







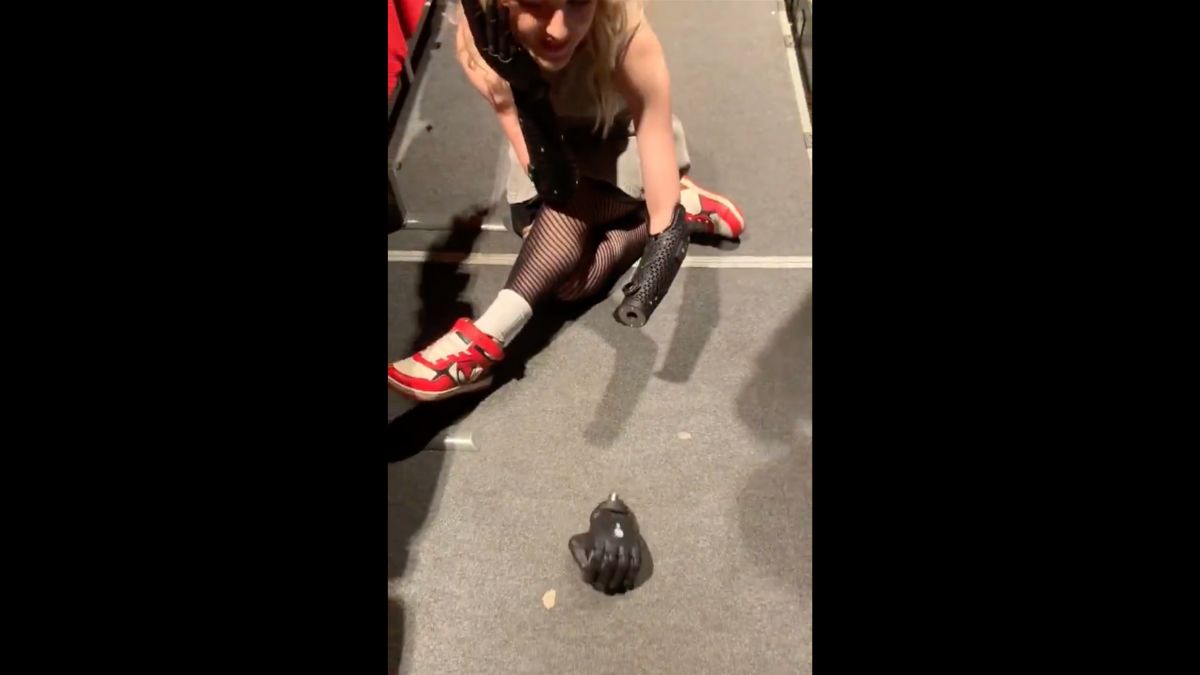


/2025/05/12/080-hl-ltrouiller-2447834-6821bc831f90a857186707.jpg?#)
/2025/04/28/gettyimages-100369899-4-680f63c07a35c653293867.jpg?#)

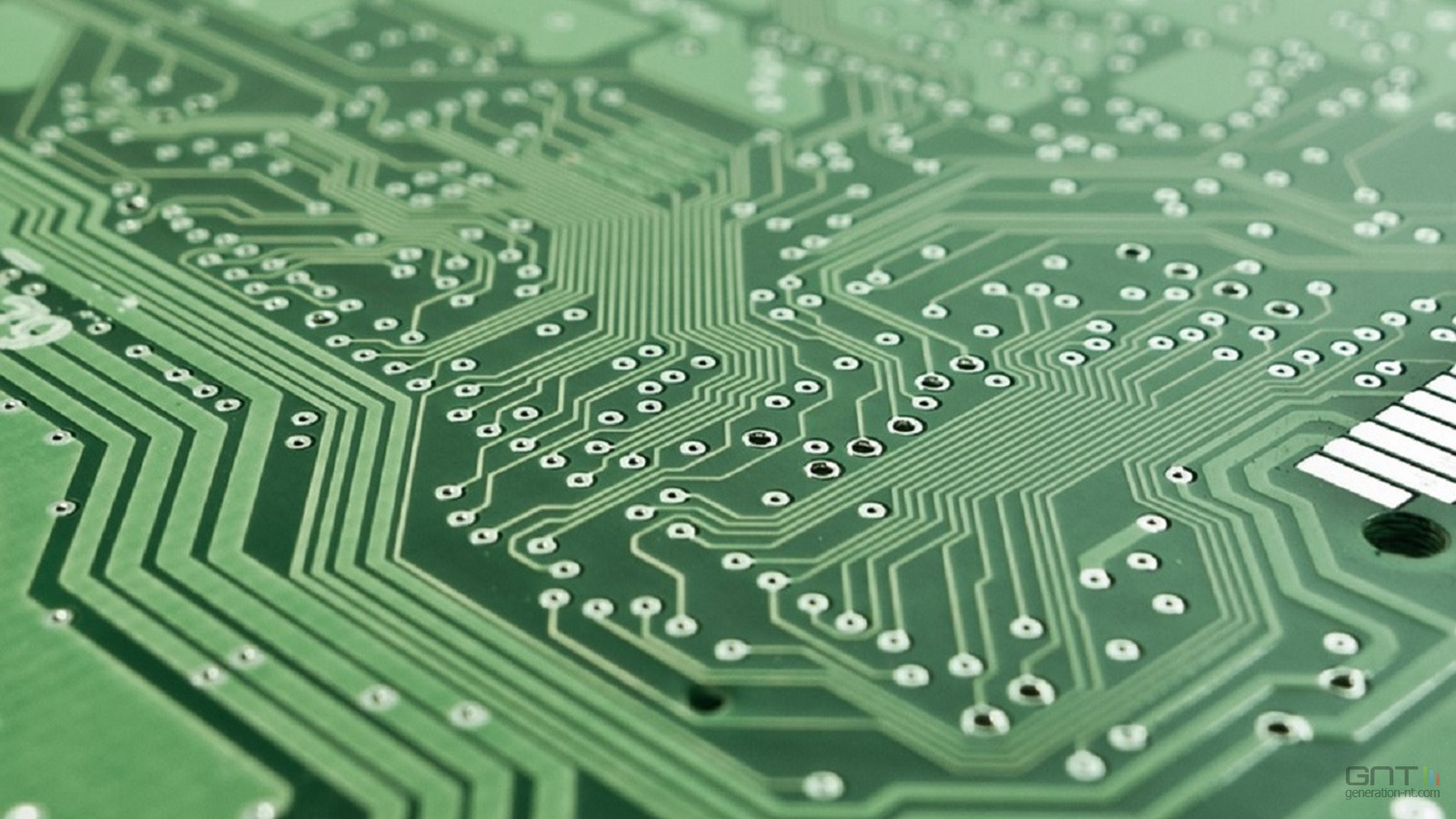



/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FL9nDWF6uqMcjvaLjlJyyoBEAViPLOyOP5IN2YFjp.jpeg)


/2025/05/12/091-i1745081422169-6821b8893952d141035587.jpg?#)