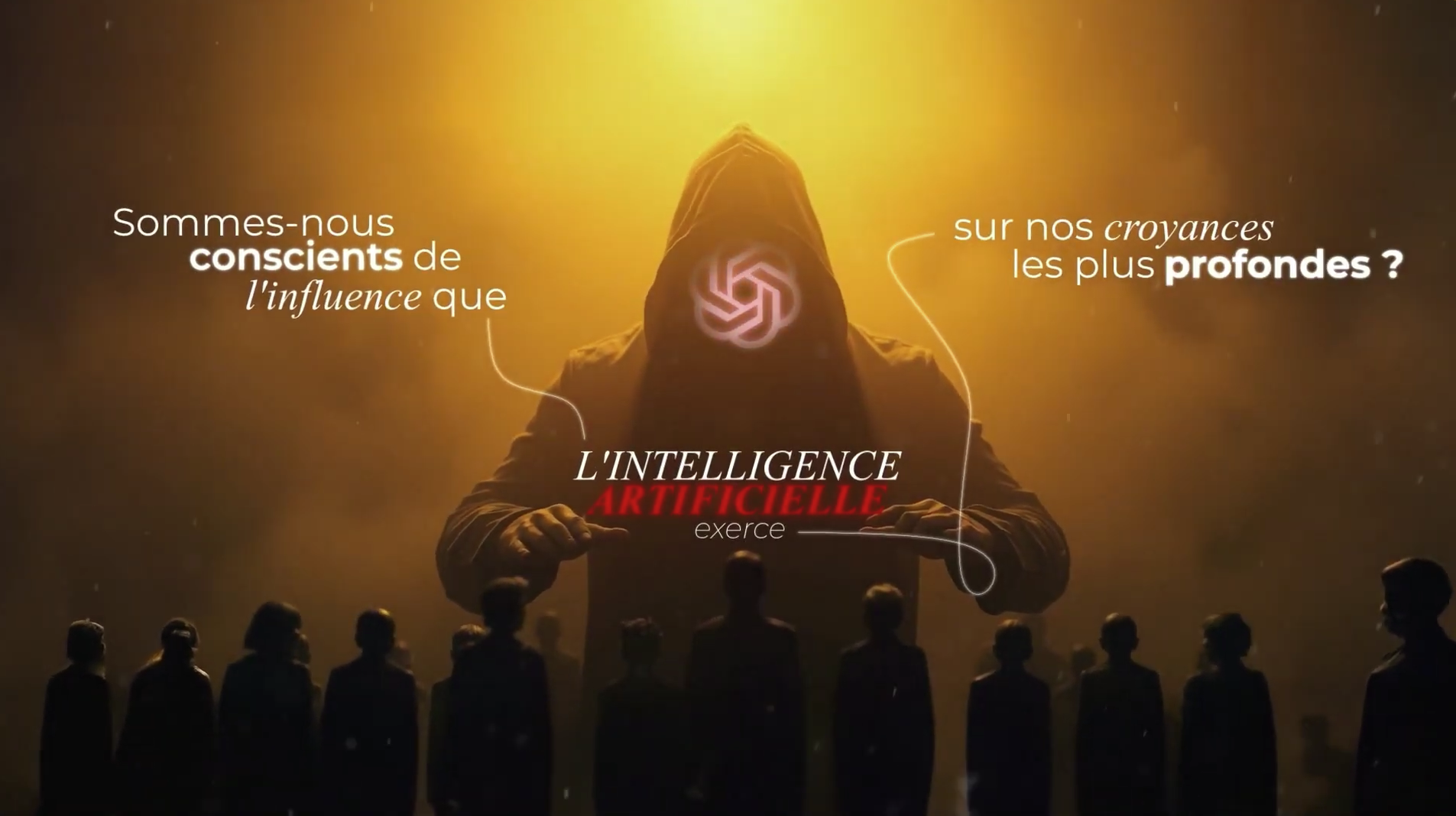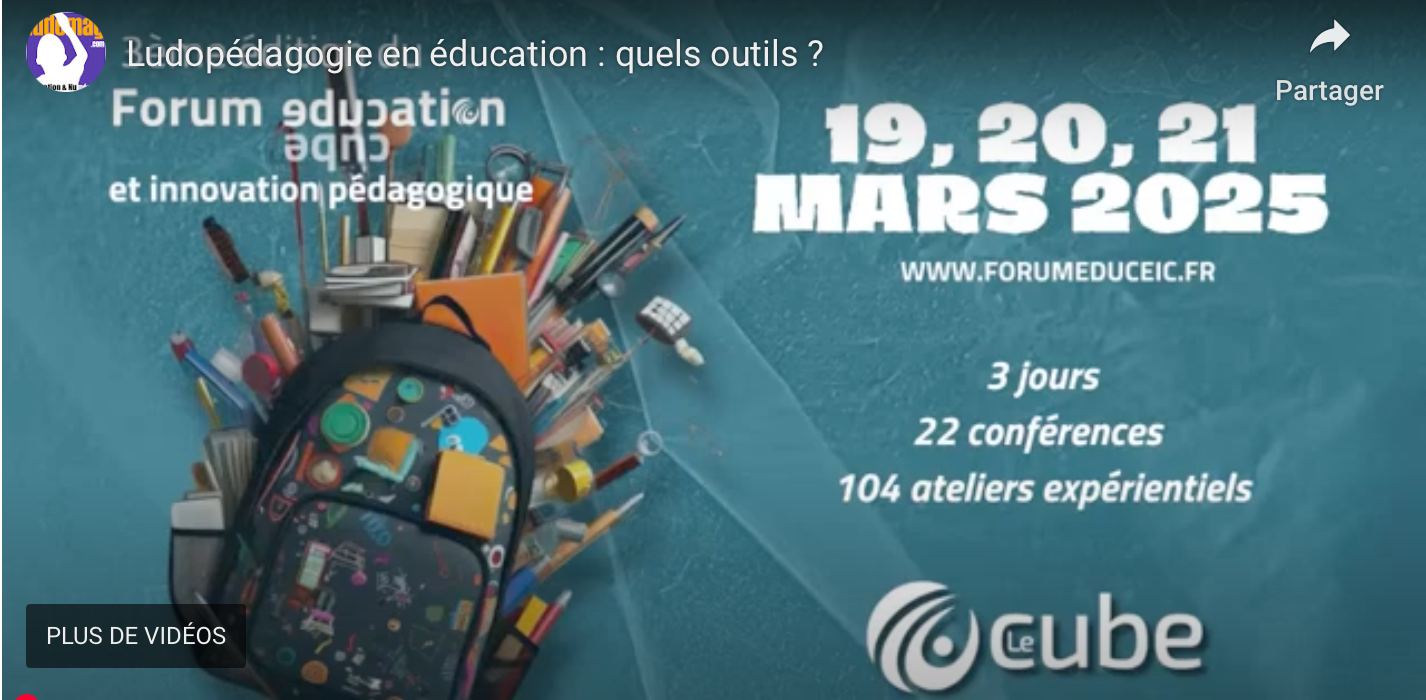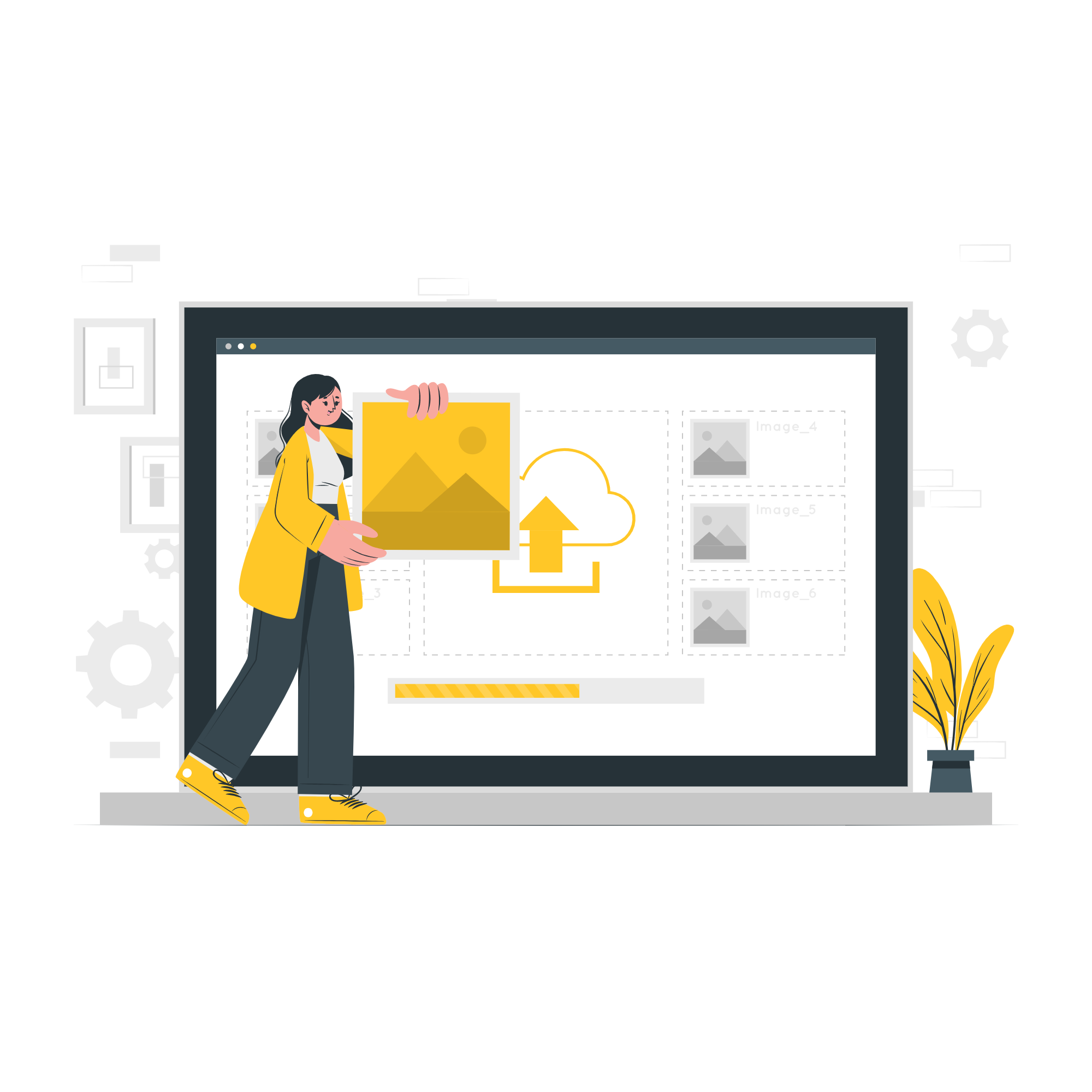Bonnes pratiques pour un référendum réussi
Mardi 13 mai, Emmanuel Macron pourrait annoncer la tenue d’un référendum avec plusieurs questions. À l’étranger, de nombreux exemples montrent que le référendum peut être un formidable outil démocratique.

Mardi 13 mai, Emmanuel Macron pourrait annoncer la tenue d’un référendum avec deux ou trois questions, dont l’organisation territoriale. Il y a quelques jours, le premier ministre, François Bayrou, a avancé l’idée d’un référendum sur le redressement des finances publiques. Sous la Ve République, le référendum a été largement utilisé, avant de tomber en désuétude. Quelles seraient les « bonnes pratiques » pour éviter le plébiscite ou le rejet du chef de l’État ? À quelles conditions un référendum peut-il être réussi ? À l’étranger, de nombreux exemples montrent que le référendum peut être un formidable outil démocratique.
Les annonces désynchronisées du chef de l’État et du premier ministre concernant l’organisation d’un ou de plusieurs référendums mettent en évidence la concurrence entre les deux têtes de l’exécutif, de même que leur volonté de restaurer un lien dégradé avec les Français ou encore de revitaliser l’un des piliers constitutionnels du présidentialisme (le dernier référendum date de 2005). Mais elles révèlent surtout une sorte de rendez-vous référendaire presque incontournable : plébiscité dans les sondages, maintes fois promis par le président de la République, le référendum pourrait finir par s’imposer dans le contexte actuel d’absence de majorité au Parlement et de nécessité d’opérer des choix difficiles.
Dès lors, la question est : comment s’assurer, en l’état actuel du droit (une réforme de l’institution n’étant pas réalisable à court terme), que le procédé fonctionne correctement ? Une telle interrogation, dans le cas du référendum présidentiel français, revient surtout à se demander comment empêcher sa personnalisation, dite aussi « plébiscitarisation », dans une large mesure à l’origine de sa raréfaction après de Gaulle.
Héritage gaullien
Si le glissement d’enjeu de la question posée vers l’initiateur, explicitement sollicité par le fondateur de la Ve République (qui demandait aux Français d’exprimer un vote de confiance à son égard), a pu jouer en faveur de celui-ci lors des quatre premiers référendums, en stimulant la participation et le vote oui, il a commencé à agir en sens inverse dans la phase déclinante du gaullisme : le référendum de 1969 est un échec (victoire du non), entraînant la démission du général, comme le seront, à des degrés divers, les référendums organisés par ses successeurs, moins charismatiques et victimes de la baisse chronique de popularité présidentielle.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Sur les cinq référendums post-gaulliens, trois ont été gagnés largement mais avec une participation dérisoire (en 1972 sur l’entrée de la Grande-Bretagne et des pays nordiques dans la Communauté européenne ; en 1988 sur l’auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie ; en 2000 sur le quinquennat) ; tandis que les deux référendums sur l’Europe ont remporté, le premier sur le traité de Maastricht (1992), une victoire à la Pyrrhus, obtenue in extremis alors que les sondages donnaient une majorité des deux tiers au oui en début de campagne, et une défaite cuisante en ce qui concerne le second, sur le projet de Traité constitutionnel européen (2005).
Éviter la personnalisation
Après avoir favorisé la participation et la victoire, la personnalisation du scrutin semble donc, après de Gaulle, vouer le référendum présidentiel à la défaite ou à l’abstention.
Dans un cas comme dans l’autre, cela pose problème dans une perspective démocratique, car le référendum décide d’une politique publique sur la base d’une volonté qui a un autre objet. Comment donc empêcher la personnalisation du référendum, et d’abord, est-ce possible ? Les travaux sur la démocratie directe tendent à considérer comme indépassable ce biais du référendum d’initiative présidentielle et suffisant à le disqualifier. Certains vont même jusqu’à affirmer que tout « référendum d’en haut », qu’il soit initié par le président, par le gouvernement ou par le Parlement, serait structurellement enclin au glissement d’enjeu.
Pour autant, ce type de référendum comporte un certain nombre d’avantages par rapport au « référendum d’en bas » (d’initiative populaire), comme le fait de pouvoir porter plus facilement sur des grands choix publics, ou sur des projets aptes à remporter une adhésion large, car élaborés au sein des institutions représentatives. Et il est susceptible d’être « dépersonnalisé », par des mesures dont la plupart sont de l’ordre des « bonnes pratiques » – qui sont devenues un volet important de la production normative en matière électorale et référendaire dans les démocraties matures (voir le « Code de bonne conduite en matière référendaire » de la Commission de Venise).
Dépolitiser le référendum
La première bonne pratique est la dépolitisation du référendum par les acteurs politiques, à commencer par l’initiateur, qui doit éviter toute mise en jeu personnelle. Contrairement à ce qui est parfois entendu, l’engagement de responsabilité et la démission en cas d’échec ne rendent pas le référendum plus démocratique. C’est le contraire, car cela brouille les cartes et égare le choix des électeurs. Ce n’est pas au référendum de corriger les excès du présidentialisme et l’irresponsabilité présidentielle.
En d’autres termes, la conception gaulliste du référendum doit être abandonnée. C’est ce qu’ont fait François Mitterrand et Jacques Chirac en déclarant qu’ils ne démissionneraient pas en cas d’échec. Cela a indiscutablement contribué à « déplébiscitariser » le référendum. Mais il faut aller plus loin : le président pourrait demander explicitement aux Français de se concentrer, en leur âme et conscience, sur la question posée.
Au-delà, il revient à l’ensemble des acteurs politiques de garantir que cet exercice de démocratie directe soit un vrai débat d’idées, non biaisé par des enjeux de compétition électorale. Ce qui n’empêche pas les partis d’exposer leur position – il est même souhaitable qu’ils le fassent pour fournir des repères aux électeurs. Les médias ont aussi un rôle majeur à jouer dans cet effort collectif de non-politisation du référendum.
Conventions citoyennes
Une deuxième pratique efficace pour dépersonnaliser le référendum est la mise en place d’une convention de citoyens tirés au sort, chargée de présenter durant la campagne référendaire une sorte d’audit de la proposition soumise au vote, expliquant ses enjeux, les points de vue en présence et éventuellement une position adoptée par elle dans une sorte de « pré-référendum ». L’Oregon, et d’autres pays dans la foulée, ont mis en place ces Citizen’s Initiative Reviews, en général en lien avec l’initiative populaire, mais cela peut très bien fonctionner aussi avec les « référendums d’en haut ».
Il y a tout lieu de penser que l’avis d’une telle assemblée serait beaucoup moins politisé et sujet au glissement d’enjeu que celui des forces politiques. L’intervention d’une convention de citoyens pourrait aussi avoir lieu en amont, et le président convoquer le référendum sur des propositions de cette convention reformulées en projets de loi du gouvernement, comme cela avait été envisagé pour la Convention citoyenne sur le climat C’est ce qui a été expérimenté en Islande sur la réforme de la Constitution et en Irlande sur l’avortement puis sur le mariage pour tous. La question des temps de l’enfant, qui sera l’objet de la prochaine convention, se prêterait sans doute à cet exercice.
Le choix du sujet
À condition d’être suffisamment médiatisée, une convention citoyenne permet aussi de stimuler la curiosité du public sur un sujet. Or, il est essentiel que le référendum porte sur une question qui intéresse les citoyens et ne soit pas trop complexe. Le glissement d’enjeu (de même que l’abstention) dérive, en effet, souvent du manque d’intérêt pour la question posée et de la difficulté à la comprendre. Dans cette optique, on peut regretter que l’article 11 de la Constitution qui définit la procédure de référendum, n’ait pas été étendu aux questions de société, souvent inclues dans le domaine référendaire à l’étranger. Ainsi imagine-t-on mal un référendum sur le sujet de la fin de vie, par exemple, connaître un glissement d’enjeu.
Il reste qu’une campagne intense et pédagogique peut aussi être décisive pour sensibiliser et familiariser l’opinion à un problème. La démonstration en a été faite par le référendum de 2005, qui portait sur un sujet lointain (l’Europe) et très juridique (une Constitution). Cela n’a pas empêché les électeurs de se rendre nombreux aux urnes et de se focaliser très majoritairement sur la question posée.
Pratique régulière, « Referendum Day », référendum à plusieurs options
Une bonne pratique est enfin une pratique régulière. La routinisation du référendum entraîne le développement d’une culture de la participation directe aux décisions. Les votants prennent l’habitude de se prononcer exclusivement sur les questions posées. L’organisation d’un « Referendum Day » regroupant plusieurs consultations, comme en Suisse ou aux États-Unis, est aussi un antidote à l’expression d’un vote de confiance ou de défiance – qui suppose de répondre de la même façon à toutes les questions.
Le référendum proposant un choix entre plusieurs options diminue aussi le risque de glissement d’enjeu. Mais il pose d’autres problèmes, comme la victoire d’une option qui n’a pas atteint la majorité absolue, le vote utile, ou la détermination des options en présence à des fins de manipulation ; tandis que le classement par ordre de préférence ne permet pas de dégager un vainqueur indiscutable (paradoxe de Condorcet). Une voie à explorer est la méthode du « jugement majoritaire », qui demande aux votants d’attribuer des appréciations aux différentes options. Les calculs permettant de déterminer l’option victorieuse apparaissent cependant compliqués.
Le meilleur système reste sans doute le référendum classique demandant d’approuver ou rejeter une proposition fruit d’un processus d’élaboration inclusif en amont – ce pour quoi le « référendum d’en haut » est mieux outillé.![]()
Laurence Morel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

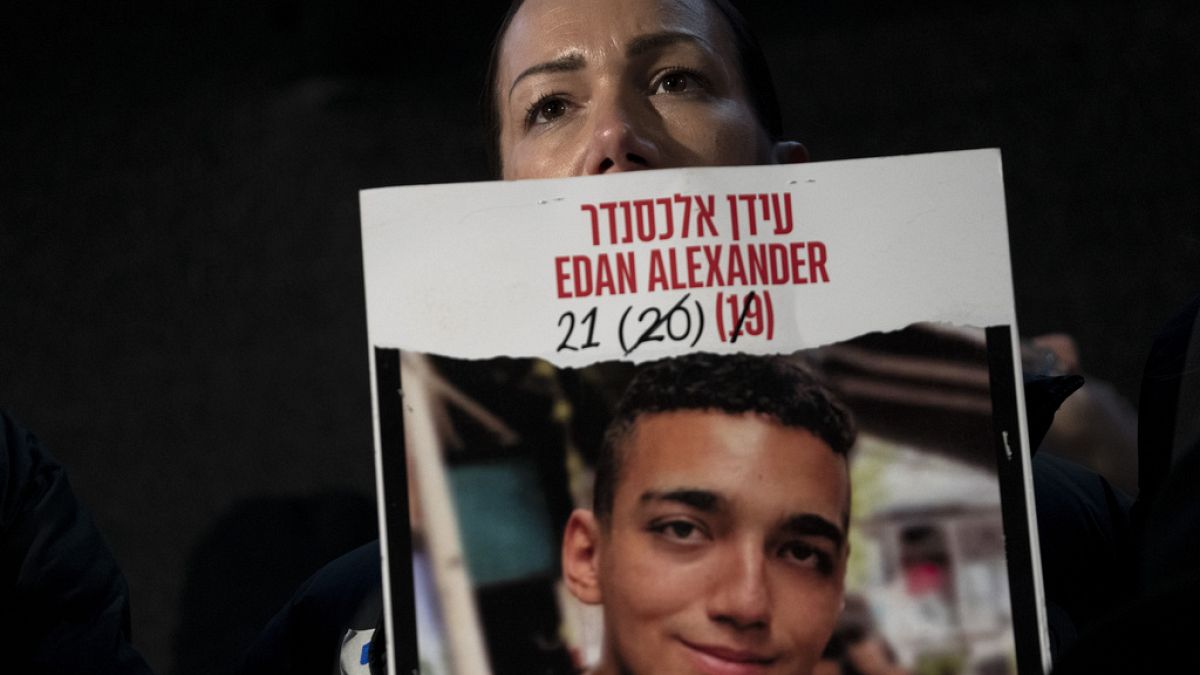














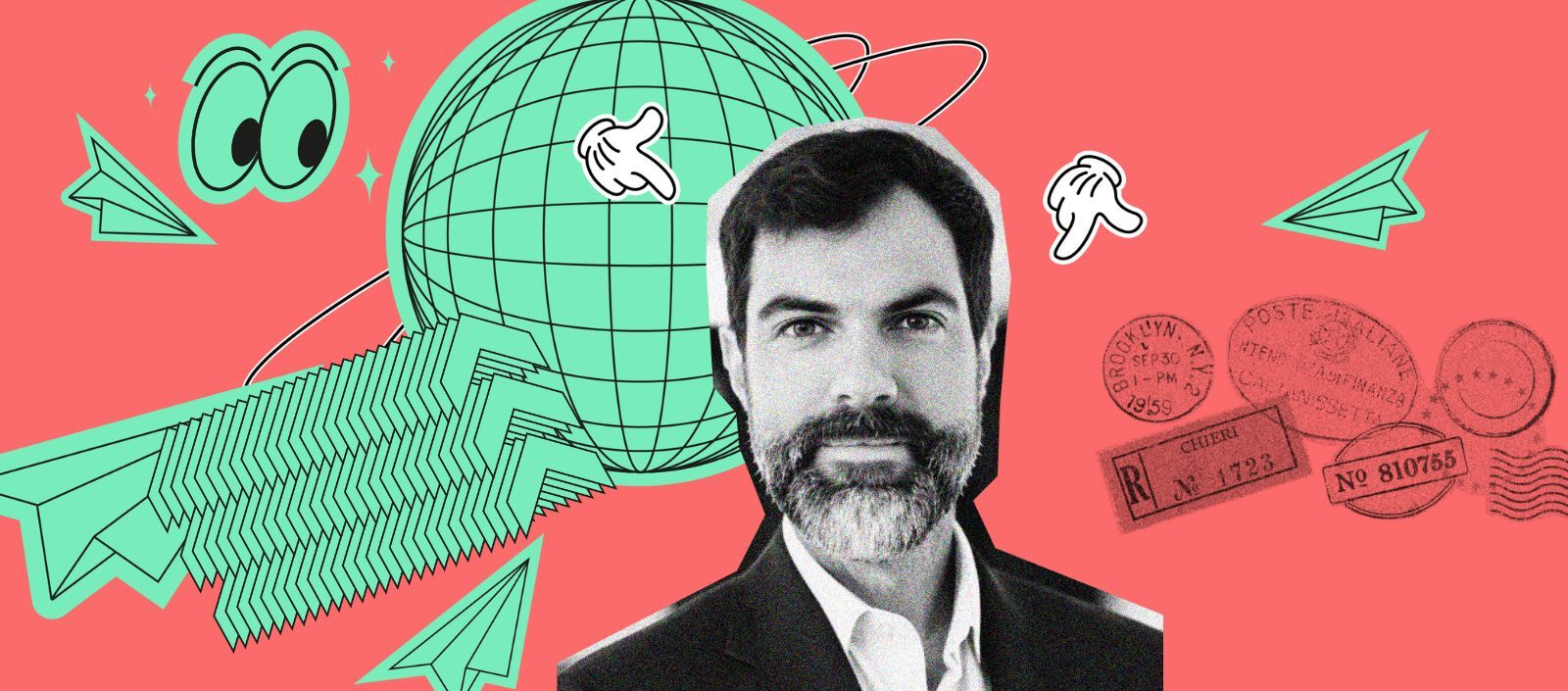












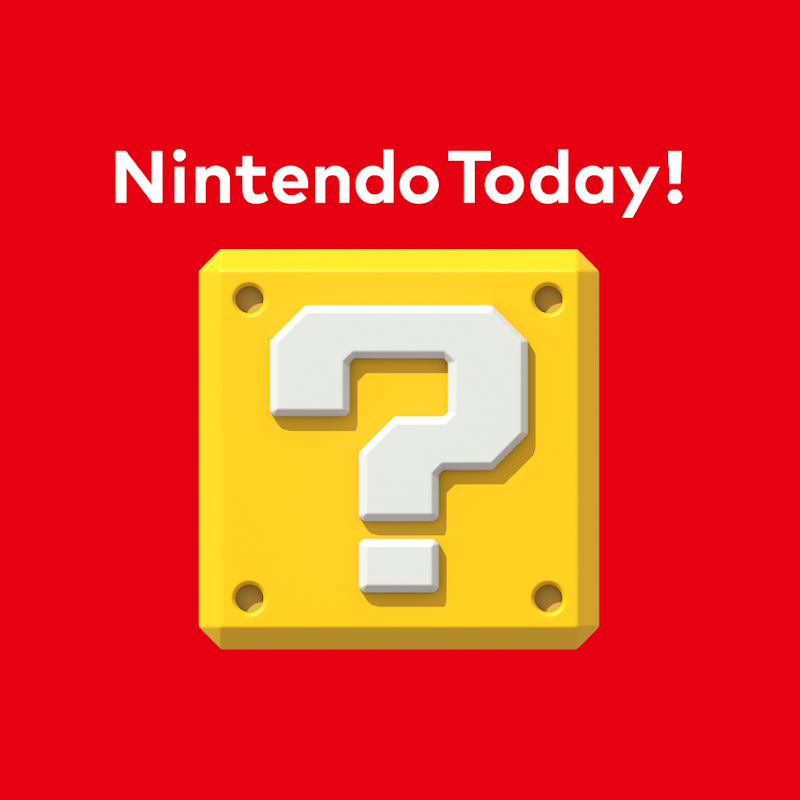













/2025/05/09/000-34rp49b-bonne-version-681dc1312dfca766407434.jpg?#)
/2025/05/12/000-par1886446-1-6821a58b2655a760562013.jpg?#)