La politique spatiale de la Chine déjoue-t-elle le narratif imposé par les États-Unis ? Une conversation avec Isabelle Sourbès-Verger
La Chine doit lancer sa mission spatiale Tianwen-2 en mai 2025. L’occasion de décrypter la politique spatiale chinoise avec Isabelle Sourbès-Verger, qui observe l’occupation de l’espace extra-atmosphérique depuis les années 1980.


Isabelle Sourbès-Verger conduit une géographie des politiques spatiales depuis les années 1980 : en analysant les missions des grandes puissances spatiales, elle décrypte leurs enjeux sur le plan national et international.
Ce mois-ci, la Chine doit lancer sa mission spatiale Tianwen-2, qui a pour but d’aller chercher des échantillons sur un astéroïde. Cette mission s’inscrit dans un portefeuille spatial chinois très étoffé, avec des missions vers la Lune et vers Mars, de nombreux satellites pour observer la Terre, une station spatiale similaire à la station spatiale internationale, des plans pour installer une base sur la Lune, entre autres.
À cette occasion, Isabelle Sourbès-Verger a reçu Elsa Couderc, cheffe de rubrique Sciences et Technologies, pour décrypter la politique spatiale souvent méconnue de cette grande puissance. Cet entretien illustre également comment la science et l’exploration spatiale sont aussi un terrain géopolitique, des imaginaires collectifs au soft power.
The Conversation : La mission Tianwen-2 a pour destination l’astéroïde Kamoʻoalewa, dont elle va collecter des échantillons. Elle suit la mission Tianwen-1, qui est allée poser un rover sur Mars en 2021 – la Chine était la deuxième nation à le faire après les États-Unis ; et cette mission précède Tianwen-3, qui doit partir fin 2028 vers Mars et en ramener des échantillons, ce que personne n’a jamais encore fait à ce jour. Comment cette série de missions Tianwen illustre-t-elle la stratégie spatiale chinoise ?
Isabelle Sourbès-Verger : Pour comprendre les avancées spatiales chinoises, il faut se rappeler que la reconnaissance de la Chine comme puissance spatiale s’est faite lentement. Le premier satellite chinois est mis en orbite en 1971, avec presque quinze ans de retard par rapport à l’Union soviétique et aux États-Unis. Ce n’est qu’en 2003, plus de quarante ans après Gagarine, qu’un Chinois a accompli le premier vol spatial. Il y avait d’abord un fossé à combler. Ainsi, jusqu’à il y a dix ans, le mot d’ordre de la politique spatiale chinoise était de « rattraper », c’est-à-dire d’acquérir et de maîtriser les compétences que les autres grandes puissances spatiales maîtrisaient déjà : les États-Unis, bien sûr, dans tous les domaines, mais aussi la Russie – plutôt dans le spatial habité et le spatial militaire, et l’Europe ou le Japon, notamment sur le plan scientifique. Par exemple, la mission Tianwen-2, qui est d’aller chercher de la poussière d’astéroïde en se posant et en repartant (une manœuvre appelée « touch and go »), est quelque chose que les Japonais ont déjà effectué avec Hayabusa-1 dès 2010, puis avec Hayabusa-2 en 2020 – même si c’est rarement évoqué dans les médias.
Pendant longtemps, cette volonté de rattrapage transparaissait clairement dans les documents officiels de présentation des activités spatiales, les Livres blancs qui sortent tous les cinq ans depuis l’an 2000 en parallèle des plans quinquennaux. Ces documents détaillent ce qui a été réalisé et ce qui va être fait dans les cinq prochaines années, par catégorie : les lanceurs, l’exploration spatiale, les télécommunications, l’observation de la Terre, etc. On est dans une planification de pays communiste, qui assure des financements et des priorités stables. Cette continuité est un atout pour des programmes spatiaux qui se font dans la durée comme, par exemple, la réalisation de la station spatiale Tiangong – en orbite depuis 2021, soit plus de trente ans après la décision du programme et dix-huit ans après le premier vol d’un taïkonaute.
Mais dans le dernier Livre blanc, paru en 2022, le ton change nettement : la Chine souligne qu’elle va faire des choses qui n’ont pas été faites auparavant.
Tous les quinze jours, de grands noms, de nouvelles voix, des sujets inédits pour décrypter l’actualité scientifique et mieux comprendre le monde. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui !
Et de fait, aujourd’hui, avec les plans d’aller chercher des échantillons sur Mars (Tianwen-3) et ceux déjà couronnés de succès, comme celui de ramener des échantillons de la face cachée de la Lune (Chang’e-6), on a l’impression que le fossé se comble. Les Chinois revendiquent-ils une forme de concurrence avec les autres grandes nations spatiales, dans une « course à l’espace » ?
I. S.-V. : Ce que j’observe, c’est qu’officiellement, les Chinois ne disent pas qu’ils sont en concurrence avec les États-Unis. Ils insistent plutôt sur la fierté nationale, le désir de reconnaissance en tant que puissance de premier plan – le fameux « rêve chinois » de Xi Jinping pour 2049. Ils ne veulent pas tomber dans le piège que leur tendent les États-Unis en les présentant systématiquement comme des compétiteurs acharnés. Ce n’est pas une priorité pour eux d’être les premiers à installer une base sur la Lune. Ils ont leur propre calendrier et ne sont pas prêts à accélérer pour le principe, car il s’agit d’abord de réussir la mission prévue aux conditions qu’ils se sont fixées.
L’Agence spatiale chinoise met en avant des notions comme la coopération scientifique internationale et l’ouverture. Strictement exclue depuis la fin des années 1990 par le Congrès américain de toutes les coopérations, y compris avec des pays tiers, qui impliquent des technologies américaines, la Chine s’affiche comme un modèle alternatif n’imposant aucune discrimination politique.
Si les États-Unis ont besoin d’un compétiteur dans l’espace pour justifier des budgets importants demandés au Congrès et pour démontrer au monde leur supériorité, la Chine n’a pas de raison de jouer un tel jeu. En revanche, cette communication américaine sur la « menace » chinoise dans l’espace est habilement exploitée en Chine avec des articles reprenant des citations de journaux américains annonçant que « des Chinois pourraient aller sur la Lune avant les Américains ». C’est un exemple que je cite souvent à mes étudiants pour qu’ils aient conscience des effets de boomerang possibles des discours médiatiques, mais surtout pour l’absurdité du propos, puisque la première mission lunaire restera à jamais la mission américaine Apollo-11. C’était en 1969, il y a plus de cinquante-cinq ans déjà !
Cela n’empêche pas que la Chine privilégie les missions spatiales spectaculaires comme caisse de résonance de ses capacités nationales. Elle a ainsi réalisé des « premières » remarquées en alunissant sur la face cachée de la Lune en 2019 (mission Chang’e-4) et en en rapportant des échantillons en 2024 (mission Chang’e-6). Ces missions étaient annoncées dès le Livre blanc de 2016 puis de 2022. Se poser sur la face cachée est plus compliqué pour communiquer avec la Terre, mais la Chine démontre ainsi qu’elle peut réaliser des missions totalement nouvelles. Surtout, en rapportant presque deux kilogrammes de sol lunaire de la face cachée, elle a suscité un très grand intérêt des scientifiques du monde entier, au point que la Nasa a dû intercéder auprès du Congrès pour que des chercheurs américains puissent postuler pour recevoir des échantillons… que la Chine leur a d’ailleurs accordé.
Qu’en est-il du « New Space » : existe-t-il en Chine des équivalents de SpaceX d’Elon Musk ou de Blue Origin de Jeff Bezos ?
I. S.-V. : Le « New Space » – un phénomène nouveau aux États-Unis à partir des années 2000, lié à l’émergence de sociétés privées qui n’appartiennent pas au monde du spatial traditionnel, mais plutôt à celui du numérique et qui privilégient l’innovation — a été stimulé par les gouvernements américains, afin de renforcer la compétitivité sur le plan international tout en garantissant une avance stratégique dans des secteurs clés. Les États-Unis nous répètent depuis dix ans que, hors du New Space, point de salut. En Europe, on est en train de considérer que c’est assez vrai ; au Japon aussi. Mais dans la mesure où l’écosystème spatial américain reste unique, ce ne sera pas possible d’être aussi performant.
Les Chinois, eux, disent qu’il faut soutenir la dimension commerciale du spatial, avoir des acteurs et des débouchés qui ne soient pas seulement étatiques, mais sans consentir d’efforts particuliers d’encouragement. Je pense qu’il y a quand même en Chine une idée très claire du spatial comme outil de souveraineté, et le poids des entreprises d’État – qui peuvent aussi créer des sociétés commerciales en parallèle – reste très fort.
Ce qui est intéressant d’ailleurs, c’est que, bien que le New Space chinois n’existe pas sur le modèle américain, ça n’empêche pas beaucoup d’experts occidentaux de faire comme si. Et je pense que, là, on touche à une vraie difficulté dans les grilles d’analyse, à savoir l’idée que le modèle américain serait universel.
Comment étudiez-vous la politique spatiale chinoise sans parler ou lire le chinois ?
I. S.-V. : C’est une difficulté récurrente sur tous mes champs de recherche, car je ne lis pas non plus le russe, le japonais ou le coréen. Ce n’est pas la seule raison, mais il est vrai que j’apprécie particulièrement de travailler sur le spatial indien qui a très longtemps utilisé l’anglais, une tendance en recul avec l’utilisation de l’hindi de plus en plus répandue, comme le souhaite le premier ministre Modi. En fait, j’ai toujours travaillé en binôme avec des collègues spécialistes du pays que j’étudiais et surtout je m’appuie sur des éléments factuels : je compte les satellites, je recense les programmes…
Les progrès de la traduction automatique vont sûrement aider les futurs chercheurs, mais cela ne réglera pas la question essentielle qui, selon moi, est de dénicher des indices dans des documents très différents, et de faire des vérifications croisées entre les annonces et les réalisations pour proposer une compréhension d’une politique spatiale nationale replacée dans son contexte.
En ce qui concerne Mars, une des ambitions des agences spatiales aujourd’hui est de ramener sur terre des échantillons de la planète rouge. Un créneau propice pour les lancements s’ouvre fin 2028, et les Chinois ambitionnent d’en profiter pour lancer leur mission de retour d’échantillons martiens, Tianwen-3. En parallèle, le plan de la Nasa et de ses partenaires, très complexe et ambitieux, est en train d’être revu à la baisse, voire reporté sine die…
I. S.-V. : Aujourd’hui, à la surface de Mars, il n’y a eu que des missions chinoises et américaines. Mais leurs engins ne font pas les mêmes choses du tout et n’ont pas eu la même durée de vie : l’expérience sur Mars des Américains est bien supérieure à celle des Chinois. La Nasa fait même voler un petit hélicoptère, un exploit technologique en soi ! De même, la mission de retour d’échantillons que les Américains envisagent de faire est beaucoup plus complète que celle des Chinois.
Les Américains et leurs partenaires – dont les Européens – ont prévu de récupérer des échantillons prélevés par le robot Perseverance sur différents sites martiens. L’objectif est de construire des briques pour répéter des allers-retours. Cela suppose de disposer à terme de ressources d’ergols (du carburant), de les déposer et les stocker préalablement sur la planète… à défaut de les fabriquer sur place, qui serait l’étape ultime. Le programme actuel sur la Lune, Artemis, est conçu comme une répétition des opérations martiennes, dans des conditions moins complexes – mais qui coûte tout de même près de 10 milliards de dollars par an environ, si on inclut les lancements.
Quoi qu’il en soit, si les Chinois deviennent la première nation à ramener des échantillons de Mars, ils auront accompli quelque chose de majeur.
Si, et seulement si, cette mission réussit ! Car il y a beaucoup d’échecs en ce qui concerne les missions spatiales d’exploration…
I. S.-V. : On touche là au grand marqueur des missions chinoises. J’ai comparé les missions d’exploration spatiale depuis le début de la conquête spatiale, et plus précisément ce qui est annoncé par les agences spatiales et ce qui est finalement réalisé : le taux d’échec moyen est de presque 50 %.
Or, aujourd’hui, les missions chinoises ont 100 % de réussite. Certes, les moyens actuels ne sont pas ceux d’il y a cinquante ans : les ordinateurs sont plus puissants, les composants sont plus fiables, on profite des retours d’expérience, etc. Mais malgré cela, le taux de réussite et les résultats sont impressionnants.
La force de la démarche chinoise, c’est de combiner les compétences acquises, sans forcément chercher à chaque fois une rupture technologique à la mode américaine. Le plan chinois pour ramener des échantillons de Mars s’appuie ainsi sur plusieurs expériences : ils ont déjà posé un rover sur Mars en 2021 ; la collecte d’échantillons a déjà été faite sur la face visible et la face cachée de la Lune ; la mission Tianwen-2 vers un astéroïde va tester d’autres technologies.
Le taux de réussite des missions d’exploration est vraiment la preuve que le secteur spatial chinois est mûr, fiable et bien organisé. C’était un vrai défi quand on sait qu’ils ont développé leurs capacités spatiales en autonomie complète.
Depuis l’élection de Donald Trump, si on peut sentir l’influence d’Elon Musk pour pousser certains aspects de la conquête spatiale, il y a aussi des coupes budgétaires importantes à la Nasa. Les changements politiques aux États-Unis peuvent-ils affecter la politique d’exploration spatiale chinoise ?
I. S.-V. : Les Chinois peuvent simplement faire ce qu’ils ont déjà prévu de faire : aller sur la Lune, y installer une base automatique, aller chercher des échantillons sur Mars. De toute façon, ils vont continuer à progresser étape par étape. Les programmes sont en cours de réalisation et ils ne seront pas arrêtés.
La situation était différente il y a quinze ans. Je me souviens très bien que j’étais à une conférence à Pékin en 2010 au moment où Obama avait arrêté le programme Constellation de retour sur la Lune. À cette époque, la communauté spatiale chinoise avait été très inquiète, craignant que l’argumentaire de Barack Obama – pourquoi revenir sur la Lune, nous avons déjà réalisé cet exploit il y a plusieurs décennies – n’incite le pouvoir politique chinois à ralentir son soutien financier. Un des participants prétendait même qu’Obama avait pris sa décision pour empêcher que la Chine ne poursuive ses efforts !
Je dirais qu’aujourd’hui la situation est délicate aussi pour les États-Unis. Si le président Trump décidait demain que la Lune est une priorité moindre, car l’urgence c’est Mars, le risque serait que la station internationale de recherche scientifique sino-russe se retrouve, de fait, seule à fonctionner sur la Lune. Cela ne manquerait pas de poser un problème d’image pour les États-Unis après tous leurs discours sur la nécessité d’empêcher une « colonisation » chinoise.
Du fait du caractère très politique aujourd’hui des programmes d’exploration, il y a inévitablement des effets d’influence des uns sur les autres. La question est celle du financement global disponible et des priorités dans sa répartition. Comme l’économie chinoise est quand même un peu moins efficace qu’elle ne l’a été, il peut y avoir des arbitrages, des équilibrages… mais le cadre quinquennal continuera à lisser les changements éventuels de cap.
J’en profite pour mentionner que le budget du spatial américain est, depuis longtemps et toujours aujourd’hui, absolument considérable en comparaison des budgets des autres pays : il atteint environ 70 milliards ou 80 milliards de dollars – ce qui est peu par rapport au budget total de la défense par exemple, mais énorme par rapport à celui de la Chine, évalué à environ 20 milliards. Ajoutons 18 milliards pour l’Europe, autour de 4 milliards ou 5 milliards pour le Japon et la Russie, et 2,5 milliards pour l’Inde. Au total, les États-Unis dépensent plus dans le spatial que toutes les autres puissances spatiales réunies. Les Chinois sont parfaitement conscients de ce hiatus, d’où le choix d’autres démarches.
Les coupes budgétaires américaines affectent aussi massivement d’autres agences fédérales qui impliquent le spatial pour observer la Terre, son environnement, son climat…
I. S.-V. : Les Chinois ont une position bien différente de celle du président Trump vis-à-vis de l’écologie. Le changement climatique renforce les risques naturels déjà importants, la désertification avance et le développement économique qui conditionne la stabilité du système politique chinois fait qu’il y a une vraie sensibilité à la question du développement durable. Or, les satellites sont des atouts essentiels pour la compréhension et le suivi du climat, mais aussi pour la gestion des crises majeures liées à des événements extrêmes.
Mais un autre facteur est celui des relations internationales : si les États-Unis se retirent des programmes sur le climat, la place de la Chine va devenir plus importante dans le soutien aux recherches d’une communauté scientifique internationale très inquiète. Autant les Européens auraient du mal à s’allier avec la Chine pour aller sur Mars alors qu’ils se sont engagés avec la Nasa, autant, sur le climat, ce serait moins compliqué. La Chine réalise déjà des missions en coopération internationale, et elle fait très attention à ne pas imposer des contraintes politiques identiques à celles que pratiquent les États-Unis. De plus, les recherches sur le climat bénéficient d’une image positive globale et la Chine y trouvera certainement une opportunité de soft power en plus de satisfaire ses propres préoccupations.
Donc oui, je pense que l’étude de la planète Terre depuis l’espace est un élément sur lequel la Chine peut vraiment capitaliser. Et ça ne coûte pas si cher que cela, en plus : un satellite scientifique, ce n’est rien par rapport à un programme de station et de vols habités.
Quelle place prend l’espace dans l’imaginaire chinois, dans la culture populaire ?
I. S.-V. : Les Chinois n’ont pas eu d’instant Apollo : en 1969, en pleine Révolution culturelle, ils ne regardaient pas la télé (qu’ils n’avaient pas) pour voir Neil Armstrong faire son « grand pas pour l’humanité ». En 2003, j’étais en mission en Chine juste après le premier vol habité chinois. C’était intéressant de se rendre compte que les gens étaient fiers, mais en même temps très conscients de leur retard – ils disaient eux-mêmes qu’ils arrivaient après Gagarine et les autres.
Aujourd’hui, c’est autre chose. La communication médiatique sur la Lune et sur Mars est très présente, et la perception du spatial par le grand public en Chine évolue énormément depuis les réussites des missions d’exploration. Les journaux chinois ont bien insisté sur le fait qu’aller sur la face cachée de la Lune était une première, et que les scientifiques du monde entier ont demandé à pouvoir accéder à ces échantillons. Cet intérêt international voulu a beaucoup compté pour l’image que la Chine se fait d’elle-même comme grande puissance en devenir. On en revient au « rêve chinois », une Chine au tout premier rang des nations en 2049.
La communication autour du spatial chinois est aussi beaucoup plus ouverte. La nouvelle base de lancement spatial de Hainan – qui vient s’ajouter aux bases historiques de Xichang et Taiyuan – est un pôle très visible de la modernité du spatial chinois et de toutes les grandes missions d’exploration, avec des initiatives pour développer du tourisme autour des lancements.
La scénarisation par Elon Musk des tests de ses lanceurs réutilisables, les discours sur l’exploration, la place accordée à l’innovation, l’autorisation de création d’entreprises avec des capitaux publics et privés font que l’espace est aussi redevenu à la mode comme défi technologique.
Et enfin, vous avez des dessins animés, des robots qui parlent, des images de taïkonautes dans des publicités pour des banques, etc. Le secteur suscite beaucoup plus d’enthousiasme, notamment sur les réseaux sociaux.
Le spatial a aujourd’hui toute sa place dans l’imaginaire chinois. Il participe indéniablement de la fierté nationale et contribue efficacement à la reconnaissance internationale des compétences nouvelles acquises par la Chine.![]()
Isabelle Sourbès Verger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[SANTÉ] BV à la rencontre des soignants qui « ne veulent pas tuer »](https://www.bvoltaire.fr/media/2025/05/soins.avif?#)
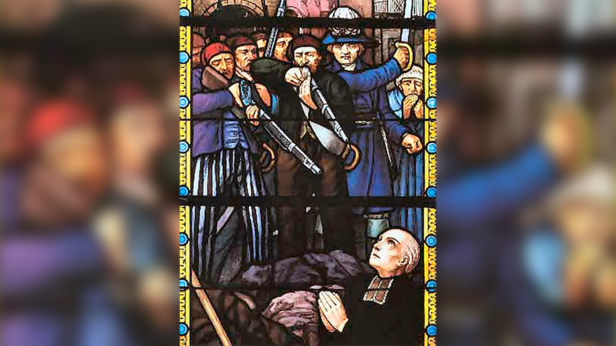

![[BIENVENUE CHEZ LES WOKE] Antispécisme : des mouches d’extrême droite !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/vignette-modele13-1-616x347.jpg?#)






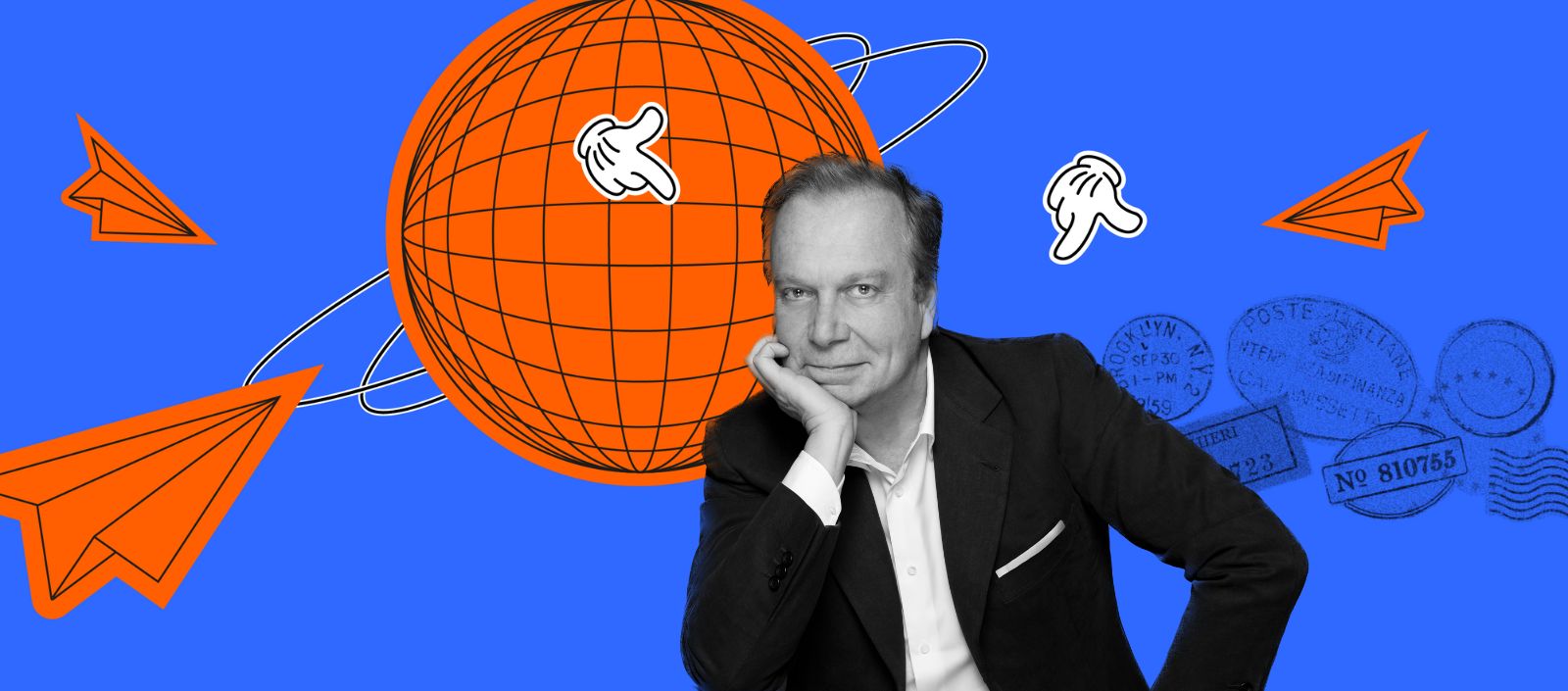















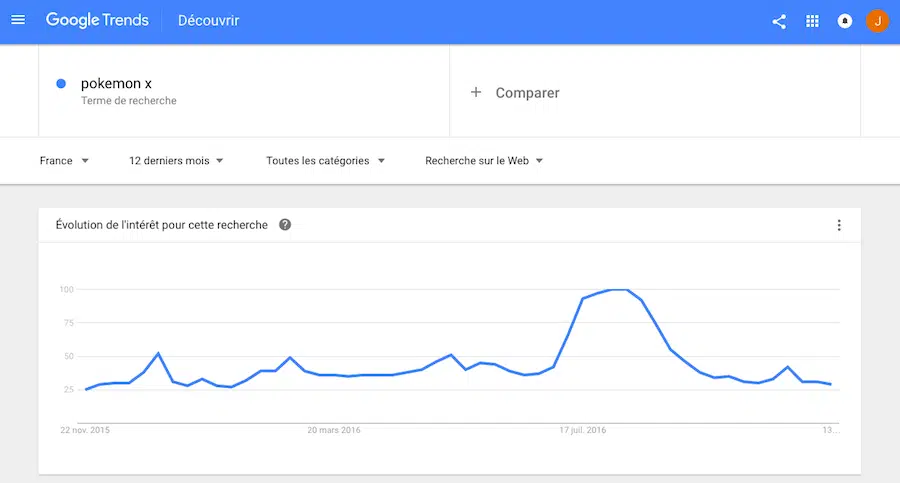

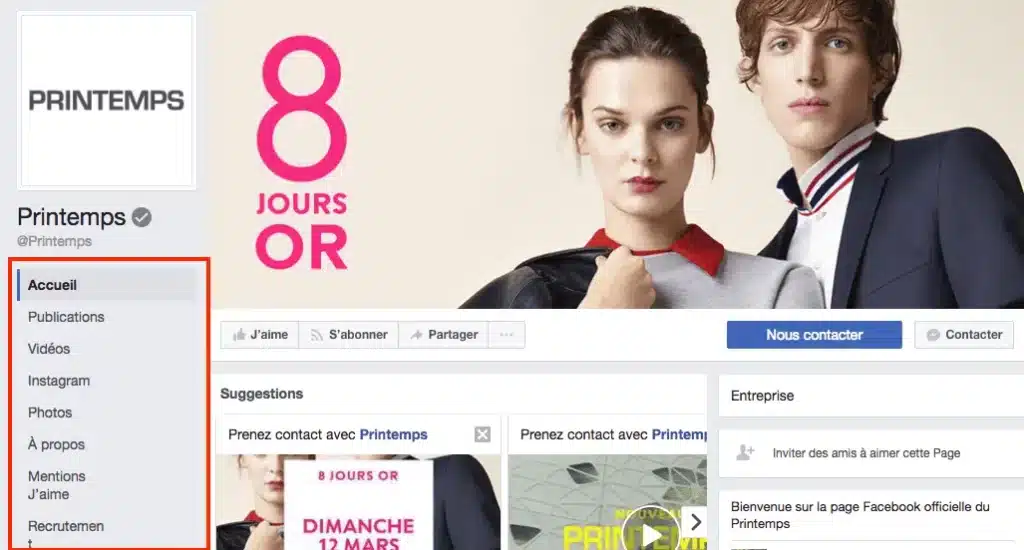




/2025/05/14/000-46gj4aw-68244ec2f24df893222783.jpg?#)
/2025/05/05/000-33fq4j6-68187ffcca334578959891.jpg?#)
/2025/05/14/000-46ma8t2-6824a0a9d785f102147799.jpg?#)




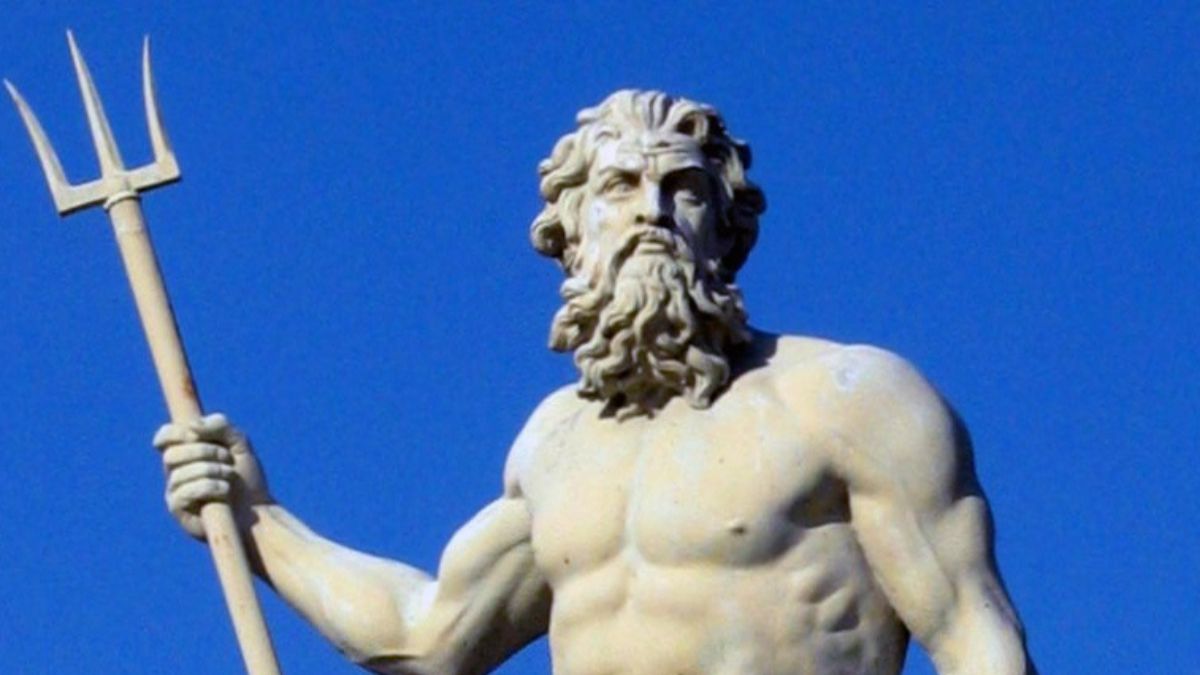



.jpg?#)






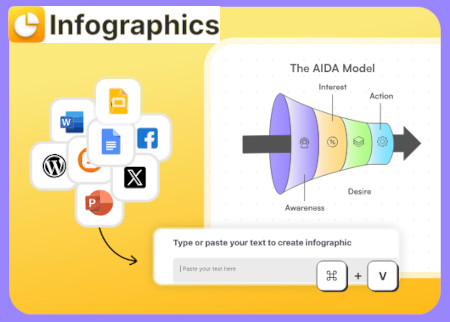









/2025/05/02/illustr-cosmos-6814d7490605e803046365.png?#)

