Conduire une voiture thermique : un luxe bientôt réservé à quelques happy few ?
La fin des voitures thermiques est annoncée dans un délai assez court. Pourtant, le texte européen qui le prévoit inclut une exception, qui pourrait bien devenir une bombe sociale.

La fin des voitures thermiques est annoncée dans un délai assez court. Pourtant, le texte européen qui le prévoit inclut une exception qui pourrait bien devenir une bombe sociale, pour peu qu’elle soit mal anticipée par les gouvernements.
Alors que l’Union européenne (UE) multiplie les mesures pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, le secteur des transports s’impose comme un enjeu majeur. Et pour cause : en 2022, il représentait en moyenne 25 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) sur le continent, devant les secteurs résidentiel et tertiaire (12,8 %), l’industrie manufacturière et la construction (12,5 %), ou encore l’agriculture (11,7 %). Seule l’industrie de l’énergie se plaçait devant, avec 29,5 % des émissions.
Pire encore, les émissions liées aux transports ont augmenté de 19,5 % depuis 1990 dans l’UE. Un triste record, puisque c’est le seul grand secteur – à l’exception marginale des solvants et produits divers (2,2 % des émissions) – à avoir vu ses émissions croître sur la période.
Dans le détail, c’est le transport routier qui explose : +23 % depuis 1990, devant le transport aérien (+16 %). À l’inverse, les modes maritime et fluvial ont réduit leurs émissions de 18 %, et le ferroviaire affiche même une chute impressionnante de 73 %.
2035 : la fin du thermique… mais pas pour tous
Face à ce constat, le Conseil de l’Union européenne a tranché : la vente de véhicules thermiques et hybrides neufs sera interdite dans les pays membres à partir de 2035, selon le règlement européen 2023/851. Cette date est loin d’être symbolique : avec une durée de vie moyenne d’un véhicule inférieure à 15 ans, cela permettrait à l’ensemble du parc automobile d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon de 2050.
Cependant, cette interdiction ne s’appliquera pas à tout le monde.
Ainsi, les petits constructeurs – ceux qui produisent moins de 1 000 véhicules par an – seront totalement exemptés de cette obligation. Des marques comme Ariel, Bugatti ou Morgan, souvent associées à une production artisanale et à une clientèle ultra-aisée, pourront donc continuer à vendre des voitures thermiques sans restriction.
À lire aussi : La voiture électrique accessible à tous ? Les marges de manœuvre limitées des constructeurs européens
Écologie à deux vitesses ?
Certes, l’impact environnemental de ces véhicules de niche est dérisoire au regard des chiffres globaux. En 2024, la France a enregistré 1,71 million de nouvelles immatriculations, pour un parc total de 39,3 millions de véhicules. Autant dire que les modèles vendus par les marques sous la barre des 1 000 pèsent peu, écologiquement parlant. Mais sur le plan social, la question est tout autre.
Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Chaque lundi, recevez gratuitement des informations utiles pour votre carrière et tout ce qui concerne la vie de l’entreprise (stratégie, RH marketing, finance…).
Le privilège accordé à ces constructeurs risque bien d’alimenter un sentiment d’injustice. Celui d’une écologie à deux vitesses, où seuls les plus riches pourront continuer à rouler dans des véhicules thermiques. Ce type de mesure pourrait renforcer la fracture sociale et nourrir des discours déjà bien installés autour d’une « écologie punitive » ou d’une « écologie pour les riches ». Et la situation pourrait encore évoluer.
2026 : année de tous les ajustements ?
En effet, une clause de réexamen est prévue pour 2026. Son objectif initial était de vérifier la faisabilité des mesures proposées et, le cas échéant, de les ajuster. Un moment clé à venir, d’autant qu’un précédent existe. En 2022, un amendement avait déjà été déposé pour permettre à certains constructeurs produisant entre 1 000 et 10 000 véhicules particuliers (et jusqu’à 22 000 véhicules utilitaires légers) de solliciter une dérogation jusqu’au 31 décembre 2035. Si, en 2026, les textes étendaient l’exemption d’interdiction aux constructeurs sous le seuil des 10 000 véhicules annuels, cela signifie que des marques comme Aston Martin, McLaren ou Rolls-Royce, seraient aussi concernées.
L’impact environnemental d’une telle dérogation resterait là encore très faible. Mais le symbole social, lui, est puissant. Cette situation s’inscrirait dans la continuité du long processus – encore inachevé – de mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) en France. Souvent pointées du doigt pour leur caractère inégalitaire, ces zones toucheraient en priorité les ménages modestes, plus susceptibles de posséder des véhicules anciens et donc plus polluants.
À l’heure où les écarts de richesse ne cessent de se creuser, depuis plus de quanrante ans, dans la majorité des pays, ces mesures doivent être accompagnées d’un effort massif de justice sociale pour garantir leur acceptabilité. Cette situation rappelle à quel point la conciliation entre objectifs économiques, sociaux et environnementaux reste complexe. Cette conciliation était pourtant au cœur du rapport « Notre avenir à tous » avec la promesse d’un développement plus durable, popularisé… en 1987.![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.



![Soudan: l'école Al Shourta à Port-Soudan, un refuge pour les artistes déplacés [3/3]](https://s.rfi.fr/media/display/befb5940-2a94-11f0-a327-005056a97e36/w:1024/p:16x9/1000187457.jpg?#)



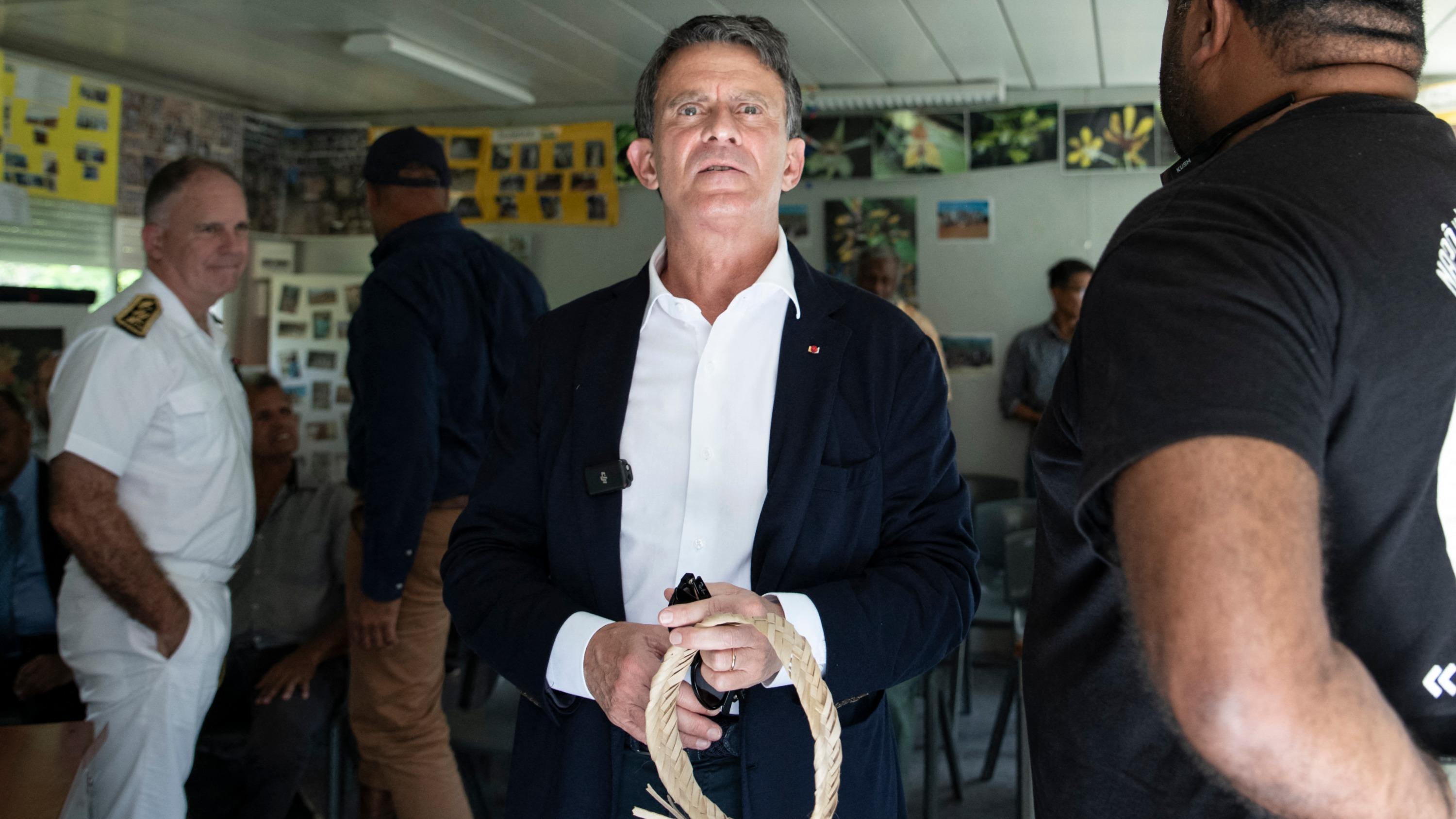

























/2025/05/06/carmen-ou-comment-un-fiasco-est-devenu-le-plus-celebre-des-operas-francais-681a741eaaa72694641786.jpg?#)
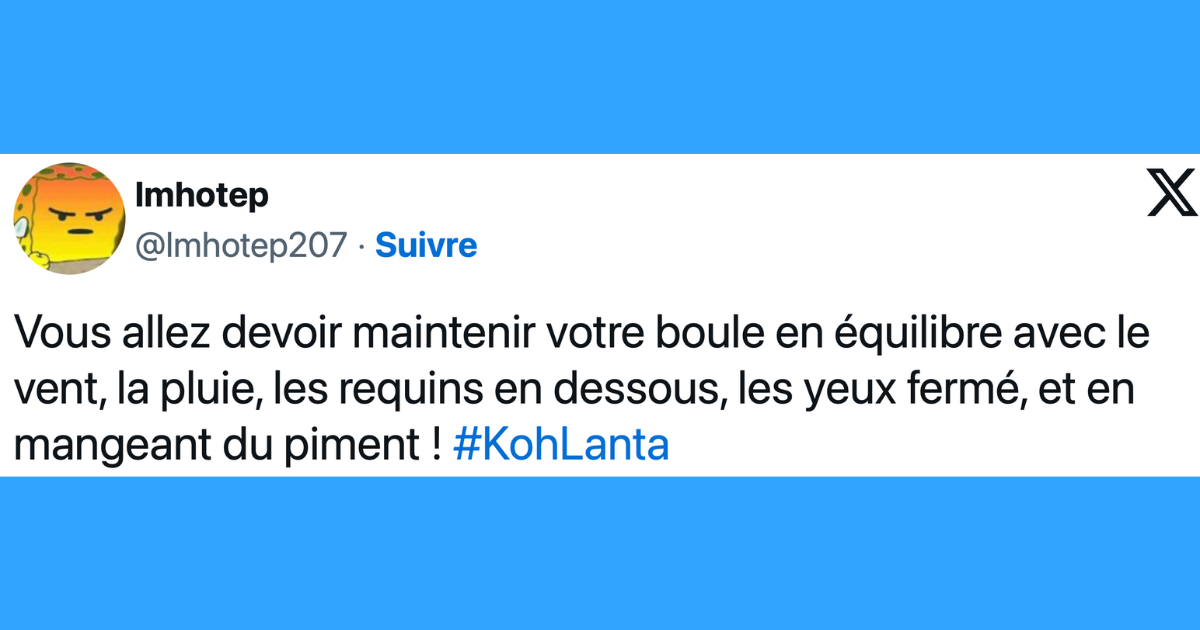



/2025/05/06/v2-florence-seyvos-c-patrice-normand-681a20670109b637542013.jpg?#)











/2025/05/04/etats-unis-des-chercheurs-sous-pression-est-menaces-6817c2eb45876085234095.jpg?#)
















