Comment anticiper les risques d’inondations ? Grâce aux « Blue Managers »
Premier risque naturel au monde, les inondations menacent en France 3,5 millions de maisons et 18,5 millions de personnes. Quelles sont les solutions d’adaptation ? Quel est le rôle des Blue Managers ?


Premier risque naturel au monde, les inondations menacent en France 3,5 millions de maisons, 18,5 millions de personnes et 14,3 millions d’actifs. Avec le réchauffement climatique, les coûts explosent, mais des solutions d’adaptation émergent. Avec, en chef d’orchestre, les Blue Managers. Car ce n’est pas une question seulement technique, mais aussi humaine et managériale.
En ce printemps 2025, des crues historiques ravagent la Dordogne. Pluies extrêmes, sols imperméables, urbanisation galopante… les inondations frappent plus souvent, plus fort, dans des zones autrefois jugées sûres.
Pourtant, les modèles fondés sur les crues historiques ne suffisent plus à anticiper un climat en pleine mutation. Les diagnostics de risque évoluent. Jumeaux numériques et projections climatiques permettent désormais d’évaluer les hauteurs d’eau et les probabilités d’occurrence à l’échelle d’une adresse, et d’identifier des solutions d’adaptation.
Des outils puissants à transmettre aux Blue Managers pour accélérer la résilience des territoires.
Apparus récemment dans le sillage des initiatives éducatives liées à la transition climatique, les Blue Managers incarnent une nouvelle génération de professionnels, formés à la gestion durable des ressources en eau et à l’anticipation des risques hydriques. Ce mouvement trouve un écho croissant dans les travaux académiques consacrés au Blue Management.
Crue de référence
En France, les zones inondables sont délimitées par les plans de prévention du risque inondation (PPRI) communaux. Basés sur une logique historique, ils extrapolent les hauteurs d’eau à partir de crues observées ou modélisées, en s’appuyant sur les repères de crue pour entretenir la mémoire du danger.
Une zone est inondable si elle est exposée à une crue de référence. En France, on mentionne généralement la crue centennale. Son niveau est estimé à partir d’observations historiques, de séries de débits maximaux et de calculs hydrologiques. Le PPRI découpe ensuite le territoire en trois zones : rouge, interdiction de construire ; bleue, construction possible avec adaptations, comme la surélévation ; et blanche, sans règle spécifique mais non sans risque.
Inondations en Île-de-France : 88 % des arrêtés de catastrophe naturelle en quarante ans
L’approche actuelle des risques présente de sérieuses limites : elle ignore l’impact du changement climatique. Si le Giec prévoit un volume d’eau annuel stable en France, sa répartition évolue rapidement : périodes sèches plus longues, saisons des pluies raccourcies, pluies moins fréquentes, mais plus intenses. Elle ignore aussi les effets cumulés de l’urbanisation sur les écoulements et néglige les crues éclairs causées par le ruissellement pluvial. En Île-de-France, ces épisodes ont motivé 88 % des arrêtés de catastrophe naturelle pour inondation entre 1982 et 2021, touchant 1 090 communes. À l’échelle nationale, environ 175 000 habitants sont directement affectés chaque année.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
La méthode actuelle lisse la variabilité climatique et sous-représente les crues dites millénales, dont la période de retour est évaluée à mille ans, soit 0,1 % de probabilité annuelle. Les PPRI les évoquent parfois à titre informatif ou pour les infrastructures sensibles, sans imposer de contraintes. Il reste possible de construire là où seule la crue centennale est prise en compte, alors que la base Catastrophe naturelle (Cat-Nat) montre que des crues millénales surviennent déjà à des fréquences proches des crues décennales ou trentennales.
Jumeaux numériques
L’inondation se manifeste de trois manières : fluviale, par débordement d’un cours d’eau ou remontée de nappe souterraine, côtière, par submersion marine, ou pluviale, par ruissellement. Pour permettre aux territoires et aux entreprises de mieux s’adapter, il est essentiel de mesurer précisément le risque : hauteur d’eau attendue, vitesse d’écoulement et période de survenue la plus probable. De nouvelles solutions géolocalisées d’évaluation répondent aujourd’hui à ces besoins, et alimentent des jumeaux numériques tels que celui de la ville d’Angers.
Un jumeau numérique de terrain est une réplique virtuelle détaillée d’un site réel. Il agrège, à une maille fine, des données sur la nature des sols, la hauteur des bâtiments, le couvert forestier, la pente et l’urbanisation. Ces données proviennent principalement d’imagerie satellite, de relevés Lidar, et de modèles numériques d’élévation à haute résolution comme Fabdem ou Copernicus GLO-30. Un jumeau numérique intègre également les infrastructures d’évacuation (diamètres des canalisations, réseaux) ainsi que les dispositifs de défense situés en amont sur les bassins versants (digues, bassins d’expansion, barrages).
À ce jumeau numérique, on applique les régimes de précipitations actuels et à venir. Ainsi, les projections climatiques sont intégrées dans des modèles hydrologiques et appliquées au jumeau numérique de terrain. Ces derniers permettent en tout point du globe, à la coordonnée GPS et autour, d’estimer la hauteur d’eau résultant d’inondations, et les probabilités d’occurrence par saison associées.
Près de 24,8 milliards d’euros entre 1982 et 2022
En s’appuyant sur les fonctions de dommage de la réassurance, ces hauteurs d’eau probabilisées sont ensuite converties instantanément en dommage financier en fonction de la nature et l’usage de chaque bâtiment. Un système d’alerte météo géolocalisé complète l’outil, dont les seuils de déclenchement sont adaptés au diagnostic. Pourquoi ? Pour garantir la résilience opérationnelle de demain et la résilience patrimoniale d’après-demain.
Premier risque naturel au monde, les inondations menacent en France 3,5 millions de maisons, 18,5 millions de personnes et 14,3 millions d’actifs. Entre 1982 et 2022, 24,8 milliards d’euros ont été versés au titre de la garantie catastrophes naturelles, dont la moitié pour des inondations par ruissellement. Ces crues soudaines, aggravées par l’urbanisation et l’évolution des précipitations, saturent rapidement les systèmes d’évacuation.
Selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), le coût des inondations ne fera qu’augmenter dans les années à venir.
Outils d’aide à la décision
Les gestionnaires de risque disposent aujourd’hui de véritables outils d’aide à la décision. Ils ont des critères objectifs bien plus actionnables et fiables que les zonages de couleurs issus des PPRI. Hauteurs d’eau, visualisation 3D et dommages financiers permettent de préfiltrer des solutions d’adaptation, comme des batardeaux amovibles à la relocalisation, ou de mettre en place des plans de mise en sécurité des biens et des personnes ou des plans de continuité d’activité des entreprises.
Blue Manager
Mais adapter un site ou un bâtiment aux inondations n’est pas qu’une question technique. Traduire une information en plan d’action ajustable dans la durée et impactant sur la conduite même de l’activité en cas d’événement majeur n’est pas si simple. La perception d’un risque diffère d’un acteur à l’autre face aux mêmes informations, y compris face à des données alarmantes.
La résilience apparaît comme un défi de gouvernance, de perception du risque, et également de pédagogie. Ces rôles incombent notamment aux Blue Managers pour piloter de manière globale les trajectoires d’adaptation.
Un Blue Manager est un chef d’orchestre chargé de piloter de manière holistique la gestion stratégique de l’eau et les risques qui y sont associés. Il occupe une position transversale entre urbanisme, climat, ingénierie et gestion de crise. Il intervient sur la planification et la gouvernance, avec une capacité à interpréter et mettre en perspective les informations et les outils dont il dispose pour coordonner des plans de continuité et d’action.
Pour les former, les approches innovantes se développent. L’idée : rendre le risque concret, et l’adaptation opérationnelle. Former les Blue Managers et leur donner les moyens d’agir grâce aux nouveaux outils de diagnostic est sans aucun doute la plus grande des préventions face aux prochaines inondations. Les inondations – et le climat plus largement – sont une affaire de management !![]()
Professeure de Finance et Vice Associate Dean à Excelia, Miia Chabot anime également la recherche chez Tardigrade AI, où elle développe des solutions d’adaptation et de résilience aux risques climatiques physiques.
Professeur de finance à l'ESSCA School of Management, Jean-Louis Bertrand est engagé dans l'analyse des vulnérabilités climatiques des entreprises et des collectivités territoriales chez Tardigrade AI et en tant que vice-président du GIEC des Pays de la Loire.
Abdessemed Tamym ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[SANTÉ] BV à la rencontre des soignants qui « ne veulent pas tuer »](https://www.bvoltaire.fr/media/2025/05/soins.avif?#)
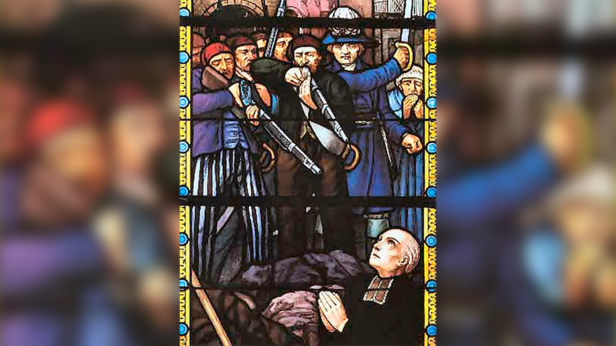

![[BIENVENUE CHEZ LES WOKE] Antispécisme : des mouches d’extrême droite !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/vignette-modele13-1-616x347.jpg?#)






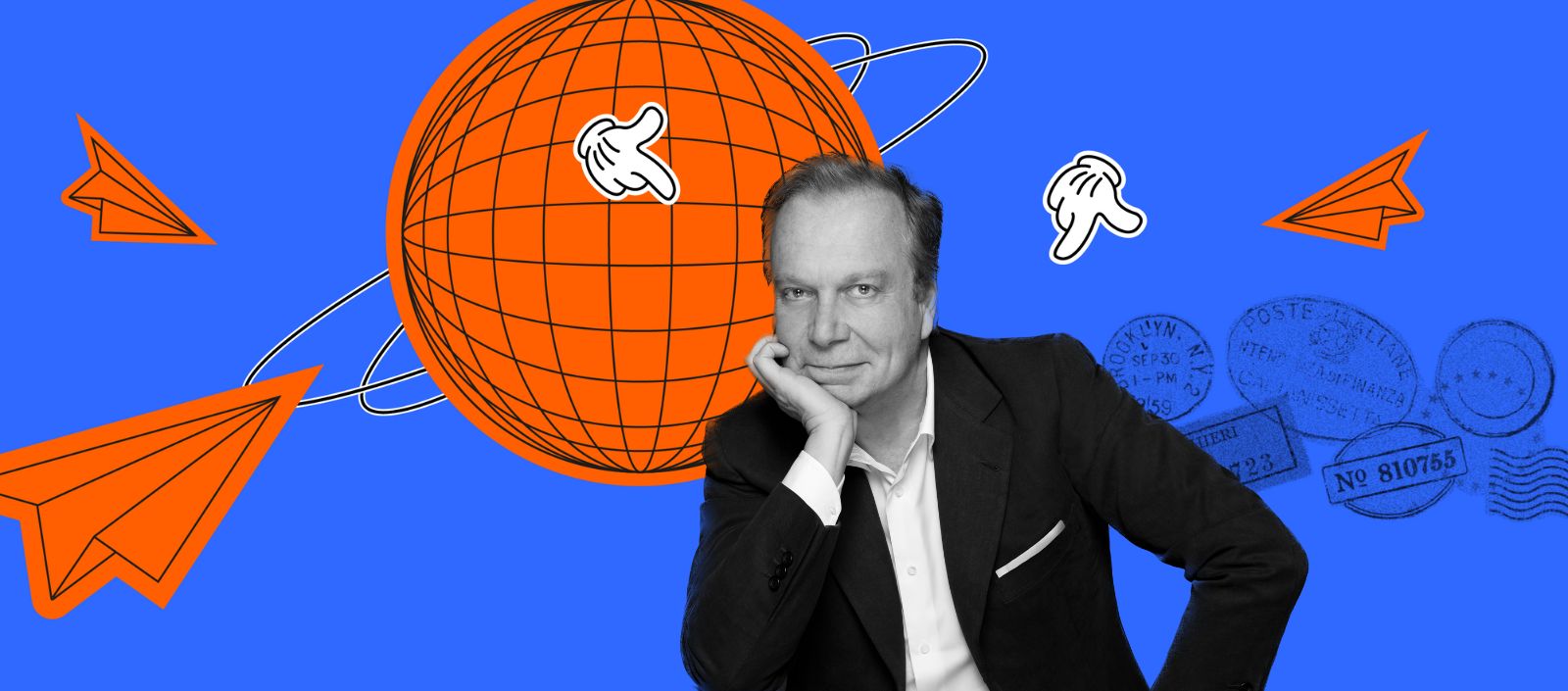















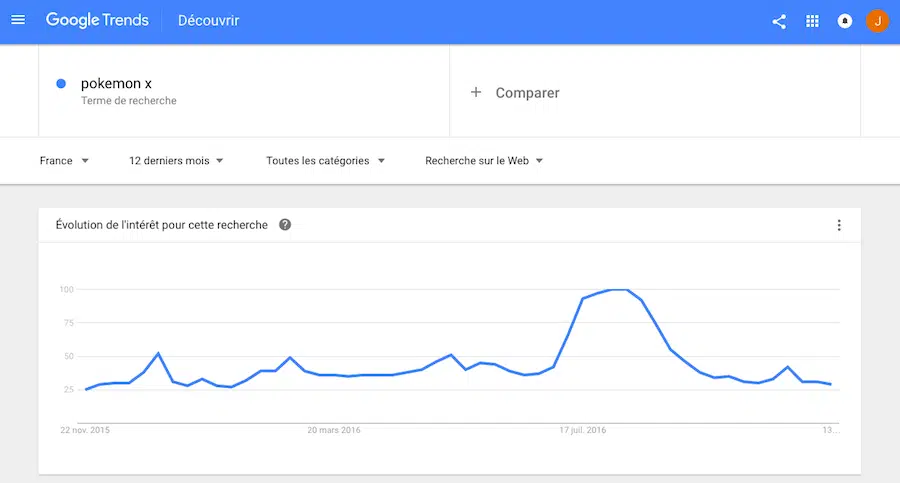

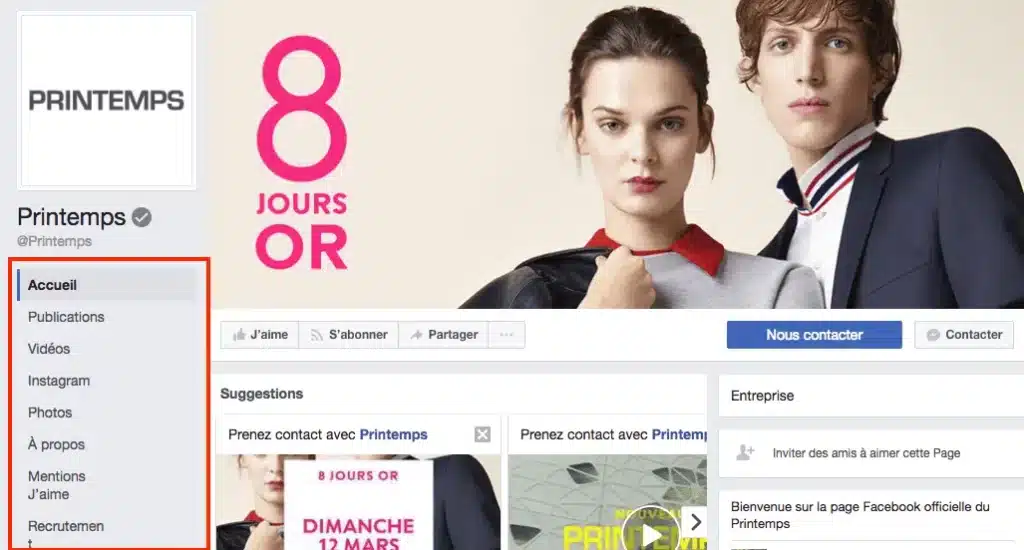




/2025/05/14/000-46gj4aw-68244ec2f24df893222783.jpg?#)
/2025/05/05/000-33fq4j6-68187ffcca334578959891.jpg?#)
/2025/05/14/000-46ma8t2-6824a0a9d785f102147799.jpg?#)




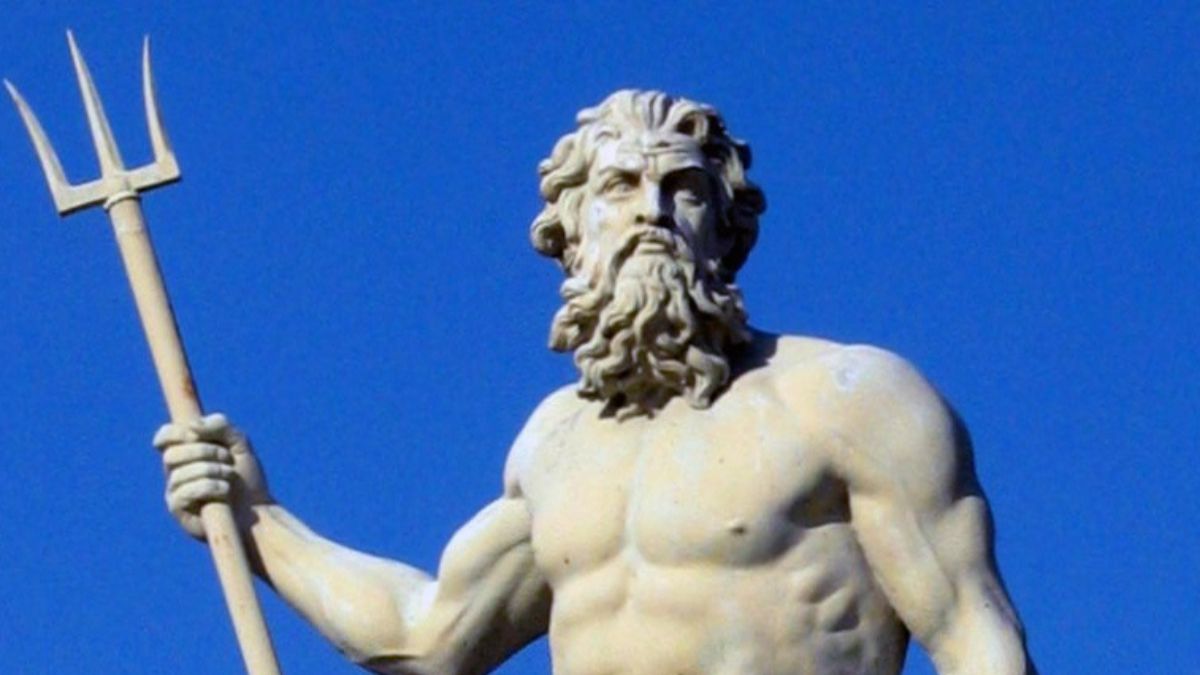



.jpg?#)





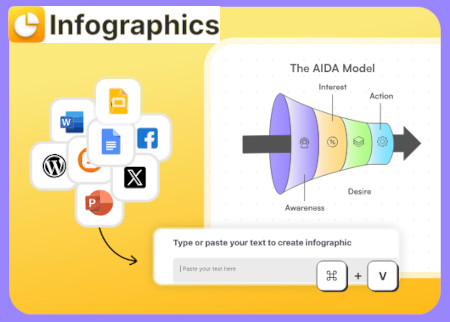










/2025/04/28/000-38vu4zp-680f12366cf22515788583.jpg?#)
