Échouer à un examen ou à un concours : quelques réflexions sur le système scolaire français
Le contrôle continu du bac, censé répartir la pression de l’évaluation sur l’année, finit par se muer en « contrôle en continu ». Une logique compétitive qui peut nourrir un sentiment d’échec.

Si l’examen est fortement lié à l’orientation, il permet aussi à un élève de dresser un état des lieux de ses compétences, de visualiser ses points forts et ses lacunes pour mieux ajuster son travail et ses révisions. Or, bien souvent, la logique compétitive l’emporte sur celle de l’évaluation, ce qui peut nourrir un sentiment d’échec.
En France, de nombreux examens ponctuent la scolarité des élèves et se différencient selon les parcours de formation. Ils ont la plupart du temps un caractère national – comme pour le brevet, les CAP ou les différents baccalauréats – et permettent selon les cas, l’accès à d’autres formations ou à certains métiers.
L’ex-recteur Alain Boissinot fait justement remarquer que les examens scolaires reflètent la plupart du temps dans notre pays une logique de concours, c’est-à-dire qu’un taux important d’échec semble normal dans l’imaginaire collectif.
À lire aussi : Faut-il continuer à noter les élèves ?
Un concours est censé recruter ou non un candidat, il définit la réussite de façon globale en fonction d’un nombre de places, et établit un classement de chaque candidat par rapport à d’autres; alors que la réussite à un examen est censée valider l’acquisition d’un ensemble de savoirs, acquis tout au long d’un parcours de formation et prédéfinis.
C’est donc la réussite du plus grand nombre qui devrait être recherchée, ce qui nécessite par conséquent de questionner et d’améliorer la qualité de la formation dispensée pour aider les plus fragiles.
Échec : à qui la faute ?
Si l’échec à un concours renvoie à une place trop lointaine dans la hiérarchie des candidats et n’est pas forcément lié à des « manques », échouer à un examen traduit un écart trop important entre des attentes et ce que le candidat a pu montrer de ses ressources ou de ses compétences.
Toutefois, quand cet écart est trop béant ou trop fréquent, on doit bien reconnaître que l’échec interroge moins la responsabilité du candidat que l’inadaptation de la formation suivie ou plus largement celle du système éducatif. Par exemple, on sait qu’aujourd’hui, plus que jamais, la réussite scolaire dans l’école française est fortement corrélée à l’origine sociale des élèves.
Les enfants de familles modestes et éloignées des repères scolaires, même avec de bons résultats à l’école primaire, vivent des parcours plus heurtés que les autres, et sont orientés de façon moins favorable. Ils sont par exemple bien plus nombreux en proportion à échouer au premier examen, le Diplôme National du Brevet.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Les résultats dépendent bien sûr du travail fourni par les élèves, mais aussi du niveau de sélection qu’explicitement ou non un système attend à un moment donné, et des contenus enseignés – puis évalués –, qui reflètent davantage la culture des familles favorisées.
Les élèves de milieu populaire rencontrent plus de difficultés : leur culture familiale les aide moins à répondre aux attentes fixées par les programmes et les traditions, ils interprètent différemment les savoirs enseignés et ce qu’ils apprennent à l’école trouve moins d’écho ou d’utilité dans leur univers familial.
Mettre en échec : des conséquences à long terme
Le fait d’échouer à un examen ou concours amène sur le coup des émotions négatives, pouvant aller de la déception à l’humiliation. Mais des conséquences s’observent aussi à long terme. En effet, vivre des expériences négatives affecte les croyances de l’individu en son efficacité, de façon plus générale.
Les échecs, surtout quand ils se cumulent, conduisent les personnes à éviter de nouvelles situations similaires pour ne pas échouer de nouveau, à moins s’engager, mais aussi à user de stratégies d’évitement, à moins persévérer en cas de difficulté et même à développer parfois des comportements antisociaux, comme la triche ou la fraude.
L’échec n’est donc pas anodin et n’entraîne pas mécaniquement, comme on pourrait l’imaginer, un redoublement d’effort pour réussir la prochaine fois.
La pression exercée par la peur de l’échec se diffuse en amont et peut générer de l’angoisse, voire de la panique et ce, quel que soit le niveau scolaire des élèves. Si ces effets peuvent être atténués en favorisant par exemple la prise en compte des résultats sur une plus longue durée, il existe une grave dérive qui consiste à évaluer sans cesse en vue de l’examen.
C’est par exemple le cas aujourd’hui du baccalauréat. La part accrue du contrôle continu censée atténuer le stress, le bachotage, et réduire le côté souvent regretté de « l’examen-couperet », aboutit dans la réalité à ce que les élèves sont évalués en permanence avec des résultats qui comptent pour le bac – et de façon bien plus prescriptrice avec Parcoursup –, durant deux années.
Ce contrôle continu est finalement un « contrôle en continu », qui réduit à peu de choses le caractère formatif de l’évaluation, si bien que les élèves doivent sans cesse faire leurs preuves et n’ont pas le temps d’apprendre de leurs erreurs. Or, « la pire des choses est de polluer le travail pédagogique quotidien par d’intempestives évaluations à valeur sommative/certificative, qui n’ont leur place qu’à la fin d’un processus d’enseignement d’une durée significative ».
Ainsi, cette pression évaluative génère beaucoup d’angoisse ; en 2024, 6 adolescents sur 10 déclarent être angoissés par les évaluations et lors du rendu des notes.
Réussir après l’échec ?
Bien sûr, l’échec pourrait être formateur si des retours précis et qualitatifs étaient transmis avec les résultats. Or, ceux qui échouent disposent en fait de très peu d’informations pour pouvoir s’autoréguler et espérer réussir la prochaine fois. Le « relevé de notes » ne mentionne qu’une succession de données chiffrées : que signifie avoir 8/20 ou 12,23/20, à part montrer un écart avec une limite ou moyenne à atteindre qui, elle-même, n’a que peu de signification ?
Comment comprendre ses erreurs quand on reçoit plusieurs résultats agrémentés de coefficients, qui se cumulent les uns aux autres pour aboutir à une note globale ? Quel sens cela peut-il avoir de connaître son rang parmi un ensemble de candidats, ce qui n’est pas la finalité d’un examen ?
À lire aussi : « L’emprise scolaire » : les diplômes ont-ils trop de poids sur nos vies ?
Les examens scolaires français sont pour la plupart globalisants, c’est-à-dire construits à partir d’un calcul de moyennes, où tout est mélangé, où tout se compense plus ou moins selon le jeu des coefficients. Dans beaucoup de systèmes étrangers on ne « compense » pas et l’examen (c’est par exemple le cas du A-level anglais) signifie donc quelque chose de précis sur les acquis et compétences du lauréat.
En France, le jugement est fondé sur un calcul rarement interrogé. Prenons l’exemple du baccalauréat général aujourd’hui : entre le contrôle continu qui dure deux ans dans certaines disciplines, le contrôle en cours de formation pour l’éducation physique et sportive (et uniquement l’année de terminale) et les épreuves terminales pour le reste, la somme des coefficients atteint 100 ! Sans compter les éventuelles options… Ainsi, un mauvais résultat à l’oral de français, coefficient 5, sera compensé facilement par une note « moyenne » dans une spécialité coefficient 16, alors que les contenus n’ont rien à voir.
Il est donc possible d’échouer avec des compétences très inégales, dans des domaines très différents, et sans savoir ce qu’il faudrait concrètement travailler pour s’améliorer.
Cette mauvaise qualité des examens français a pour conséquence que l’essentiel de la sélection repose de plus en plus sur d’autres modes d’évaluation, aux logiques différentes et plus opaques. On en vient ainsi insidieusement à remplacer par des fonctionnements non maîtrisés l’évaluation plus objective qu’on est en droit d’attendre d’un examen. Lutter contre l’injustice sociale à l’école ne peut que passer par un changement drastique du système d’examens.
Cet article a été écrit par Lucie Mougenot, professeure des universités en sciences de l’éducation, et Roger-François Gauthier, Inspecteur général de l’éducation nationale honoraire et docteur en sciences de l’éducation.![]()
Lucie Mougenot est membre du Collectif d'interpellation du curriculum (CICUR)






















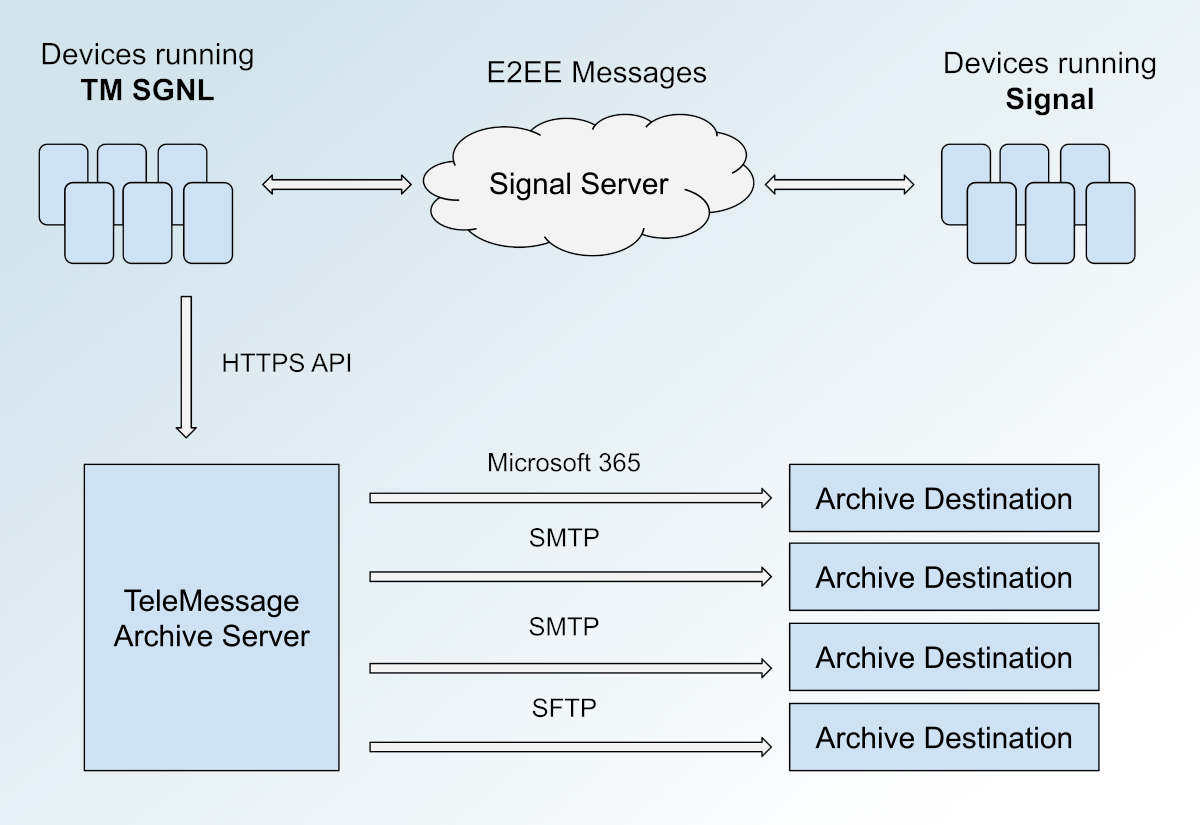






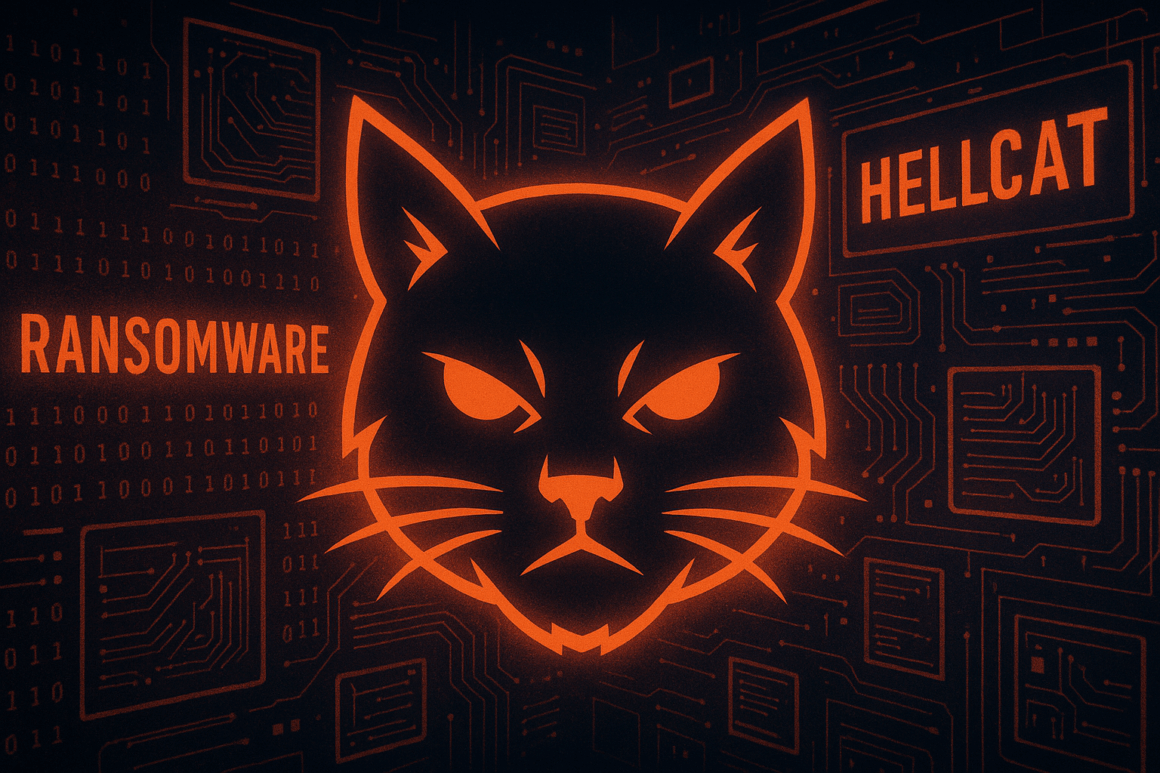


/2025/05/06/carmen-ou-comment-un-fiasco-est-devenu-le-plus-celebre-des-operas-francais-681a741eaaa72694641786.jpg?#)




/2025/05/06/v2-florence-seyvos-c-patrice-normand-681a20670109b637542013.jpg?#)











/2025/05/04/etats-unis-des-chercheurs-sous-pression-est-menaces-6817c2eb45876085234095.jpg?#)


















