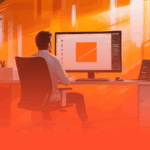Maladies cardiaques : demain, transformer le diagnostic grâce à l’IRM en couleurs
L’IRM cardiaque est précieuse pour le diagnostic de l’infarctus et d’autres pathologies cardiaques. Mais sa mise en œuvre est complexe. L’IRM cardiaque en couleurs, en développement, pourrait la simplifier.

L’IRM cardiaque est un technique d’imagerie médicale précieuse pour le diagnostic de l’infarctus et autres pathologies cardiaques. Mais, en pratique, sa mise en œuvre reste complexe. Une technique d’IRM nouvelle génération, qui permet de visualiser les lésions en couleurs, est en cours de développement. Elle a donné de premiers résultats prometteurs chez des patients ayant un infarctus du myocarde.
Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde devant le cancer, les maladies respiratoires chroniques ou encore le diabète. C’est la première cause de mortalité chez la femme, avec près de 73 000 décès par an en France.
Au total, les maladies cardiovasculaires sont responsables d’environ 140 000 morts par an en France et près de 2 millions de décès par an en Europe.
L’IRM pour évaluer la fonction et l’anatomie du cœur
L’IRM (imagerie par résonance magnétique) cardiaque est un outil indispensable dans la prise en charge des patients souffrant de maladies cardiovasculaires. En effet, cet examen permet une évaluation complète de la fonction et de l’anatomie du cœur battant.

Chaque mardi, le plein d’infos santé : nutrition, bien-être, nouveaux traitements… Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui.
Cette technique d’imagerie médicale permet d’obtenir des images de haute qualité du cœur de manière non invasive et sans recourir à l’utilisation de radiation (contrairement au scanner, par exemple).
Cependant, les systèmes d’IRM cardiaque actuels sont lents, complexes et nécessitent une expertise spécialisée, tant pour l’acquisition que pour leur analyse, ce qui limite leur adoption à grande échelle.
Pourquoi l’IRM cardiaque est-elle si complexe ?
Si l’on vous a informé que vous deviez subir un examen d’IRM cardiaque, vous êtes probablement curieux de connaître le temps d’attente prévu. Vous avez peut-être entendu dire que la période d’attente pour un examen d’IRM cardiaque peut être assez longue, de quatre à six mois. Une brève visite dans n’importe quel service de radiologie peut vous éclairer sur les raisons de cette attente apparemment prolongée.
En effet, la réalisation des examens d’IRM cardiaque est complexe et nécessite des spécialistes hautement qualifiés pour collecter et analyser les données, ainsi qu’une coopération totale des patients.
Les patients qui effectuent cet examen passent souvent 40 à 60 minutes à l’intérieur d’une machine bruyante et imposante. Il est nécessaire de retenir son souffle tout au long de l’examen afin d’obtenir des images claires, sans artefacts liés à la respiration.
Du côté médical, des manipulateurs radio hautement qualifiés planifient et exécutent méticuleusement la collecte de presque 1 000 images par examen. Ces images varient en termes de contraste et de résolution. La planification de leur acquisition implique de prendre soigneusement en compte le confort du patient, son rythme cardiaque et sa respiration.
Enfin, l’analyse de ces images est également très chronophage et représente un enjeu majeur. Une fois les images recueillies, les radiologues doivent en extraire les éléments diagnostiques. Pour ce faire, ils consacrent un temps considérable par patient à annoter manuellement les images pour localiser précisément le cœur et les tissus lésés afin d’identifier d’éventuelles pathologies. Très peu d’outils sont disponibles pour automatiser ces tâches, ce qui limite leur efficacité et augmente la charge de travail des spécialistes.
Une technique précieuse pour l’analyse des cicatrices d’infarctus
La force de l’IRM cardiaque réside, entre autres, dans sa capacité unique à visualiser les lésions du cœur. Ces lésions ou tissus endommagés dans le muscle cardiaque sont appelées cicatrices. Ces cicatrices se forment lorsque les cellules du muscle cardiaque ont été trop longtemps privées de sang riche en oxygène, c’est le cas à la suite d’un infarctus par exemple.
La présence, la taille et la localisation de la cicatrice sur le muscle cardiaque sont des indicateurs clés pour diagnostiquer les maladies cardiaques structurelles. L’analyse des caractéristiques de la cicatrice est primordiale pour le pronostic du patient et pour déterminer la thérapie à suivre.
La recherche a aussi montré que l’étendue et l’hétérogénéité de la cicatrice sur les images d’IRM peuvent prédire efficacement les arythmies cardiaques (des troubles sévères du rythme cardiaque dans lesquels une partie du cœur, les ventricules ou les oreillettes, n’arrivent plus à se contracter correctement, ndlr), ce qui pourrait améliorer la prévention de la mort cardiaque subite, notamment avec l’usage de défibrillateurs implantables. Enfin, visualiser cette cicatrice avec précision pourra aussi permettre de guider des traitements curatifs appliqués par cathéters.
Malgré ces applications prometteuses aux implications cliniques directes, cette technologie se heurte à un problème de contraste, rendant parfois difficile la visualisation des cicatrices d’infarctus. En effet, le contraste à l’interface sang-cicatrice est sous-optimal, car les signaux du sang et de la cicatrice présentent des intensités lumineuses similaires.
Les cicatrices situées à cette interface sont plus difficiles à identifier et peuvent, dans certains cas, être manquées par les radiologues. Cette limitation réduit également la sensibilité aux petites cicatrices et compromet la robustesse des outils automatiques existants pour leur quantification.
À terme, transformer le diagnostic avec une précision colorée
En manipulant intelligemment la physique IRM pour ne capturer que le signal des tissus cardiaques anormaux, il est maintenant possible de faire toute la différence. Lorsque cette technique est combinée à une imagerie par IRM conventionnelle, le résultat est bluffant : les cicatrices d’infarctus s’allument dans l’image !
En réponse à ces défis associés aux images IRM cardiaques conventionnelles à sang clair, nous avons introduit l’imagerie cardiaque IRM en couleurs.
Cette technique innovante s’est avérée efficace chez les patients pour révéler les motifs cicatriciels qui pourraient autrement être masqués par le signal sanguin, ce qui offre une solution potentielle aux limites observées dans les méthodes d’imagerie traditionnelles.
Demain, automatiser la caractérisation des cicatrices grâce à l’IA
L’un des aspects les plus remarquables de l’imagerie cardiaque améliorée en couleurs est la visualisation aisée et, par conséquent, la segmentation des cicatrices. Nous pensons que cette technique est particulièrement adaptée à la cartographie et à la quantification automatisées des cicatrices myocardiques grâce à l’intelligence artificielle.
En effet, avec l’annulation complète des signaux du sang et du myocarde sain et avec un signal cicatriciel principalement lumineux sur les images, une segmentation et une quantification robustes deviennent possibles.
Cela permettrait une localisation précise des cicatrices, une mesure fiable de leur épaisseur et une modélisation 3D automatisée du cœur entier. Cette avancée devrait transformer la caractérisation des cicatrices myocardiques en un processus intelligence, simple et précis.
Le projet de plateforme multimodale d’exploration en cardiologie (projet Equipex music) est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.![]()
Thaïs Génisson was supported by funding from the French National Research Agency under grant agreements Equipex MUSIC ANR-11-EQPX-0030, Programme d’Investissements d’Avenir ANR-10-IAHU04-LIRYC, ANR-22-CPJ2-0009-01, and from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme (Grant agreement No. 101076351).
Bustin Aurelien was supported by funding from the French National Research Agency under grant agreements Equipex MUSIC ANR-11-EQPX-0030, Programme d’Investissements d’Avenir ANR-10-IAHU04-LIRYC, ANR-22-CPJ2-0009-01, and from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme (Grant agreement No. 101076351).









![[PEOPLE] Patrick Sébastien, un chanteur trop « vieux », trop « blanc », trop gaulois…](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/whatsapp-image-2025-05-13-a-113204-59bd9dfc-616x346.jpg?#)







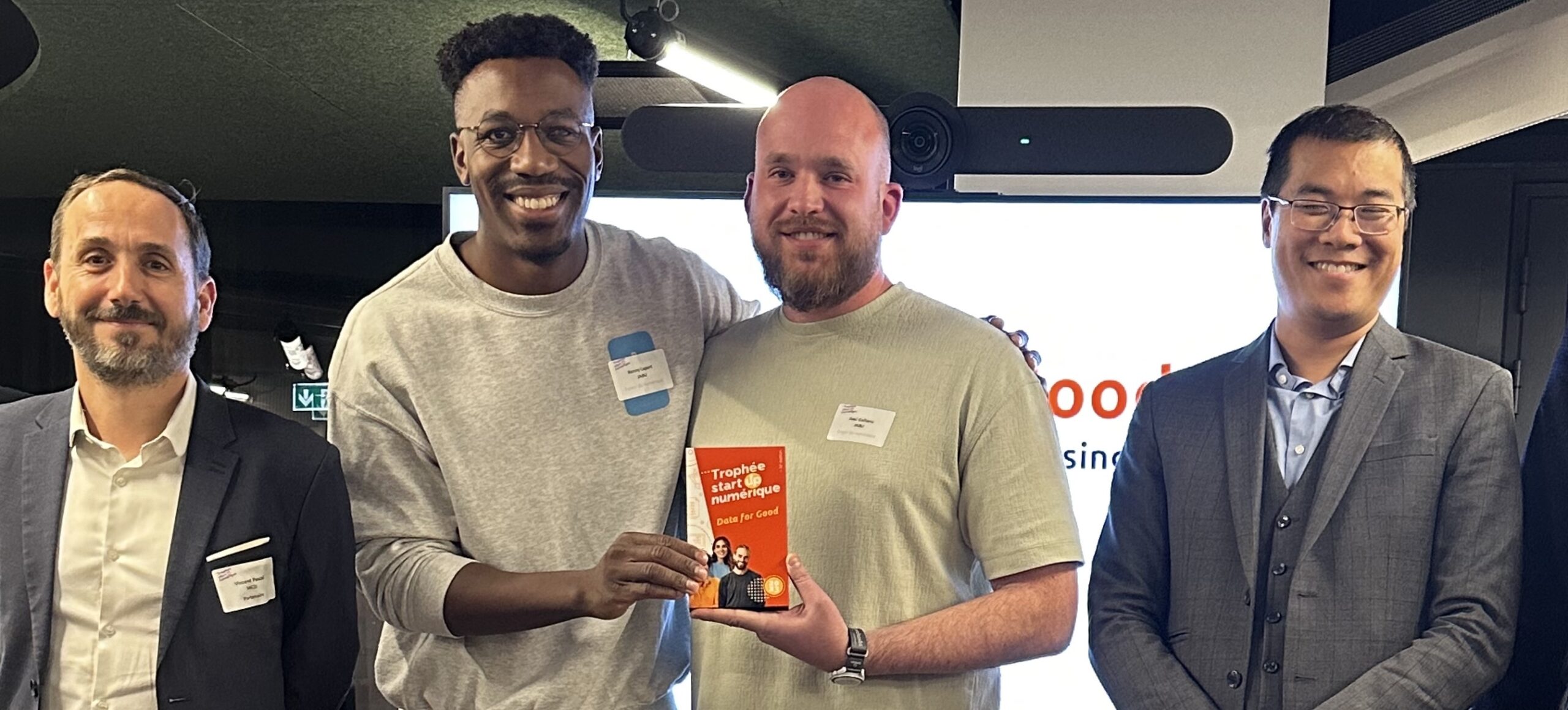














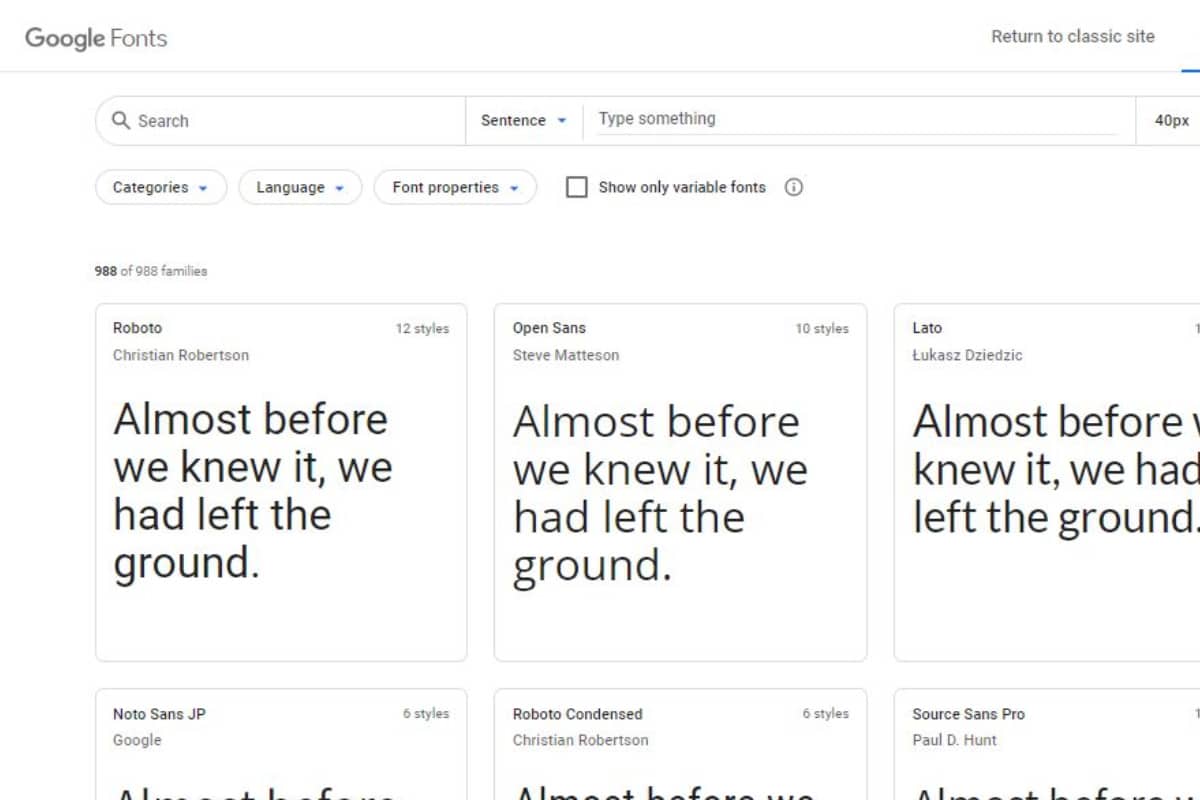







/2025/05/12/laurent-lafitte-682264ed2cc93652161562.jpg?#)
/2025/05/13/000-43u24vp-6822f813ef081947044577.jpg?#)

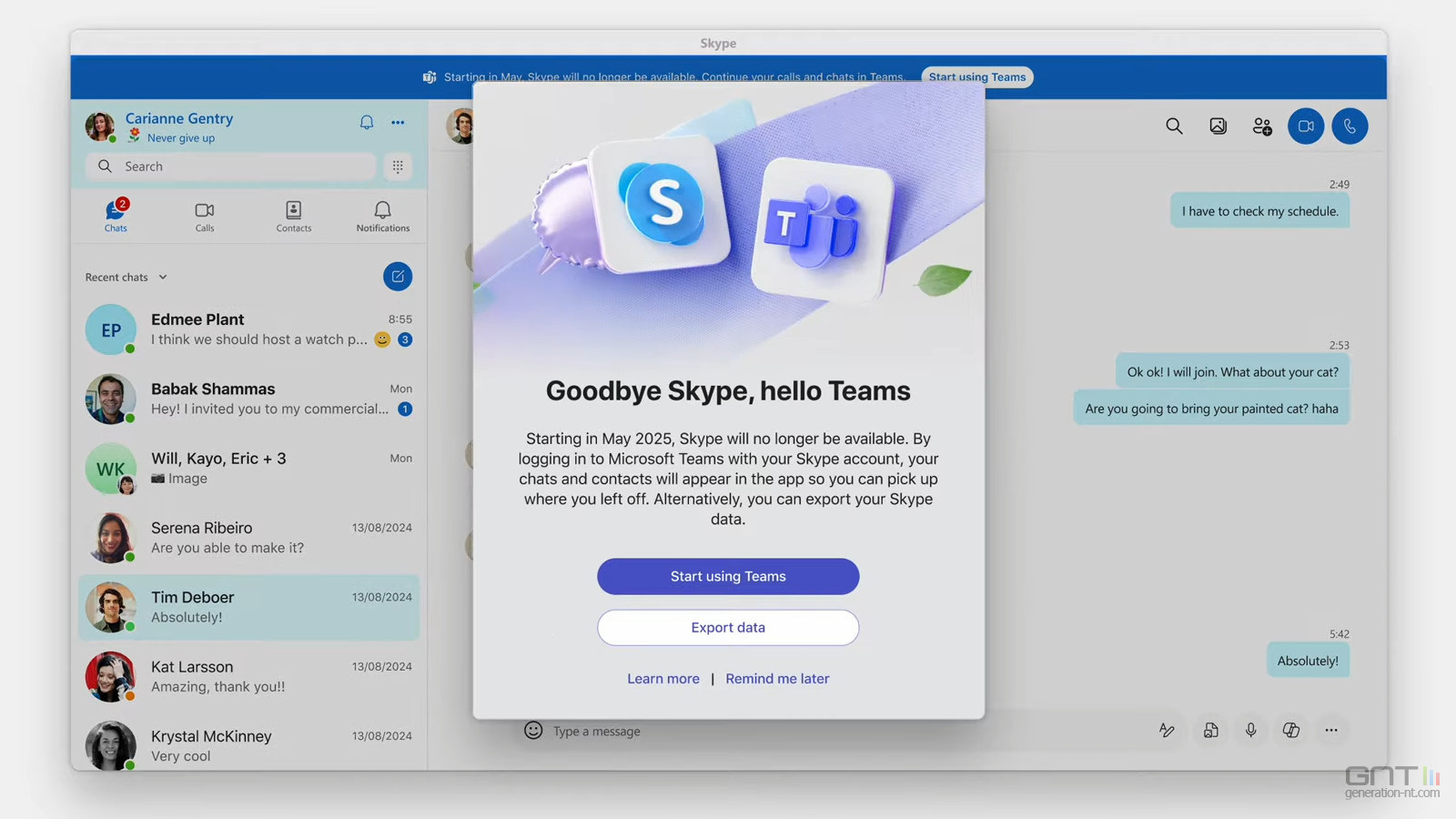





/2025/05/13/maxnewsspecialtwo182384-6822d40520d0f196828666.jpg?#)