Les femmes vivent plus longtemps mais en moins bonne santé : un projet de recherche tente de comprendre ce paradoxe
Un projet de recherche tente d’expliquer le paradoxe mortalité-morbidité en mettant en perspective des populations présentant des organisations sociales différentes mais partageant un environnement écologique et économique similaire.

Un projet de recherche tente d’expliquer le paradoxe mortalité-morbidité en mettant en perspective des populations présentant des organisations sociales différentes mais partageant un environnement écologique et économique similaire.
Il est mondialement reconnu que les hommes et les femmes présentent des disparités de santé. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes de 4,85 ans en moyenne. En France, les données de l’Insee estiment que les femmes vivent 6 ans de plus que les hommes, contre 5,5 ans dans l’Union européenne. Inversement, des études suggèrent que les femmes ont globalement une moins bonne santé que les hommes sur toute la vie.
Sachant que la mortalité équivaut au nombre de décès rapporté à la population totale moyenne d’une année et que la morbidité correspond au nombre des malades dans un groupe donné et pendant un temps déterminé, le paradoxe mortalité-morbidité s’illustre par le degré plus élevé de perte fonctionnelle et de difficultés à effectuer des tâches observées chez les femmes âgées.
Alors que les hommes sont plus à risque pour les maladies cardiovasculaires, les femmes ont une incidence plus élevée de maladies inflammatoires ainsi que pour les dépressions. Ce raisonnement ne s’applique pas à l’individu – imaginairement isolé et maître de sa destinée – mais se déploie à l’échelle des populations humaines. Ces variations ont à voir avec l’organisation, le fonctionnement et le rapport au monde entretenus par différentes sociétés. Les pratiques sociales et des facteurs socioculturels joueraient ainsi un rôle sur l’état de la santé différentiel des hommes et des femmes.
Des organisations sociales différentes à comparer
D’où la volonté d’initier une recherche susceptible d’apporter de nouvelles précisions concernant ce paradoxe mortalité/morbidité en mettant en perspective des populations présentant des organisations sociales différentes mais partageant un environnement écologique et économique similaire. L’une des principales composantes de l’organisation sociale choisie comme base de référence est la règle de descendance associée à une règle de résidence, qui affilie les enfants à des groupes de parenté.
Il existe au sein des communautés humaines trois formes principales d’organisation sociale ayant chacune une règle de descendance associée à une règle de résidence particulière. La règle de résidence indique le lieu où les couples mariés s’installent. Elle peut être néolocale (dans un lieu différent des villages natals des conjoints), patrilocale (l’épouse va vivre avec son mari après mariage) ou matrilocale (le mari va vivre avec son épouse).
Trois formes de descendance sont envisageables. Elle peut être en premier lieu cognatique ou indifférenciée : le mode de descendance ou de filiation passe aussi bien et indifféremment par les hommes que par les femmes. Les sociétés occidentales contemporaines adoptent ce type de descendance cognatique, où tout enfant est issu d’un système de lignée familiale dans lequel les parents du côté maternel et du côté paternel sont tout aussi importants pour les liens affectifs que pour le transfert du nom, de la propriété ou de richesse.
Il existe des groupements humains dont l’organisation sociale se distingue de ce que nous connaissons actuellement en France, avec des sociétés patrilinéaires et matrilinéaires dont les enfants sont respectivement affiliés à la famille paternelle et maternelle, au groupe de parenté du père uniquement ou au groupe de parenté de la mère uniquement. Des sociétés africaines, amazoniennes ou asiatiques présentent ainsi une organisation patrilinéaire caractérisée par de règles de filiation s’effectuant uniquement de père en fils. Le nom de famille ainsi que les biens se transmettent préférentiellement d’une génération d’homme à une autre, tandis que les femmes sont l’objet d’échange entre deux groupes d’hommes non apparentés. Inversement les femmes dans les sociétés matrilinéaires occupent une position originale puisque c’est par elles que le nom, la filiation et la transmission des biens s’effectuent. Les sociétés matrilinéaires sont de moins en moins fréquentes de par le monde, mais se retrouvent encore chez certaines populations autochtones du nord-est Cambodgien. D’où l’intérêt d’une étude en épigénétique comparative entre deux pays limitrophes comme le Cambodge et le Laos prenant en considération des sociétés matrilinéaires et patrilinéaires dans leur milieu social de vie.
Lancement d’une recherche en Asie du Sud-Est
Le programme EpiGender « influence des normes de genre sur les marqueurs épigénétiques de santé » est une des toutes premières recherches à évaluer par enquête interdisciplinaire l’influence d’une pratique sociale (règle de filiation associée à des règles de résidence) sur la santé des femmes et des hommes en utilisant des marqueurs épigénétiques de santé. L’objectif vise à mettre en lumière les facteurs socioculturels qui influencent la santé humaine suivant le sexe en reliant trois domaines d’investigation scientifiques : les perspectives anthropologiques sur les normes de genre, la science du stress et l’épigénétique sociale. En tant qu’anthropologue, mes enquêtes portent sur la dimension socioculturelle relative aux normes de genre, en collaboration avec des partenaires Sud des universités de santé publique du Cambodge et du Laos.
De l’épigénétique à l’anthropologie
Le patrimoine génétique se compose de 46 chromosomes hérités des deux parents. Il compte environ 20 000 gènes ne représentant qu’une petite partie de ce génome. Des recherches récentes démontrent que le génome est un système dynamique et interactif. La régulation de l’expression des gènes est réversible. Cette découverte révolutionnaire s’appelle l’épigénétique. Si la génétique correspond à l’étude des gènes, l’épigénétique s’intéresse à une « couche » de données complémentaires informant comment les gènes vont être utilisés, exprimés ou non par une cellule. Les changements dans l’activité des gènes sont en partie liés à ces modifications (marques) épigénétiques n’impliquant pas de changement dans la séquence d’ADN, mais ils peuvent être transmis lors de divisions cellulaires. Ces variations peuvent être transitoires ou pérennes si elles persistent lorsque le signal qui les a induites disparaît.
À lire aussi : Épigénétique, inactivation du chromosome X et santé des femmes : conversation avec Edith Heard
Les modifications épigénétiques seraient alors générées par le milieu de vie : les cellules reçoivent constamment toutes sortes de signaux sur leur environnement, de manière à ce qu’elles se spécialisent au cours du développement (cellules de la peau, du cœur…) à moins qu’elles ajustent leur activité à une situation donnée. Les comportements tout comme les pensées et les émotions figurent également parmi ces signaux pouvant conduire à des modifications dans l’expression des gènes. De telles attitudes ne s’examinent pas uniquement par le prisme individuel mais par des configurations sociétales et culturelles mouvantes et évolutives, étant donné que toute manifestation de vie partagée relève de conventions, de normes régissant la vie collective – elles-mêmes soumises à questionnement par des sujets disposant d’une marge de manœuvre.
En moins de dix ans, l’épigénétique a bouleversé certaines convictions de la biologie : l’interaction avec l’environnement, les aliments consommés, les comportements et croyances adoptés, les relations affectives et sociales tissées sont autant de facteurs qui modulent, réveillent ou bloquent l’activité des gènes. Cela dit, la part exacte du phénotype liée respectivement à la séquence d’ADN, aux marques épigénétiques et à l’environnement est encore à l’étude et va constituer une des tâches de travail de l’anthropologue généticienne du CNRS porteuse du projet EpiGender, Raphaëlle Chaix.
Dynamiques sociales et morbidité
La variabilité de l’organisation sociale constituerait un indicateur pertinent permettant de rendre compte des normes de genre. Pour estimer l’effet de ces dernières sur les inégalités en matière de santé, des données qualitatives et quantitatives illustrant cette variabilité sont nécessaires. On avance l’hypothèse que le statut des femmes peut être impacté négativement lorsque le système de résidence est patrilocal et la filiation patrilinéaire, vu que les femmes y exercent un moindre contrôle sur les ressources, sont davantage absentes de la sphère politique décisionnelle, acquièrent un investissement parental plus faible et bénéficient d’un soutien familial moins important que dans les systèmes matrilinéaires car elles doivent quitter leur village natal lors du mariage si le mari réside ailleurs. Le propos consiste alors à vérifier, moyennant des enquêtes socio-anthropologiques, si les normes de genre affectant les femmes sont plus dépendantes des organisations sociales que les normes de genre affectant les hommes.
Le travail de terrain
EpiGender s’appuie sur l’échantillonnage d’un précédent programme ANR SoGen (2009-2015) ayant permis la collecte de données ethno-démographiques et salivaires auprès de douze populations autochtones du Cambodge et du Laos partageant des cadres de vie et des modes de production similaires, parlant des langues austro-asiatiques apparentées mais présentant des organisations sociales hétéroclites. EpiGender combine cet ensemble unique de données ethno-démographiques et des données génétiques/épigénétiques déjà obtenues, avec de nouvelles données complémentaires sur les normes de genre et le niveau individuel de stress psychosocial afin de vérifier si les femmes des populations patrilinéaires et patrilocales ont des profils épigénétiques prédictifs d’un risque accru de morbidité/mortalité par rapport aux femmes des populations matrilocales et/ou matrilinéaires, à cause des normes de genre moins favorables auxquelles elles sont exposées.
Une quarantaine de foyers domestiques non directement apparentés, répartis en une dizaine de villages pour chaque profil de descendance (cognatique, matrilinéaire, patrilinéaire), vont être interviewés afin de vérifier si les normes de genre « en faveur » des hommes associées aux organisations patrilinéaires/patrilocales conduisent à des formes associées à un risque plus élevé de morbidité/mortalité chez les femmes. On en est actuellement au stade de la collecte des informations au Laos et au Cambodge. Les résultats ne seront pas disponibles avant la fin de l’année 2026.![]()
Le projet Epigender est financé par l’ANR (2022-2026) et rassemble une équipe CNRS UMR7206, une équipe IRD UMR DEVSOC et une équipe du MNHN.






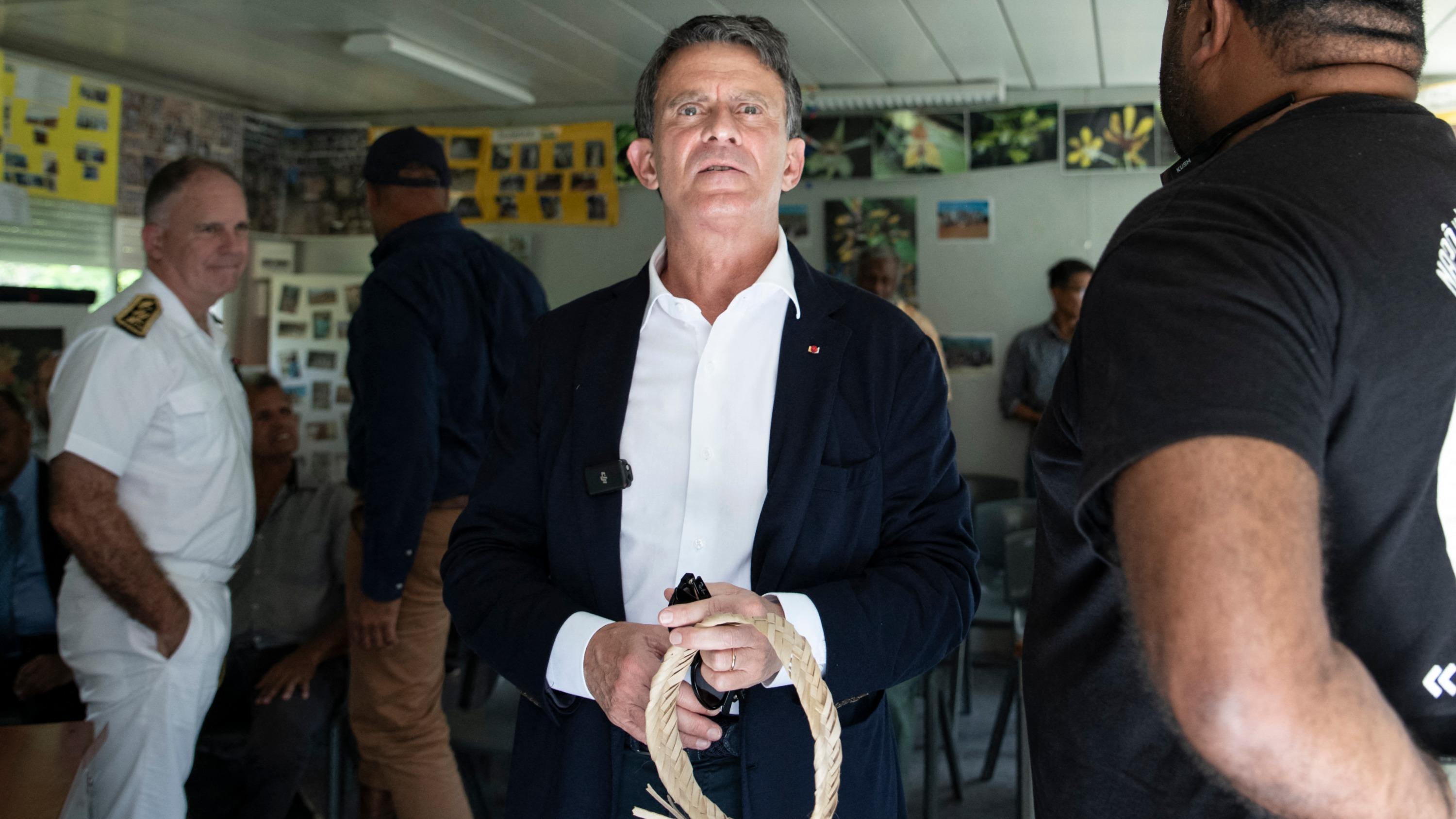















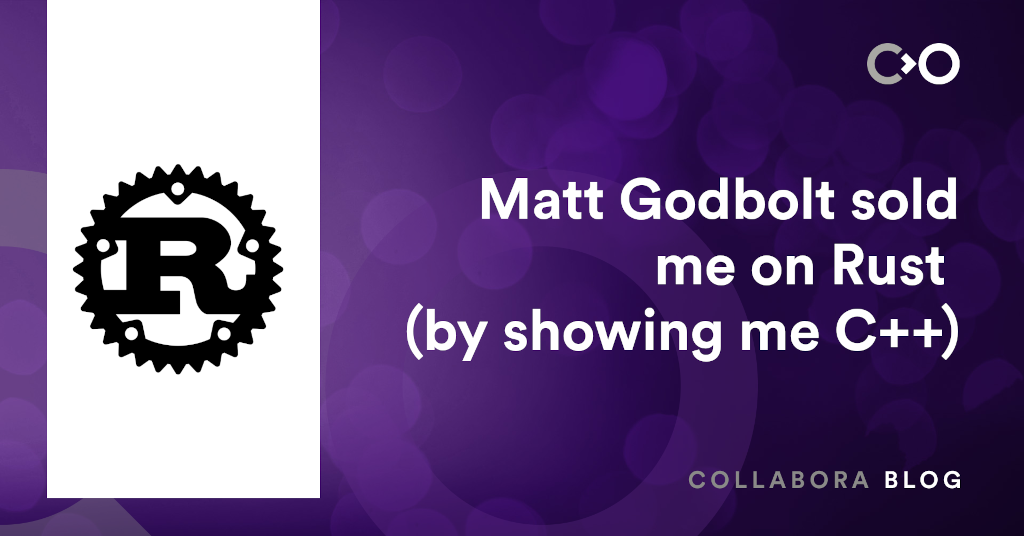















/2025/05/06/v2-florence-seyvos-c-patrice-normand-681a20670109b637542013.jpg?#)
/2025/05/06/000-43v36kd-681a24e5ac974754142745.jpg?#)
/2025/05/06/000-32c4366-681a35f513a42795994441.jpg?#)











/2025/05/04/etats-unis-des-chercheurs-sous-pression-est-menaces-6817c2eb45876085234095.jpg?#)
















/2025/04/25/capture-d-ecran-2025-04-25-105854-680b4edbac4e3157238485.png?#)
