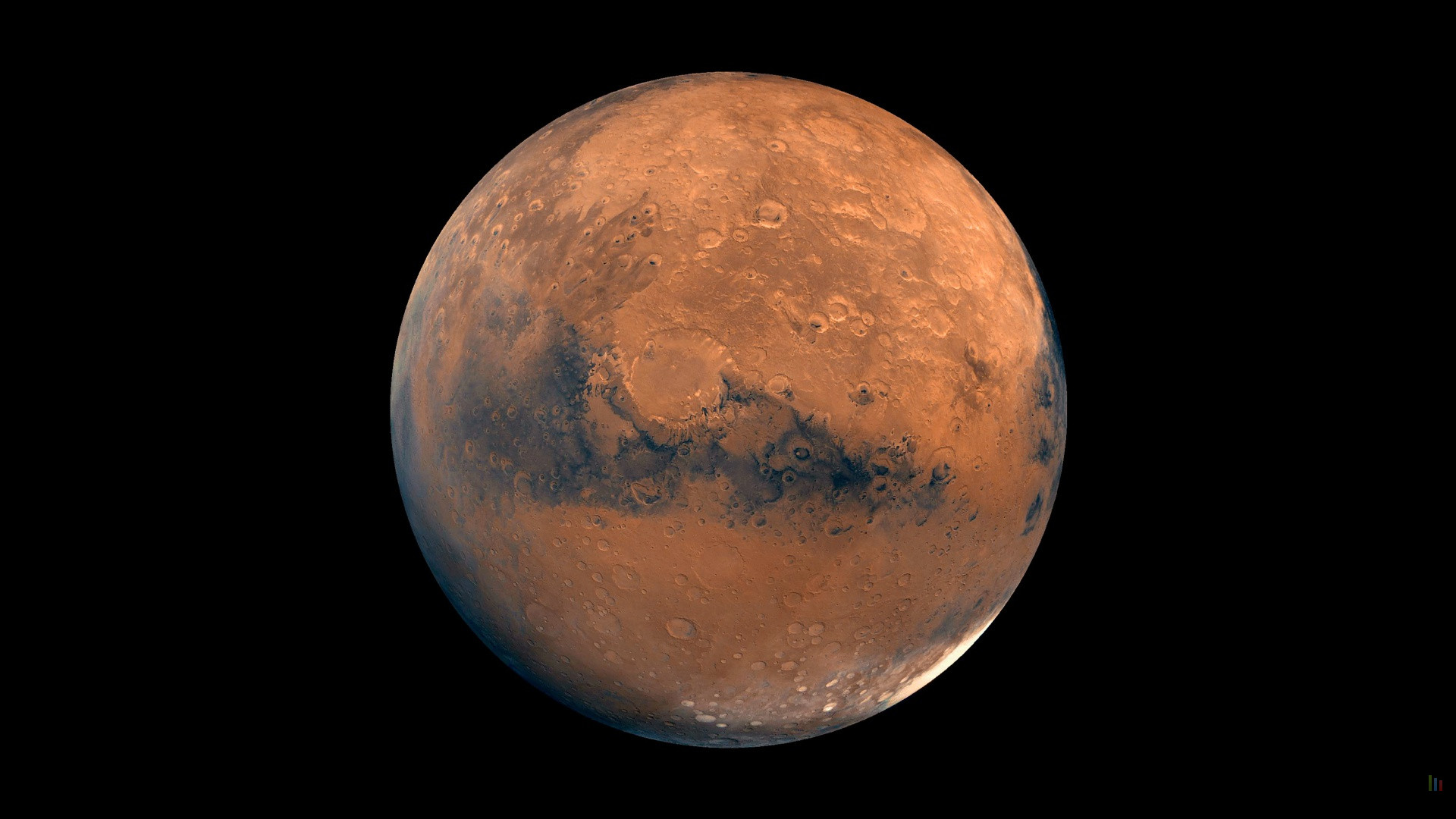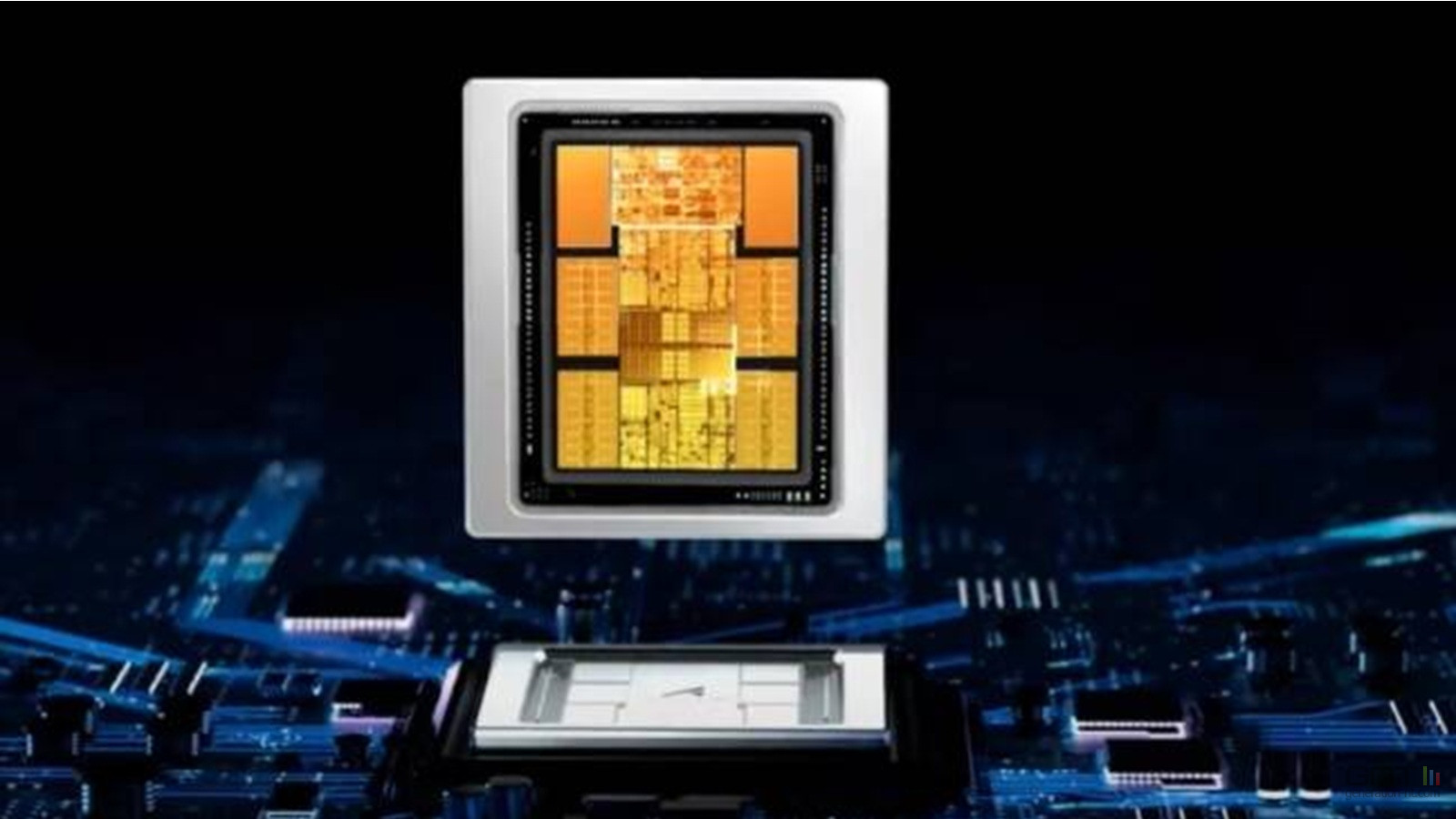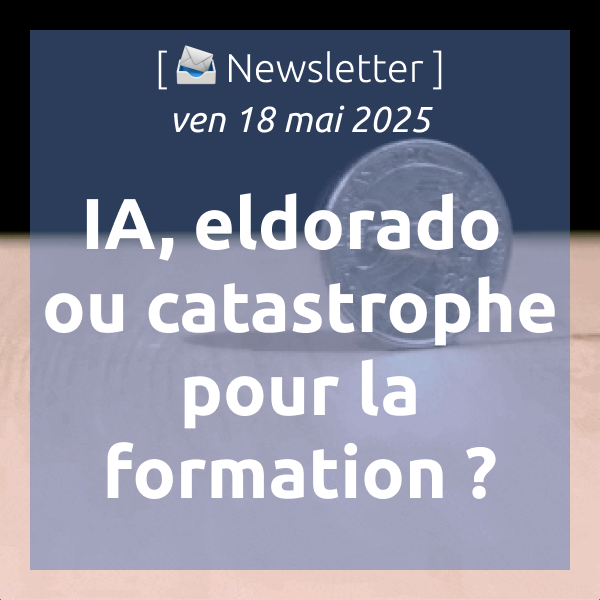« Très souvent, ce qui a été pensé pour les plus vulnérables finit par être utilisé de manière universelle »
Dans une société qui fait la part belle à la compétition, quelle place pour les personnes vulnérables ? Entretien avec la philosophe Cynthia Fleury qui plaide pour une « société du care ».


Dans un monde qui fait la part belle à la performance et à la concurrence, les personnes les plus fragiles sont-elles prises en compte ? Si l’on n’a jamais autant parlé d’inclusion, si la pandémie de Covid-19 nous a collectivement placés face à nos fragilités, la vulnérabilité reste stigmatisée.
Or, c’est en considérant ce que traversent les personnes malades et précaires que l’on peut élaborer des politiques de prévention qui bénéficient à tous, explique la philosophe Cynthia Fleury, professeur titulaire de la chaire Humanités et Santé du Conservatoire national des arts et métiers et titulaire de la Chaire de philosophie à l’hôpital (GHU Paris Psychiatrie et neurosciences). Autrice de la Clinique de la dignité et du Soin est un humanisme, elle plaide pour une « société du care ». Entretien.
The Conversation : Dans nos sociétés compétitives, quelle place pour les personnes vulnérables ? Et où la vulnérabilité commence-t-elle ?
Cynthia Fleury : La vulnérabilité se définit essentiellement selon deux approches. La première, ontologique, la considère comme la condition sine qua non de l’homme en tant qu’être qui naît, meurt, est touché par la maladie. Purement biologique, cette approche manque la complexité du fonctionnement humain et de son développement qui nécessitent, pour être compris, de s’inscrire dans des modèles biopsychosociaux.
C’est par exemple le sens de la thèse de la néoténie et de l’altricialité secondaire – popularisée par les travaux du biologiste Adolf Portmann et, plus récemment, par le sociologue Bernard Lahire – qui pose que nous sommes physiologiquement tous des prématurés : autrement dit, sans le soutien (présent et à venir) des autres, l’individu ne peut survivre.
C’est aussi ce que veut dire le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott avec son étonnante formule, « Un bébé, ça n’existe pas ». Pour qu’un être humain se développe, il faut que se mette en place autour de lui une structure de « care » et de soins prolongés, bien au-delà de sa naissance. Sauf à être transhumaniste – et à considérer donc que nous n’aurions pas de limites substantielles et d’interdépendances –, la vulnérabilité est la réalité initiale à laquelle nous sommes tous confrontés.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
La deuxième approche de la vulnérabilité est sociologique : elle se définit comme la propension des individus à subir des impacts négatifs dus à des facteurs économiques, sociaux, culturels, institutionnels.
En sociologie, la vulnérabilité est à envisager comme une interaction complexe entre ces différents facteurs structurels. D’où le fait que, pour produire un diagnostic et une thérapeutique (c’est-à-dire une politique de correction des inégalités dues aux vulnérabilités), rigoureux l’un comme l’autre, il est déterminant d’avoir une approche dite « intégrée » mêlant l’analyse des facteurs structurels et la question des trajectoires plus personnelles. C’est une affaire dynamique, psychodynamique, collective.
La société est plus ou moins une fabrique de « vulnérabilisation », selon ce qu’elle permet légalement, systématise, etc. Dès lors, nos choix collectifs, consciemment ou inconsciemment, endiguent, régulent ou renforcent ces vulnérabilités.
T. C. : On parle de plus en plus d’inclusion, les derniers Jeux paralympiques ont bénéficié de plus de visibilité dans les médias… La vulnérabilité est-elle socialement plus acceptée ?
C. F. : Comme je l’avais noté dans la Clinique de la dignité, jamais il n’y a eu dans nos sociétés occidentales un discours aussi consensuel de reconnaissance de la vulnérabilité, jamais on n’a tant donné à la vulnérabilité la possibilité de se raconter, non seulement dans les espaces privés, mais aussi dans l’espace public.
Prenons l’exemple récent du journaliste Nicolas Demorand, présentateur de la matinale de France Inter, déclarant : « Je suis un malade mental. » Cette prise de parole ne relève pas tant de la « Mad Pride » que d’un refus de continuer à vivre cette ultravulnérabilité comme une honte. À un moment donné, il prend le risque de franchir le Rubicon de la possible stigmatisation pour produire un plaidoyer à partir de son expérience. Il y a vingt ans, il n’aurait sans doute pas agi ainsi. Il le fait parce qu’il est dans une conscientisation différente de sa situation, mais aussi parce que la société accueille différemment cette « singularité », pour ne pas dire cette « vulnérabilité ».
Malgré ces évolutions, cependant, les stigmatisations persistent. C’est le cas dans la sphère du travail, tous les patients peuvent vous le raconter. Les personnes souffrant de maladies chroniques sont toujours renvoyées à un questionnement sur leur mythomanie possible, sur leur fiabilité. L’ère du soupçon persiste.
T. C. : Cela veut-il dire que la reconnaissance de la vulnérabilité reste de l’ordre du discours ?
C. F. : Non, cela va au-delà du discours, il y a dans nos sociétés occidentales toute une axiologie (ou théorie des valeurs morales), qui intègre la dignité de la vulnérabilité. Celle-ci est envisagée comme un vecteur de connaissance et un levier capacitaire au sens où, c’est au chevet des plus vulnérables que l’on peut vraiment appréhender la complexité des situations et que l’on peut avoir une clinique du réel, au sens lacanien du terme (séminaires XI et XX).
On peut définir la « clinique du réel » comme l’analyse clinique des effets que le réel, dans sa dimension non symbolisée et irréductible, produit dans la structuration du psychisme. L’expression s’est depuis banalisée pour définir toute tentative de diagnostic et de thérapeutique confrontée aux dimensions les plus « effractantes » du réel.
Mais, au-delà de ces discours et de ces représentations de soi nourries de la Déclaration des droits de l’homme, subsistent un « rejet » et une crainte de la vulnérabilité. On reste dans un système social qui est une véritable machine à mettre à mal les vulnérabilités, à les stigmatiser, au mieux à les invisibiliser. En fait, les deux réalités coexistent. Les stéréotypes ont la vie dure, on est face à des situations clivées.
Par ailleurs, nous subissons une vague post #MeeToo, notamment dans les sociétés occidentales, ressentimiste et masculiniste qui stigmatise la vulnérabilité, la dévalorise, considère qu’elle est un danger culturel et social, et qu’elle doit être mise à mort.
T. C. : Des scandales ont levé le voile sur des situations terribles dans les crèches et dans les Ehpad. Les hôpitaux manquent de moyens. Dans quelle mesure la société fabrique-t-elle de la vulnérabilité ?
C. F. : Pour forger une alliance thérapeutique entre soignants et patients, il faut du temps. Plus on est vulnérable, plus on évite les soins. Pour construire un consentement à ces soins, pour que leur efficience ne soit pas mise à mal, il faut donc encore plus d’écoute et d’empathie. Or, le new management, avec sa pression gestionnaire, empêche cela.
Cette restriction des moyens qui pèse sur l’humain ne concerne pas seulement les services hospitaliers, on la retrouve à l’école, dans l’entreprise, dans la magistrature – aussi délirant que cela puisse paraître, elle touche même les soins palliatifs. Les travaux de la psychodynamique autour de la souffrance au travail ont mis au jour cette fabrique de situations indignes, qui empêche des soignants et des personnels de services publics de pouvoir faire leur métier dignement, produit des burn out et génère du mal-être chez les patients et leurs familles…
Il existe une deuxième grande fabrique de vulnérabilités, plus géopolitique, face à ces failles systémiques que sont les zoonoses, les pandémies. Alors qu’on atteint les limites planétaires de la croissance, l’accès aux ressources devient de plus en plus concurrentiel. Le nombre de réfugiés climatiques augmente, les conflits conduisent à des déplacements de populations.
À lire aussi : Zoonose : cinq ans après le début du Covid, comment minimiser les risques d’émergence ?
Ces situations terribles vont de pair avec une instrumentalisation de la notion de résilience : on continue sciemment de produire des vulnérabilités en considérant qu’il restera toujours une solution, le recours à la résilience. Or, il faudrait avant tout se dire : « Arrêtons de produire de telles situations. » La première des résiliences, c’est la culture de la prévention.
T. C. : Qu’est-ce que prendre soin, dans une société du care ? En quoi cela va-t-il au-delà de la prise en charge matérielle, physique ?
C. F. : Le soin passe par le corps, il passe par des ressources, mais ce n’est jamais une simple activité matérielle. Le soin active la fonction symbolique des êtres, il fabrique de l’éducation, il fabrique la potentialité des êtres et la résilience des sociétés.
Il y a quatre grandes approches philosophiques, ce que j’appellerais quatre grands âges du care qui, d’ailleurs, ne s’opposent pas, mais s’entrelacent, se combinent. Dans les années 1950 surgissent les théories de l’attachement, la pédopsychiatrie pose que l’absence de soin crée des troubles du développement. C’est la première définition du soin évoquée plus haut et toujours valable aujourd’hui.
Puis il y a eu des approches plus éthiques et politiques du care, centrée sur l’activité de soin, s’interrogeant sur les différences pratiques et morales entre les hommes et les femmes. Ces considérations genrées ont été essentielles pour démontrer dans un premier temps la « féminisation » du soin, donc sa dévalorisation, et son invisibilisation, et dans un deuxième temps leur nécessaire dépassement pour définir une activité générique de l’espèce humaine. On pense notamment aux travaux de Joan Tronto qui explique que le soin est tout simplement l’activité prioritaire de l’espèce humaine et qui le définit comme ce qui travaille à maintenir la vie bonne, à « réparer notre monde ».
Aujourd’hui, le « prendre soin » s’ouvre à des approches intégrées de type « One Health », où l’on considère que la santé humaine s’insère dans un tout et qu’à ce titre, elle est en dialogue constant avec la santé des écosystèmes et avec la santé animale. Prendre soin n’est plus seulement une activité interhumaine, mais une activité inter-vivants. L’homme n’est plus une exception ou, si exceptionnalité il y a, c’est dans la conscience aiguë et responsable qu’il a de cette nécessité de créer des liens réciproques et de faire baisser les externalités négatives sur les ressources naturelles.
T. C. : De quelle manière travaillez-vous sur cette notion de care à la Chaire de philosophie à l’hôpital ?
C. F. : Nous défendons une approche capacitaire de la vulnérabilité, autrement dit, en la considérant d’abord comme une « épistémologie », au sens où elle est un vecteur de connaissance et permet d’avoir une vision très fine de la réalité. Ensuite, nous travaillons à faire d’elle un levier capacitaire. Nous avons théorisé cette approche par la notion de « générativité de la vulnérabilité » : personne ne peut nier que la vulnérabilité est prioritairement, hélas, une matrice à créer de l’incapacité ; autrement dit, une vulnérabilité en entraîne une autre, comme en cascade.
Prenons la question de la maladie, ses effets physiologiques peuvent se répercuter sur la sphère du travail, la sphère familiale et amicale, la vie psychique… Les maladies chroniques notamment sont des bombes à retardement. Il n’y a pas une personne qui subisse une maladie chronique sans être, à un moment donné, touchée par une souffrance psychique importante, qu’il s’agisse de troubles anxieux ou dépressifs, de troubles du sommeil, de troubles de l’alimentation…

Cette dynamique déficitaire dangereuse, il importe de mieux la saisir, pour mieux déconstruire ses imbrications… Pour autant, la générativité du vulnérable ne se résume pas à cette seule approche déficitaire qui étudie les dysfonctionnements en chaîne. La vulnérabilité peut aussi être source d’invention. Pour résister à l’hyper-contrainte qu’elle représente, il faut produire ce que le philosophe Georges Canguilhem appelle une norme de vie et c’est ainsi que l’on crée des objets qui n’existaient pas, des dispositions d’être inédites, des usages nouveaux, etc.
En tenant compte de ce potentiel d’innovation, on peut activer une autre théorie de la conception, partant du point de vue des personnes vulnérables. C’est d’ailleurs très intéressant de voir à quel point susciter la part « agente » des patients, et notamment leur capacité de conception, est thérapeutique. À la chaire, nous défendons une « fonction soignante en partage », autrement dit, celle où le soin est une activité créatrice portée par l’ensemble des parties prenantes (soignants, patients, familles, citoyens lambda). Nous appelons cela du « design capacitaire », soit le co-design de protocoles de soin avec les patients, le personnel hospitalier, les familles, les citoyens.
Nous avons travaillé par exemple sur des solutions de « contenance » volontaire (le protocole Cisuco) qui puissent être des alternatives aux dispositifs de contention chimique et mécanique utilisés en psychiatrie contre la volonté des patients.
T. C. : Accepter la vulnérabilité, c’est donc un facteur de progression ?
C. F. : Disons que c’est un facteur d’« intelligence » pour la résilience des systèmes. C’est en allant sur les marges qu’on peut élaborer des politiques de prévention plus efficaces. C’est en prenant en considération entre autres ce que traversent les migrants qu’on viendra au mieux protéger les citoyens. Nous qui pensons être très éloignés de leur situation pourrions très bien connaître ces déplacements forcés face aux bouleversements climatiques.
Très souvent, ce qui a été pensé pour les plus vulnérables finit par être utilisé de manière universelle. La démocratie sanitaire, par exemple, c’est par la clinique du sida qu’elle a été révolutionnée, pas par la clinique des patients lambda.
L’ergonomie montre aussi combien l’inclusivité sert à tous. Imaginons des femmes qui arrivent dans une entreprise où il y a de lourdes charges qu’elles ne peuvent pas porter. On va aménager les postes, produire d’autres outils, éventuellement des exosquelettes. Certains de leurs collègues, qui auront au départ protesté contre la féminisation des métiers, finiront par revenir sur leur position, par reconnaître la fatigue générée et les troubles musculo-squelettiques générés par cette manutention, puis par avoir recours aux dispositifs mis en place.
T. C. : Quel lien entre État social et État de droit ? En quoi la prise en compte de la vulnérabilité est-elle essentielle à la démocratie ?
C. F. : On voit bien que les premières attaques de Donald Trump dès son retour au pouvoir ont visé la santé ou encore l’aide au développement.
Par définition, les régimes autoritaires fascisants – au sens de « late fascism », d’Enzo Traverso – sont des régimes de hiérarchisation des êtres, qui fonctionnent sur l’activation de relations de subordination, d’exploitation du corps d’autrui (« Your body, my choice ») et dévaluent la notion de vulnérabilité, considérant qu’il faut la repérer et l’éradiquer. Et cette vulnérabilité est multiple : il peut s’agir de handicap, de sexualité, de genre, d’âge…
A contrario, il existe une sorte de pacte essentiel entre la vulnérabilité et l’État social de droit qui, chaque fois qu’il élabore une loi, doit produire une loi qui ne renforce pas les vulnérabilités des plus faibles. La normativité dans un État de droit est « critique », « réflexive » envers elle-même, sans cesse relégitimée par de nouvelles « inclusivités » ou encore « prises en considération » de ce qui était, jusqu’alors, exclu et discriminé.
Propos recueillis par Aurélie Djavadi.![]()
Cynthia Fleury-Perkins ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.



![[EXPO] Les fastes du dernier sacre : le « voyage à Reims » de Charles X](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/whatsapp-image-2025-04-15-at-145836-1-616x347.jpeg?#)



















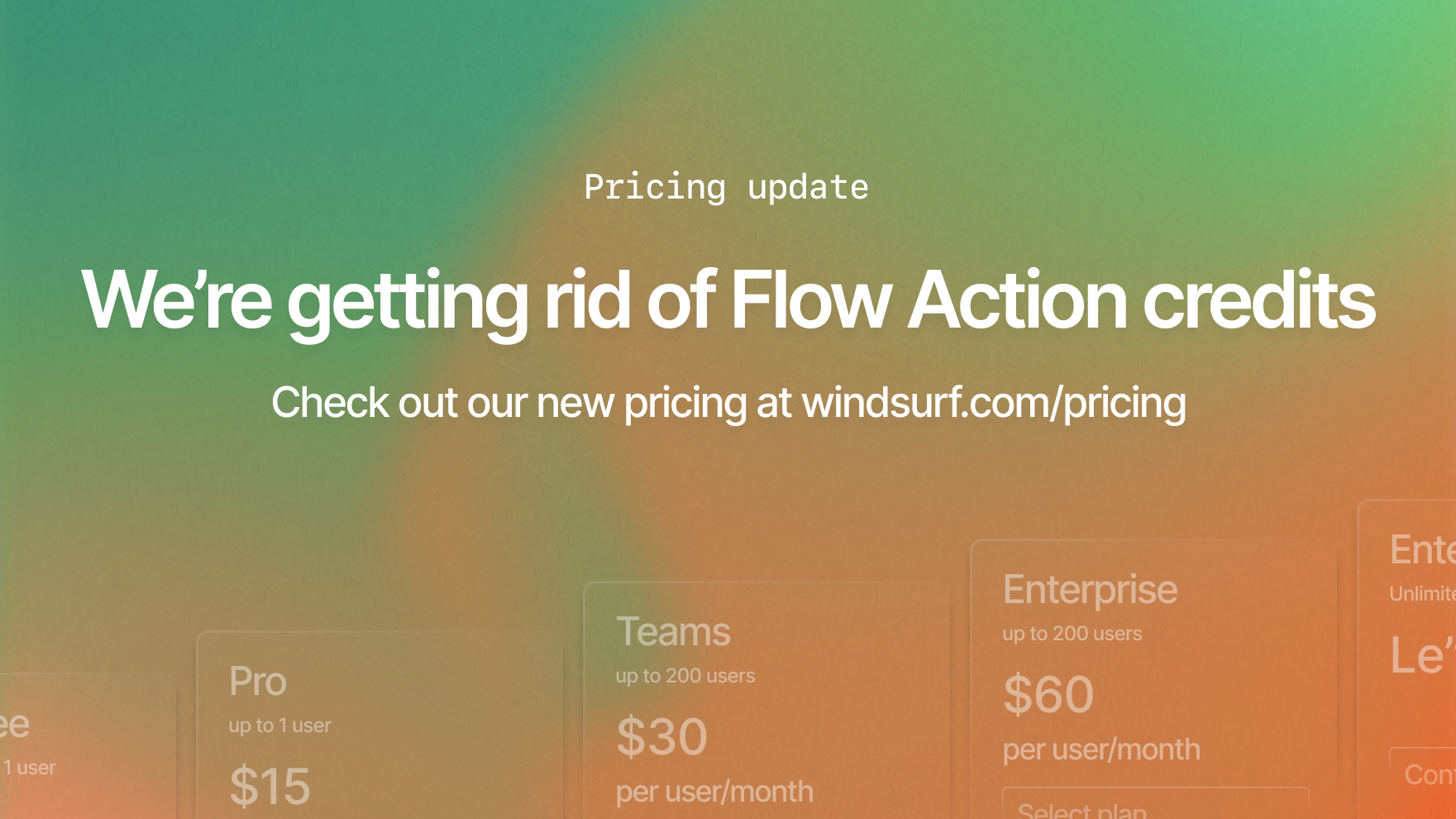












/2025/04/21/cannes2025-68069b5639eeb322746073.png?#)