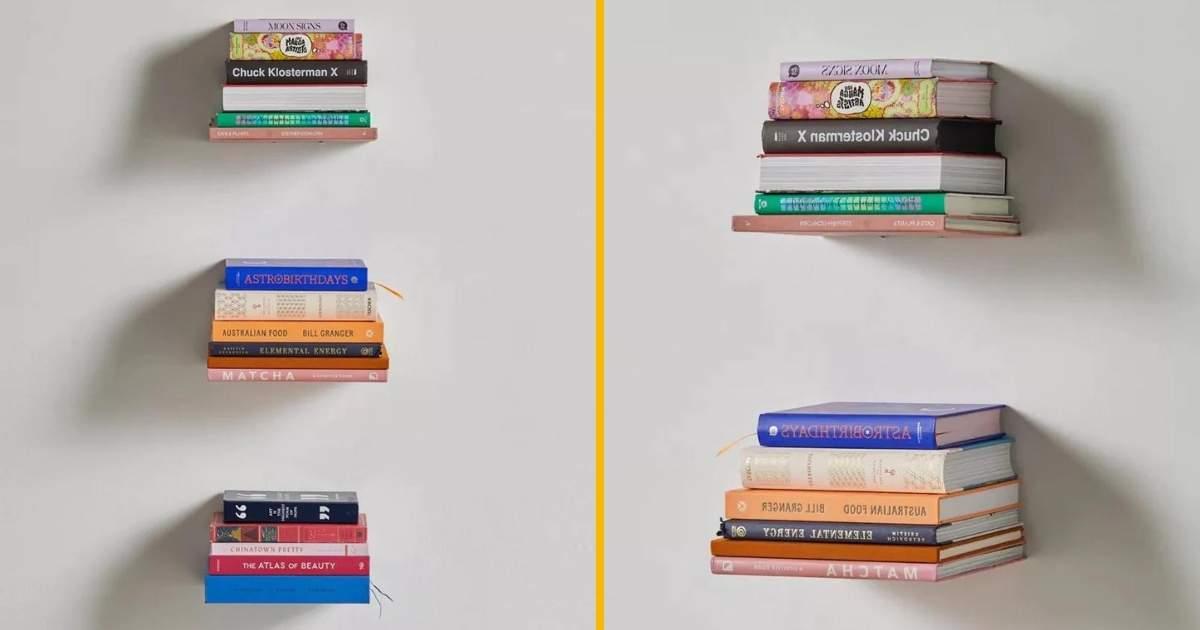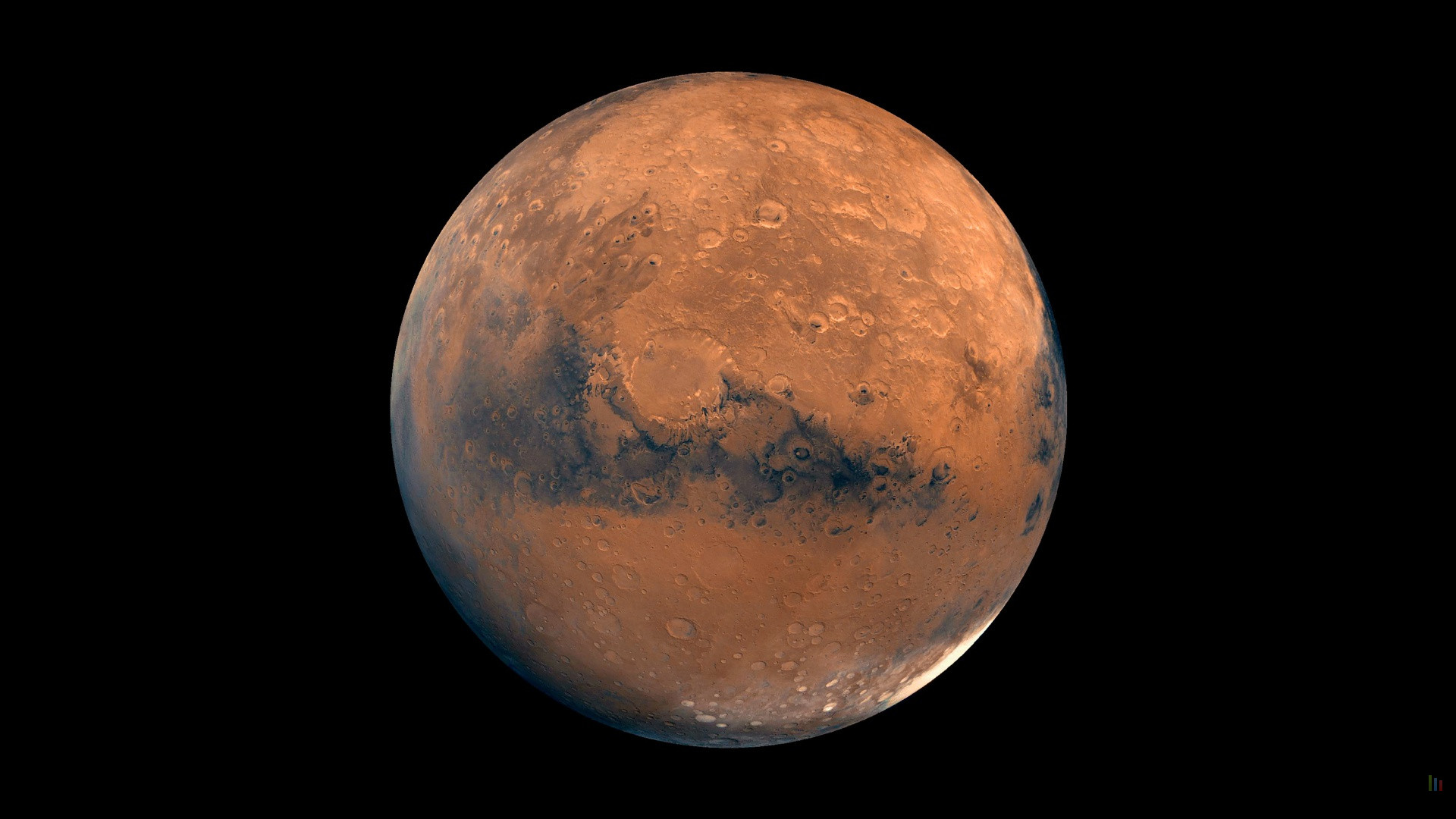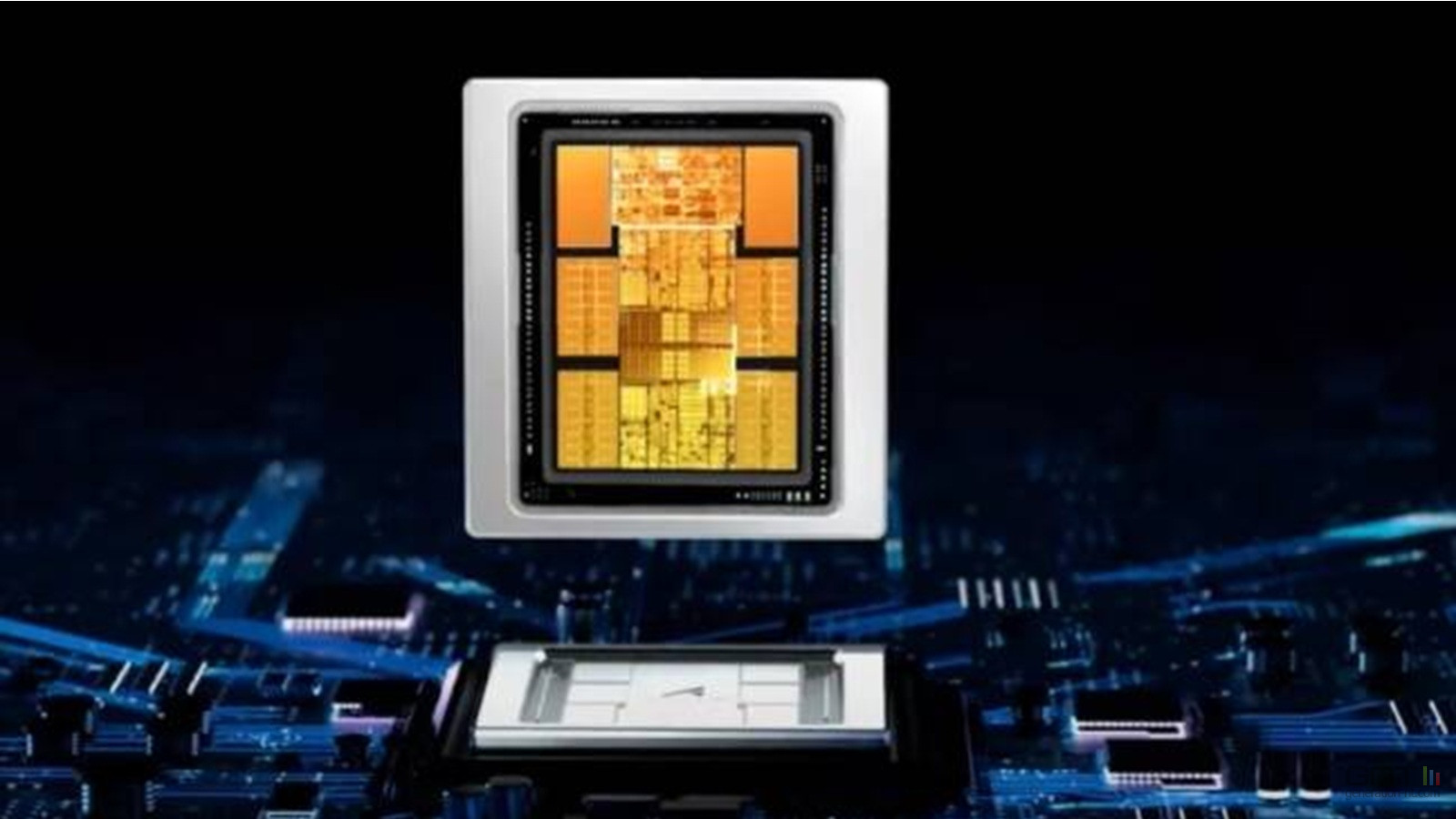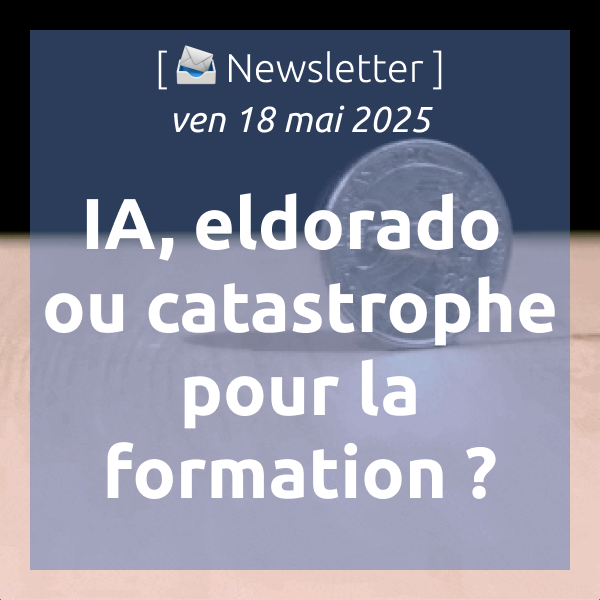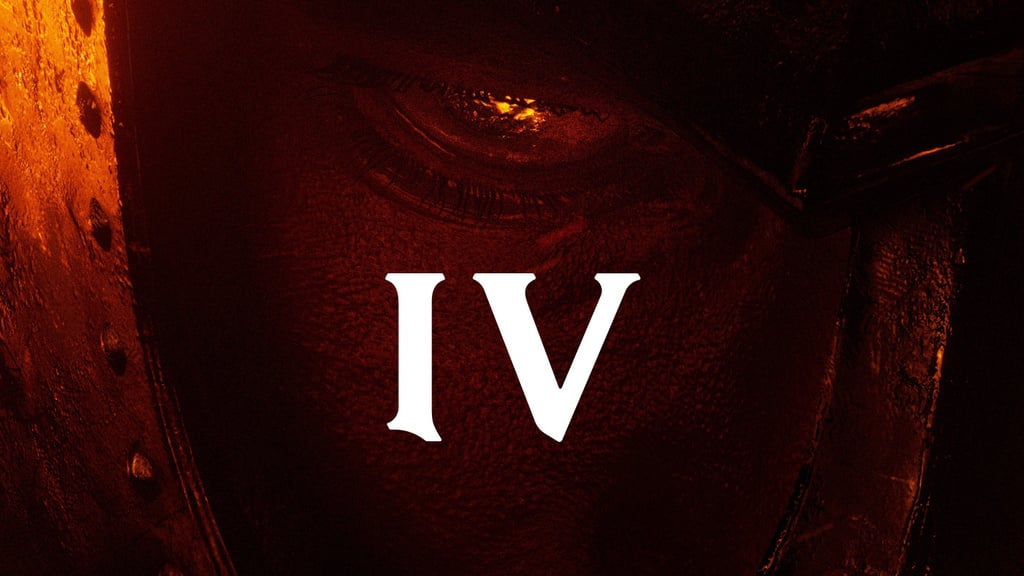François, un pape différent ?
Retour sur les douze ans à la tête de l’Église catholique d’un pape dont les engagements furent plus sociaux que sociétaux.

Premier pape non européen depuis longtemps, François aura lancé des réformes importantes et laissera une marque indéniable dans l’histoire de l’Église catholique. Pour autant, son engagement aura été bien plus social que sociétal : s’il a beaucoup insisté sur la nécessité pour l’Église d’aider les pauvres et, notamment, les migrants, il n’aura pas impulsé de changement notable de la doctrine sur des questions comme l’IVG, l’euthanasie ou encore l’homosexualité.
L’ambiance de fin de règne au Vatican s’achève avec le décès, lors des fêtes de Pâques, du pape François, à 88 ans. Au-delà des interrogations récurrentes liées au fait que les papes sont nommés à vie et que leurs dernières années sont souvent marquées par la maladie – ce fut le cas pour François comme avant lui pour Jean-Paul II, Benoît XVI ayant préféré abdiquer –, quel bilan peut-on dresser des douze années qu’il a passées à la tête de l’Église catholique ?
L’Argentin Jorge Mario Bergoglio, élu en 2013 à 76 ans, après la renonciation de son prédécesseur, avait déjà appartenu à la courte liste des possibles papes lors de la désignation de Benoît XVI en 2005. Après le Polonais Jean-Paul II et l’Allemand Benoît XVI, qui tous deux appartenaient plutôt au courant intransigeant, François présente un autre visage de l’Église. Certains ne furent pas insensibles à cette nouvelle incarnation comme le démontre le film que lui consacre Wim Wenders en 2018, Le Pape François, un homme de parole. Le successeur de Pierre a acquis une indéniable autorité morale fondée sur un réel charisme.
Dans un pouvoir aussi personnalisé, l’image du pape joue un rôle important. Le choix de son nom est déjà un programme. Peu après son élection, le 16 mars 2013, il explique aux journalistes : « J’ai immédiatement pensé au Poverello. J’ai pensé aux guerres, j’ai pensé à François, l’homme de la paix, celui qui aimait et protégeait la nature, l’homme pauvre. »
La paix, la pauvreté et la nature nourrissent l’imaginaire de réception du nouveau pontife en l’associant à François d’Assise. Le XXe siècle adore le fondateur du franciscanisme. Jean-Paul II a fait de lui le saint de l’écologie en 1979 et promu Assise comme lieu de rencontres interreligieuses.
Un pape sud-américain

Enfant d’immigrés italiens en Argentine, né le 17 décembre 1936, Jorge Mario Bergoglio fait des études de chimie avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre en 1969, il fait sa profession solennelle en 1973. Il est nommé Provincial des jésuites d’Argentine, fonction qu’il occupe jusqu’en 1980.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Lors de la dictature militaire (1976-1983), certains témoignent d’actions de sauvetage de persécutés de sa part, mais d’autres lui reprochent son silence alors que l’Église d’Argentine soutient largement le pouvoir et ne condamne pas ses pratiques de torture et d’assassinat. En 2000, Bergoglio reconnaît le rôle de soutien à la dictature de l’Église d’Argentine.
Évêque auxiliaire en 1992 puis archevêque de Buenos Aires en 1998, cardinal en 2001 et président de la Conférence épiscopale argentine de 2005 à 2011, certains traits du personnage percent déjà dans l’exigence d’une existence modeste, à l’exemple de sa décision de ne pas loger à l’archevêché mais dans un petit appartement, du choix de son véhicule, et de sa forte pratique de la confession, qui crée une réelle proximité avec les fidèles.
Devenu pape, François ne mobilise pas les ors et dorures du pouvoir papal dès sa première apparition au balcon de la place Saint-Pierre. Il choisit de loger dans la résidence Sainte-Marthe plutôt que dans les appartements papaux, illustration d’une humilité qui est un des traits de son magistère, couplée à une proximité avec les fidèles qui participe d’un indéniable charisme.
Ses positionnements l’associent au catholicisme « social », anticommuniste et antilibéral qu’illustre sa condamnation de « l’idole de l’argent », sa promotion de la charité et, en corollaire, de la pauvreté, ainsi que l’importance accordée à la question sociale.
Le fondateur Ignace de Loyola (1491-1556) a défini le jésuite comme un homme de grande culture humaine et théologique dont le but est d’être apôtre. Au XXe siècle, la Compagnie ne se projette plus de l’Europe vers le monde, d’où provient maintenant le plus grand nombre de jésuites. En 1957, la Compagnie compte 34 000 jésuites. Presque le quart est américain. En 2022, le nombre de jésuites était tombé à quelque 15 000, dont un tiers aux Amériques. Cette réelle internationalisation se concrétise dans l’élection de l’Argentin François, premier pape jésuite de l’histoire en 2013.
Libération titre le 14 mars 2013 : « Du Nouveau Monde au balcon ». En effet, bien qu’enfant d’immigrés italiens, l’élu argentin est le premier pape venant des Amériques et aussi le premier jésuite à accéder au poste suprême.
Un pape novateur ?
Plusieurs textes adoptés – dont en 2013, Lumière de la foi (Lumen Fidei), en 2015 Loué soit le Seigneur (Laudato Si) et en 2020 Tous Frères (Fratelli tutti) – illustrent l’activité abondante de mise à jour de l’Église à laquelle se livre François. Certains s’inscrivent dans la lignée d’engagements antérieurs en les approfondissant, par exemple l’attention à la nature ; d’autres sont plus novateurs et reflètent particulièrement la vision de Jorge Bergoglio. Un bel exemple est la conception qu’il promeut du rôle des artistes et des écrivains.
En 1964, Paul VI leur demande de « rendre accessible et compréhensible, voire émouvant, le monde de l’esprit, de l’invisible, de l’ineffable, de Dieu » alors que l’intransigeant Jean-Paul II, dans sa Lettre aux artistes en 1999, exige qu’ils christianisent leurs œuvres. Or François, dans la Lettre du pape sur le rôle de la littérature dans la formation (17 juillet 2024), inverse le rapport. Les arts sont un moyen d’accéder à Dieu, de donner corps à l’incarnation :
« Grâce au discernement évangélique de la culture, il est possible de reconnaître la présence de l’Esprit dans la réalité humaine diversifiée, c’est-à-dire de saisir la semence déjà enfouie de la présence de l’Esprit dans les événements, dans les sensibilités, dans les désirs, dans les tensions profondes des cœurs et des contextes sociaux, culturels et spirituels. »
Selon lui, les œuvres éclairent le croyant :
« La représentation symbolique du bien et du mal, du vrai et du faux […] ne neutralise pas le jugement moral mais l’empêche de devenir aveugle ou de condamner superficiellement. »
François modifie l’approche des débats qui parcourent l’Église – une autre façon de faire, jésuite diraient certains critiques –, sans nécessairement modifier les dogmes. Pour François, rappeler le message des Évangiles ne suffit pas, il faut l’incarner. Ce nouveau pape change l’air du temps, chose bien éphémère, mais qui n’est pas sans effets sur le sacerdoce en Amazonie, notamment sur l’accès aux sacrements des divorcés-remariés.
Pour lui, l’Église doit être une mère qui accueille tous ses enfants dans la « joie de l’amour » (Amoris Laetitia, 2016). Il le rappelle dans une lettre du 8 mai 2022 à un jésuite qui se consacre aux homosexuels. Il y développe une proposition de modification de la gouvernance de l’institution, affirmant que « tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne devraient pas être tranchés par des interventions magistérielles » – ce qui, dans une institution aussi centrifuge que la papauté, est révolutionnaire. La formule qu’il utilise aux Journées mondiales de la Jeunesse de Lisbonne, « Todos, todos, todos », l’incarne. Ce que modifie François est bien la position d’autorité.
À lire aussi : Portugal, Philippines, France : comment les JMJ éclairent les différentes pratiques de la laïcité
L’accueil prime sur la condamnation qu’illustre la politique de synodalité (2024), conçue comme un « marcher ensemble », pour modifier la gouvernance. L’Église ne fournit plus nécessairement des réponses tombées d’en haut. En octobre 2023, le dicastère pour la Doctrine de la Foi affirme que l’accès aux sacrements des divorcés-remariés peut se faire avec discernement (il est jésuite), car tout baptisé doit recevoir l’aide de l’Église, mais la valeur sacramentelle du mariage n’est pas remise en cause.
Si la réforme de la Curie n’est pas achevée, des éléments ont été accomplis. François nomme des femmes à la tête de certains ministères. Il a su tenir compte de l’équilibre des forces au sein du Vatican et de ce petit monde de clercs qui gouverne, plus ou moins, le vaste monde des fidèles mondialisés.
Ces changements heurtent une partie des fidèles. Le pape est confronté dès le départ à une vigoureuse opposition des courants les plus intransigeants et conservateurs : on a parlé de « Françoisphobie ».
Des traits de permanence
Son règne illustre également des continuités : le pape est devenu mobile depuis Paul VI et le fameux voyage à Jérusalem en 1964 et surtout avec Jean-Paul II (104 voyages dans 127 pays alors que Benoît XVI n’en réalise que 25). François, avec le matériel adéquat au fur et à mesure de son vieillissement, a aussi multiplié les déplacements dans le monde entier.
Sur le plan des questions éthico-sexuelles, la continuité l’emporte. François est plus conservateur que vraiment novateur, défavorable au mariage homosexuel et au mariage des prêtres, et sous sa férule le Vatican s’oppose à ce qu’il appelle « l’idéologie du genre ». Défavorables à tout libéralisme sociétal, le Pape, le Vatican et une bonne partie des fidèles restent attachés à la famille traditionnelle et rejettent tout ce qu’ils considèrent comme des menaces contre « l’ordre naturel » et la « vie » (IVG, euthanasie…).
Si officiellement l’Église est neutre et si le Vatican réaffirme depuis longtemps son aspiration à des paix justes et durables, le pape a eu parfois des interventions hasardeuses. Ainsi en mars 2024, quand il appelle à arrêter les combats en Ukraine, il ne condamne pas l’invasion russe, et rejette l’idée d’une guerre juste.
Dans le même temps, François poursuit le dialogue interreligieux dans la lignée d’Assise proposée par Jean-Paul II. Il rappelle l’Occident à ses devoirs sur la défense de la paix, le soutien aux pauvres et aux migrants. Il énonce des normes, et les fidèles comme les populations attendent cela des papes, sans toujours les suivre. Les fidèles pensent ainsi largement que leur sexualité ne concerne pas l’Église.
Sa relation à la France est complexe. François est un lecteur et un promoteur de Pascal et de François de Sales, de Bernanos et de Joseph Malègue. Mais ses voyages en France sont en périphérie (Strasbourg, Marseille, La Corse). En 2024, son absence à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris surprend. La vieille Europe nourrit-elle encore, à part financièrement, la vie de l’Église ?
Au final, ce pape apparaît plus conformiste que l’on ne le croit et plus traditionnel qu’on le présente souvent. Il fut néanmoins novateur en prenant et en proposant pour modèle l’imitation du Christ pour réaffirmer un humanisme. Il aspirait à modifier la gouvernance du Vatican ; le processus est inachevé. Mais son autre façon d’être et de faire a donné un air neuf à la papauté après la sévérité de Benoît XVI. Ses réalisations ne sont pas négligeables. Des évolutions sont perceptibles, sauf quand on s’approche de l’autel (sacrements, rites, dogmes…). François n’a pas entraîné l’Église dans la Réforme.![]()
Frédéric Gugelot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.



![[EXPO] Les fastes du dernier sacre : le « voyage à Reims » de Charles X](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/whatsapp-image-2025-04-15-at-145836-1-616x347.jpeg?#)



















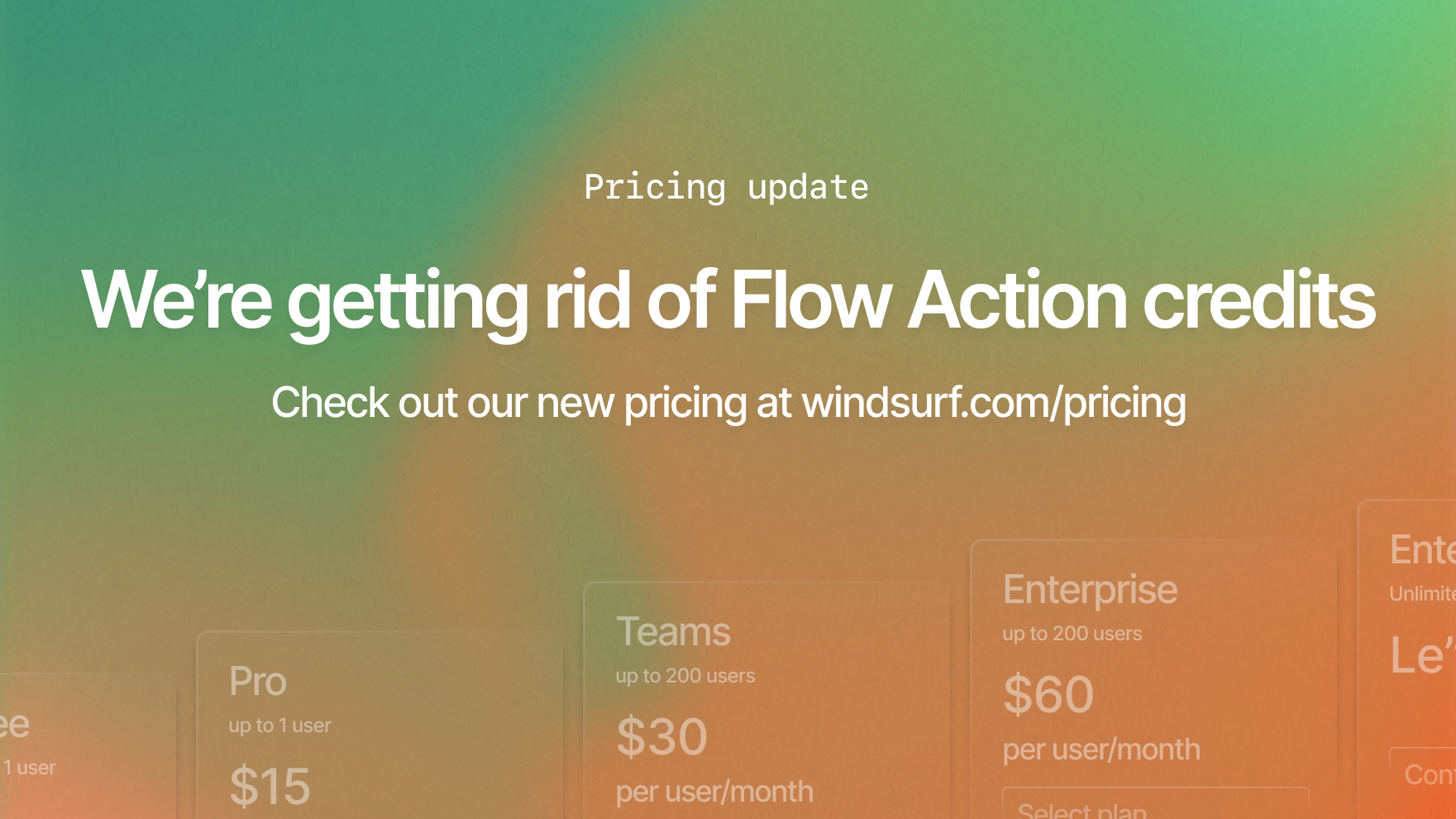












/2025/04/21/cannes2025-68069b5639eeb322746073.png?#)