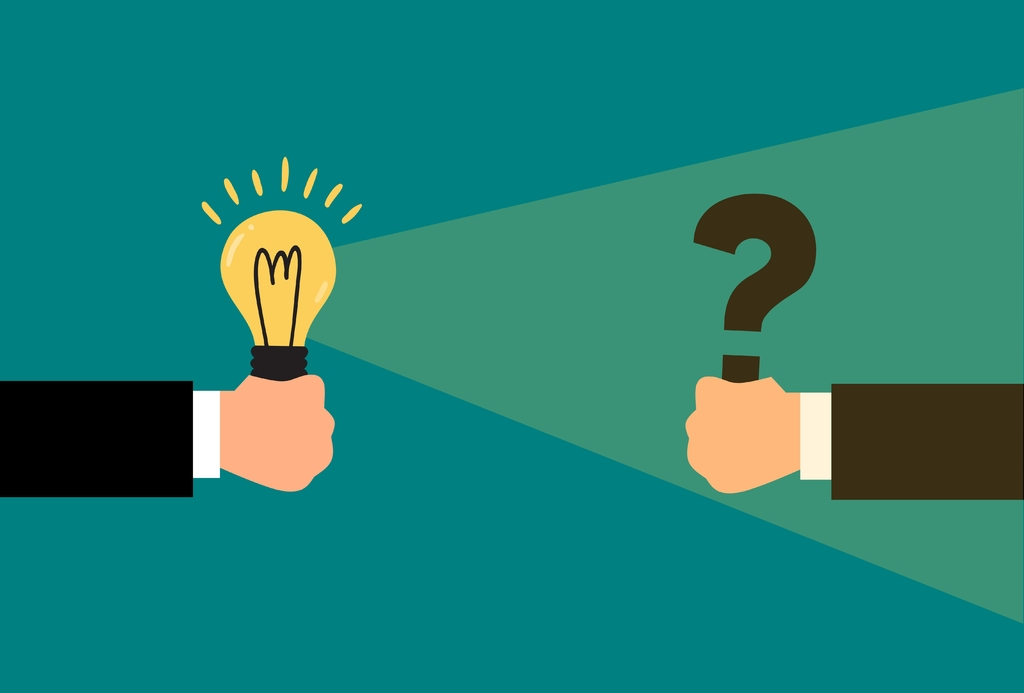Quand les fromages arrivent en ville
Oh lait lait à Bordeaux, Les Frox à Annecy, Marengo à Bayonne… à l’instar des micro-brasseries, les laiteries urbaines font (ou refont) leur apparition dans les villes.


Oh lait lait à Bordeaux, Les Frox à Annecy, Marengo à Bayonne… à l’instar des micro-brasseries, les laiteries urbaines font (ou refont) leur apparition dans les villes. L’image d’Épinal de la laiterie localisée en pleine campagne et liée à une ferme s’estompe. La production de fromages au lait cru a désormais sa place en zone urbaine.
Le locavorisme et les circuits courts ont la cote. En 2020, 63 % des Français étaient prêts à consommer le plus de produits locaux possible pour soutenir l’économie. La pandémie de Covid-19 a modifié le comportement des consommateurs, entraînant de nouveaux modes ou lieu de production et de nouvelles vocations.
Ce phénomène n’est pas nouveau. Au XIXe siècle déjà, des laiteries à Paris, Londres et Copenhague existaient, comme le souligne l’historien Fabien Knittel. Elles répondaient à l’essor croissant de l’urbanisation et la nécessité de fournir du lait frais aux populations. Ces derniers s’approvisionnaient auprès de fermes en périphérie des villes ou développaient des systèmes d’élevage urbain posant des problèmes sanitaires. Leur essor s’établira à partir des années 1860-1880 avec les techniques de pasteurisation et l’industrialisation du lait.
Alors pourquoi son retour au XXIe siècle ?
Boom partout en France
Les laiteries urbaines actuelles transforment le lait issu de circuits courts – fermes périurbaines ou rurales proches –, pour en faire des fromages, du beurre, de la crème. Le phénomène reprend vigueur dans les années 1970 à la suite de la dynamique des circuits courts, d’agriculture urbaine et de relocalisation de la production alimentaire. Ces initiatives répondent à une demande croissante des consommateurs pour les produits locaux, frais et traçables, tout en sensibilisant le public aux enjeux de l’élevage et de la production laitière. Et les Français sont de grands consommateurs de fromage : 27 kg par personne et par an en 2022.
En France, la Laiterie de Paris en 2013 est l’une des premières à transformer du lait local en yaourts et fromages directement en ville. En Europe la Stadtkäserei ouvre à Zurich en Suisse et en Amérique du Nord, le même phénomène se répand. Depuis 2020 l’accélération du phénomène est sensible en France, Belgique et Londres.
L’ouverture des laiteries urbaines n’est pas l’apanage d’une région ou d’une ville. Elles fleurissent sur tout le territoire, souvent dans les moyennes ou grandes villes : Annecy, Bordeaux, Pau et Bayonne, Marseille, Metz et Nancy, Limoges, Brest, Toulouse, Rennes, Avignon, Paris, Saint-Ouen. Et bien sûr la liste est loin d’être close.
Proximité relationnelle
Ces fromagers souhaitent recréer du lien entre consommateurs et producteurs, que la grande distribution a distendu. Face à la main mise sur le secteur des géants du lait, en soutien à l’agriculture en crise et aux commerces de proximité, les consommateurs découvrent ces nouveaux lieux de production, en ville. Cette proximité se fait à un triple niveau :
Le lait provient de producteurs locaux, en général de moins de 50 km.
La proximité du lieu de vente invite les consommateurs urbains à redécouvrir les productions artisanales au cœur de leur ville.
La proximité relationnelle du producteur et du consommateur qui veulent partager des valeurs identiques, des valeurs du terroir.
À lire aussi : Le lait de foin arrive dans nos magasins et ce n’est sans doute pas ce que vous pensez
Le lait de foin, provenant d’animaux nourris exclusivement d’herbe fraîche ou de foin, est par exemple un des produits emblématiques de ces laiteries urbaines. Il renforce le caractère authentique, rural et sain de la production fromagère dans l’imaginaire des consommateurs et qui se fait réalité.
Quête de sens
Ces crémiers de temps modernes recherchent du sens. Ces fromagers urbains sont souvent issus de reconversion, délaissant leur ancien métier au profit d’un engagement. Ce changement radical dans leur vie correspond à leurs valeurs tournées vers le local, l’artisanal et aussi à un engagement plus profond envers la société et ce qu’ils ont envie de vivre. « En 2021, j’ai quitté mon emploi pour me recentrer sur un métier qui a du sens ». Délaisser un travail intellectuel au profit d’un travail manuel pour trouver une satisfaction dans la réalisation concrète des produits.
« Notre boutique située rive droite offre une vue directe sur le laboratoire pour vous dévoiler les différentes étapes de transformation », lit-on sur le site de la Laiterie brestoise.
Cette quête de sens se manifeste aussi par la transparence : de la traçabilité du lait, de la fabrication pour le partage avec les clients. Les opérations de production, d’affinage donnent à voir aux clients sous diverses formes : espaces aménagés, ateliers, fromagers ouverts au public ou encore ateliers de formations professionnelles dans un souci de partage.
Éthique et zéro déchet
Le prix du lait est souvent affiché dans un souci éthique vis-à-vis du producteur comme à la Laiterie de Lyon ou à Paris. Les mots clés « bio, urbain, local et artisanal » sont souvent écrits sur les bouteilles du précieux breuvage.
« C’est simple, on double le prix du lait. On achète leur lait environ 8O centimes d’euros le litre alors que Lactalis est à 35 centimes », rappelle Pierre Coulon, le fondateur de la Laiterie de Paris.
Certaines laiteries urbaines vont encore plus loin dans leur engagement écologique. Elles proposent des consignes pour les bouteilles de lait ou de yaourts comme à Marseille ou valorisent le zéro déchet comme à Limoges.
Innovations gustatives
Si la France est le pays du fromage, la liste des produits n’a pas fini de s’enrichir… Ces laiteries-fromageries urbaines développent leurs propres créations alliant savoir-faire traditionnel et innovation. La transformation en ville permet d’expérimenter de nouveaux profils sensoriels et des méthodes d’affinage atypiques : croûtes atypiques, textures particulières ou arômes qui évoluent différemment de ceux produits en milieu rural traditionnel.
À Marseille, la laiterie urbaine revendique une identité voir un terroir lié à cette production avec saveurs méditerranéennes : zaatar, épices, coagulation à la figue et au citron. La laiterie de Paris propose un « sakura », un chèvre affiné à la fleur de cerises.
Au-delà du simple produit, ces initiatives visent souvent à éduquer le public aux enjeux de la production locale durable. Ces lieux deviennent des lieux de rencontres et d’échanges où la démarche artisanale et écologique est mise en avant. Ces laiteries urbaines reposent souvent sur une vision éthique et écologique où l’humain est aussi au centre tant côté producteur de lait que consommateur. La laiterie de La Chapelle accueille des classes pour former les jeunes enfants. De futurs amateurs de lait, de beurre et de fromage ?![]()
Anne Parizot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.



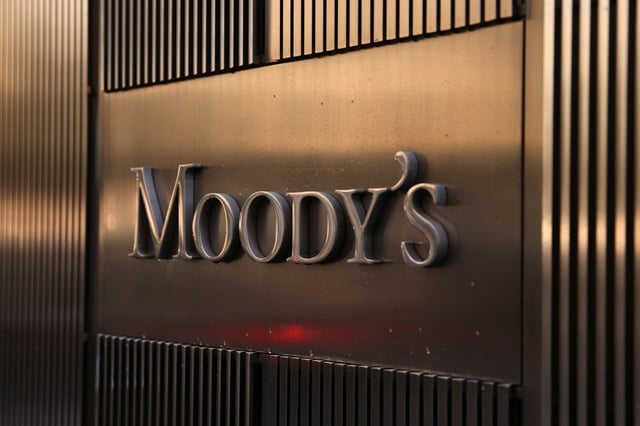



![[LE CROC D’IXÈNE] L’émir du Qatar offre un Boeing 747 à Trump](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/bv92-boeing-qatar-trump-vign-516x482.jpg?#)
![[STRICTEMENT PERSONNEL] À droite toute !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2024/07/IL20240409190919-jamet-dominique-929x522-1-616x346.jpg?#)
![[POINT DE VUE] Présidentielle en Pologne : un premier tour sous tension](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/rafal-trzaskowski-616x310.jpg?#)







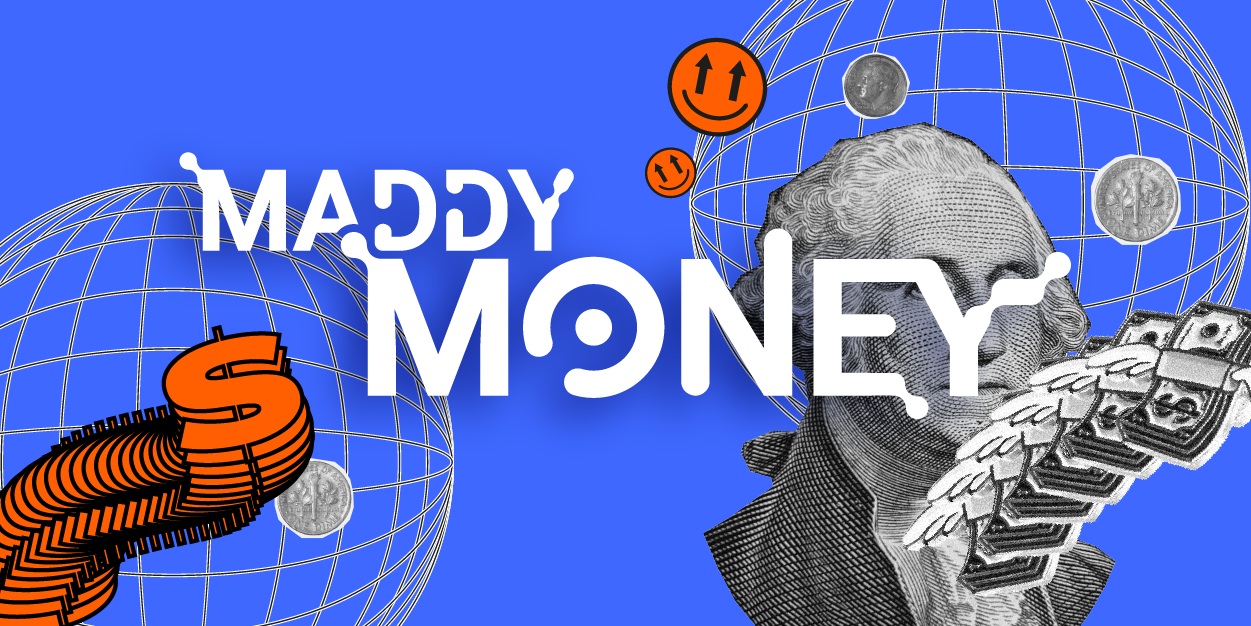













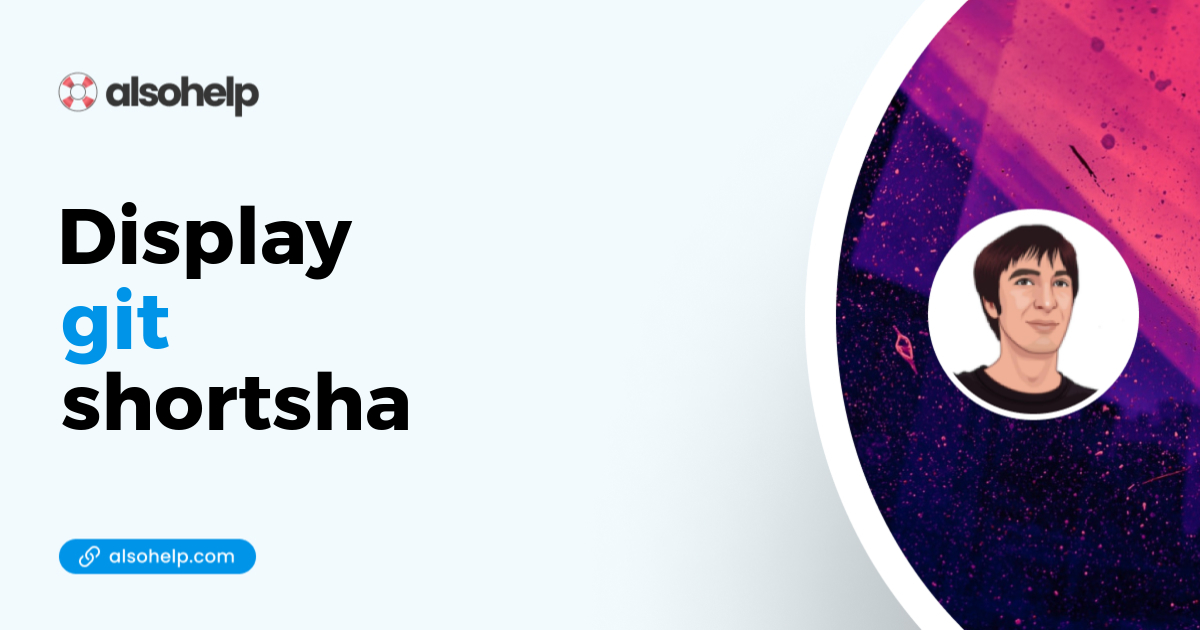


















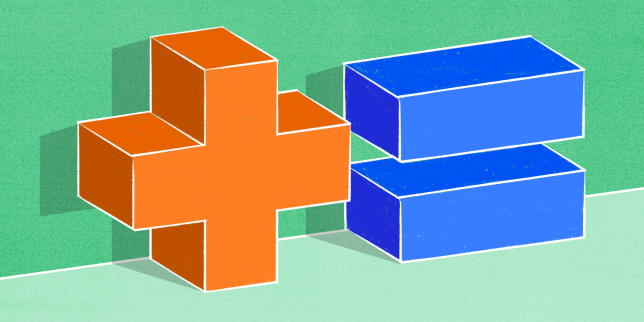

.jpg?#)