La (re)valorisation du magasin de proximité à l’heure de la transition écologique et sociale : l’exemple de la mode circulaire
Le commerce de proximité a un rôle à jouer pour contribuer au passage d’un modèle de surconsommation à une consommation davantage circulaire.

Le commerce de proximité a un rôle de pédagogie et de sensibilisation à jouer pour contribuer au passage d’un modèle de surconsommation à une consommation davantage circulaire.
La mode circulaire s’impose aujourd’hui comme une réponse concrète aux dérives sociales et environnementales de la fast fashion et de l’ultra-fast fashion. Tandis que les grandes enseignes multiplient les collections à un rythme effréné, la circularité invite à repenser le cycle de vie des vêtements dans son ensemble. Autrement dit, plutôt que de suivre un modèle linéaire « produire-consommer-jeter », il s’agit de prolonger autant que possible la durée de vie des vêtements.
Dans une logique de circularité forte, cela reviendrait à refuser même de produire ou d’acheter des vêtements neufs. Cette mutation ne concerne pas seulement les producteurs ou les consommateurs : elle prend racine au cœur des territoires, où le magasin de proximité, bien plus qu’un lieu de vente, pourrait bien représenter un atout clé en faveur de la transition.
De l’agora au magasin
Historiquement, les fonctions des boutiques de quartier dépassaient la simple transaction marchande : approvisionnement de base, lieux de rencontre, voire espaces de mobilisation socioculturelle. À l’instar des agoras antiques, marchés médiévaux et souks ou bazars orientaux, où les artisans spécialisés (couturiers, épiciers, boulangers, libraires, etc.) contribuaient à l’organisation de la vie quotidienne des citoyens à partir de leurs petites échoppes rudimentaires.
Les premiers à tenir boutique ont été les artisans. Les vrais boutiquiers arriveraient ensuite : ce sont les intermédiaires de l’échange ; ils se glissent entre producteurs et acheteurs, se bornant à acheter et à vendre sans jamais fabriquer de leurs mains (du moins entièrement) les marchandises qu’ils offrent. Ils sont d’entrée de jeu comme le marchand capitaliste qu’a défini Marx, lequel part de l’argent A, acquiert la marchandise M pour revenir régulièrement à l’argent A, selon le schéma AMA :
« Il ne se sépare de son argent qu’avec l’arrière-pensée de le rattraper. » (Fernand Braudel, 1979, p.59)
Avec l’essor des grands magasins et l’apparition généralisée des vitrines, dont Émile Zola décrit les enjeux du commerce ostentatoire, les boutiques subissent une première grande déprise. Le citoyen devient « flâneur », se livre au « lèche-vitrines » et cède davantage aux nouveautés mises en scène.

L’arrivée plus tardive de la grande distribution puis du e-commerce a également fragilisé le commerce de proximité, en promouvant une consommation de masse soutenue par des techniques marketing de plus en plus élaborées.
Commerce et lien social
Néanmoins, le petit commerce de proximité a, de tout temps, su faire face aux mutations du marché grâce à son rôle social]. D’ailleurs, ce rôle a regagné en intérêt pendant la pandémie de Covid-19, où il a été reconnu pour sa capacité à soigner le lien social, éprouvé par les différents confinements. Une reconnaissance confortée par l’étude Excom (2025) sur les retombées positives de son apport non marchand. Elle démontre qu’en plus de ses fonctions sociales historiques, il contribue à animer et à embellir nos villes contemporaines.
Malgré ces considérations, le constat d’une vacance commerciale dans le paysage urbain est saillant. Selon le rapport de Codata (2025), elle a atteint un record en 2024 avec un taux de vacances (structurelle) de 10,64 % (contre 9,29 % en 2022). Ce que l’on voit au quotidien en observant des boutiques fermées, des rideaux baissés et des vitrines abandonnées.

La concurrence des plateformes
Dans l’univers de la mode, la vacance est notamment imputée à l’arrivée des plateformes de vente en ligne, comme celles des spécialistes de l’ultra-fast fashion Shein et Temu, ou encore le généraliste Amazon et la plateforme collaborative Vinted. Une autre explication tient à l’expansion des enseignes de fast fashion, dont les capacités d’investissement font grimper les prix du foncier commercial. Le groupe Inditex qui compte parmi ses marques Zara, Bershka, Oysho et Stradivarius, concentre par exemple de plus de 5 500 boutiques dans 97 pays en 2024.
« Nous allons continuer à mettre en œuvre des projets nous permettant d’accéder aux places commerçantes les plus emblématiques du monde », Oscar Garcia Maceiras, président-directeur général du groupe Inditex.
La marque H&M mise, elle aussi, sur des emplacements de magasins à forte fréquentation dans notamment dans les centres commerciaux.
Toutefois, ce phénomène peut ouvrir de nouvelles voies pour repenser les territoires à l’aune des transitions écologiques et sociales, comme l’ambitionne « Action cœur de ville ». Le réinvestissement de certaines friches industrielles en tiers-lieux montre qu’il est également possible de donner un nouveau souffle aux espaces autrefois abandonnés.
Ces espaces hybrides, intègrent dans une démarche collective, les préoccupations sociales, économiques, écologiques et territoriales dans leur fonctionnement. Différentes activités y cohabitent sous le même toit (commerce, artisanat, coworking, création artistique, etc.). Le Plateau fertile et Tissel comptent parmi ces tiers-lieux, où dynamique d’innovation durable et modèles circulaires de la mode sont au service d’une transition territoriale.
Des magasins avec une préoccupation circulaire
Nos recherches révèlent l’émergence d’un nouveau type de magasin de proximité qui intègrent la circularité au cœur de leur action. Leurs business modèles circulaires les engagent dans une mode plus éthique, soucieuse des conditions sociales et des impacts environnementaux. S’y retrouvent la vente de vêtements écoconçus ou de seconde main, le troc et le réemploi par le recyclage ou l’upcycling.
Bien plus que de simples vitrines, ces magasins agissent comme catalyseurs d’une réflexion critique pour ralentir nos modèles de consommation et de production de vêtements, dans la lignée de la « slow fashion movement ». Ils fonctionnent comme des espaces de médiation socioculturelle de la consommation, où l’on prend le temps de s’interroger sur la provenance et la qualité des matières textiles, les conditions de travail derrière leur confection et les manières de prendre soin du vêtement.

En pratique, les équipes de vente, autant que les affichages dans ces espaces, encouragent les clients à une consommation plus consciencieuse. Ils les invitent à participer à des ateliers de personnalisation, d’upcycling ou de réparation. Ainsi les principes de la mode circulaire deviennent tangibles. Les échanges entre clients, commerçants et designers locaux, bâtissent finalement une compréhension commune des enjeux de la mode, dotant le magasin de proximité d’une dimension pédagogique forte.

Raconter le vêtement avant de le vendre et de l’acheter
Le vêtement y est raconté, explicité, touché, essayé, partagé, ce qui transforme progressivement la perception de sa valeur : au lieu d’être vu comme un produit « jetable » ou « remplaçable », il redevient un objet empreint de sens, porteur de mémoire et d’histoire. Cette dynamique s’inscrit dans ce que nous avons appelé la « proximité affective et matérielle ». Lorsque cette dernière se manifeste, elle contribue à considérer le lien émotionnel avec les vêtements. Réduire les déchets textiles devient alors un objectif plus concret et accessible.
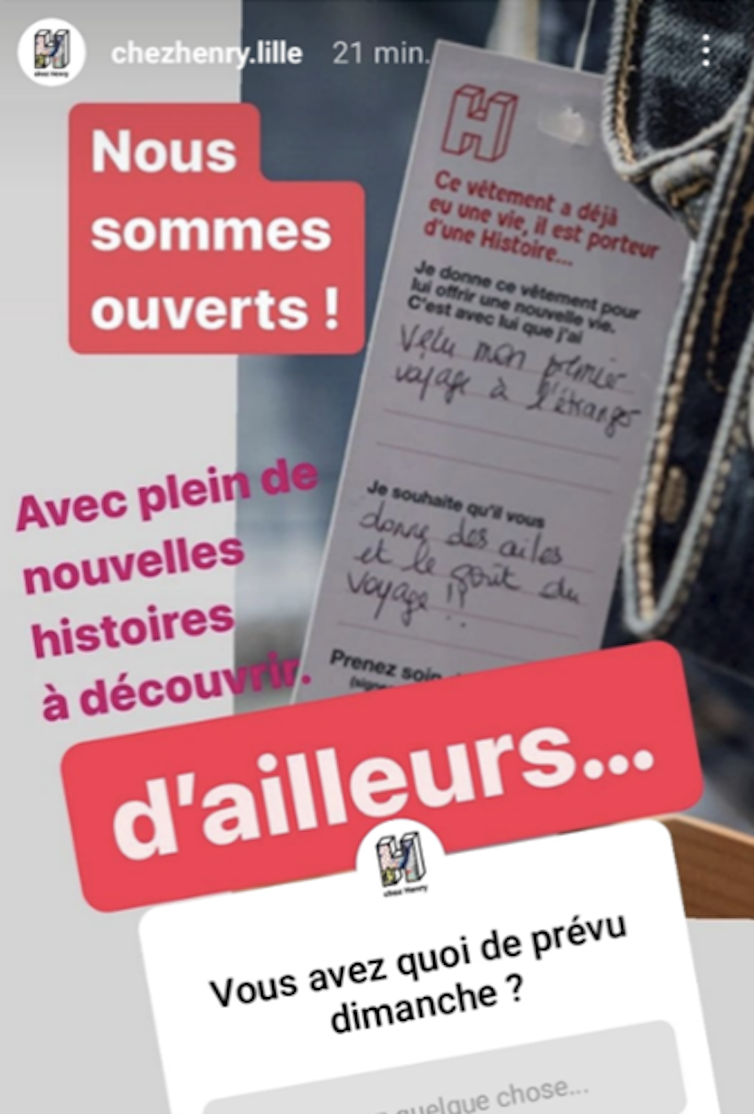
Un commerce au visage humain et un attachement renoué
Dans cette dynamique, le magasin de proximité reprend une place essentielle en tant que maillon actif de la chaîne circulaire. Il (re)devient un espace d’expérimentation. Des pratiques locales et alternatives y émergent. Modestes en apparence, elles participent à une transition concrète.
Réparer des vêtements, transformer des textiles, cultiver des liens ou sensibiliser à une consommation responsable représentent autant de nouvelles façons de faire commerce. Dans ce sillage, des espaces hybrides apparaissent, réconciliant production, consommation et lien social. C’est le cas du tiers-lieu des Trois Tricoteurs à Roubaix. Un espace qui combine boutique de vêtement, café-bar et atelier de production textile. Les visiteurs peuvent y observer les ingénieurs confectionner des vêtements, à la demande, tout en passant un moment de détente autour d’un café ou d’un livre.
Souvent négligés dans les grandes analyses économiques et marketing, au profit de l’épopée de la grande distribution et du e-commerce, les petits magasins de proximité semblent incarner les prémices d’un changement en profondeur : ils s’appuient sur la proximité pour créer de nouvelles valeurs territoriales, résolument tournées vers l’avenir.![]()
Membre du laboratoire LUMEN axe Consommation, Culture et Marchés. Membre de la Chaire Tex & Care. Recherche doctorale financée par la région Hauts-de-France et l'Université de Lille.
Isabelle Robert est co-fondatrice de Tex & Care, la chaire interdisciplinaire universitaire de la mode circulaire (IAE Lille-ENSAIT). La chaire Tex&Care est une chaire de la Fondation de l'Université de Lille.
Cet article est issu d'un travail doctoral financé par la Région Hauts de France et l'Université de Lille.
















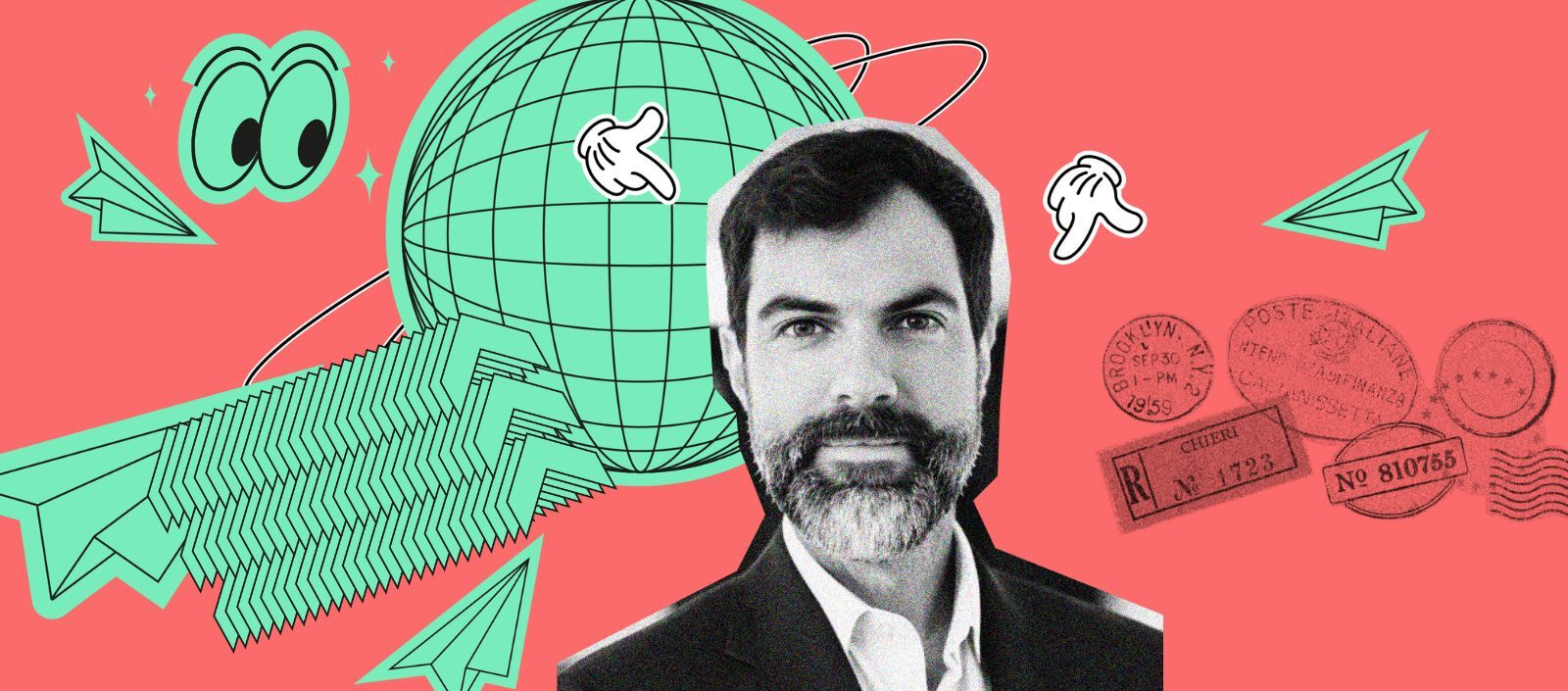




























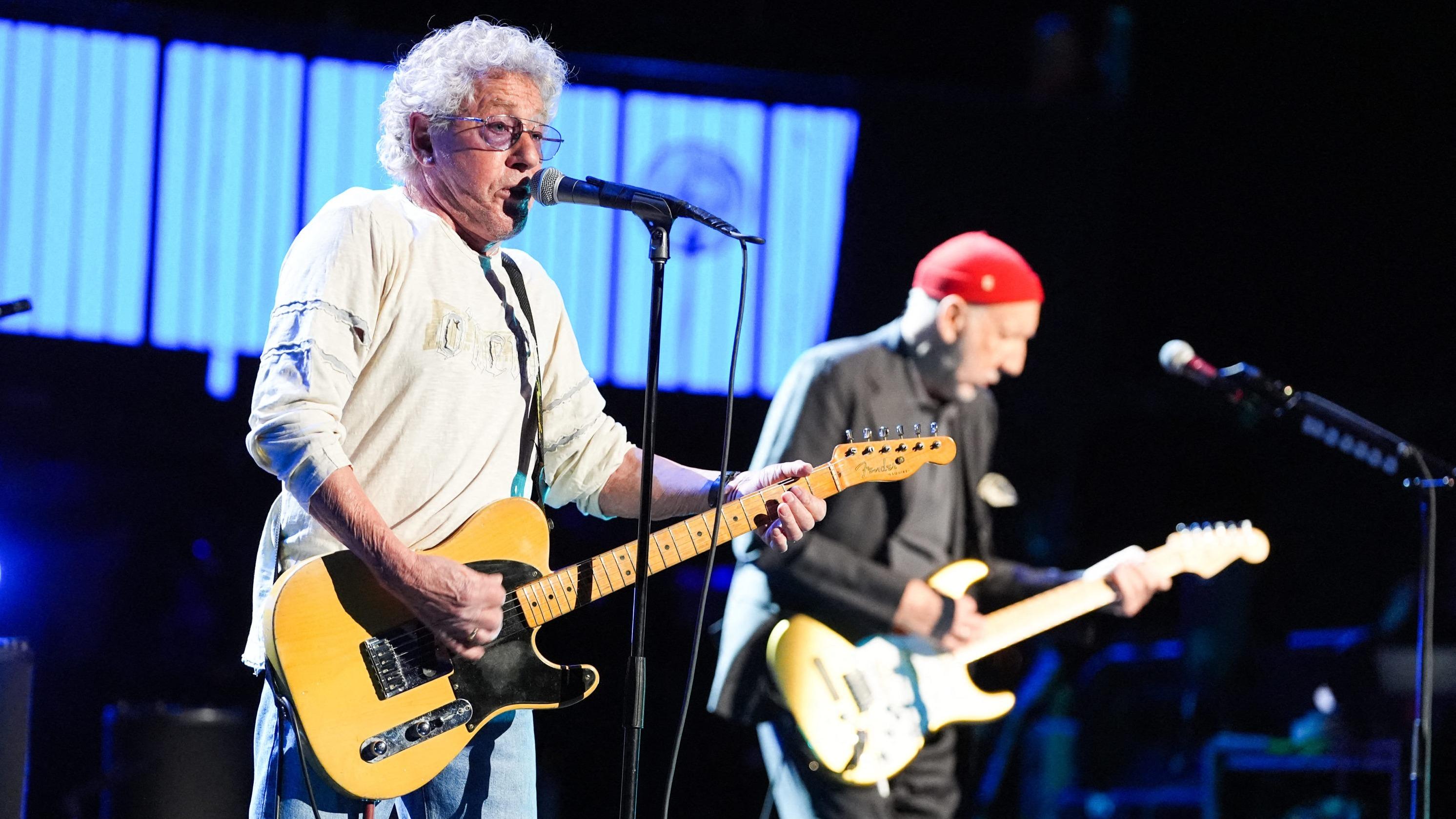


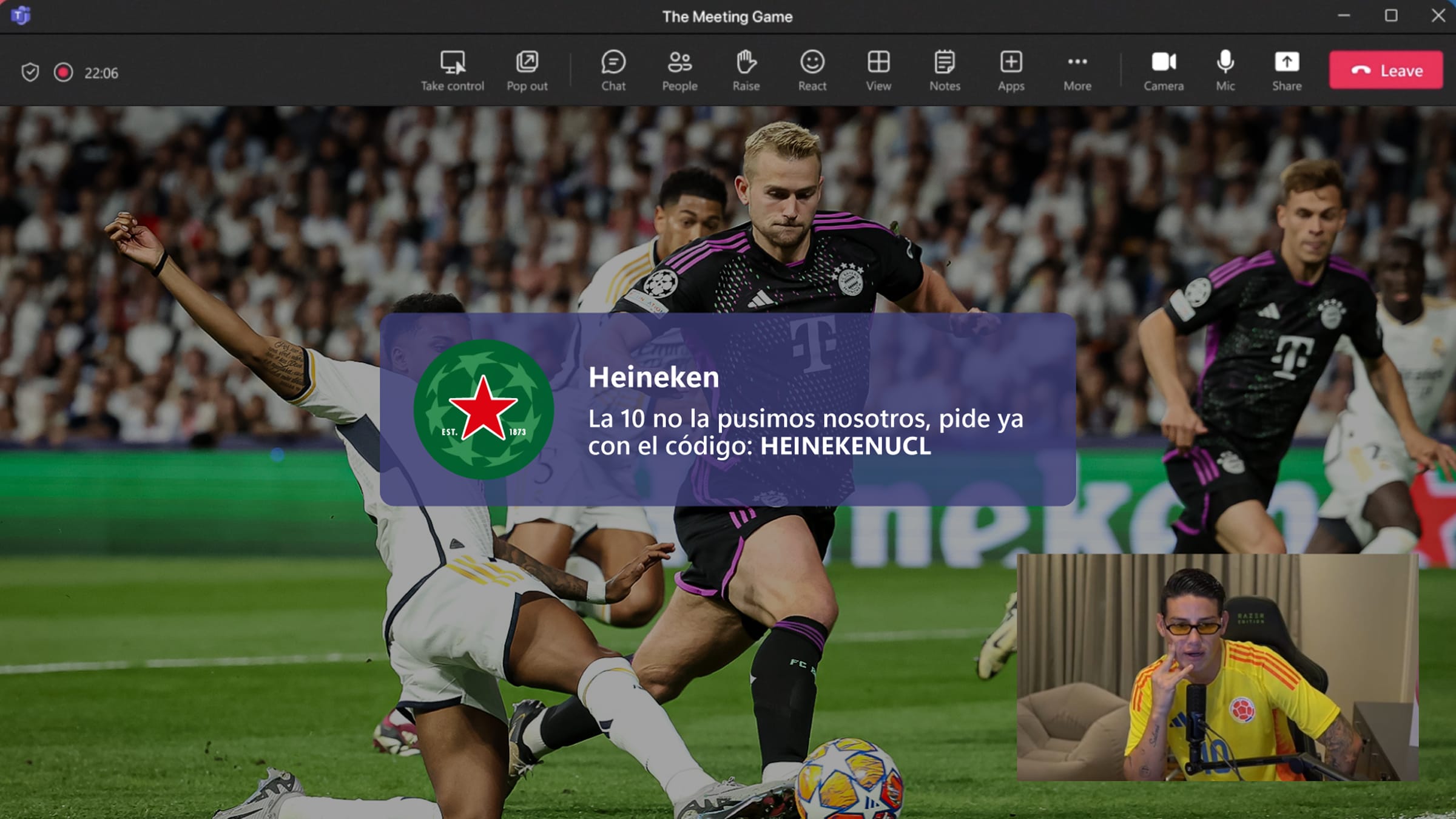

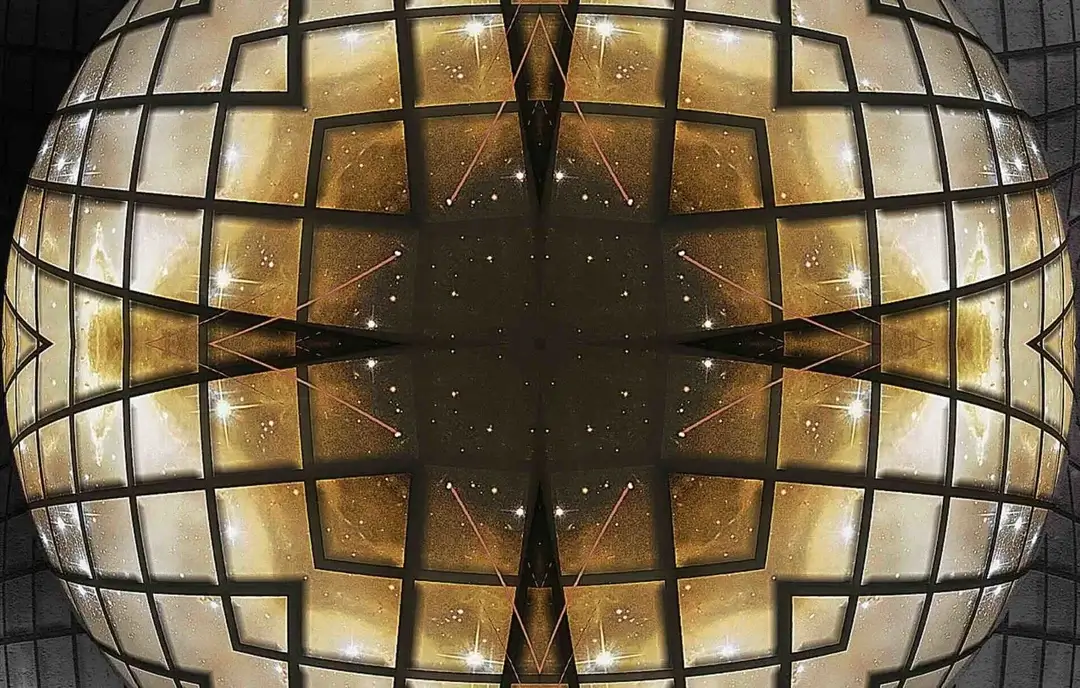
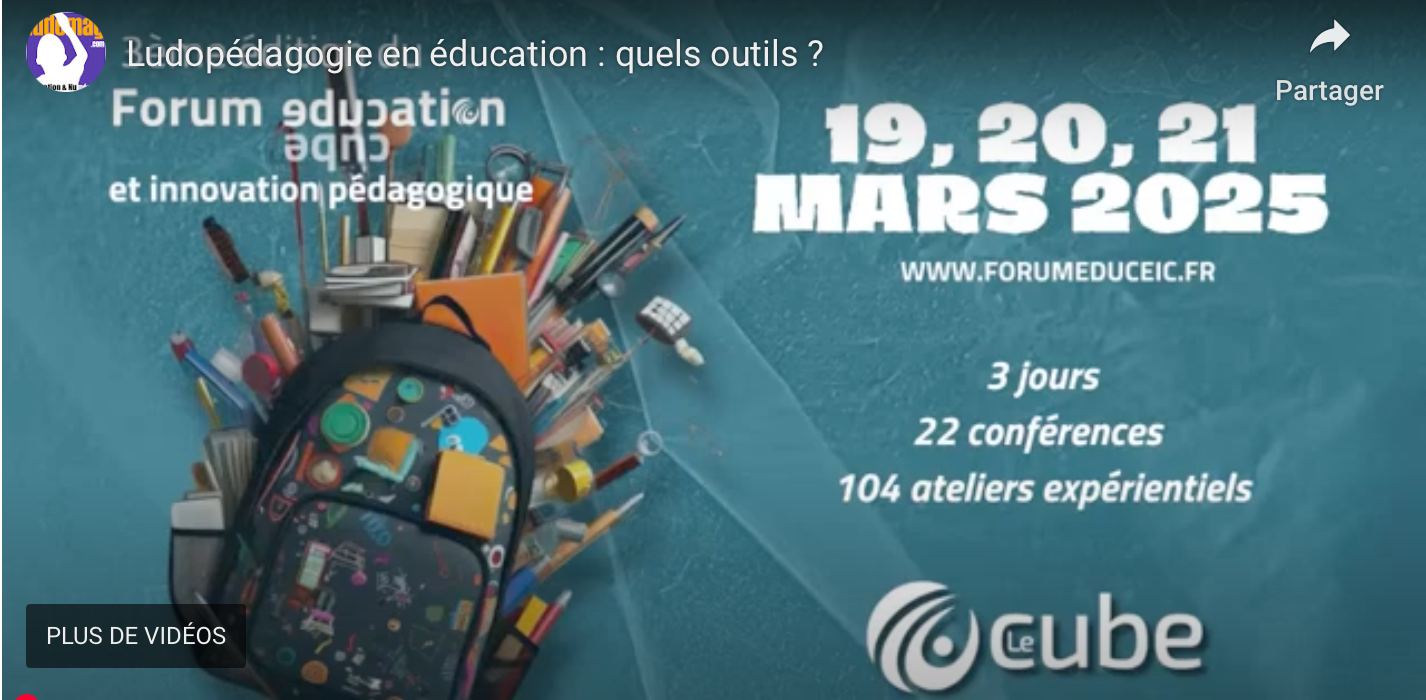
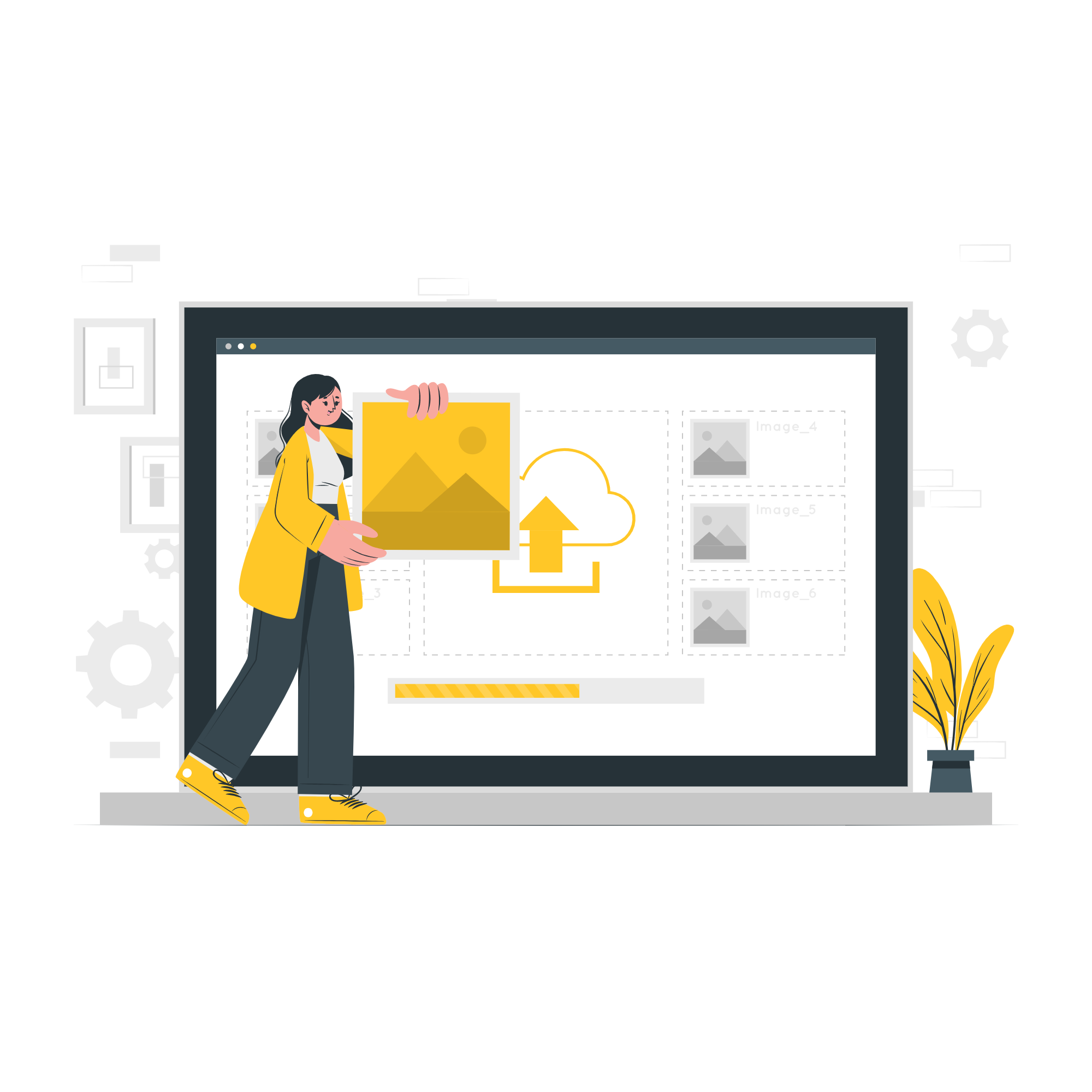








/image%2F0535633%2F20250511%2Fob_99adb5_350923261-262956939623899-919156463266.jpg)




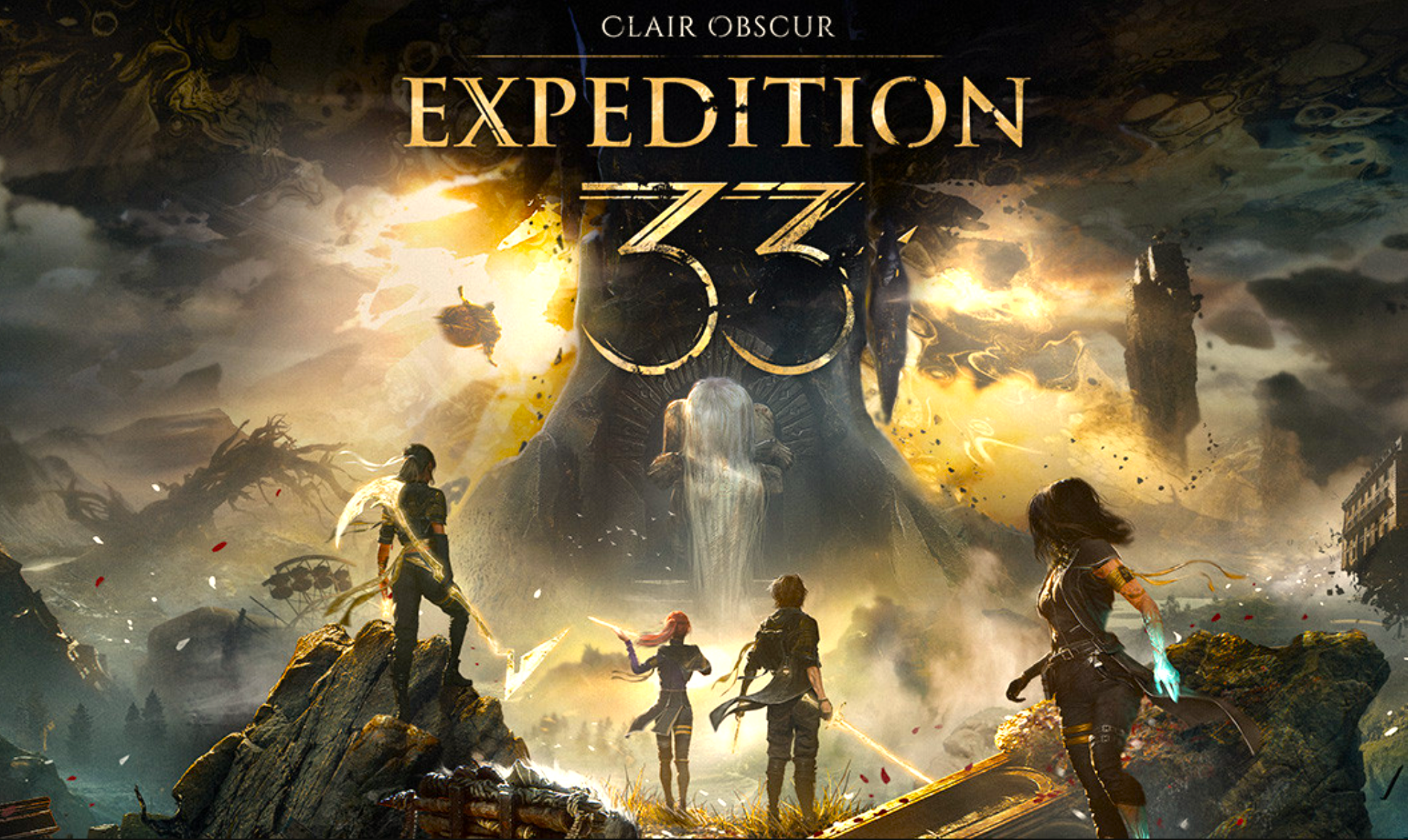








/2025/05/05/maxbestof321206-6818ca413c981094713563.jpg?#)