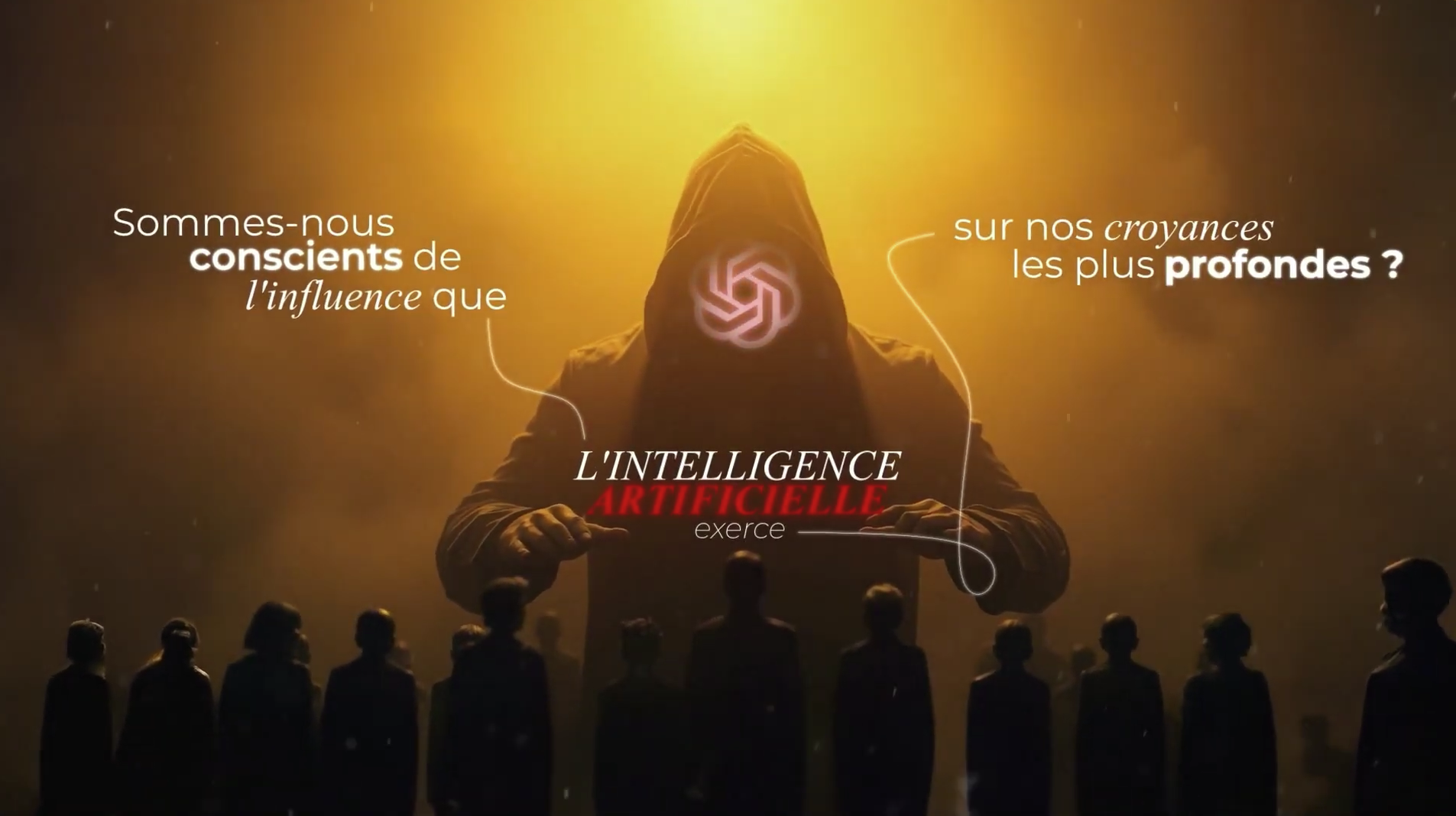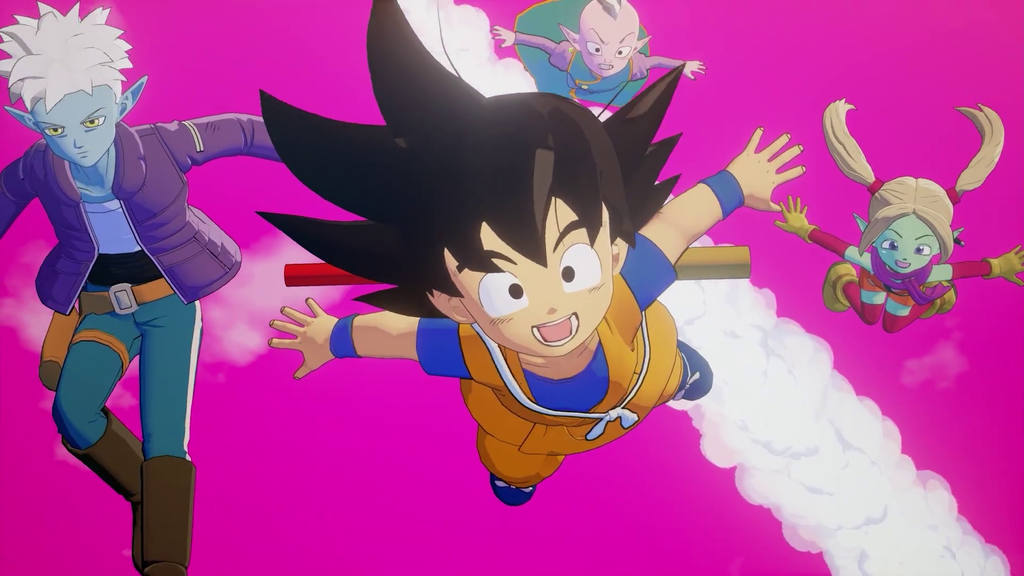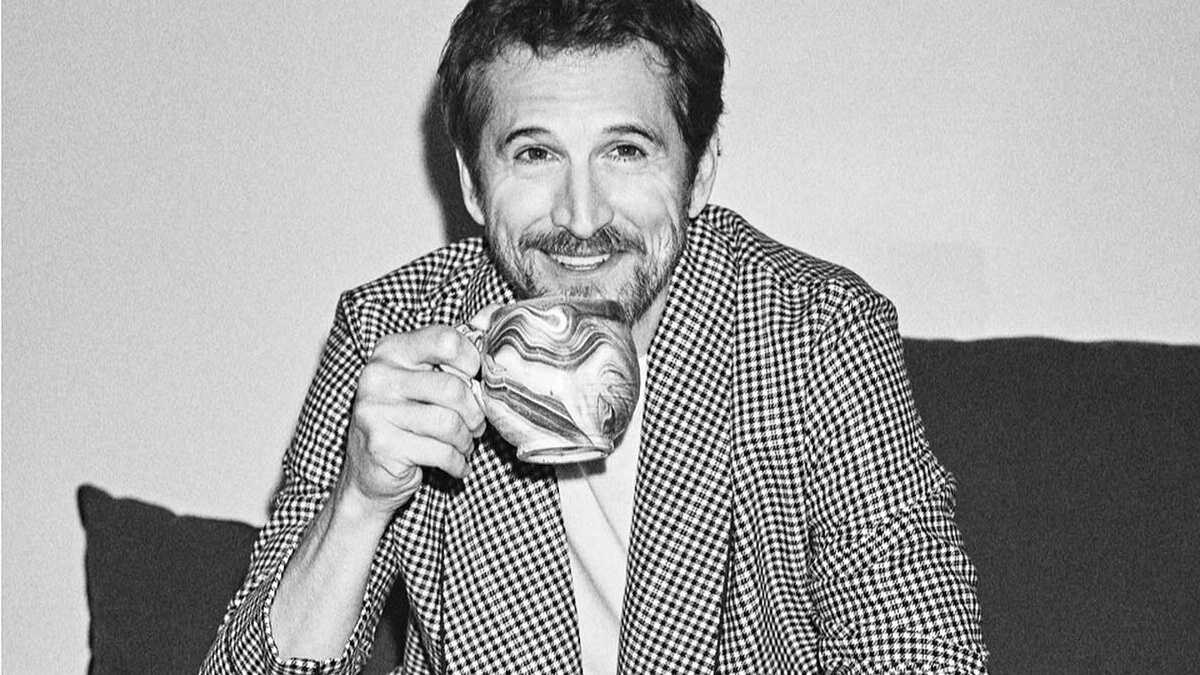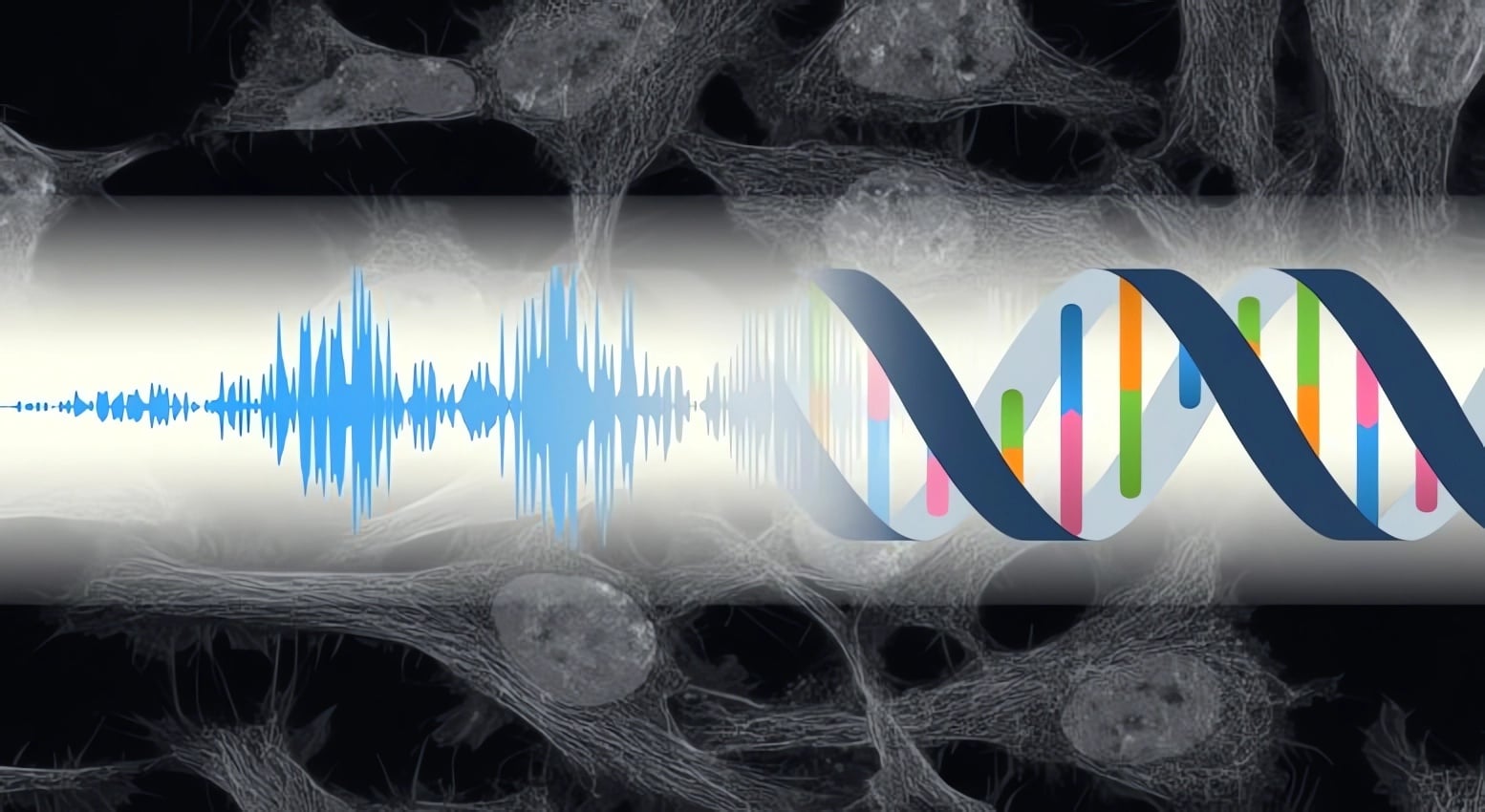Blackout en Espagne et au Portugal : une opportunité de repenser la prévention et la résilience, vers une transition énergétique soutenable
La panne d’électricité massive en Espagne et au Portugal nous fait prendre conscience de notre dépendance à l’électricité. Comment mieux se préparer à ces événements ? Comment réagir lors d’un blackout ?

La panne d’électricité massive en Espagne et au Portugal nous fait prendre conscience de notre dépendance à l’électricité. Comment peut-on mieux se préparer à ces événements, individuellement et en tant que société ? Comment réagir lors d’un blackout ?
L’ampleur et la durée de la panne ont permis de mesurer le « risque systémique » que constituent les blackouts — signifiant que l’impact est technique, économique, social et sociétal. Sans énergie électrique, la société s’arrête, car privée de communication, de signalisation, de transport, d’alimentation en eau, de possibilité de transaction pour faire, ne serait-ce que des achats d’urgence, esquissant le risque du chaos si le phénomène devait perdurer, et posant la question sociétale de la dépendance à l’électricité.
En s’appuyant sur une analyse scientifique et historique, le propos sera ici de comprendre pourquoi, si le blackout est un phénomène hautement improbable, le risque zéro n’existe pas. Dès lors, dans un cadre de nécessaire transition énergétique vers plus d’énergie électrique décarbonée, et d’augmentation des menaces climatiques et géostratégiques pouvant augmenter le risque de blackout, nous chercherons à identifier les leviers d’une prévention et d’une résilience plus globale et plus efficace, qui considèrent à la fois les dimensions techniques, humaines, sociales et sociétales.
Un exemple historique pour comprendre les blackouts
Le blackout est une perte de contrôle du réseau en alimentation électrique, subie et non choisie. Si l’analyse du blackout qui s’est produit le 28 avril n’est pas encore disponible, les précédents incidents et accidents de même envergure sont largement documentés et analysés par des travaux académiques, à l’instar du dernier blackout massif que nous avons connu en France le 19 décembre 1978, qui a pu être analysé et comparé scientifiquement à d’autres.
Dans les grandes lignes, le scénario reste toujours le même : l’équilibre entre production électrique et consommation est rompu par un évènement initiateur, qui par un effet en chaîne ou effet domino, provoque un effondrement du réseau. En 1978, c’est la défaillance d’une ligne haute tension, partant de l’est de la France, qui fut l’évènement initiateur, dans un contexte de journée hivernale froide et de forte activité économique et commerciale pour ce dernier mardi avant les fêtes de Noël.
L’incident peut se propager sur de grandes distances, en particulier si le phénomène touche au réseau de transport électrique qui maille des échelles nationales aux échelles européennes et internationales. Ainsi, en 1978, toute la France avait disjoncté excepté une partie du Nord-Est qui se retrouva isolée du défaut et alimentée par une ligne transfrontalière avec l’Allemagne.
Dès lors que le « blackout » se produit, la procédure de restauration du réseau, appelée « blackstart » peut prendre de plusieurs heures à plusieurs jours. En 1978, le réseau a été remis en fonctionnement en quatre heures pour la plus grande partie du pays, c’est-à-dire vers midi… mais on annonçait encore au journal de 20h que 5 % du territoire restait non réapprovisionné.
Les blackouts sont donc des évènements rares, mais de très grande ampleur spatiale et temporelle, avec de lourdes conséquences économiques, sociales et sociétales.
La nature systémique du risque du blackout et l’impossibilité du risque zéro
Pour comprendre la nature systémique des blackouts dans son entièreté, on doit considérer le système électrique comme un système sociotechnique complexe, résultant d’un assemblage de systèmes techniques opérés par des acteurs qui mettent en synergie des producteurs et des consommateurs.
La sûreté et la sécurité de cet assemblage sociotechnique peuvent être pensées scientifiquement par le modèle dit « du fromage suisse ».

Ce modèle vise à considérer le système comme un empilement de couches techniques, procédurales, sociales et humaines, qui visent à parer aux incidents.
Ainsi, une des couches de sécurité pour les réseaux électriques est que celui-ci est « maillé », ce qui permet de pallier à une coupure potentielle sur une ligne, en passant par une ligne adjacente. D’autres couches de protection sont assurées par des mécanismes automatisés ou manualisés qui permettent d’isoler une zone problématique, de mobiliser des moyens de réserve (type centrale hydraulique, centrale au gaz…), ou de modulation de la production (à la hausse ou la baisse pour les centrales et unités en services) et de la demande (par délestage de gros consommateurs industriels, de partie de réseau, ou de demande civique aux consommateurs, à l’instar du dispositif Écowatt, une « météo de l’électricité » pouvant donc impliquer les usages et les consommateurs).
À lire aussi : Blackout dans le sud de l’Europe : une instabilité rare du réseau électrique
Dès lors, le risque d’avoir un accident systémique global, correspondant dans le modèle du fromage suisse à des trous qui s’alignent pour donner lieu à l’accident, s’en voit drastiquement minimisé pour devenir hautement improbable.
Pour autant, le risque zéro, correspondant à la situation où aucune couche n’a arrêté l’accident systémique, ne peut être exclu. Autrement dit, des facteurs internes (déséquilibre entre offre et demande énergétique, défaillance technique, manque de coordination ou d’implication par et entre les acteurs) peuvent se combiner à des facteurs de stress externes (évènement météo ou climatique extrême, cyberattaques, tempête électromagnétique solaire, situation de maintenance ou d’intervention exceptionnelle sur le système) pour résulter en la trajectoire de l’accident systémique.
Mais il faut constater que lors d’évènements comme celui du 28 avril 2025, aucune couche de sécurité ne s’est mobilisée pour arrêter la trajectoire de l’accident. Face à ce constat — celui de l’impossibilité du risque zéro — chercheurs et opérateurs de réseaux électriques se mobilisent pour identifier et mettre en œuvre des leviers de prévention et de résilience en conséquence.
Sensibiliser aux blackouts pour mieux les gérer lorsqu’ils adviennent : une prévention collective face à l’impossible risque zéro
Si nous avons déjà évoqué que le blackout n’est pas un impensé dans le monde de la recherche, le blackout est encore moins un impensé au sein des gestionnaires de réseau, dont la doctrine en Europe comme en France est une approche de prévention par le déploiement de systèmes automatiques de protection et d’équipes de gestion, d’analyse et de prévention. Ces éléments, techniques et humains, ont un but commun : gérer le réseau et disposer de plans de reconstitution du réseau en cas de black-start.
Mais parce que le risque est systémique, la sensibilisation, l’appropriation et la capacité de réaction doivent incontestablement dépasser le cercle des précédents acteurs et atteindre les sphères civiles, sociales, sociales, économiques et territoriales.

Cette sensibilisation sur les risques de blackout peut paraître délicate. Pourtant une telle communication est possible, à l’instar de ce qui est fait par le gouvernement fédéral en Allemagne, ou par la sécurité civile en Autriche.
L’objectif de prévention de cette communication est une invitation à se projeter dans la situation pour mieux la comprendre, développer les bons réflexes, notamment de solidarité, et mettre en place des moyens préventifs de résilience pour permettre l’attente du retour à la normale : ouvrir un poste de radio type transistor, limiter les déplacements, avoir une réserve minimale d’argent liquide, d’eau et de nourriture…
Vers une prévention et une résilience sociétale face au risque systémique de blackout dans un nécessaire contexte de transition énergétique
Bien que la crise du 28 avril ait été gérée avec efficacité par les gestionnaires de réseau, on a observé une forme de choc et de sidération chez d’autres acteurs — donc hors du cercle des gestionnaires de réseau — et c’est bien pour cela qu’il faut penser le problème blackout dans des sphères sociales et sociétales plus globalement.
Les activités liées à l’énergie sont responsables de près de 74 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour lutter contre le changement climatique, la décarbonation du secteur passe par une électrification massive et rapide de notre société, basée sur une montée en puissance des énergies décarbonées et en particulier les énergies renouvelables, ce qui fait consensus. Mal géré et mal anticipé, ce contexte, doublé des risques croissants climatiques (réchauffement, évènements climatiques extrêmes…) et géostratégiques (risques de cyberattaques, attaques des infrastructures…) pourrait être favorable à des blackouts.
Ainsi, ce risque de blackout pourrait s’amplifier si nous en restons au paradigme historique de conception d’un réseau principalement architecturé par des sources d’énergie centralisées et pilotables, et pour un usage énergétique par les consommateurs (particuliers et industriels) qui se fasse sans contrainte, par exemple demandant sobriété et flexibilité.
Par ailleurs, les premiers retours de la crise ibérique montrent que les parties de réseau conçues avec une approche décentralisée (c’est-à-dire qui ont une capacité à s’isoler du reste du réseau) ont pu se maintenir, à l’instar de l’université d’Almería alimentée par ses panneaux solaires.
Une capacité technique de production locale peut ainsi créer les conditions d’une résilience robuste, d’autant plus si elle est mobilisée en complément d’une intelligence collective pour être sobre, flexible et solidaire. L’ensemble permet de limiter les impacts du blackout et d’apporter une solution temporaire dans l’attente du rétablissement du réseau.![]()
Wurtz Frédéric a reçu des financements de la Chaire Sobriété & Résilience portée par la Fondation de l'Université Grenoble Alpes
Béatrice Roussillon a reçu des financements de la Chaire Sobriété & Résilience portée par la Fondation de l'Université Grenoble Alpes


![Choléra : l’Angola mise sur la prévention [Africanews Today]](https://static.euronews.com/articles/stories/09/28/23/60/1200x675_cmsv2_be3c7d7e-45bc-5d3b-b12c-bbbdcefc9bff-9282360.jpg)






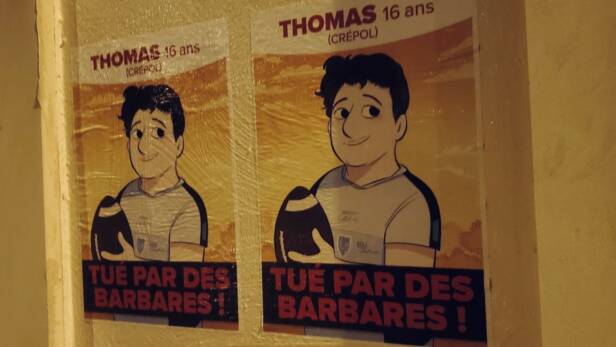
















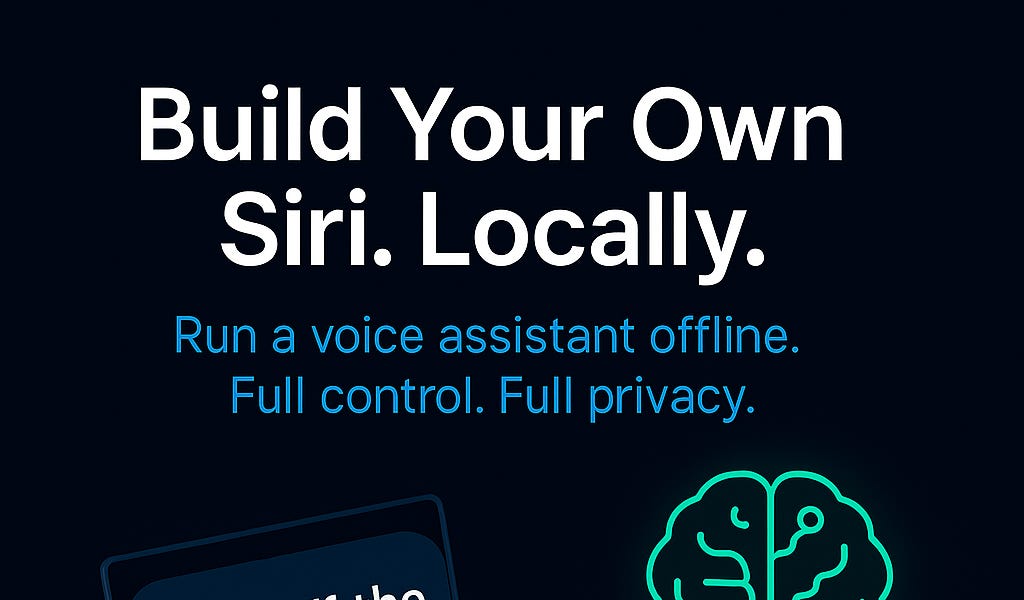







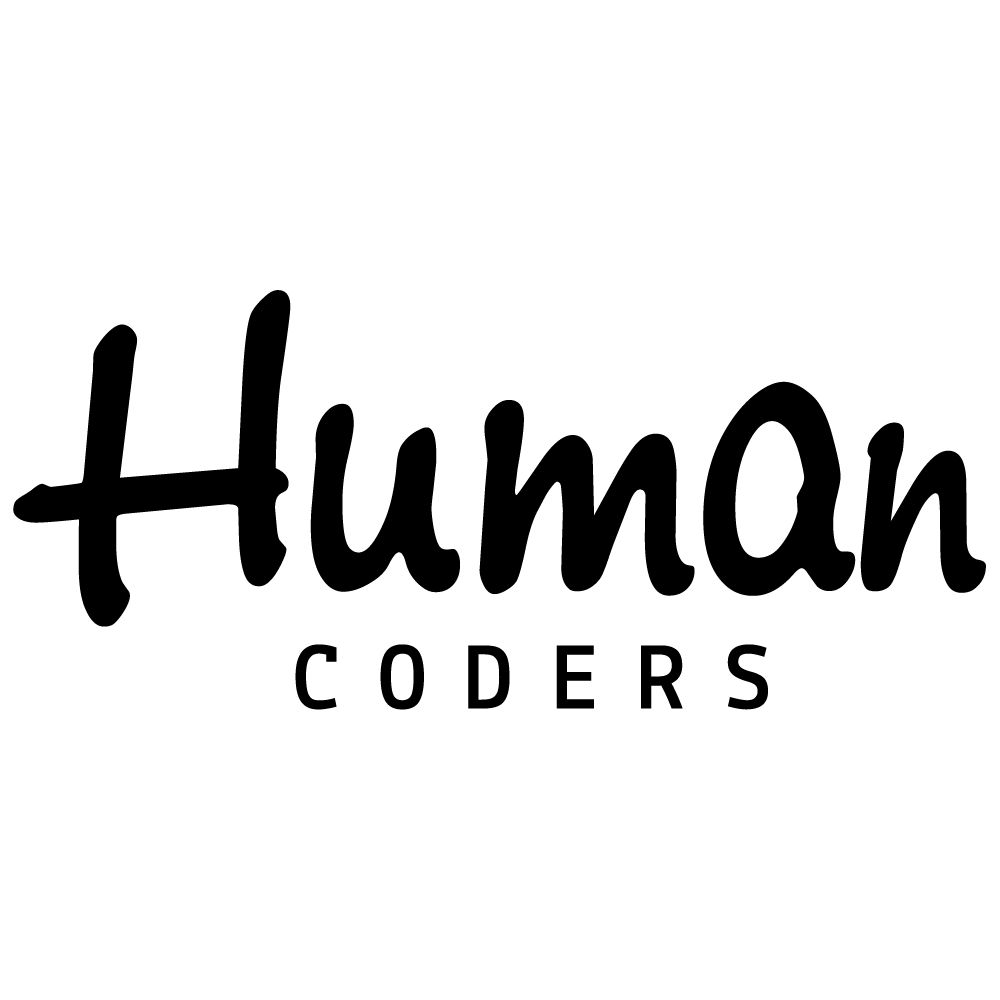
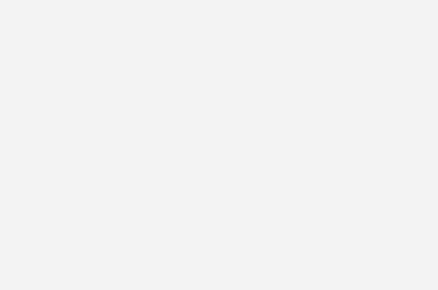


/2025/05/12/fauxparis-682249ca5318e703910796.jpg?#)
/2025/05/12/festival-de-cannes-retour-sur-les-plus-gros-scandales-de-l-evenement-68225b0fad736238314184.jpg?#)
/2025/05/12/video-28-68225e6a8dd59250420407.jpg?#)
/2025/05/12/festival-de-cannes-j-etais-une-jeune-actrice-qui-essayait-de-survivre-juliette-binoche-revient-sur-ses-debuts-sur-le-tapis-rouge-682262188ce90785310633.jpg?#)




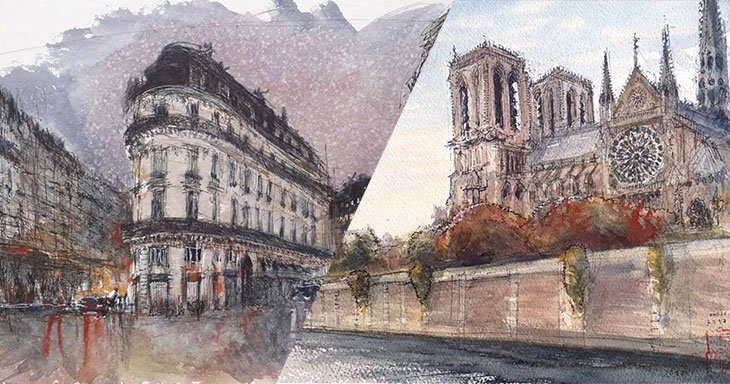

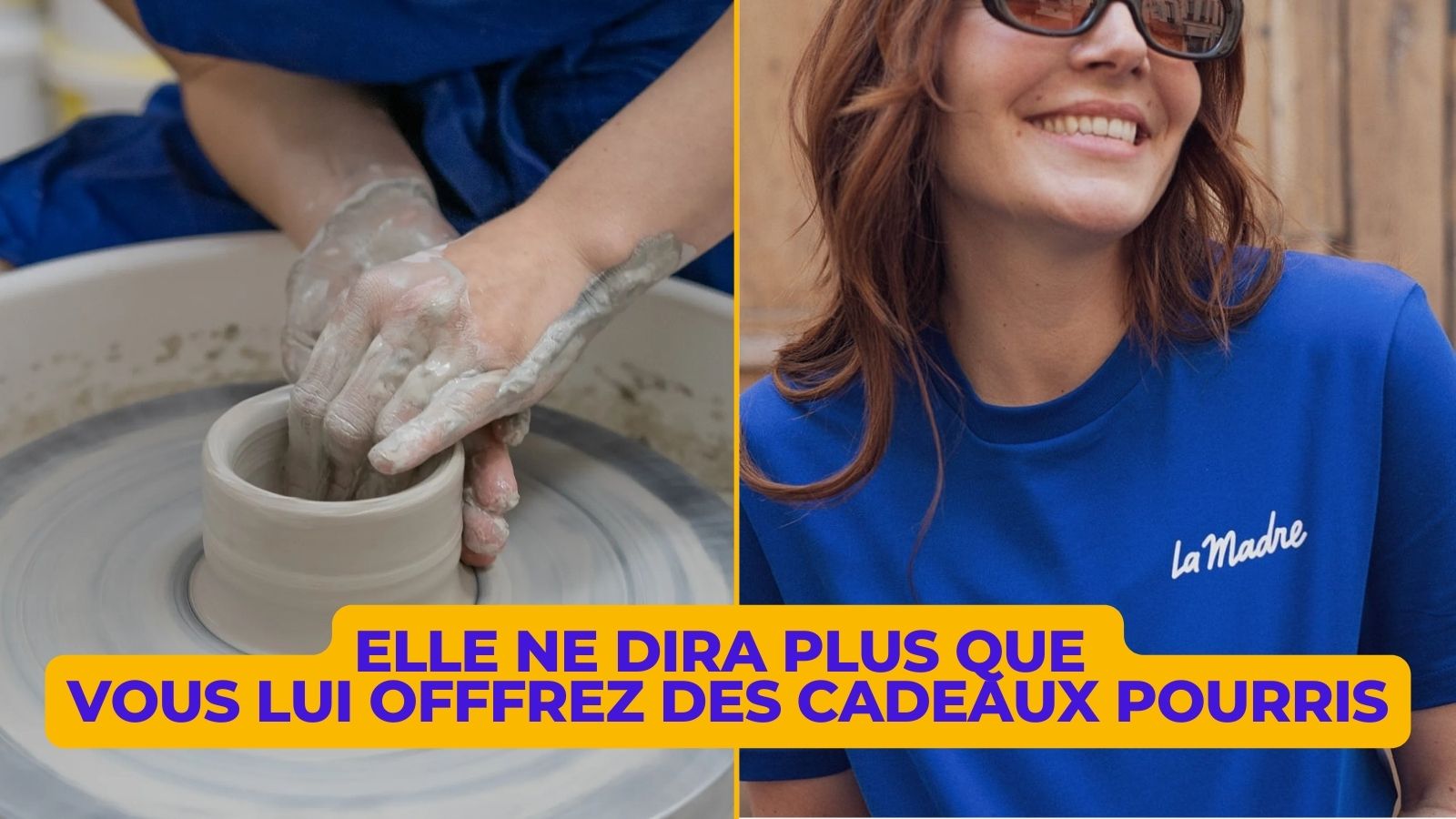

/2025/05/12/video-27-6822558621a00062027265.jpg?#)









/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FL9nDWF6uqMcjvaLjlJyyoBEAViPLOyOP5IN2YFjp.jpeg)