Vidéos sur TikTok et Instagram : un apprentissage social de la mise en scène de soi
Filmer, monter, publier des vidéos sur les réseaux sociaux est désormais une activité centrale dans la vie sociale des jeunes. Mais c’est aussi une activité complexe, voire dangereuse.

Filmer, monter, publier des vidéos sur les réseaux sociaux est désormais une activité centrale dans la vie sociale des jeunes. Mais c’est aussi une activité complexe, voire dangereuse, notamment pour les jeunes femmes. Que filment-elles, que ne filment-elles pas et pourquoi ? Retour sur les enseignements d’une enquête.
Dans un article daté du 12 mars 2025, France 3 Normandie relatait que plusieurs jeunes filles dans le département de la Manche, étaient victimes de fausses vidéos, appelées « deepfakes », à caractère « pornographique et érotique ».
En France, comme dans nombre d’autres pays, les activités liées à la réalisation, à l’édition et au partage de vidéos occupent une place croissante dans la vie sociale. Poster une vidéo sur TikTok, Instagram, WhatsApp ou LinkedIn est un moyen courant de créer du lien avec ses amis ou sa famille, de promouvoir une activité professionnelle, d’exprimer sa créativité, de partager un point de vue politique.
Cependant, la pratique de ces activités par les jeunes est en partie genrée. Sans qu’on en arrive systématiquement à des cas aussi graves que des vidéos falsifiées, on peut dire que, pour les jeunes femmes, publier des vidéos, notamment des vidéos où elles apparaissent, s’inscrit dans un apprentissage plus général de la mise en scène de soi qui comporte des normes, des défis et des risques à gérer.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Afin de mieux comprendre ces dynamiques, nous avons choisi d’interroger, lors d’entretiens approfondis, 19 jeunes femmes âgées de 18 à 21 ans (avec l’aide des étudiantes de licence de sciences de l’éducation de l’Institut catholique de Paris-ICP). Il s’agissait pour nous de saisir le sens donné à ces pratiques par une génération massivement équipée de smartphones, qui a commencé à filmer et à partager des vidéos souvent dès l’adolescence et dont la consommation de contenus audiovisuels, via Instagram ou TikTok, est devenue une activité quotidienne.
Comment conçoivent-elles la réalisation de vidéos ? En produisent-elles elles-mêmes ? Pour quels réseaux sociaux ? Quels dispositifs techniques (appareils, applications) utilisent-elles ? Comment ont-elles appris à réaliser et à diffuser ces images ? Quels rôles jouent les amies, les tutoriels en ligne, les enseignements scolaires et universitaires dans l’apprentissage de ces pratiques ?
(Se) filmer, une pratique quotidienne ?
Pour commencer à caractériser notre échantillon, précisons que toutes les étudiantes interrogées sont des utilisatrices régulières des réseaux sociaux : elles publient des contenus sur Instagram (17 sur 19) et TikTok (16 sur 19). S’y ajoutent YouTube (8 sur 19), SnapChat (7 sur 19) et d’autres applications. Ces réseaux sont quasi exclusivement consultés et utilisés via leur téléphone. Elles y repostent des publications de leurs amies, d’artistes ou d’influenceurs. Elles commentent, likent et publient aussi des textes qu’elles écrivent, des photos qu’elles prennent.
À lire aussi : Deepfakes, vidéos truquées, n’en croyez ni vos yeux ni vos oreilles !
Cependant, filmer et partager une vidéo réalisée par soi relève d’une autre démarche, plus complexe, plus engageante. Notre première interrogation était donc d’identifier dans quelle mesure et avec quelles précautions les enquêtées partageaient des vidéos qu’elles avaient elles-mêmes tournées.
Dans l’entretien, il leur a été demandé de décrire les trois dernières vidéos enregistrées dans leur smartphone. D’emblée, toutes les personnes interrogées confirmaient bien avoir au moins trois vidéos filmées récemment par elles-mêmes, et publiées (à quelques exceptions près) sur l’un ou l’autre des réseaux sociaux cités. En outre, 17 enquêtées sur 19 ont qualifié leur pratique de partage de vidéos de « régulière », 8 sur 19 affirmant même en publier chaque jour, voire plusieurs fois par jour.
Se mettre en scène sans se mettre en danger
Si la dimension technique de la conception de vidéos ne semble pas être perçue par elles comme problématique, c’est bien le fait que les vidéos soient mises en ligne, sur un espace public pas, ou peu, contrôlé qui peut poser des difficultés aux étudiantes – surtout si les vidéos relèvent de mises en scène d’elles-mêmes pouvant être perçues comme une mise en danger.
Ces jeunes femmes s’emparent progressivement et prudemment de ces nouvelles libertés. C’est en tâtonnant qu’elles identifient ce qui peut relever des domaines du privé ou du public. Les options de partage d’Instagram ou de TikTok sont perçues par les utilisatrices comme engageantes vis-à-vis d’elles-mêmes mais aussi de leurs proches. Une partie des enquêtées affirme ainsi n’avoir jamais partagé leurs vidéos qu’en mode privé, c’est-à-dire en les rendant uniquement visibles par leur cercle proche (dans 7 cas sur 19), tandis que cinq d’entre elles expliquent avoir deux comptes, l’un privé et l’autre public, ne partageant en mode public que des contenus qu’elles estiment non dangereux (des vidéos de paysage, de concerts, dans lesquelles elles ne sont pas identifiables).
Ces modes de partages raisonnés découlent notamment de discussions et de négociations avec les parents, les proches et les amies. Les jeunes femmes que nous avons interrogées témoignent ainsi d’une conscience aiguë des dangers qui peuvent les menacer à travers ces activités, comme le détournement de vidéos que 2 enquêtées sur 19 ont eu à subir directement. L’une d’elle raconte l’escalade dans laquelle elle a été emprisonnée :
« C’était la nouvelle copine de mon ex qui voulait à tout prix casser l’image que mon ex avait de moi. Donc elle a pris des photos, elle a créé un faux compte sur Instagram avec mon prénom à moi […] et, de là, elle a contacté un pote de mon ex pour envoyer des nudes en faisant croire que c’était moi. »
Les enquêtées identifient donc bien ces nouveaux procédés parmi les multiples formes de harcèlement en ligne auxquelles sont exposées les femmes. Pour la majorité des étudiantes, heureusement, la création de contenus vidéo ne se résume pas à ces dérives. Elles disent apprendre à scénariser et à monter leurs vidéos, tout en exprimant leur créativité à l’aide d’applications de montage ou de retouche d’image. Certaines indiquent même que ces activités leur donnent un nouveau pouvoir d’agir :
« Moi, ça m’aide à avoir plus confiance en moi, ça m’aide à romantiser un peu mon quotidien et ça m’aide aussi à continuer d’être créative. »
Une perspective professionnalisante
Le fait de développer des compétences vidéographiques est aussi pensé par une partie des enquêtées avec un objectif de professionnalisation. Cela concerne celles qui se destinent aux métiers de l’audiovisuel ou de la communication, mais aussi celles qui visent d’autres types de professions, comme cette étudiante qui voudrait devenir enseignante spécialisée et qui imagine réaliser « des vidéos préventives et des vidéos explicatives, sur les différentes discriminations que peuvent rencontrer des enfants avec des handicaps mentaux. Mais aussi des vidéos explicatives : comment les aider, comment les soutenir et puis même aider d’autres éducateurs spécialisés ou d’autres professeurs des écoles ».
Les stratégies de réalisation et de publication de ces étudiantes font ainsi l’objet d’un apprentissage complexe, en partie autodidacte, fonctionnant par essais et erreurs, s’appuyant sur des tutoriels et sur la reproduction de formats populaires. Cet apprentissage est aussi collectif, co-construit avec les pairs, en tenant compte des réactions et des commentaires suscités par les vidéos partagées, y compris des formes de violence que les garçons du même âge vivent sans doute de manière très différente.
La subtilité qui apparaît dans les pratiques de ces jeunes étudiantes va à l’encontre des clichés sur une génération sans réflexivité et sans repères face aux réseaux sociaux. Ce constat doit cependant être nuancé en rappelant que les compétences numériques, notamment celles ayant trait à la gestion de la vie privée sont en partie liées au niveau social et au capital culturel.![]()
Laurent Tessier a reçu des financements de l'infrastructure de recherche publique française Huma-Num ainsi que de l'initiative EOSC (European Open Science Cloud) lancée par la Commission européenne.
Virginie Tremion ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.










![[SATIRE À VUE] L’incorrigible Lucie fraude dans les transports clermontois](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/t2c-616x283.jpg?#)























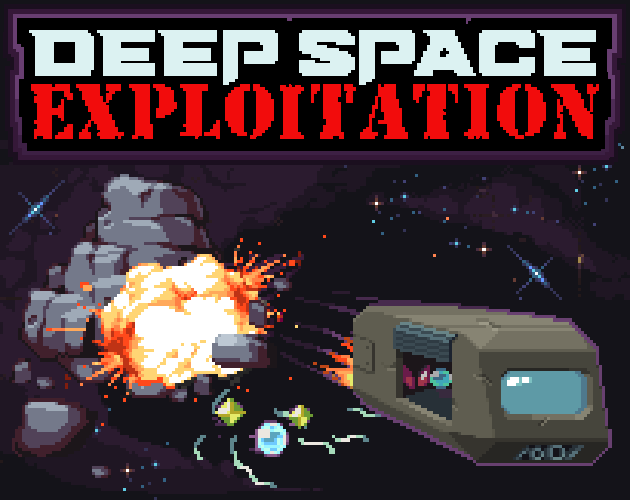




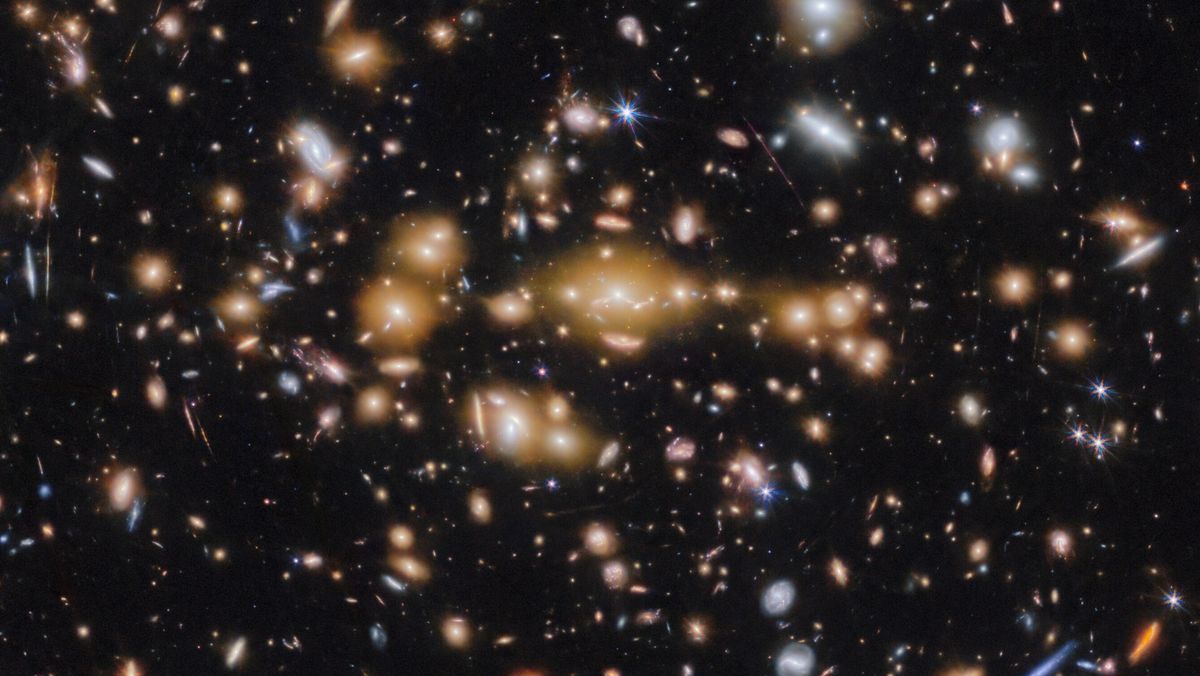















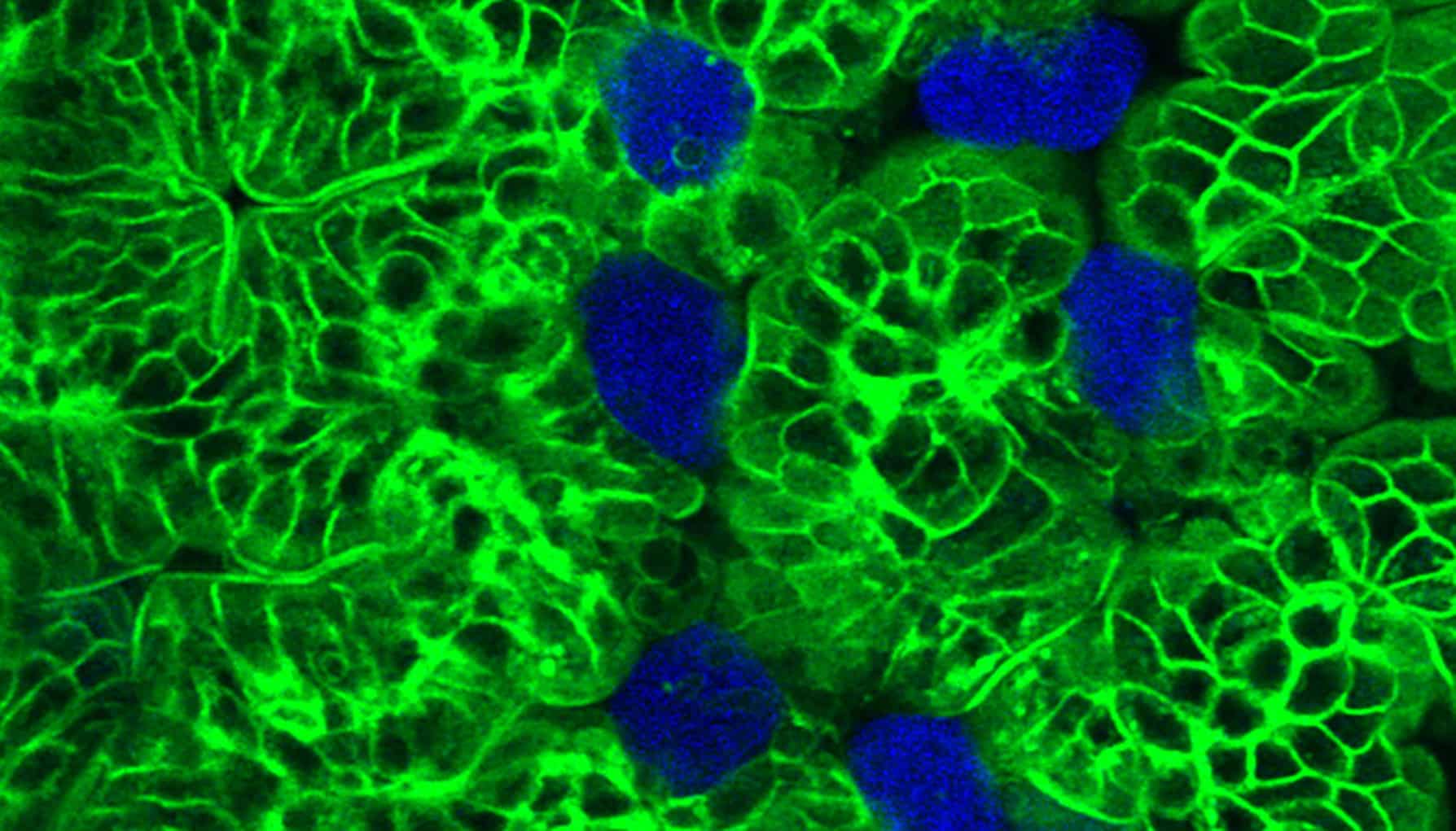
















/2025/05/05/whatsapp-image-2025-05-05-at-08-36-18-681862a939791258496518.jpg?#)