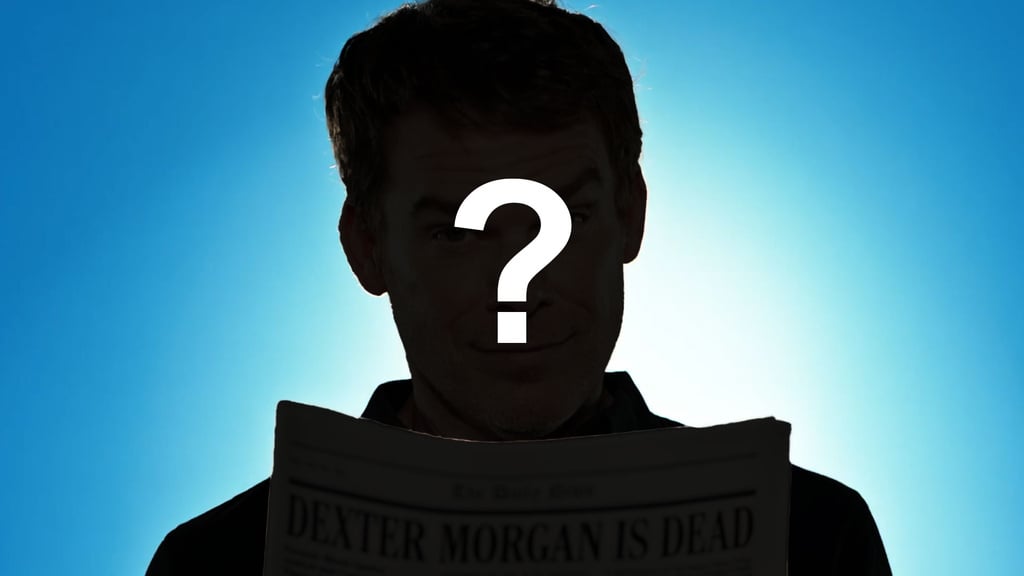Pêches durables : et si on faisait le pari de la nuance ?
Si on veut s’assurer que les promesses de pêche durable soient tenues, il faut d’abord s’interroger sur la façon dont on construit les chiffres et aux mots employés.

L’impact des pêches sur les océans est souvent décrié, mais les débats manquent de nuances. Si on veut s’assurer que les promesses de pêche durable soient tenues, il faut d’abord s’interroger sur la façon dont on construit les chiffres et sur les mots employés.
La pêche est souvent désignée par les médias comme une menace pour les océans. Un rapport de l’IPBES affirmait que son empreinte spatiale couvre 55 % de la surface océanique totale, soit quatre fois celle de l’agriculture. Ces chiffres sont en réalité tirés d’une étude de Global Fishing Watch (GFW), dont les choix méthodologiques méritent d’être interrogés.
En effet, l’empreinte de la pêche varie considérablement selon la résolution spatiale choisie comme montré dans une autre étude. En passant d’une résolution de 0,5 ° (c’est-à-dire, chaque « maille » mesure 3 100 km2 à l’équateur) à 0,01 ° (environ 123 km2 à l’équateur), celle-ci serait divisée par plus de cinq. Ainsi, la pêche occuperait plutôt 9 % des océans à cette échelle plus fine. Se pose aussi la question de sa comparaison à l’empreinte de l’agriculture, dont le calcul s’appuie sur une résolution bien plus fine (86 km2), ce qui tend à minimiser son impact relatif par rapport à la pêche.
Les auteurs de la première étude ont défendu leurs choix en arguant que leur objectif était de représenter non seulement l’empreinte spatiale directe de la pêche, mais aussi son empreinte indirecte sur l’ensemble des habitats de l’aire de répartition des espèces exploitées. Cette distinction est pourtant essentielle, car elle introduit une confusion entre effets de la pêche sur les populations de poisson et ses effets sur leurs habitats. Le risque est alors grand de mélanger deux sujets qui, s’ils ne sont pas sans lien, relèvent de deux logiques différentes.
Si l’on souhaite questionner l’impact environnemental de la pêche, il est donc crucial d’adopter le bon niveau de détail et de prendre en compte toute la complexité liée à la diversité des pratiques. Au-delà des choix méthodologiques, les choix terminologiques importent également pour s’assurer que les promesses de « pêche durable » ne soient pas un vœu pieux.
Pêche « industrielle » ou « artisanale », le choix des mots
Le choix des mots n’est jamais anodin. En matière de pêche, sujet éminemment complexe, les termes employés dans le débat ne sont jamais neutres et peuvent être intentionnellement chargés. Prenons l’exemple de la « pêche industrielle ». Cette expression est souvent opposée à la « pêche artisanale », qui ne repose pourtant sur aucune définition universellement admise.
Pourtant, cette opposition structure de nombreuses discussions, alors que la réalité est bien plus complexe et ne peut pas s’enfermer dans un déterminisme technique opposant les techniques de capture des « petits » et les « gros » navires de pêche, ou encore les arts traînants (ex. chaluts, dragues) et les arts dormants (ex. casiers, lignes). Loin d’être des catégories bien cloisonnées, les multiples formes de pêche s’inscrivent dans un continuum qui intègre notamment lieux de pêche (proche des côtes, en haute mer), caractéristiques des navires (longueur, jauge, puissance), nature active ou passive des engins de pêche, type de propriétaire (artisanal, industriel).

L’Histoire regorge d’exemples de surexploitation des océans par des formes de pêche qualifiées d’artisanales. Au Chili, la pêche du « loco » (Conchelopas conchelopas), un faux ormeau, a failli éradiquer l’espèce en quelques années, alors qu’elle était pratiquée à la main !
De même, d’un point de vue énergétique, certaines formes de pêche industrielle, comme celles pratiquées par les mégachalutiers, pourraient afficher paradoxalement un meilleur bilan carbone à la tonne capturée en raison de leur redoutable efficacité. Les oppositions binaires ne rendent donc pas justice à la diversité et à la complexité des situations, que l’emploi des pêches au pluriel permet d’approcher.
Autre terme problématique : l’« empreinte ». Dans le rapport de l’IPBES cité plus haut, la pêche est désignée comme la principale pression sur la biodiversité marine, en combinant l’empreinte spatiale (le chiffre de 55 % dont on a parlé plus haut) avec d’autres indicateurs biologiques, soit une baisse de 14 % du nombre de prédateurs marins et une surexploitation d’environ 30 % des stocks halieutiques au-delà du « rendement maximum durable », c’est-à-dire le seuil utilisé par les politiques publiques pour qualifier l’état de surexploitation ou non d’un stock donné.
Certes, la surexploitation des océans par la pêche est une question préoccupante, mais il ne faut pas tout confondre. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, si toutes les populations de poissons étaient exploitées durablement, c’est-à-dire en deçà du rendement maximum durable, la pêche demeurerait la principale source de pression sur la biodiversité marine. Il est donc théoriquement possible d’exploiter les ressources halieutiques de façon « durable » tout en ayant un fort niveau d’impact sur la biodiversité marine.
Les paradoxes des pêches françaises
Les données globales sur l’état des stocks halieutiques montrent une dégradation préoccupante. Concernant les stocks « biologiquement viables » (c’est-à-dire « en bon état » – à la fois non surpêché et présentant une biomasse supérieure à un seuil de référence – et « reconstituables » – pour lesquels la pression de pêche est compatible avec une reconstitution des populations), ceux-ci sont passés selon la FAO de 68,9 % en 2017 à 62,3 % en 2021 (hors stocks non classifiés et non évalués).
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Cette moyenne masque toutefois d’importantes disparités régionales :
dans le Pacifique Centre-Est (au large du Mexique et des États-Unis), 84,2 % des stocks sont exploités à des niveaux biologiquement viables, contre seulement 33,3 % dans le Pacifique Sud-Est (au large du Pérou et du Chili).
En Europe, la situation s’est améliorée : l’Atlantique Nord-Est affiche désormais 79,4 % de stocks exploités de manière durable, en nette progression en comparaison de la situation il y a trente ans.
En France, la tendance est également positive par rapport à la situation d’il y a trente ans. En 2022, 63 % des stocks étaient pêchés à des niveaux biologiquement viables – toujours hors stocks non classifiés et non évalués.
Ce chiffre reste inférieur à celui de l’Atlantique Nord-Est, mais il marque un progrès, surtout si l’on considère que la mauvaise situation de la Méditerranée fait baisser la moyenne française. Si l’on raisonne désormais en termes de volume de débarquement, la situation apparaît encore plus favorable : 71,4 % des poissons débarqués en 2022 provenaient de stocks exploités à des niveaux biologiquement viables, contre seulement 28 % en 2000.
On voit ainsi comment le choix des échelles et des indicateurs donne à voir les nuances entre les régions du monde, les façades maritimes hexagonales, entre les ports, etc. Les questions qui traversent les pêches telles que la surexploitation, le « bon » dosage entre les modèles de pêche (et donc la question de la « pêche industrielle ») ou encore la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), par exemple, n’ont pas la même consistance ou réalité en fonction des contextes et échelles. Pour poursuivre sur ce dernier exemple, la pêche INN amalgame en effet des choses très différentes allant du « petit braconnage » – sans vouloir ni le banaliser ni le minorer – jusqu’à une pêche pirate qui repose sur un esclavagisme moderne.
Ainsi, trois principaux paradoxes peuvent être relevés concernant la situation des pêches en France, comparée aux pêcheries mondiales.
La pêche française est en déclin (navires, emplois, et même débarquements), alors qu’elle est en plein essor à l’échelle mondiale.
Les stocks s’améliorent en Europe et en France, alors que leur dégradation se poursuit ailleurs.
La production nationale baisse, alors que la consommation reste stable ; ce qui accroît la dépendance aux importations. La France ne produit plus qu’un quart des produits de la mer qu’elle consomme.
D’une certaine manière, pour alléger la pression sur les stocks qui approvisionnent le marché européen, il est nécessaire de maintenir des volumes de production en Europe et en France. Le risque, dans le cas contraire, serait d’améliorer la situation en Europe et en France tout en externalisant une partie grandissante de la pression de la pêche sur les populations de poisson et sur la biodiversité dans le reste du monde.
Remettre de la nuance dans le débat
Le débat public sur la pêche est souvent marqué par des formules choc : « déforestation marine », « bulldozers des mers », « vider la mer »… Clivantes, ces simplifications sont surtout trompeuses, puisqu’elles éludent bien souvent la diversité des pratiques et des situations.
En France hexagonale, seuls 192 navires dépassent 24 mètres, dont 34 mesurent plus de 40 mètres, sur une flotte totale de 4 200 bateaux. Dans certaines régions, comme les Pays de la Loire, la flotte est composée exclusivement de navires de moins de 25 mètres, patronnés par leur armateur (propriétaire à la barre). Cette réalité contraste avec l’image erronée d’une industrie dominée par d’immenses navires-usines.
L’arbre médiatique du « méga-chalutier » cache souvent la forêt de navires de pêche plutôt petits et vieux (10 m en moyenne et âgé de plus de 30 ans), vulnérables, parfois dangereux et souvent fortement consommateurs de carburant en comparaison de navires plus récents. En faisant l’analogie avec le secteur automobile, c’est un peu comme si en 2025 le modèle de voiture le plus courant était la Renault Twingo 1.
Le nombre de marins pêcheurs en France a chuté de 85 000 à 9 200 en 80 ans. Cette réduction drastique, bien que partiellement compensée par une hausse de la productivité, illustre le déclin d’un métier soumis à de nombreuses contraintes. Pourtant, la transition vers des pêches plus « durables » ne peut se faire sans les pêcheurs.
Il ne s’agit pas de défendre un modèle figé, mais d’accompagner les évolutions nécessaires : réduction de l’impact sur les habitats marins, amélioration de la sélectivité des engins, réduction de la consommation de carburant, maintien d’une rémunération décente et accessibilité des produits de la mer à toutes et tous.
Plutôt que de condamner la pêche de manière uniforme, il est essentiel d’adopter une approche nuancée, loin des stériles oppositions binaires, et de prendre en compte la diversité des pratiques, des contextes et des enjeux. Cela passe par un dialogue constructif entre pêcheurs, politiques, scientifiques, et consommateurs, afin d’élaborer des solutions adaptées à chaque situation.
À force de simplifier à outrance le débat, la question des pêches est aujourd’hui de plus en plus mal posée, rendant plus compliquée leur transition vers la durabilité. Faire le pari de la nuance, c’est s’engager sur un chemin difficile et exigeant, mais c’est la condition pour que les pêches se maintiennent en France et en Europe et plus globalement dans les pays considérés comme « développés ».
Un maintien non pas pour servir un quelconque folklore, mais simplement parce que c’est une activité qui rend de nombreux services à la société tels que contribuer à la souveraineté alimentaire, fournir des emplois à l’année, participer à l’aménagement des territoires, assurer une présence en mer, etc. Et cela, sans aggraver une catastrophe environnementale et sociale à l’autre bout de la planète.![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.








![[CINÉMA] Oxana, un portrait hagiographique de la fondatrice des Femen…](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/oxana-616x347.jpg?#)

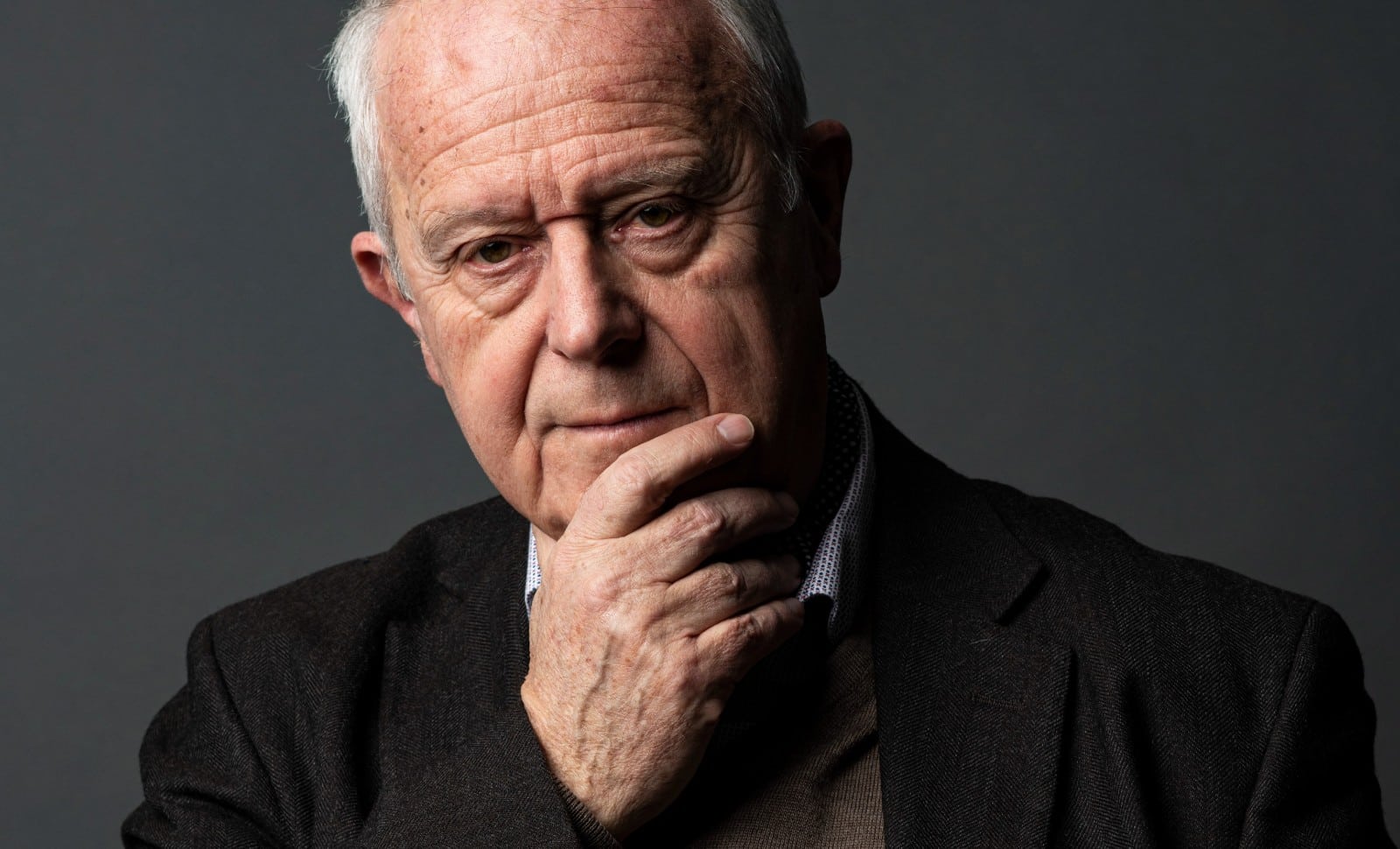



























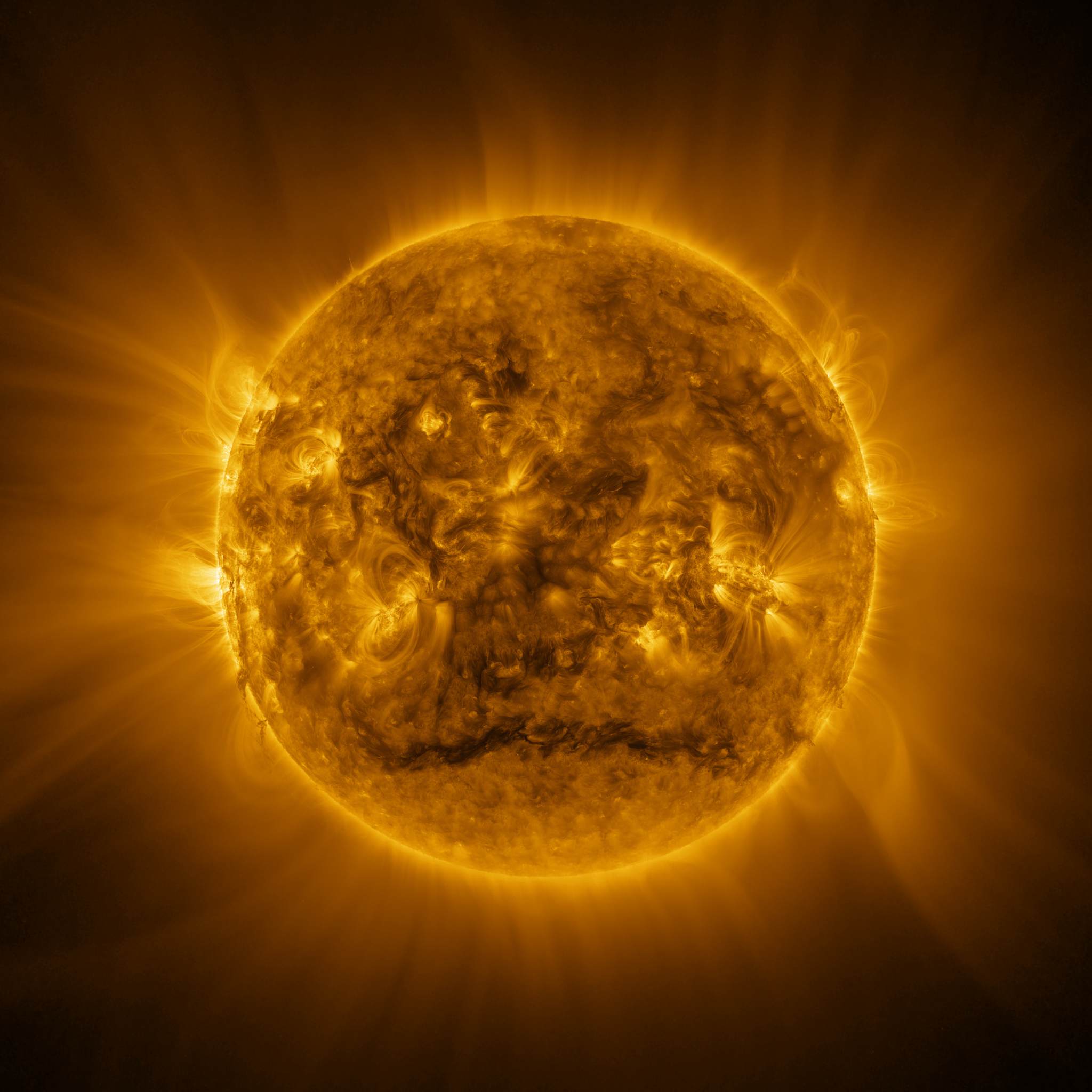


/2025/05/04/000-par7328125-68174c3939fc2906452108.jpg?#)
/2022/05/20/phpGG6TcL.jpg?#)
/2025/05/04/insolite-jamel-debbouze-croise-un-pecheur-de-silure-pres-de-la-seine-a-paris-6817618717999692628964.jpg?#)


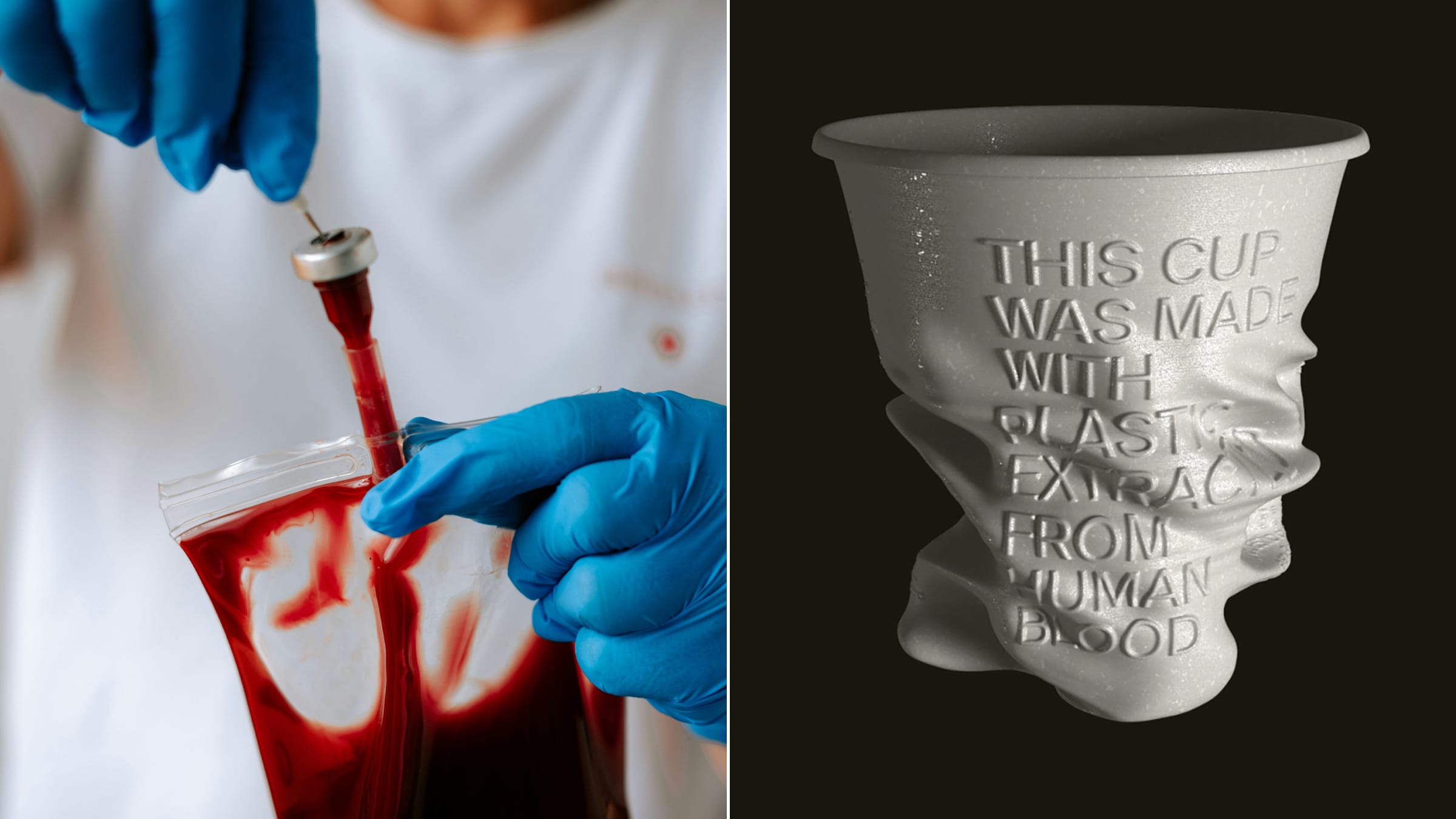


/2025/05/02/haumont-6814cd7ec0d4b492962924.jpg?#)









/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)