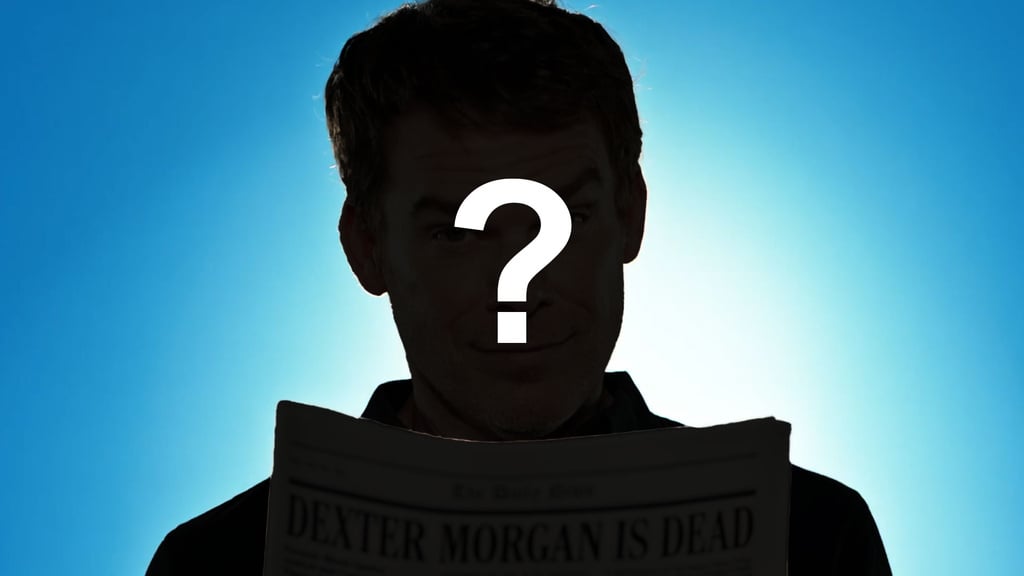Pourquoi il ne faut jamais laisser un homme d’affaires gouverner un État, ni un politicien diriger une entreprise…
Qui qu’il soit au départ, quels que soient leurs buts, tous finissent obsédés par la même exigence : protéger et accumuler le capital en maximisant la rentabilité des investissements.


Donald Trump, Silvio Berlusconi, Bernard Tapie, les exemples d’hommes d’affaires devenus hommes politiques sont légion. Qui qu’il soit au départ, quels que soient leurs buts, leur conception du monde, leurs valeurs morales, tous sont exposés à la même déformation professionnelle, et tous finissent obsédés par la même exigence : protéger et accumuler le capital en maximisant la rentabilité des investissements.
Donald Trump est un homme d’affaires, il en est fier et il s’en vante. Il entend diriger l’Amérique comme il dirige ses affaires immobilières. Quel que soit le sujet, il prétend faire des deals et se comporte en stratège tout puissant, supposé briser toute opposition sur son passage.
Pour un chercheur qui a étudié de près des hommes d’affaires comme Francis Bouygues, Ingvar Kamprad (Ikea), François Pinault ou Bernard Arnault, d’abord comme doctorant de Pierre Bourdieu, puis comme consultant, et enfin, comme chercheur universitaire, les conduites de Donald Trump paraissent familières. Même si, dans son cas, elles prennent un tour extrême… voire, caricatural.
Dans le livre que j’ai publié en 2005 avec l’historienne Catherine Vuillermot, nous avons étudié 25 hommes d’affaires qui, en moins de vingt ans, ont fait passer leurs entreprises d’un chiffre d’affaires en millions à des comptes en milliards. En étudiant ces réussites spectaculaires, nous avons compris que le plus important n’est jamais ce que sont les hommes d’affaires, ni d’où ils viennent, ni ce qu’ils disent, mais ce qu’ils font.
Le capital tient le dirigeant
En prenant du recul, on peut avancer une thèse qui s’applique aussi bien aux grands qu’aux petits patrons, à ceux qui réussissent comme à ceux qui sont au bord de la faillite. Qui qu’il soit au départ, quels que soient leurs buts, leur conception du monde, leurs valeurs morales, tous sont exposés à la même déformation professionnelle, et tous finissent obsédés par la même exigence : protéger et accumuler le capital en maximisant la rentabilité des investissements.

Au départ ils sont ingénieurs, financiers, avocats ou commerçants ; issus de familles catholiques, protestantes, musulmanes ou juives. Politiquement, ils sont de droite, mais aussi du centre, de gauche ou d’extrême gauche. Certains sont courtois et raffinés, d’autres grossiers et violents ; certains sont débauchés et d’autres de tranquilles pères de famille. Certains sont cyniques, d’autres sont des moralistes invétérés. Mais une fois à la tête d’un capital, ces personnes deviennent possédées par le capital qu’elles contrôlent, obsédées par les impératifs de sa défense et de sa prospérité. Ce n’est pas le dirigeant qui contrôle le capital, mais le capital qui tient le dirigeant et qui l’oblige.
Ethos des affaires
Instruit par l’expérience, l’homme d’affaires finit par adopter une forme particulière de morale. Au lieu de faire ce qu’il doit, il fait ce qui marche, c’est-à-dire ce qui permet de boucler chaque affaire dans les délais et avec la rentabilité prévue. C’est l’éthos des affaires, que nous avons définies dans les chapitres 4 et 5 de notre livre et que l’on peut évoquer ici brièvement :
« L’homme d’affaires, lorsqu’il se lance, prend des engagements vis-à-vis de tiers (associés, banquiers, salariés, fournisseurs, clients, administrations publiques, famille). S’il ne tient pas ses engagements, il sera discrédité. Le temps se présente pour lui comme un compte à rebours : il y a des échéances à tenir, des emprunts à rembourser, des impôts et des taxes à payer, des salaires à verser. Il lui faut donc tirer de l’entreprise suffisamment de ressources financières, dans les délais. »
Pour ce faire, il s’appuie sur un réseau d’alliés (co-investisseurs, banquiers, salariés, fournisseurs, clients…) dont il faut obtenir la loyauté de gré ou de force. Si leur contribution est insuffisante, il s’en débarrasse et noue d’autres alliances. Autrement dit, l’homme d’affaires se montre généreux avec ses amis et impitoyable avec ses ennemis. Ses amis sont ceux qui contribuent à la prospérité de l’entreprise et les ennemies, ceux qui y font obstacle. S’il s’écarte de l’éthos des affaires pour privilégier d’autres valeurs, il compromet le retour sur investissement des capitaux, et prend le risque d’être destitué ou de voir son entreprise être rachetée ou disparaitre.
Les affaires sont les affaires
Gagner suffisamment d’argent est une tâche difficile et ceux qui s’y livrent s’exposent à une déformation professionnelle qu’on qualifie de « dureté en affaire ». Il vaudrait mieux la nommer « intelligence des affaires ». Ceux qui s’y livrent avec succès, même s’ils ont été décriés, bénéficient en fin de carrière d’une réévaluation conséquentialiste de leur carrière. On oublie vite les débuts sulfureux de l’homme d’affaires pour célébrer les bénéfices tirés de sa réussite. (cf. les artistes et François Pinault).
La célèbre formule d’Octave Mirbeau : « Les affaires sont les affaires » est bien plus qu’une tautologie, c’est une explication de la manière dont le capitalisme modifie ceux qui s’y livrent.
Gouverner une cité, ce n’est pas être généreux avec ses amis et impitoyable avec ses ennemis. En politique, cela s’appelle du népotisme et de la corruption. Cela conduit à dresser les uns contre les autres jusqu’à ce que se développe la guerre de tous contre tous. L’obsession de la rentabilité des opérations ne peut suffire à entretenir le vivre ensemble. Maintenir la liberté, l’égalité et la fraternité à des seuils acceptables n’a rien à voir avec accumuler du capital.
À lire aussi : Trump 2.0 : l’arrivée au pouvoir d’une élite « anti-élite »
Il est étrange que des idées aussi simples soient si difficiles à faire partager, avec d’un côté l’idée stupide de gouverner un état comme on gouverne une entreprise. De l’autre, l’idée non moins stupide de transformer les chefs d’entreprises en entrepreneurs moraux censés prendre en compte « les intérêts de toutes les parties prenantes », et de faire de la RSE au lieu de faire leur métier : investir le capital pour en tirer le maximum de rendement !
Sans doute les états ont-ils besoin d’être administrés de façon plus efficace et plus efficiente, mais l’efficacité et l’efficience sont des problèmes d’ingénieurs, pas d’hommes d’affaires !
Trump et Berlusconi
Donald Trump apparaît comme une caricature de l’homme d’affaires. Elle n’est pas sans rappeler les attitudes de patron qu’adoptait Silvio Berlusconi lorsqu’il dirigeait l’Italie. Ces deux personnages nous alertent sur les dangers du mélange des genres : prétendre gouverner un État comme on gouverne une entreprise, c’est souvent devenir un pitre grimaçant qui peut se permettre d’insulter ses partenaires. Ce n’est généralement pas ce que font les hommes d’affaires en ascension, qui restent discrets pour mieux réussir leurs coups. Berlusconi comme Trump ont accédé au pouvoir sur leur réputation de businessmen à succès. Une fois en politique, leur psychologie est restée bloquée dans une logique de pertes et profits.
Dans la Grèce antique, les personnages devenus trop puissants étaient ostracisés car on considérait qu’ils menaçaient l’ordre démocratique de la cité. Les États-Unis de Trump, comme l’Italie de Berlusconi, ont choisi d’avoir recours à des patrons vieillissants, censés rétablir l’ordre et la justice en transposant la logique des affaires à la réforme d’un État supposé corrompu par des élites décadentes. Leur réputation de milliardaire a fait office de preuve de leur compétence. Dommage que leur électorat ne se soit pas penché sur la façon dont ils ont bâti leur fortune.
Et en France ? Nos grands hommes d’affaires ont acheté la presse et les médias, financé des Think Tanks, aidé des présidentiables, mais pour l’instant, aucun n’a brigué la présidence. Nous sommes plutôt sujets à des transferts inversés : ce sont les hauts fonctionnaires et les membres des cabinets ministériels qui vont pantoufler dans nos grandes entreprises, comme ces jours-ci, Alexis Kohler à la Société Générale. C’est une autre forme de mélange des genres ou bien, pour parler comme Pierre Bourdieu, de transfert de capital d’un champ à un autre, comme si les enjeux et les règles du jeu étaient les mêmes : faire carrière ! Qu’on soit en Amérique ou en France, les élites passent leur temps à jouer au tennis sur un terrain de football, ou au football sur un terrain de tennis. Où est l’arbitre ?![]()
Michel Villette ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[CINÉMA] Oxana, un portrait hagiographique de la fondatrice des Femen…](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/oxana-616x347.jpg?#)
































/2025/05/04/000-par7328125-68174c3939fc2906452108.jpg?#)
/2022/05/20/phpGG6TcL.jpg?#)
/2025/05/04/insolite-jamel-debbouze-croise-un-pecheur-de-silure-pres-de-la-seine-a-paris-6817618717999692628964.jpg?#)





/2025/05/02/haumont-6814cd7ec0d4b492962924.jpg?#)








/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)