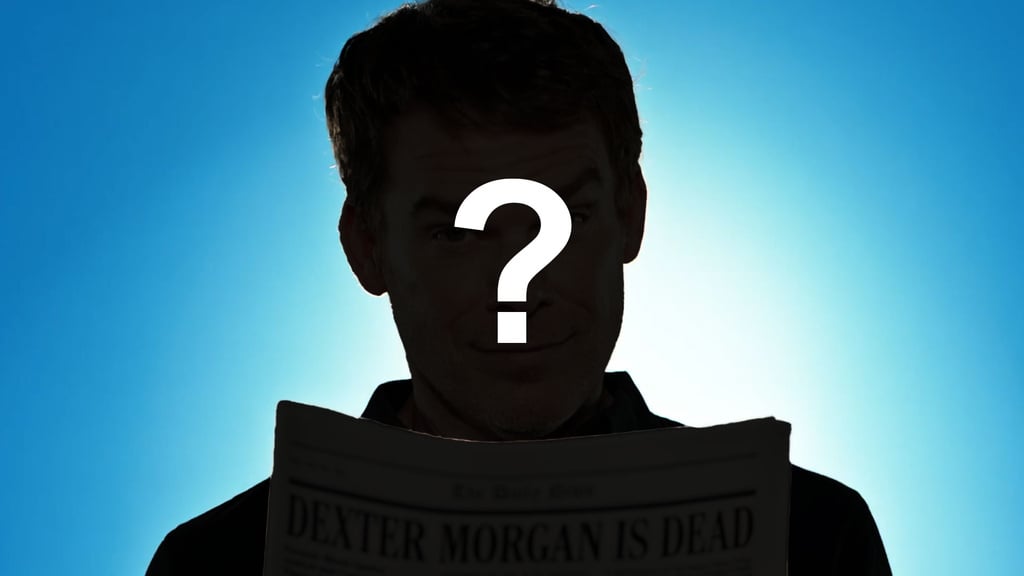Face à la précarité étudiante, les filets de sécurité s’effilochent
Confrontés à des difficultés financières croissantes, les étudiants peuvent de moins en moins compter sur des dispositifs publics de soutien. Éclairage sur les mécanismes de cette précarisation.

Confrontés à des difficultés financières croissantes, les étudiants peuvent de moins en moins compter sur le soutien des pouvoirs publics. Éclairage sur les mécanismes à l’œuvre dans cette précarisation à partir d’une enquête menée à l’échelle d’un campus.
Au lendemain des confinements, la problématique de la précarité étudiante a été mise sur le devant de la scène médiatique. Les images d’étudiants patientant masqués devant les distributions alimentaires ont elles-mêmes nourri la presse pendant plusieurs mois. Mais qu’en est-il quatre ans après ? Les files d’attente se sont-elles dispersées ?
Malheureusement non, puisque dans le contexte d’inflation, et comme a pu l’alerter l’association Cop1 dans son dernier baromètre de la précarité étudiante, la dépendance aux aides alimentaires d’une partie des étudiants n’a cessé de croître.
À lire aussi : À l’université, le cercle vicieux de la précarité étudiante
Si la question de la précarité étudiante est déjà très bien renseignée dans la littérature scientifique, autant à des niveaux nationaux que locaux (en particulier en région parisienne), quelques données sur l’évolution des conditions étudiantes méritent encore d’être exposées. Une lecture sociologique s’avère particulièrement utile pour saisir les liens entre la dégradation des conditions de vie et la reconfiguration des régimes de protection sur lesquels les étudiants peuvent compter.
En 2003, dans une contribution portant sur l’insécurité sociale, le sociologue Robert Castel affirmait déjà que la condition à la protection est de disposer de droits et de ressources minimums pour être indépendant, faire face aux principales menaces sociales et se projeter sereinement dans l’avenir. C’est précisément sur ces paramètres de la vie étudiante, et à partir des résultats d’une enquête menée à l’Université d’Angers, démarrée en 2008, répétée en 2011 et réactualisée en 2022, que notre analyse entend apporter quelques éclairages sur la progression de la précarité étudiante.
Une dégradation des conditions étudiantes
Entre 2008 et 2022, environ un tiers des répondants a déclaré rencontrer des difficultés pour équilibrer son compte. Un tiers, également, évalue sa qualité de vie de seulement « convenable » ou de « mauvaise ». Si les difficultés financières rencontrées par les étudiants sont relativement constantes depuis quinze ans, c’est surtout à des niveaux matériels et alimentaires que les choses se compliquent. Par exemple, 6 % des étudiantes et des étudiants bénéficient aujourd’hui d’une aide alimentaire régulière, contre seulement 1,5 % en 2011.
Au niveau résidentiel, non seulement les actuels étudiants rencontrent davantage de difficulté pour trouver un logement (en 2022-2023, parmi les étudiantes et étudiants décohabitants, 57 % ont déclaré avoir trouvé « très difficilement » ou « assez difficilement » leur logement contre 14 % en 2008-2009), mais, lorsqu’ils en trouvent un, ils déboursent des sommes bien plus importantes.
Le coût moyen pour un studio à Angers s’élève aujourd’hui à 440 € par mois, contre 300 € il y a encore dix ans. La conséquence est double : une partie non négligeable des jeunes se trouve contrainte de rester vivre chez ses parents. Et de plus en plus d’étudiantes ou étudiants vont vivre en dehors de la ville universitaire avec, en prime, des temps de trajets pour se rendre en cours qui augmentent à mesure qu’ils s’éloignent. Si en 2008, un peu plus d’un tiers des étudiants angevins déclaraient vivre dans une autre commune qu’Angers, ils sont désormais 40 %.
À lire aussi : Rechercher un logement : les étudiants face aux inégalités
Outre la dimension matérielle et financière, il importe de souligner la dégradation très nette des conditions relationnelles, sanitaires et psychologiques des étudiants. Ils se sentent bien plus isolés qu’il y a quinze ans : 15 % aujourd’hui, contre 8 % en 2008. Les études semblent également peser davantage, et plus négativement qu’avant, sur le quotidien : 47 % des étudiants jugent que leurs études ont des effets néfastes sur leur santé, contre 38 % en 2008. Et, dans une autre mesure, nous pouvons observer une réelle augmentation des pensées suicidaires : 10 % en 2008, contre 22 % en 2022.
En parallèle, les étudiants interrogés en 2022 ont une vie sociale de moins en moins dense. Ils sont moins nombreux à pratiquer une activité sportive et culturelle ; les festivités étudiantes ont également quelque peu diminué, ce qui est probablement lié aux périodes de confinement. Nous faisons l’observation qu’en 2022, deux étudiants sur cinq déclaraient n’avoir jamais participé à une soirée étudiante depuis le début de leurs études, contre un sur cinq en 2008 et en 2011.
Une reconfiguration des solidarités étudiantes
L’une des principales raisons à cette précarisation des existences étudiantes est à trouver du côté de la reconfiguration voire de l’ébranlement des protections dont disposent les étudiants. Le premier phénomène que nous pouvons observer renvoie à un recul progressif de l’État social.
Malgré la réforme de 2013, nous observons que le montant des bourses n’a pas réellement augmenté. Voire, si l’on prend la médiane, le montant des bourses a même plutôt diminué, passant de 265 € à 179 € par mois entre 2011 et 2022. Cela s’explique en grande partie par la création de l’échelon 0bis en 2013, qui concentre une grande partie des étudiants boursiers (38 % dans notre échantillon) pour une aide qui s’élevait à un peu plus de 100 € par mois en 2022.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
La réforme de 2023 poursuit cette logique, en augmentant marginalement le montant des bourses et en élargissant tout aussi modestement l’éligibilité à ce dispositif. Dans un contexte d’inflation, il est clair que les aides sociales étudiantes actuelles ont une fonction essentiellement palliative.
Aussi, pour contrecarrer les lacunes des pouvoirs publics, l’effort familial a rarement été aussi intense.
Deuxième phénomène donc, les parents aident davantage leurs enfants : le montant médian de l’aide familiale financière est passé de 150 € à 300 € par mois entre 2008 et 2022. Ils sont aussi plus régulièrement présents pour apporter un soutien au quotidien. En cas de coup dur, plus de la moitié des étudiants affirment appeler leurs parents en premier. Évidemment, ce renforcement du rôle familial n’est pas sans conséquences sur les rapports de dépendance ou sur les inégalités sociales en train de se creuser. Toutes les familles n’ont pas les mêmes ressources ni la même disponibilité pour soutenir leurs enfants.
À lire aussi : Précarité étudiante : un vécu lié à l’âge et au soutien familial
Et quand les étudiants manquent de solidarités publiques et/ou familiales, ils n’ont d’autres choix que de se tourner vers d’autres stratégies. Un tiers des étudiants travaille en parallèle de ces études. Près d’un étudiant sur dix a recours à un emprunt. D’autres vont se tourner vers la charité, comme en témoigne l’explosion des cagnottes en ligne.
Enfin, plusieurs vont mettre en place un ensemble de « petites tactiques » quotidiennes dans le but de faire quelques économies, en sautant des repas, en réduisant leurs consommations de certains produits, en réduisant leur vie sociale, etc. Ces formes de débrouilles, particulièrement bien exposées dans le documentaire de Claire Lajeunie la Bourse ou la vie, étudier à tout prix, sont très révélatrices des lacunes de l’État pour protéger la population étudiante.
Un rapport à l’avenir abîmé
Dans ce nouveau contexte, l’avenir est nettement plus incertain pour les étudiants. D’ailleurs, en 2022, seulement 20 % des répondants ont déclaré être confiants en l’avenir, contre 30 % il y a une dizaine d’années.
Cette incertitude, qui va de pair avec un manque de protections durables et efficaces, entraîne des formes d’insécurité sociale significatives dans la population étudiante, et en particulier pour celles et ceux qui sont les plus éloignés des principaux filets de sécurité : à savoir les étrangers et les plus âgés.
In fine, pour certains, la seule issue identifiée est de « réussir » ses examens, de valider son année et d’obtenir un diplôme, pour espérer des « jours meilleurs », sous réserve de réunir les conditions minimales pour aller au bout de ce parcours académique.
Une question se pose : comment garantir à l’ensemble des étudiantes et des étudiants, à l’Université d’Angers ou ailleurs, les supports nécessaires afin de pouvoir gagner en indépendance, en reconnaissance et en sécurité sociale ?
Si les propositions ne manquent pas (allocation universelle d’autonomie, salaire étudiant, etc.), encore faut-il dépasser certaines réticences idéologiques qui font obstacle à la mise en place d’une véritable politique étudiante et, plus largement, à une politique de la jeunesse.![]()
Jaoven Launay ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[CINÉMA] Oxana, un portrait hagiographique de la fondatrice des Femen…](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/oxana-616x347.jpg?#)

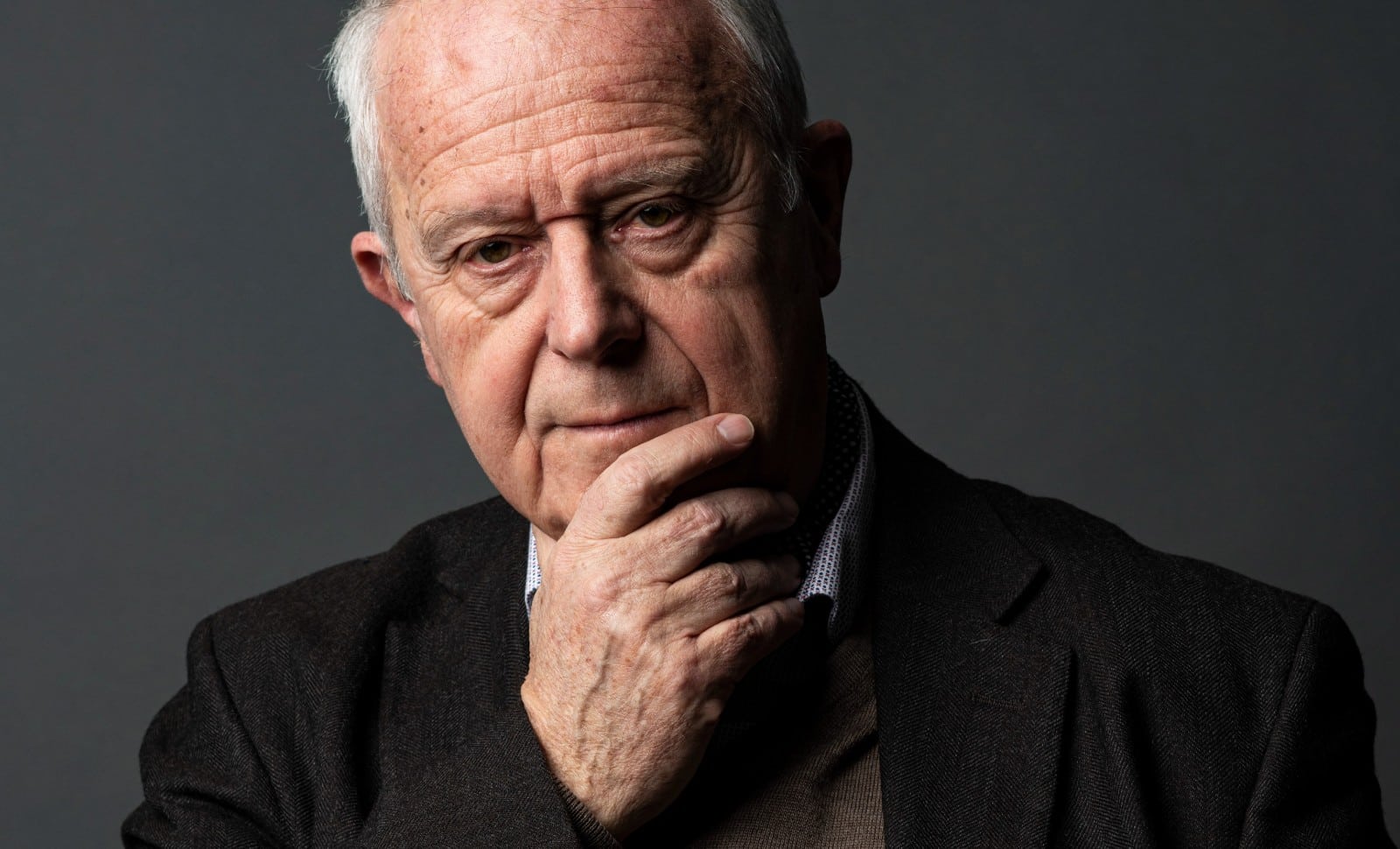



























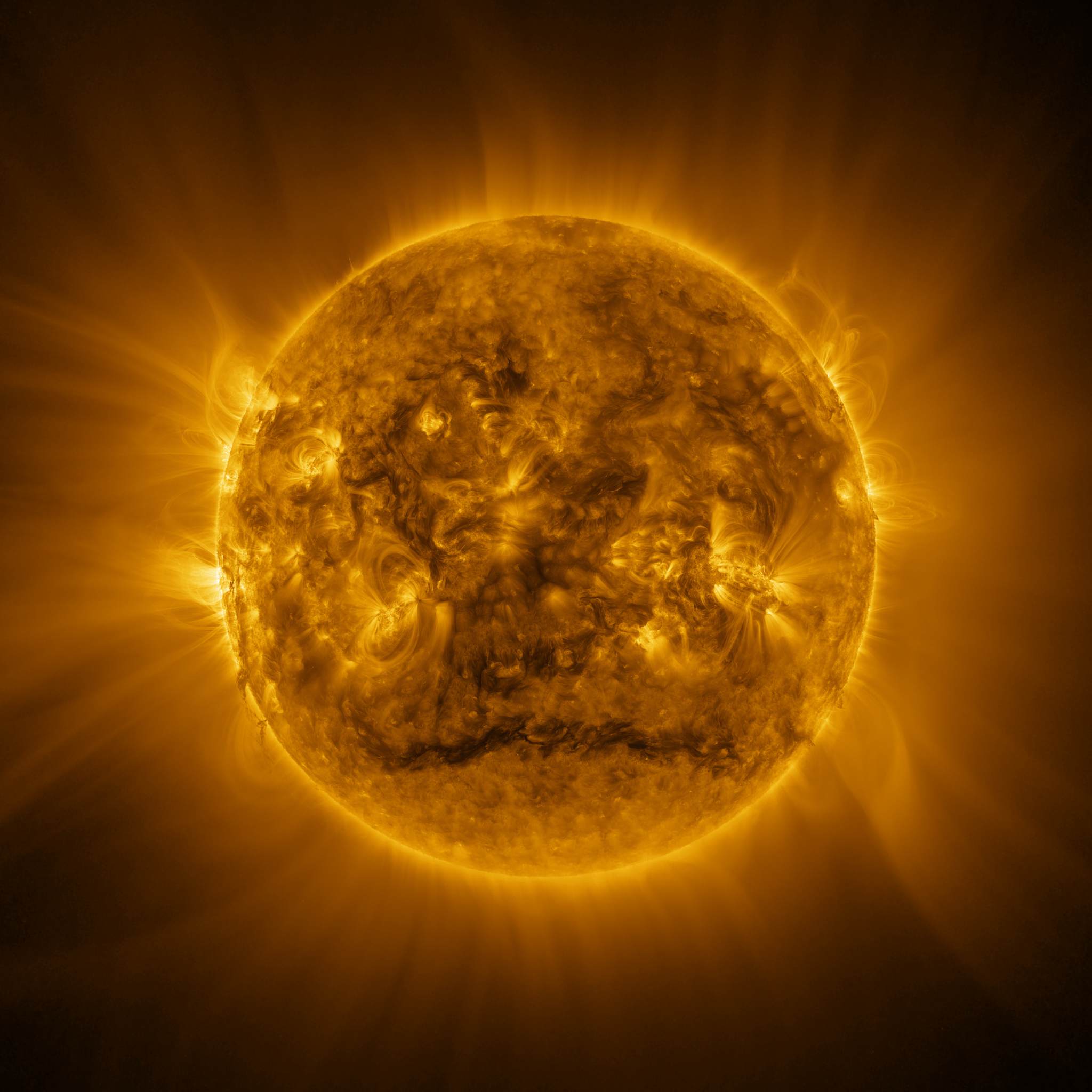


/2025/05/04/000-par7328125-68174c3939fc2906452108.jpg?#)
/2022/05/20/phpGG6TcL.jpg?#)
/2025/05/04/insolite-jamel-debbouze-croise-un-pecheur-de-silure-pres-de-la-seine-a-paris-6817618717999692628964.jpg?#)


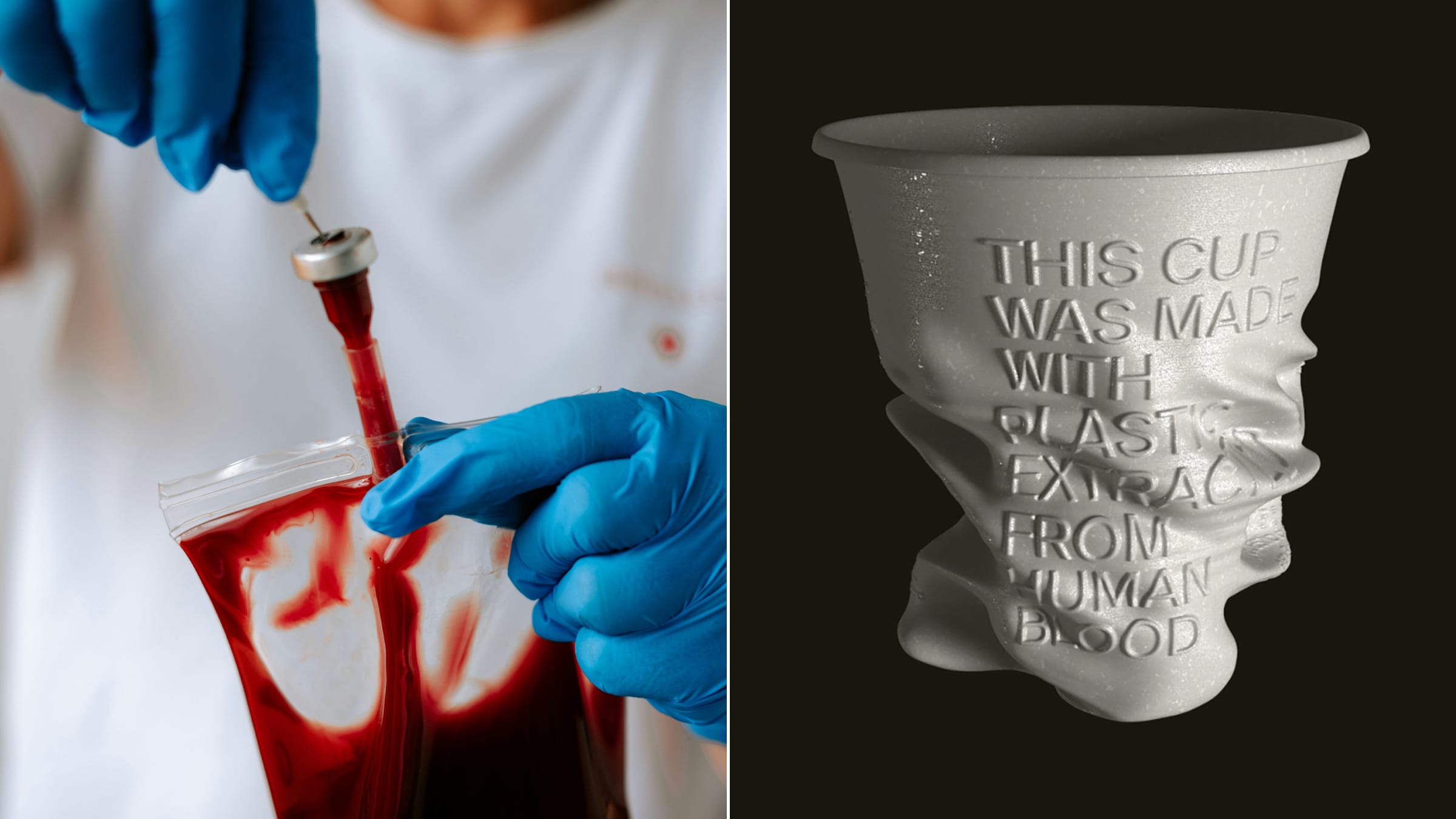


/2025/05/02/haumont-6814cd7ec0d4b492962924.jpg?#)









/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)