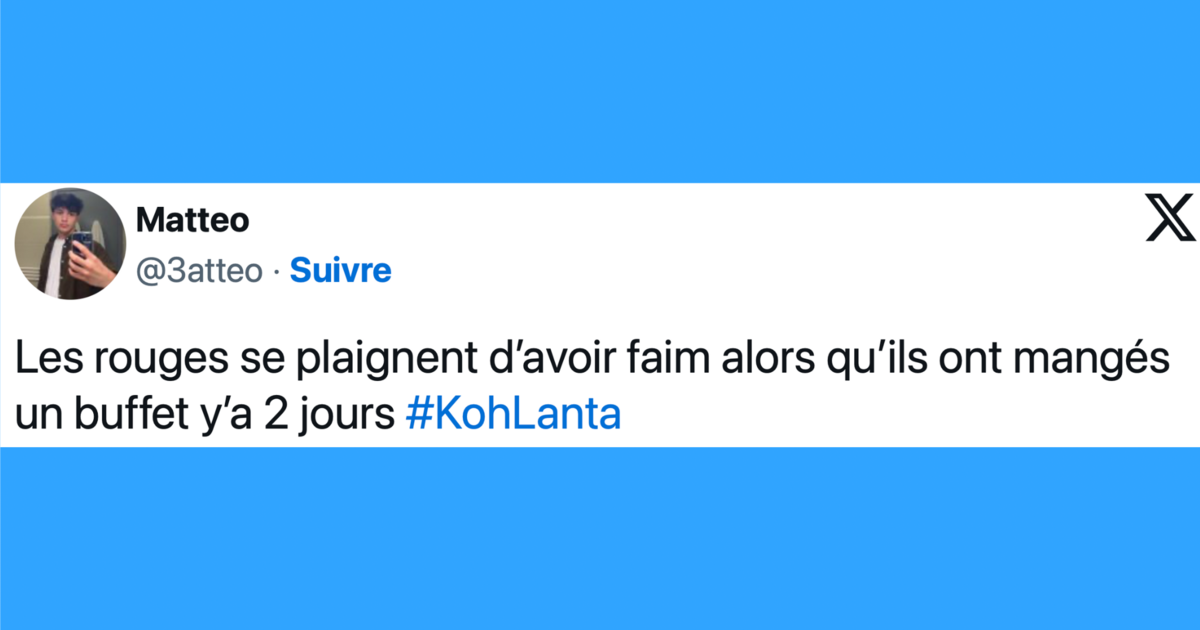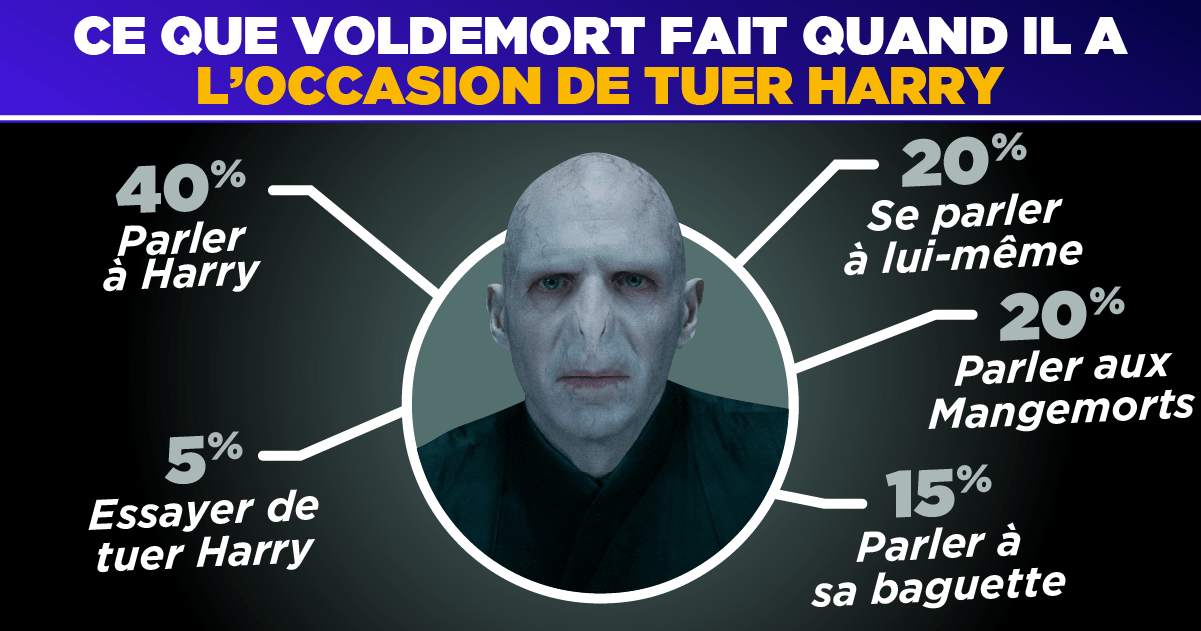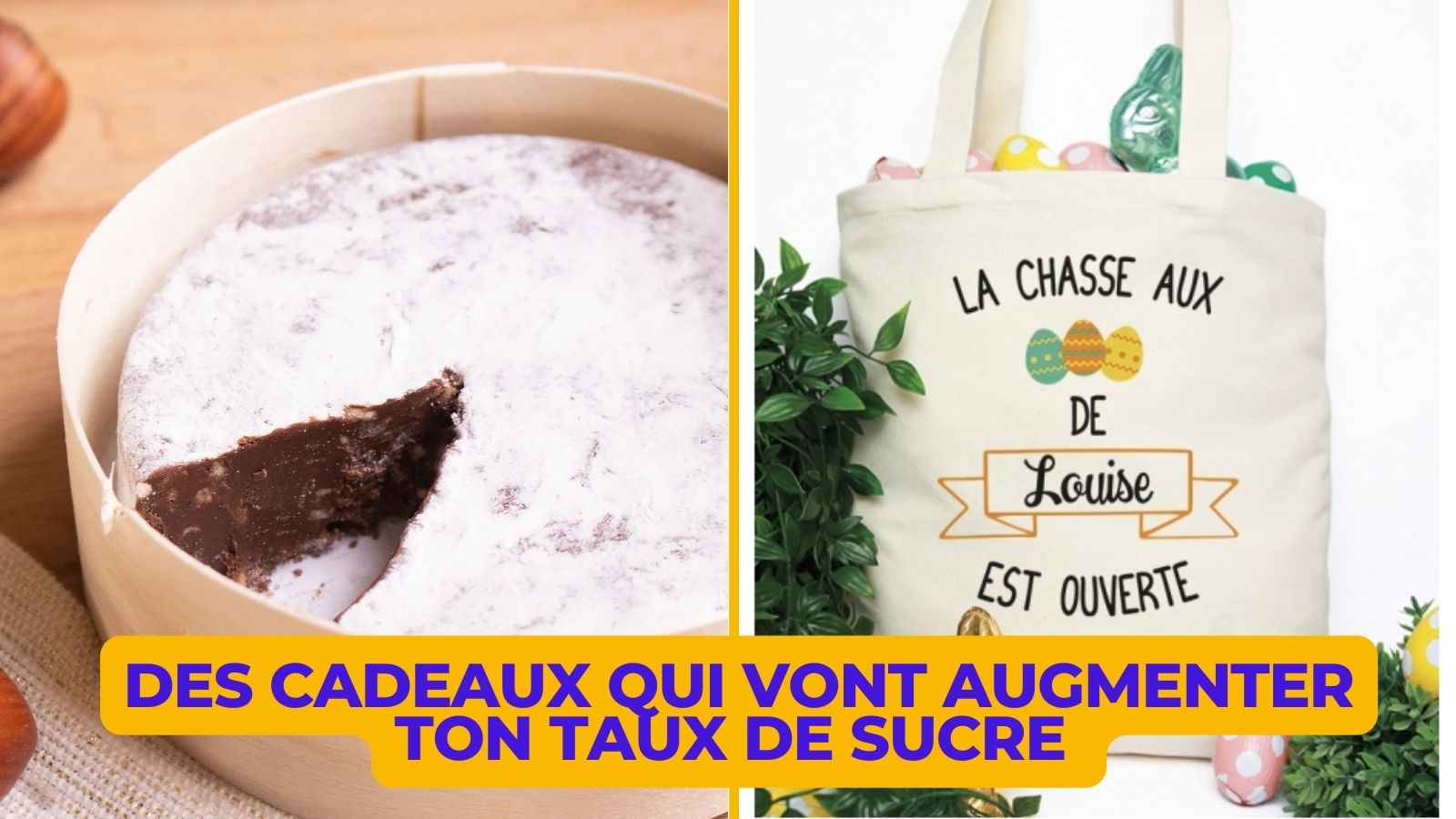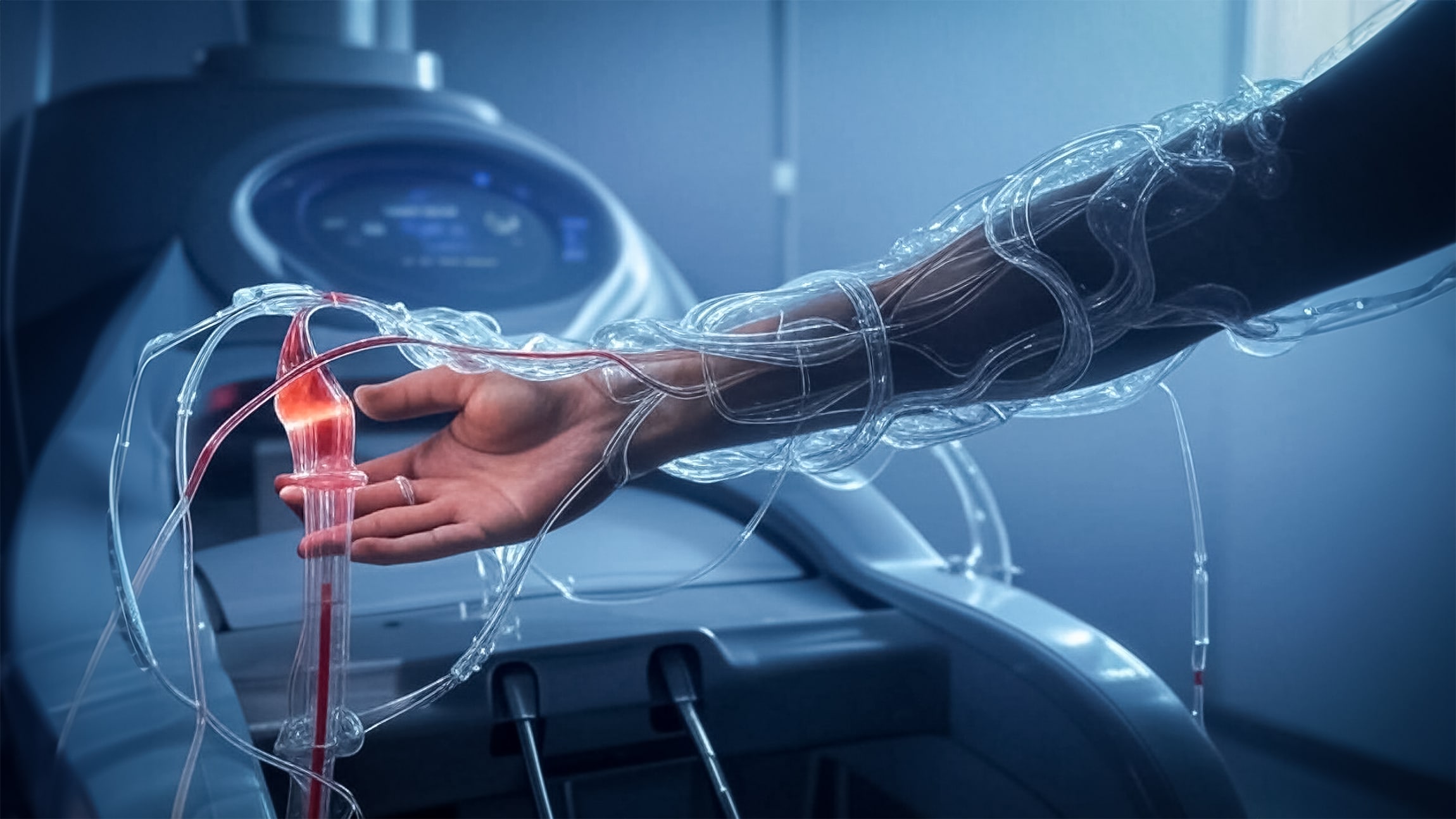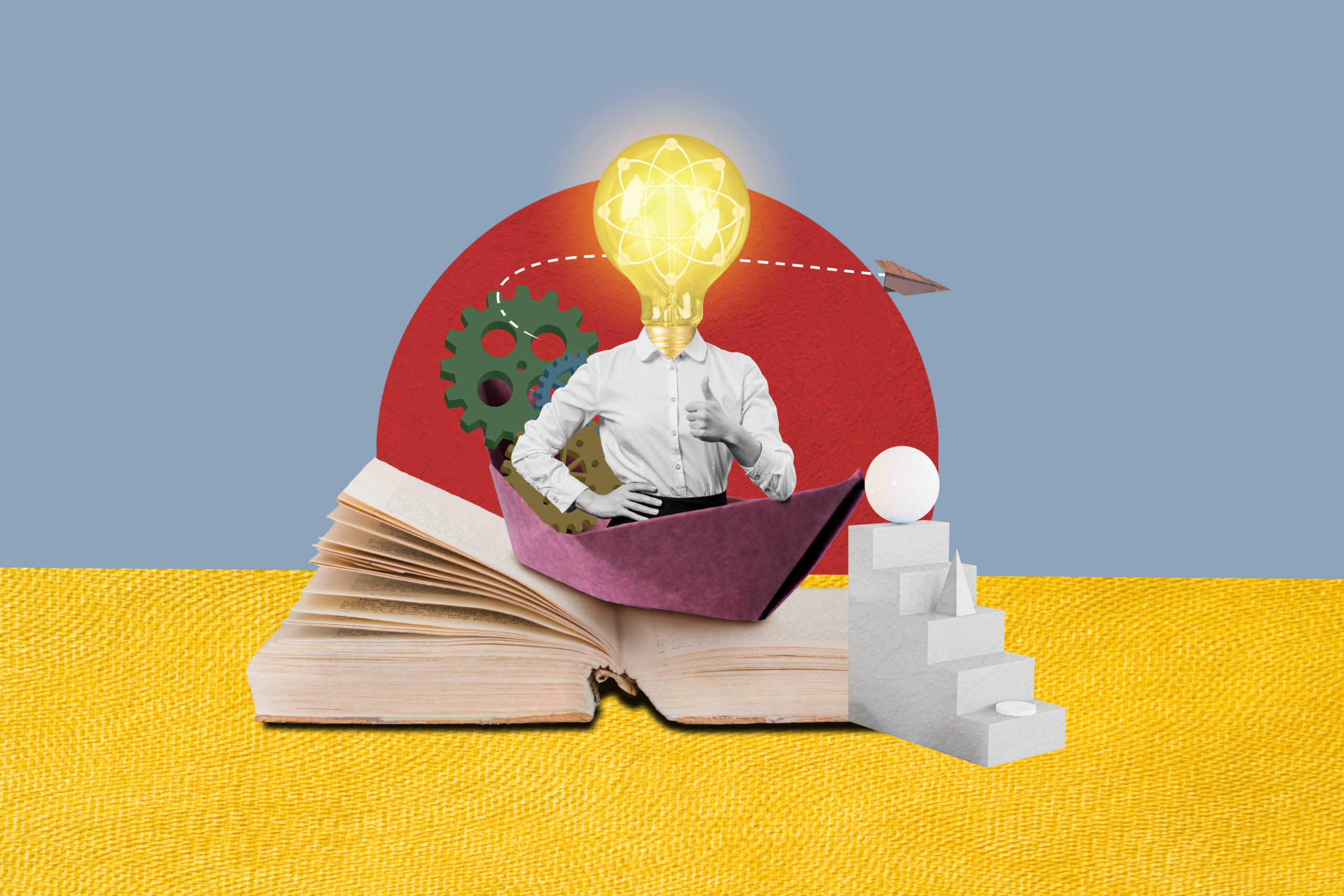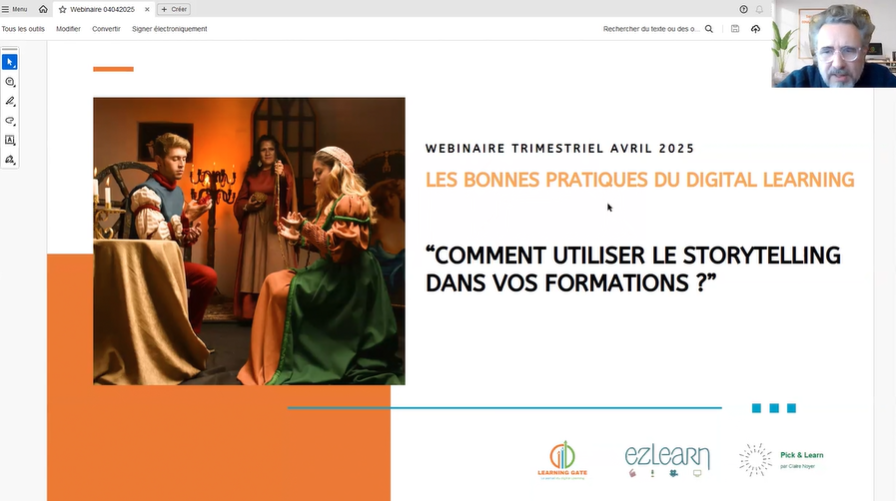Violences sexuelles, scandale de Bétharram : ce que révèlent les archives de l’Église
Le scandale Notre-Dame de Bétharram a relancé la question des violences sexuelles au sein de l’Église et des établissements d’enseignement catholiques. Que fait l’Église pour lutter contre ces crimes ?

Avec le scandale de Notre-Dame de Bétharram, la question des violences sexuelles au sein de l’Église et des établissements d’enseignement catholiques est à nouveau au cœur de l’actualité. Le rapport Sauvé (2021) estimait à 330 000 le nombre de victimes depuis les années 1950 (un tiers des abus auraient été commis dans les établissements scolaires). L’Église, qui a multiplié les dispositifs et communications depuis les années 2000, agit-elle efficacement contre ces crimes ? L’État et la justice civile ont-ils changé de posture face à une institution religieuse très autonome qui a longtemps dissimulé ces violences ? Quid du cas particulier de Bétharram et de François Bayrou ? Entretien avec Thomas Boullu, historien du droit, qui a enquêté au sein des diocèses et des communautés afin de comprendre l’évolution du phénomène.
The Conversation : Comment avez-vous mené votre enquête historique sur les violences sexuelles commises par des prêtres, dans le cadre du rapport Sauvé finalisé en octobre 2021 ?
Thomas Boullu : La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), dirigée par Jean-Marc Sauvé, a proposé à plusieurs équipes de chercheurs d’enquêter sur les abus sexuels sur mineurs et sur les personnes vulnérables au sein de l’Église catholique depuis les années 1950. Une équipe a proposé une méthode d’analyse quantitative aboutissant à une estimation de 330 000 victimes. L’équipe à laquelle j’appartenais a fait un travail historique et qualitatif fondé sur l’étude d’archives.
Pendant deux ans, avec Philippe Portier, Anne Lancien et Paul Airiau, nous avons fouillé 30 archives diocésaines et 14 archives de congrégations de communautés et d’associations de fidèles pour essayer de comprendre ce qui explique la grande occurrence de ces violences sexuelles. Nous avons également utilisé les signalements faits par l'intermédiaire d’une cellule d’appel. Au total, nous avons identifié 1 789 individus auteurs condamnés ou accusés de violences sexuelles.
Sur place, lors de nos visites, l’accueil n’était pas toujours le même. Il était parfois très bon et la collaboration sincère. Dans d’autres cas, on nous a refusé tout accès, comme à Bayonne, dont dépend Notre-Dame de Bétharram. Il est également arrivé que les évêques nous accueillent, mais taisent volontairement l’existence de certaines archives compromettantes. Dans les congrégations et les communautés, l’expérience était toujours particulière. Certaines donnent le sentiment de vivre un peu hors du monde, comme chez les frères de Saint-Jean où mon arrivée coïncidait avec un jour de silence pour l’ensemble des frères. Ce qui n’est pas toujours pratique lorsqu’on enquête…
T. C. : Qu’a fait l’Église pour agir contre les violences sexuelles depuis le rapport Sauvé, il y a plus de trois ans ?
T. B. : La principale réforme est celle de la mise en place de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr) pour les victimes. Cette dernière permet notamment de pallier l'impossibilité pour les victimes de se présenter devant la justice des hommes lorsque les faits sont prescrits ou lorsque l'auteur est décédé.
Au-delà de cette instance, la plupart des diocèses se sont engagés auprès de la justice en concluant des protocoles avec les parquets. Ces accords précisent que l’évêque s’engage à dénoncer ceux des prêtres placés sous son autorité qui sont suspectés d’avoir commis des violences sexuelles. Cette pratique avait commencé avant notre enquête, mais il y a eu une généralisation. Ces accords sont des accords particuliers entre l’Église et l’État. Comme si la dénonciation n’allait pas de soi. Ces protocoles – dont la valeur juridique peut largement être interrogée – sont assez surprenants et semblent, parfois, être un stigmate d’un ancien monde où l’Église fonctionnait à l’écart de la société civile.
Outre ces protocoles, des cellules d’écoute des victimes sont présentes presque partout maintenant dans les diocèses. Elles associent parfois des juristes, des procureurs, des psychologues, représentants d’associations et des membres de l’administration diocésaine. Mais, là encore, cela est piloté par l’Église qui se présente, au regard de ses paroissiens, comme apte à réagir en mettant en place des institutions nouvelles.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Dans sa relation avec les tribunaux laïques (il existe des tribunaux canoniques), comme pour les cellules d’écoute, l’Église reste en partie pensée comme une « société parfaite », capable de gérer ces questions toute seule.
Dans l’ensemble, depuis les années 1950, un nombre important d’instances sur les problématiques sexuelles sont mises en place par l’Église, bien avant la commission Sauvé. Cette dernière réagit, comme elle le fait depuis des siècles, en traitant le problème en interne par la mise en place d’institutions, de politiques, de sanctions, de déplacements. La logique des sanctions prises par l’Église emprunte beaucoup au droit canonique et à son évolution. Il faut rappeler que si l’État limite la juridiction de l’Église à partir du XIVe siècle, cette dernière dispose au cours du Moyen Âge d’une vaste compétence en droit pénal. Contrairement au droit laïque, essentiellement répressif, le droit pénal canonique met en avant la repentance, le pardon, la réinsertion, le salut de l’âme.
Le prêtre fautif peut être amené à faire le jeûne, ou « tenir prison », c’est-à-dire se retirer dans une abbaye ou dans une trappe pour méditer sur ses fautes. On peut également faire l’objet d’un déplacement ou être placé dans des cliniques – réservées aux « prêtres dans la brume ». Ces dernières se multiplient à compter des années 1950 pour soigner les clercs souffrant d’alcoolisme, de maladies psychiatriques ou des auteurs d’agressions sexuelles.
Dans le diocèse de Bayonne, le même que celui de Bétharram, une clinique particulière s’installe à Cambo-les-Bains, entre 1956 et 1962. Elle sera ensuite déplacée à Bruges, près de Bordeaux.
Si sauver l’âme de l’auteur est impossible, reste la sanction ultime : l’excommunication, mais elle est rare.
T. C. : L’Église, qui possède une culture de sanctions propre, se soumet-elle désormais à la justice civile ?
T. B. : L’Église peine à se départir de son propre mode de fonctionnement qui a régi sa politique pendant plusieurs siècles, mais il faut toutefois noter une récente évolution et un rapprochement avec la justice des hommes.
L’Église se transforme du fait de plusieurs dynamiques profondes qui la dépassent, notamment en raison d’une évolution des mentalités collectives vis-à-vis des violences sexuelles. Au XVIIIe ou au XIXe siècles, ce n’est pas l’agresseur sexuel qu’on craint en premier. La société a davantage peur du voleur de nuit qui rôde et qui s’introduit dans les maisons et égorge ses habitants. La figure du criminel « pédophile » comme image du mal absolu est relativement récente. Les écrits de Tony Duvert ou de Gabriel Matzneff sont encore tolérés dans les années 1970-1980. Avec l’affaire Dutroux de 1996, le monde occidental connaît toutefois une nette évolution qui pénètre aussi l’Église : les paroissiens comme les prélats acceptent de plus en plus mal ces infractions.
La deuxième raison qui fait évoluer l’institution, c’est la question de la gestion des risques. En 2001, on a la première condamnation d’un évêque – l’évêque de Bayeux, Monseigneur Pican. Elle donne lieu à de très nombreux courriers au sein de l’épiscopat entre les prêtres eux-mêmes, au sein de la Conférence des évêques de France et même avec le Vatican. Ces courriers montrent bien qu’il y a une inquiétude. Le monde de l’Église se rend compte qu’il s’expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à la prison.
En conséquence, les évêques commencent à consulter des avocats qui leur expliquent que les anciennes pratiques ne sont plus acceptables et les exposent à des condamnations. Une lettre rédigée par un avocat retrouvée dans les archives conseille, par exemple, aux évêques de supprimer les documents compromettants et de changer leur mode de gouvernance.
À partir de 2001, des réunions se tiennent au 106, rue du Bac, à Paris. Elles seront fréquentes et réunissent des évêques, des théologiens et des juristes réputés proches de l’Église. Des documents compromettants y circulent. Ce « groupe du 106 » envisage une communication plus large pour lutter contre ces abus, sans que la justice pénale ne s’en mêle. En 2001, une brochure est distribuée dans l’intégralité des paroisses pour lutter contre la pédophilie. C’est une première initiative qui traduit une évolution.
T. C. : L’Église a-t-elle couvert des crimes sexuels avec la tolérance de la justice ou d’institutions civiles ?
T. B. : Jusque dans les années 1960-1970, de nombreux procureurs acceptent de ne pas engager des poursuites contre un prêtre, voire de ne pas les arrêter, afin de permettre l’extraction du suspect. Les courriers entre les procureurs et les évêques, retrouvés dans les archives, montrent que ces derniers s’engageaient à retirer leur prêtre dans une logique de gestion interne et afin d’interrompre le trouble à l’ordre public. La plupart de ces lettres datent des années 1950.
Par la suite, ces pratiques tendent à reculer. Dans les années 1970, puis encore davantage dans les années 1980, les affaires sont plus difficiles à étouffer pour ces procureurs. La magistrature d’influence catholique recule au profit de nouveaux juges laïcs ou athées. J’ai pu découvrir des archives récentes où les procureurs sollicitent des entretiens avec les évêques pour faire le point comme ils s’adresseraient à des autorités au sein de leur territoire.
Dans ces écrits, il n’y a plus de place pour la dissimulation, mais pour une collaboration au service de la justice civile. C’est ainsi que ces protocoles parquet/diocèse doivent être compris. Des relations particulières entre les procureurs et les évêques peuvent subsister, mais la justice civile domine celle de l’Église. Concrètement, les prêtres et les évêques doivent donc dénoncer les leurs lorsqu’ils ont eu vent d’une agression sexuelle.
T. C. : Qu’avez-vous découvert dans vos archives concernant les relations entre médias et institution religieuse ?
T. B. : Pour que l’Église fonctionne en « société parfaite », elle a longtemps eu besoin de relais. Ces relais se trouvaient dans la magistrature, dans le monde politique et, globalement, dans la plupart des milieux influents. Nos archives nous montrent l’existence de ces relais dans les médias des années 1950, 1960 et 1970.
Des années 1950 aux années 1970, on trouve des lettres de responsables de journaux qui s’adressent à leurs évêques en leur disant : « Cher ami, Monseigneur, j’ai l’information sur notre territoire de plusieurs agressions sexuelles. Bien entendu, je ne ferai pas de papiers, mais, attention, le bruit pourrait s’ébruiter. »
Dans l’autre sens, nous avons trouvé des archives d’évêques qui écrivent au journal local sur le mode « Cher ami, le prêtre X est passé en jugement. Nous vous serions gré de ne pas rédiger d’articles sur ce sujet afin qu’un scandale n’éclabousse pas davantage notre institution ». Et les journaux – dans une logique de bonne collaboration au sein du territoire – acceptent les doléances de l’évêque et ne publient aucune information sur le sujet.
Désormais, l’Église ne bénéficie plus de ces relais. Les médias publient beaucoup sur le sujet des violences sexuelles et n’épargnent plus l’Église.
T. C. : Qu’en est-il des violences sexuelles dans les établissements scolaires à la suite du scandale de Bétharram ? François Bayrou est soupçonné d’avoir protégé cette institution…
T. B. : François Bayrou assume une certaine proximité avec des courants catholiques conservateurs ou faisant l’objet de nombreuses critiques. Il reconnaît en particulier être proche de la communauté des Béatitudes, fondée dans les années 1970 au lendemain du concile Vatican II et qui fait l’objet de très nombreuses plaintes pour phénomène sectaire et pour diverses agressions sexuelles.
Je crois que la question de Bétharram – entendue sous un angle politique – dépasse la simple question de la responsabilité de François Bayrou en matière de non-dénonciation. Elle pose également la question de la pertinence pour un premier ministre d’être proche de cette communauté. Cette dernière procédait à des séances de guérisons collectives et traverse des scandales de manière presque ininterrompue depuis sa fondation. De manière plus large, c’est aussi la question de la frontière entre la foi d’un homme politique et ses actions pour le bien de la nation qui est posée.
T. C. : Dans le rapport Sauvé, un tiers des violences sexuelles dénombrées a lieu dans des établissements catholiques. Élisabeth Borne a déclaré qu’il y aurait un plus grand nombre de contrôles désormais, ils étaient extrêmement faibles jusqu’à présent…
T. B. : Notre étude pointe du doigt les violences sexuelles commises dans les établissements scolaires catholiques. Les violences perpétrées dans les années 1950-1960 ou 1970 sont légion. Elles sont souvent commises en milieu scolaire ou dans le cadre du « petit séminaire » qui, éventuellement, prépare ensuite à une carrière ecclésiale. Dans bon nombre de ces institutions, les enfants dorment alors sur place. Il y a des dortoirs avec des individus chargés de les surveiller, de la promiscuité.
Ce sont les FEC, les Frères des Écoles chrétiennes, qui arrivent en tête des congrégations en termes du nombre d’agresseurs sexuels. D’autres congrégations suivent, comme les Frères maristes ou les Frères de l’instruction de Ploërmel. Si on ajoute les jésuites – qui assurent également des missions d’enseignement –, il y a une nette prévalence de ces institutions par rapport aux autres.
À partir des années 1970, avec un net mouvement de laïcisation et le recul de l’enseignement catholique, les violences sexuelles au sein de ces institutions tendent à diminuer. Ces congrégations enseignantes ont une activité très résiduelle voire nulle aujourd’hui. Les collèges et les lycées privés actuels ne sont guère comparables avec les anciennes institutions et les agressions y sont assurément moins nombreuses.
T. C. : Les violences contemporaines sont plutôt situées dans les diocèses désormais ?
T. B. : Absolument. Si les violences sexuelles au sein des établissements scolaires catholiques continuent à exister, la plupart des agressions ont surtout lieu dans les diocèses, au cœur des paroisses désormais.
Cette évolution se mesure d’ailleurs si l’on observe le profil des victimes et des agresseurs. Dans les années 1950-1960 ou 1970, la victime type identifiée par les archives est un garçon placé auprès des congrégations enseignantes et qui, en moyenne, a entre 7 et 10 ans. Désormais, le profil premier des personnes abusées, ce sont des jeunes filles de 13, 14, 15 ans. Des paroissiennes qui sont au contact du curé et qui ont des liens privilégiés avec lui.
Cas typique : les parents de la victime sont amis avec le curé, fréquemment invité à manger ou à dormir à la maison. Dans d’autres cas, les parents ne s’occupent pas de l’enfant, et le prêtre se considère comme responsable de son éducation. Un rapport de domination s’installe, susceptible de dériver vers une agression.
Le troisième modèle, fréquemment rencontré, est celui mieux connu des centres de vacances ou du scoutisme. C’est le cas dans l’affaire Preynat qui a dérivé sur l’affaire du cardinal Barbarin que les journaux ont largement relayé et dont le scandale est à l’origine de la formation de la commission Sauvé.
T. C. : Quid des violences sexuelles dans les « communautés nouvelles » ?
T. B. : Les communautés nouvelles naissent au cours des années 1970. Elles s'inscrivent dans un mouvement désigné sous le terme de renouveau charismatique qui suppose un rapport particulier avec la grâce et une relation repensée avec Jésus-Christ. J’ai cité les Béatitudes, mais on peut également évoquer le Chemin neuf ou les Puits de Jacob. De manière générale, les années 1970 donnent lieu à la création de nombreuses nouvelles structures ou communautés qui – même si elles se détachent parfois du mouvement charismatique – vont être sévèrement touchées par la question des violences sexuelles.
Dans nombre de ces structures, on note la fréquence de grappes d’agresseurs sexuels. Ces foyers sont souvent à l’écart des villes, dans des endroits un peu reclus, où l’on vit en totale synergie et communauté. À compter des années 1970, les archives montrent que de nombreuses agressions ont lieu dans ces nouvelles communautés. Par exemple, 40 individus ont ainsi été identifiés dans la communauté des Frères de Saint-Jean. En outre, les agresseurs de ces communautés sont davantage multirécidivistes que dans les congrégations enseignantes.
T. C. : Quelle est la sociologie des auteurs de violences sexuelles dans l’Église ?
T. B. : Comme pour les victimes, il y a une évolution du profil des auteurs au cours du siècle. Dans les années 2020, le prêtre agresseur a 58 ans en moyenne alors qu’il n’a que 38 ans en moyenne dans les années 1950. Cette évolution s’explique principalement par le vieillissement progressif de la population cléricale en France. Les jeunes sont également moins concernés actuellement en raison de la qualité de la formation au grand séminaire qui évolue entre les années 1950 et 2020. Sans être absolument centrale, la problématique de la sexualité est un peu mieux appréhendée – ce qui pourrait expliquer le recul des agresseurs jeunes dans nos statistiques.
Propos recueillis par David Bornstein.![]()
Thomas Boullu a reçu des financements de l’Anr (projet fermegé), de la CEF (Ciase).











/2025/04/15/fraude-fiscale-on-est-face-a-une-industrie-de-la-criminalite-organisee-assure-amelie-de-montchalin-ministre-chargee-des-comptes-publics-67fecbb381a3c847726260.jpg?#)







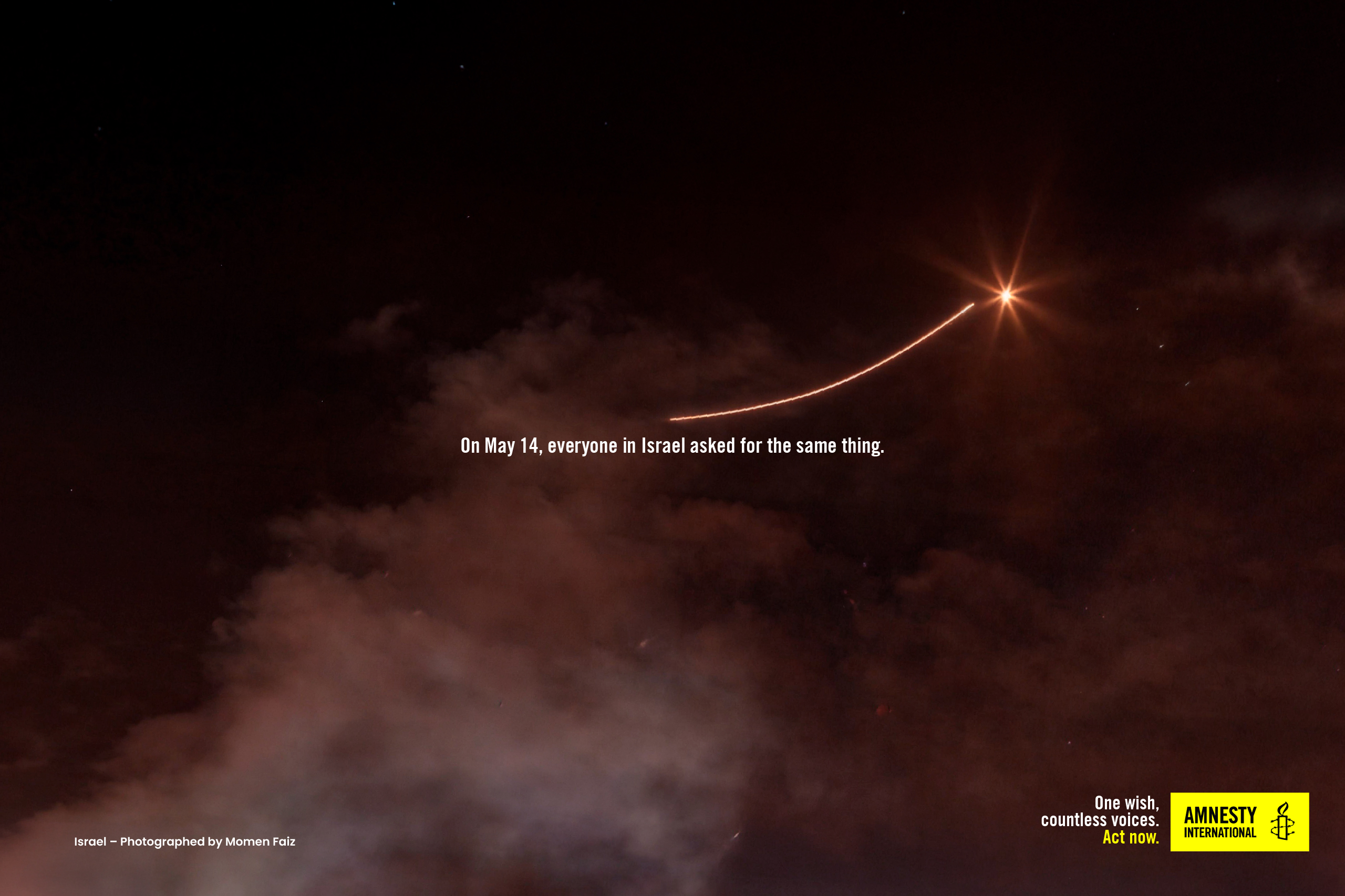



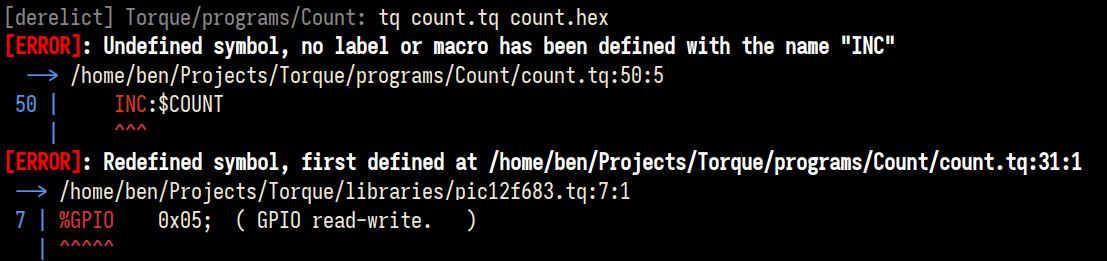
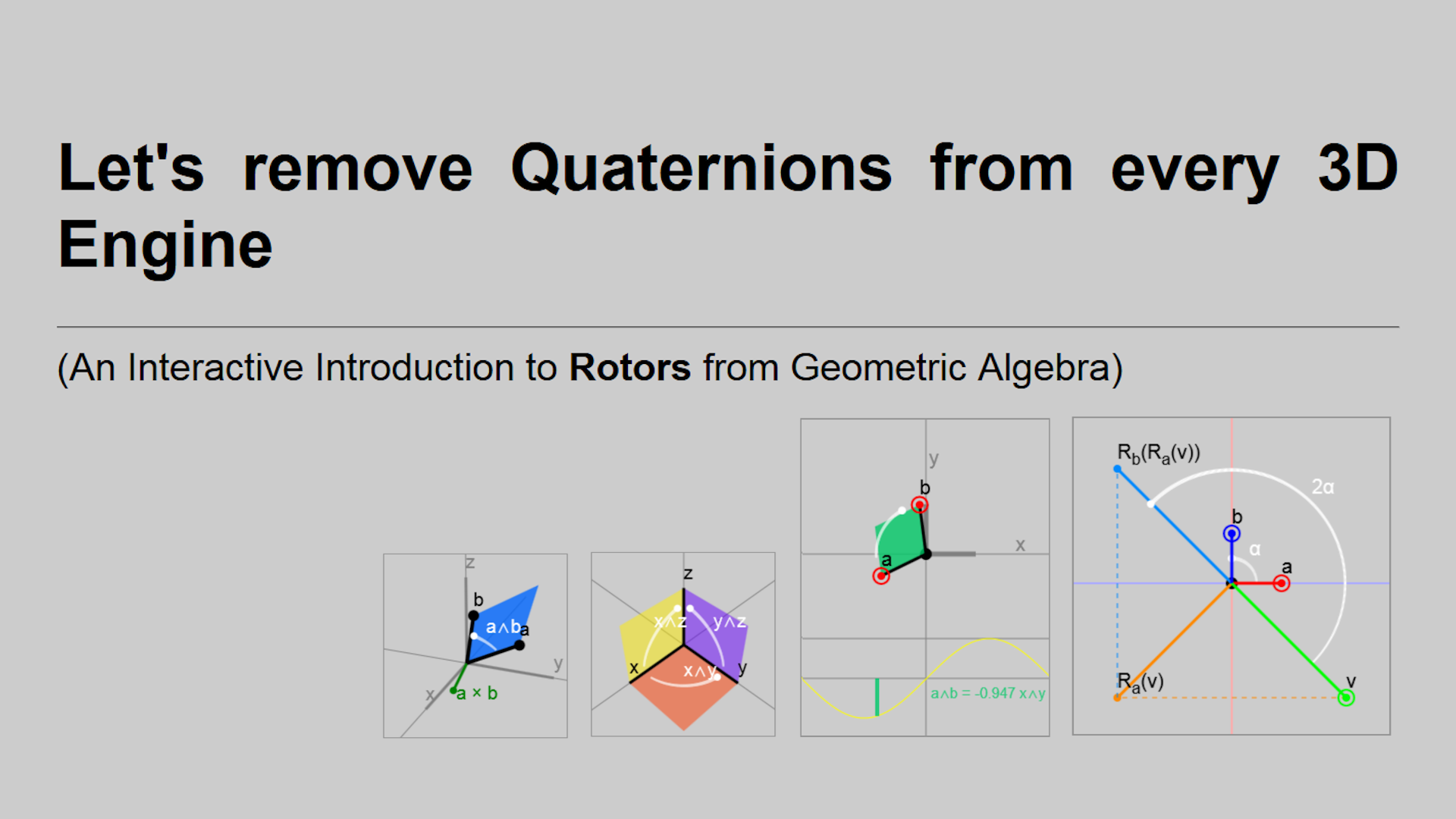







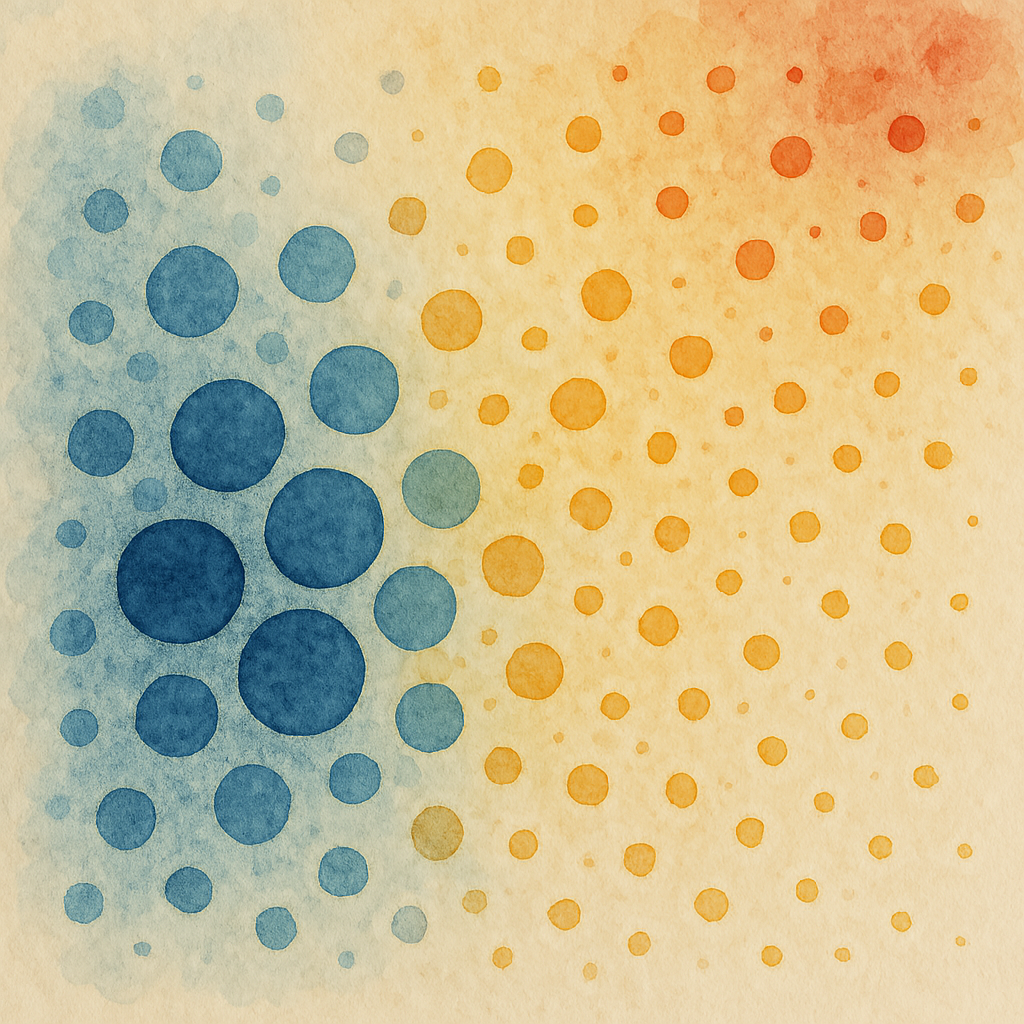
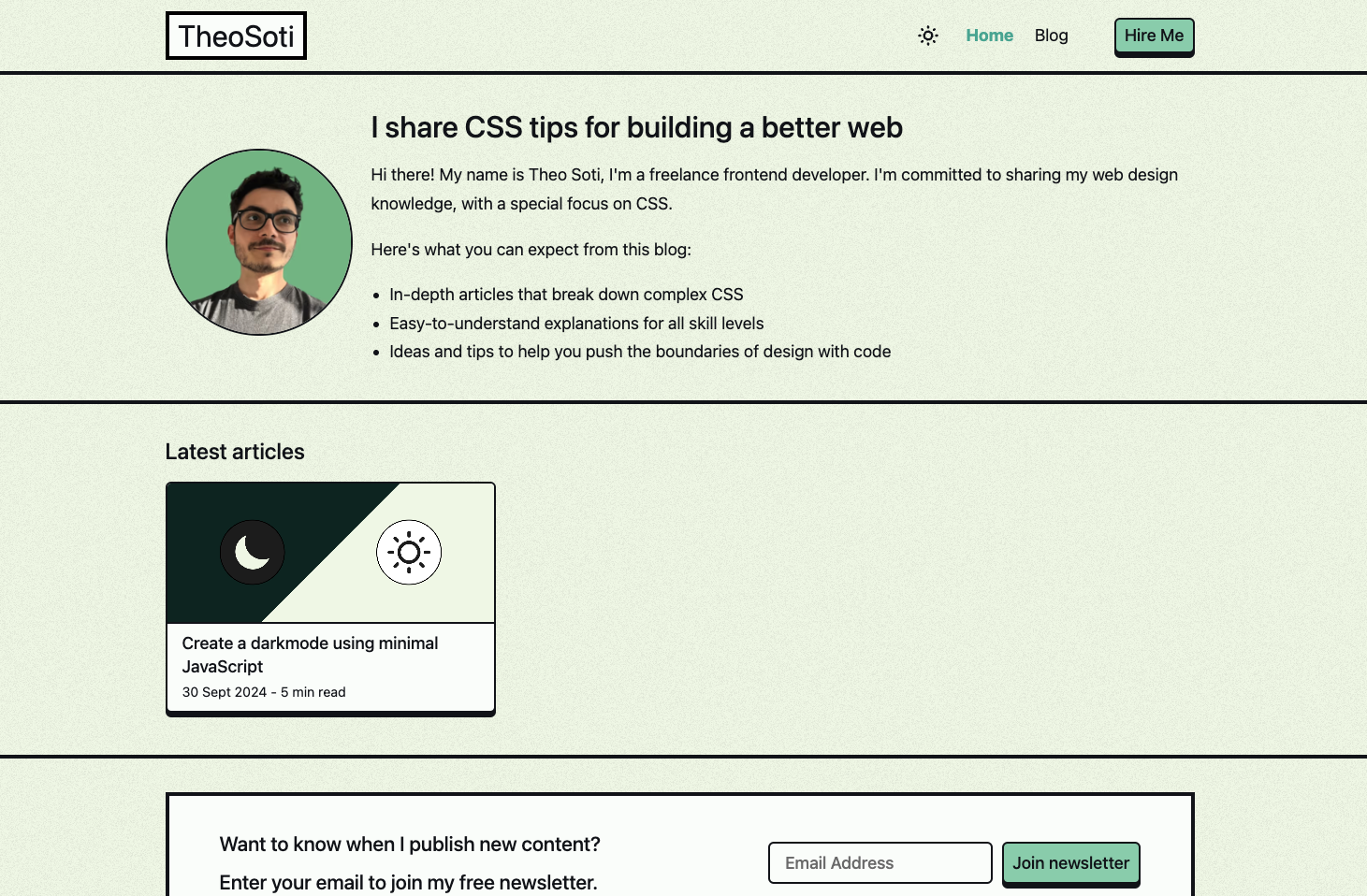




/2025/04/16/068-aa-15042025-2178248-67fed8d5c43a0221354056.jpg?#)