Léon XIV défendra-t-il les migrants comme ses prédécesseurs au Vatican ?
Le pape François et ses prédécesseurs défendaient les migrants. La doctrine chrétienne appelle à l'hospitalité. Quel sera le message du nouveau pape Léon XIV ?

Le pape François, comme ses prédécesseurs, défendait les migrants et les migrations. Le nouveau pape, Léon XIV, originaire de Chicago aux États-Unis, a, lorsqu'il était évêque, partagé sur X des publications critiquant J.D. Vance et Donald Trump pour leurs positions anti-migrants. Maintiendra-t-il le cap ?
Les catégories politiques séculières sont parfois utilisées pour décrire les orientations du Vatican. Lorsque le pape François défendait les migrants, on suggérait qu’il était un pape « de gauche ». Aujourd’hui, on se demande si le pape Léon XIV peut adopter une orientation « progressiste », ou, au contraire, une philosophie de l’immigration différente de celle de François ?
Pour répondre à cette question, il est utile d’examiner ce que les papes successifs ont dit de l’accueil des étrangers. On peut constater qu’ils n’ont pas seulement défendu les migrants mais aussi un droit à l’immigration. Leur approche est universaliste et rejette toute discrimination.
Le Vatican défend un droit à l’immigration
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Vatican a déjà connu six papes. Le premier, Pie XII (1939-1958), semble favorable à l’immigration, encore plus que ne l’était l’Organisation des Nations unies. En effet, en 1948, lorsque l’ONU a adopté la Déclaration universelle des droits humains l’émigration était consacrée comme droit fondamental :
« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. »
Cette formule ne mentionne pas le droit d’entrer dans un pays qui n’est pas le sien. Or, le pape Pie XII interroge cette imprécision.
Dans son message de Noël 1952, il considère qu’elle aboutit à ce que :
« Le droit naturel de toute personne de ne pas être empêchée d’émigrer ou d’immigrer soit pratiquement annulé, sous prétexte d’un bien commun faussement compris. »
Pie XII pense que l’immigration est un droit naturel, mais l’associe à la pauvreté. Il demande alors aux gouvernements de faciliter la migration des travailleurs et de leurs familles vers « des régions où elles trouveraient plus facilement les vivres dont ils ont besoin ». Il déplore la « mécanisation des consciences » et demande d’assouplir « en politique et en économie, la rigidité des vieux cadres des frontières géographiques ».
La même année, dans la Constitution apostolique sur la Famille exilée, il montre pourquoi la migration était essentielle pour l’église.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Le pape Jean XXIII (1958-1963) prolonge cet argument dans deux encycliques : Mater et magistra en 1961 et Pacem in terris en 1963.
Alors que Pie XII pensait le droit naturel d’émigrer au regard des seules personnes nécessiteuses, Jean XXIII vise désormais toute personne qui « espère trouver ailleurs des conditions de vie plus convenables pour soi et pour sa famille » (Pacem in terris).
Cosmopolitisme et rejet de la discrimination
Pour Paul VI (1963-1978), le devoir chrétien de servir les travailleurs migrants, doit être rempli sans discrimination. Dans une encyclique de 1965, il rappelle :
« L’impérieux devoir de nous faire le prochain de n’importe quel homme et, s’il se présente à nous, de le servir activement : qu’il s’agisse de ce vieillard abandonné de tous, ou de ce travailleur étranger, méprisé sans raison »,
et l’exigence de « fournir assistance aux émigrants et à leurs familles » (Gaudium et spes)
Jean Paul II (1978-2005) multiplie les paroles favorables à l’immigration. Par exemple, son discours pour la Journée mondiale des migrants de 1995 est consacré aux migrants en situation irrégulière. Il y rappelle que :
« L’Église considère le problème des migrants en situation irrégulière dans la perspective du Christ, qui est mort pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés (cf. Jn 11, 52), pour accueillir les exclus et rapprocher ceux qui se sont éloignés, pour intégrer toutes les personnes dans une communion qui n’est pas fondée sur l’appartenance ethnique, culturelle et sociale. »
Benoît XVI (2005-2013) reconnaît la féminisation de la migration et le fait que :
« L’émigration des femmes tend à devenir de plus en plus autonome : la femme franchit seule les frontières de son pays, à la recherche d’un emploi dans le pays de destination. » (Message, 2006.)
Puis saluant l’entrée en vigueur de la Convention sur les droits des travailleurs migrants, il rappelle que :
« L’Église encourage la ratification des instruments internationaux légaux visant à défendre les droits des migrants, des réfugiés et de leurs familles. » (Message, 2007.)
Le pape François (2013-2025) s’inscrit dans cette tradition inclusive mondiale. Son encyclique sur la Fraternité et l’amitié sociale appelle à :
« Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde. » (Fratelli tutti.)
Du point de vue chrétien, la communauté mondiale
« n’est pas le résultat de la somme des pays distincts, mais la communion même qui est antérieure à l’apparition de tout groupe particulier » (Fratelli tutti).
Sur la question migratoire, François résume :
« Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes […] en quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. » (Fratelli tutti.)

L’accueil de l’étranger : un choix politique ?
Le pontificat de Léon XIV augure d'un engagement similaire. Cette position ne s'explique ni par une préférence politique ni par son origine. Léon XIV est, en effet, né aux États-Unis, naturalisé au Pérou et petit-fils d'immigrés français, italiens et espagnols.
Les papes ne défendent pas les immigrés parce qu’ils seraient de gauche ou progressistes, mais parce qu’ils sont au sommet d’une institution dont la raison d’être est « d’agir en continuité avec la mission du Christ ».
Pour le chrétien, l’accueil de l’étranger est un devoir fondamental, qui conditionne le salut. Dans l’Évangile, Mathieu fait dire à Jésus que c’est l’un des critères du Jugement dernier. Ceux qui auront accueilli l’étranger recevront « en héritage » le royaume de Dieu. Les autres auront le châtiment éternel :
« Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité » (Mathieu, 25 : 42-43.).
L’étranger est au cœur de la révolution qu’opère le Nouveau Testament. Certes, on retrouve les injonctions à l’hospitalité aussi bien dans l’Ancien que le Nouveau Testament. C’est une hospitalité exigeante (« Vous traiterez l’étranger comme l’un des vôtres ; vous l’aimerez comme vous-mêmes », Lévitique 19 :34) et inconditionnelle (« Exercez l’hospitalité sans murmures », Pierre 4 :9).
Mais la révolution qu’opère le Nouveau Testament dote le christianisme d’une aspiration universelle : les êtres humains deviennent, de par leur origine, tous des frères. L’appartenance même au christianisme se reconnaît à la foi en cette universalité :
« Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu. » (Jean 5 :2.)
Par ce message, le christianisme parvient à effacer la distinction entre étrangers et proches (« Ainsi, vous n’êtes plus étrangers, ni hôtes de passage, mais seulement des frères », Éphésiens 2 :19).
Selon la Lettre à Diognète, c’est la spécificité des chrétiens :
« Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. »
Dans sa toute première homélie, Léon XIV a suggéré que la foi chrétienne peut sembler « absurde, réservée aux faibles ou aux personnes peu intelligentes ». Mais l'institution dont il s'est déclaré « fidèle administrateur » prêche la « miséricorde universelle » depuis plus deux mille ans.![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.


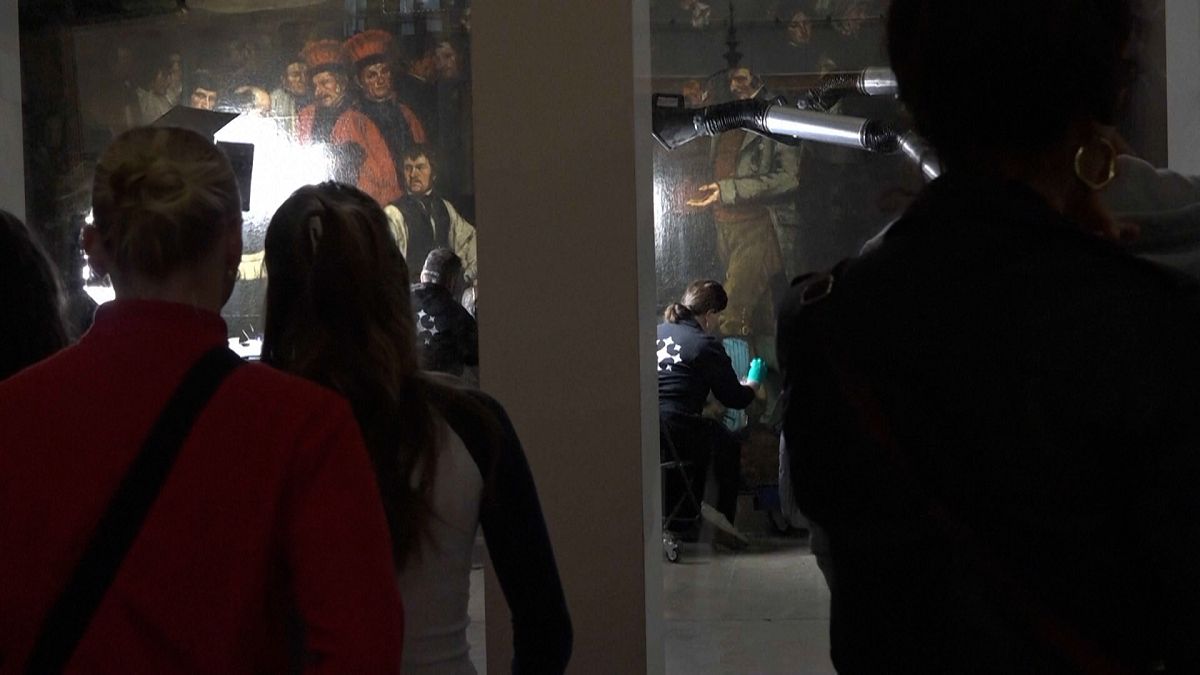





![[CINÉMA] Les Règles de l’art, récit d’un cambriolage historique en France](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/lesreglesdelart-616x411.jpg?#)














![Comment Synology combine solutions matérielles et logicielles pour assurer la protection de vos données [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2025/04/img-dsm-feature-hyper-backup.jpg?resize=1600,900&key=4d057135&watermark)

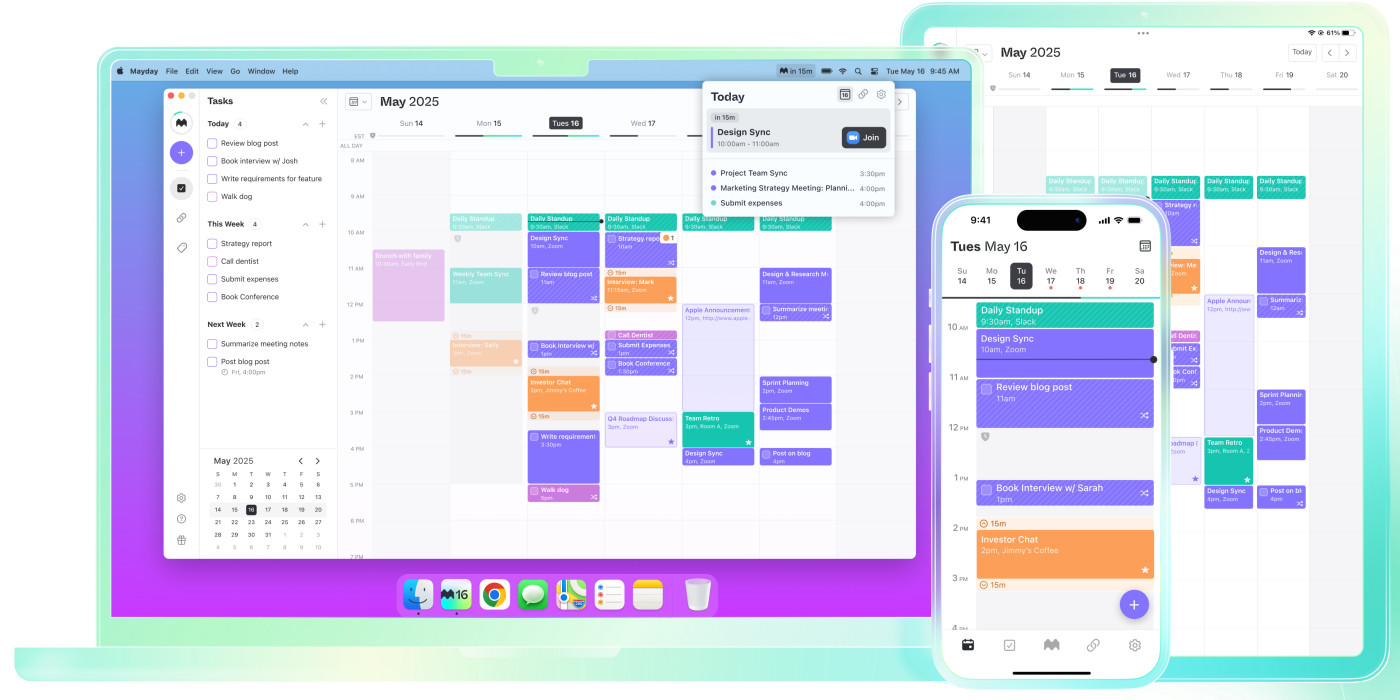

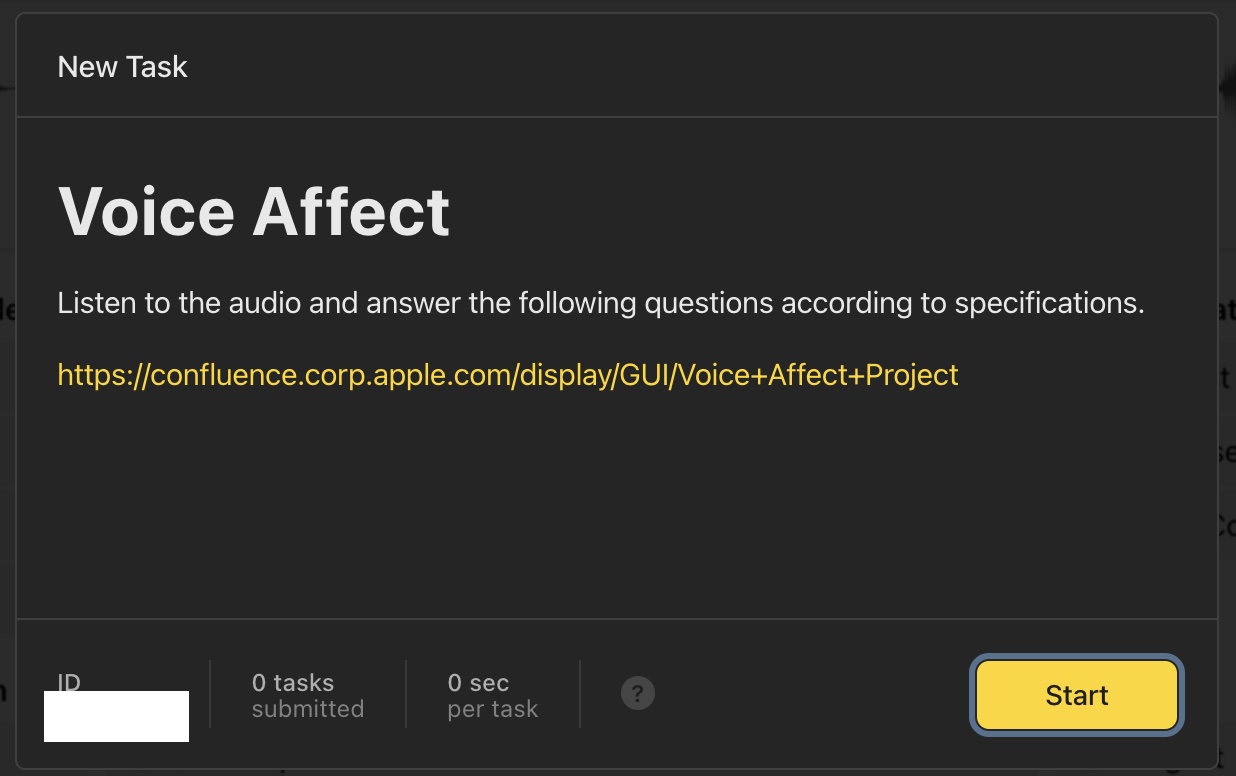





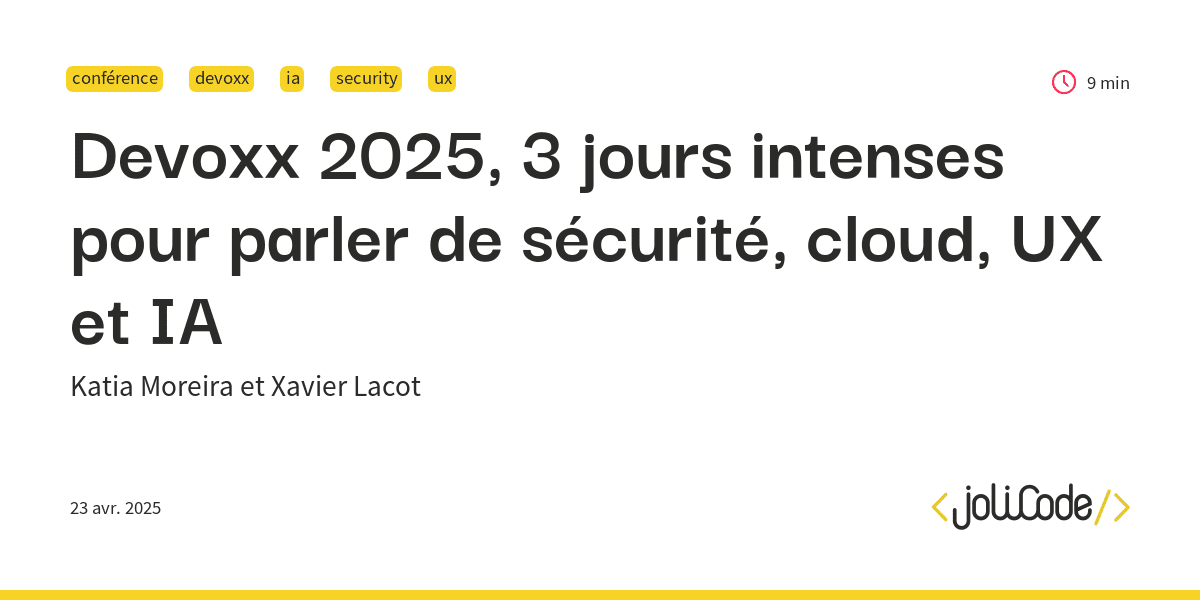



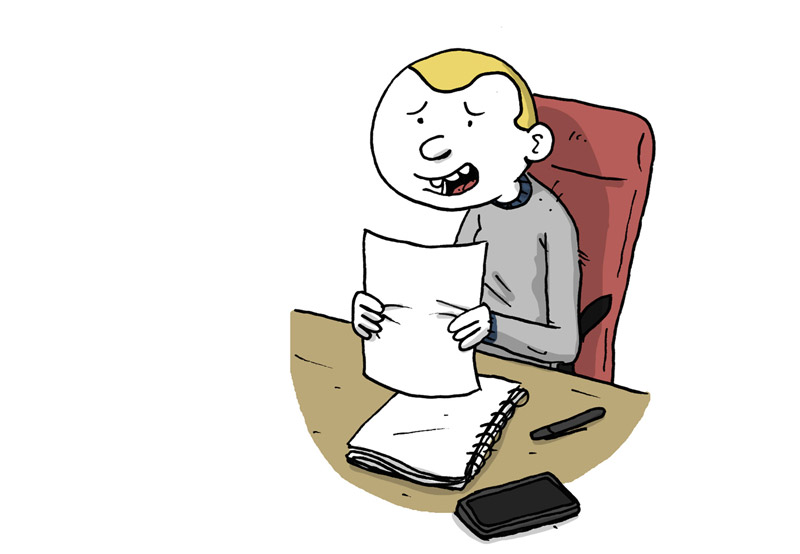




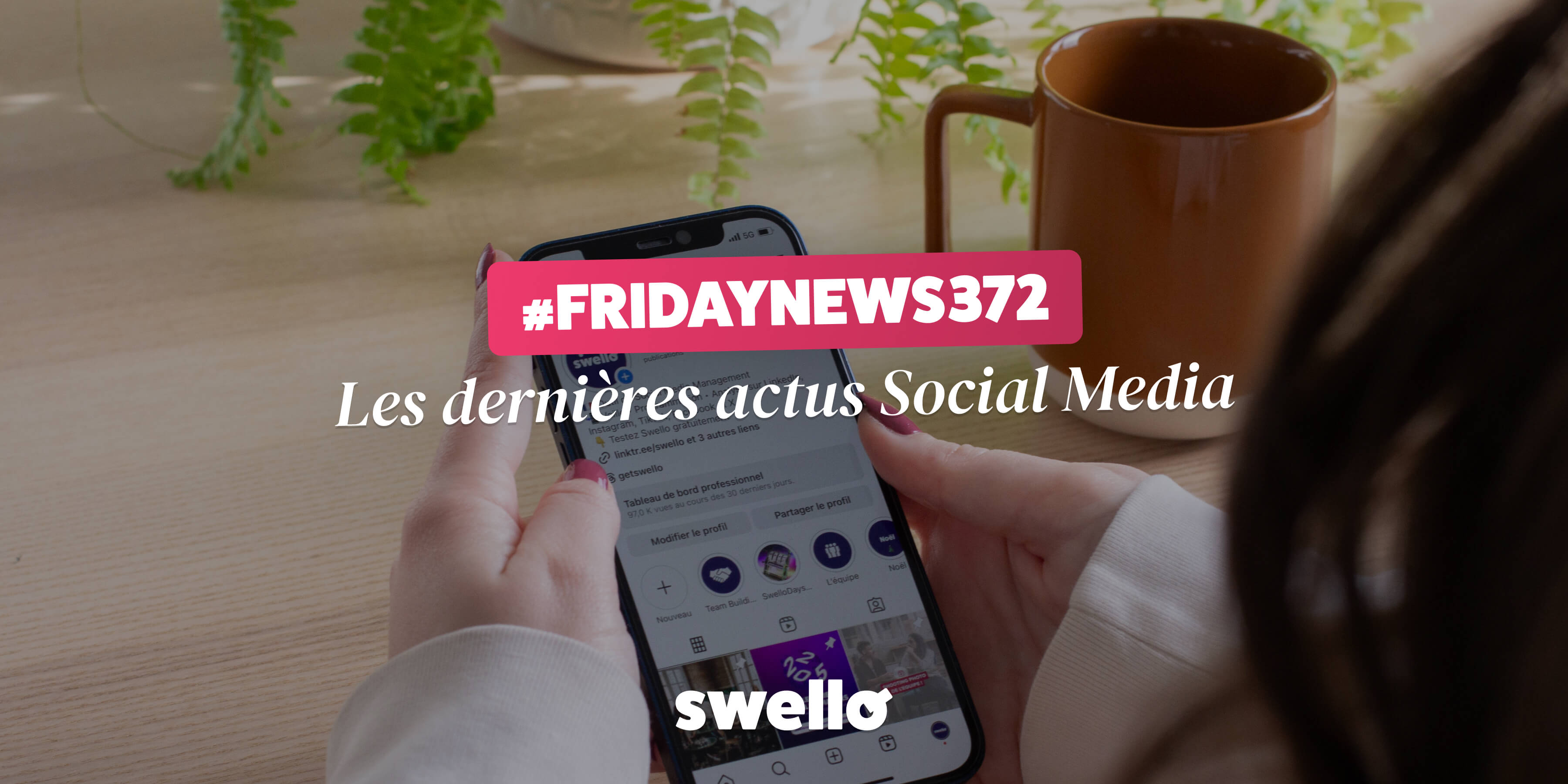



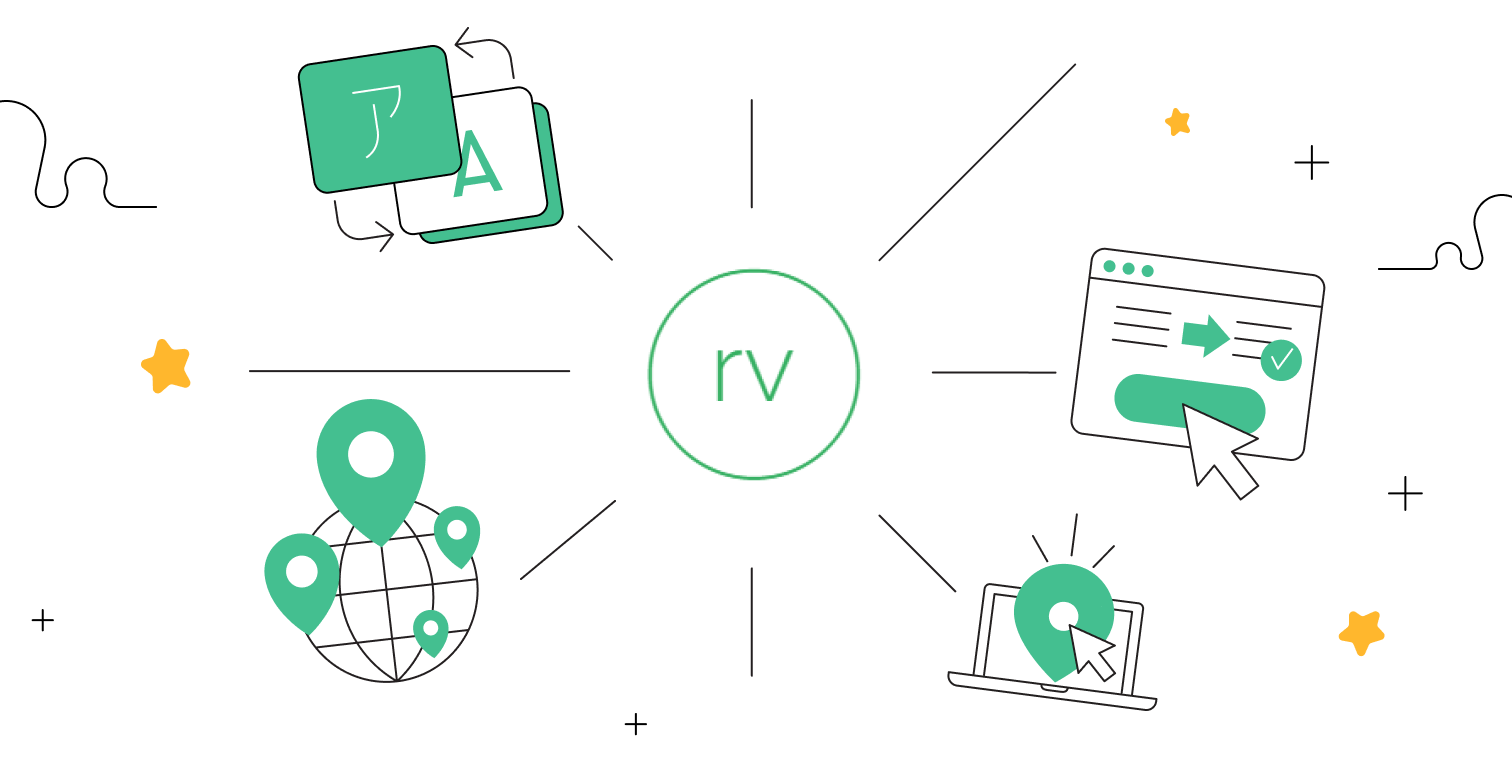
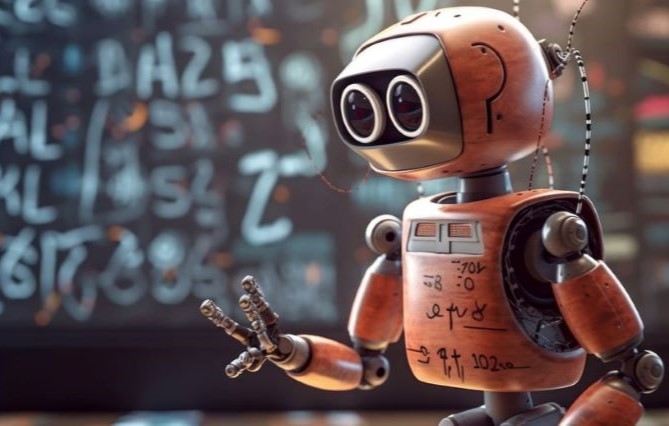
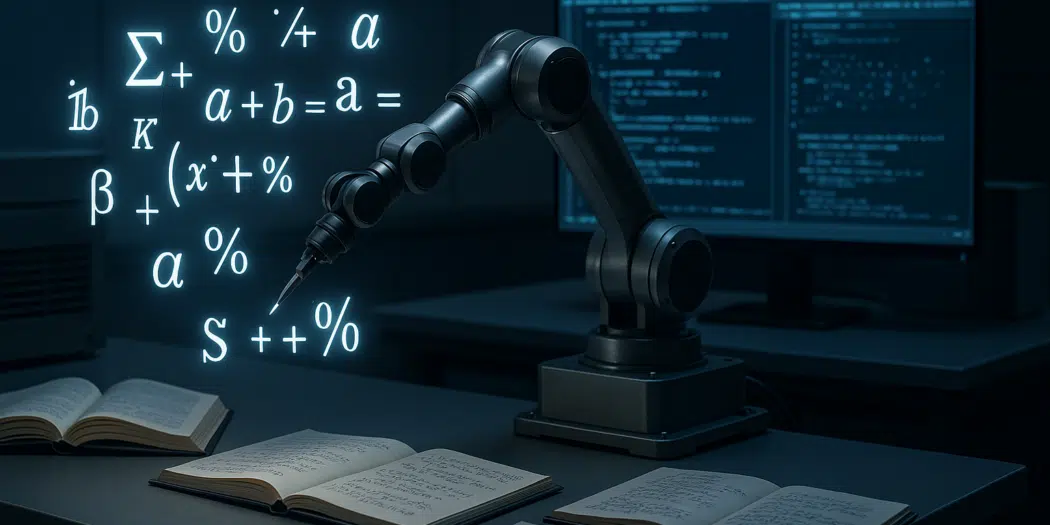
/2025/05/09/capsule-681e27dec04bf920097120.jpg?#)


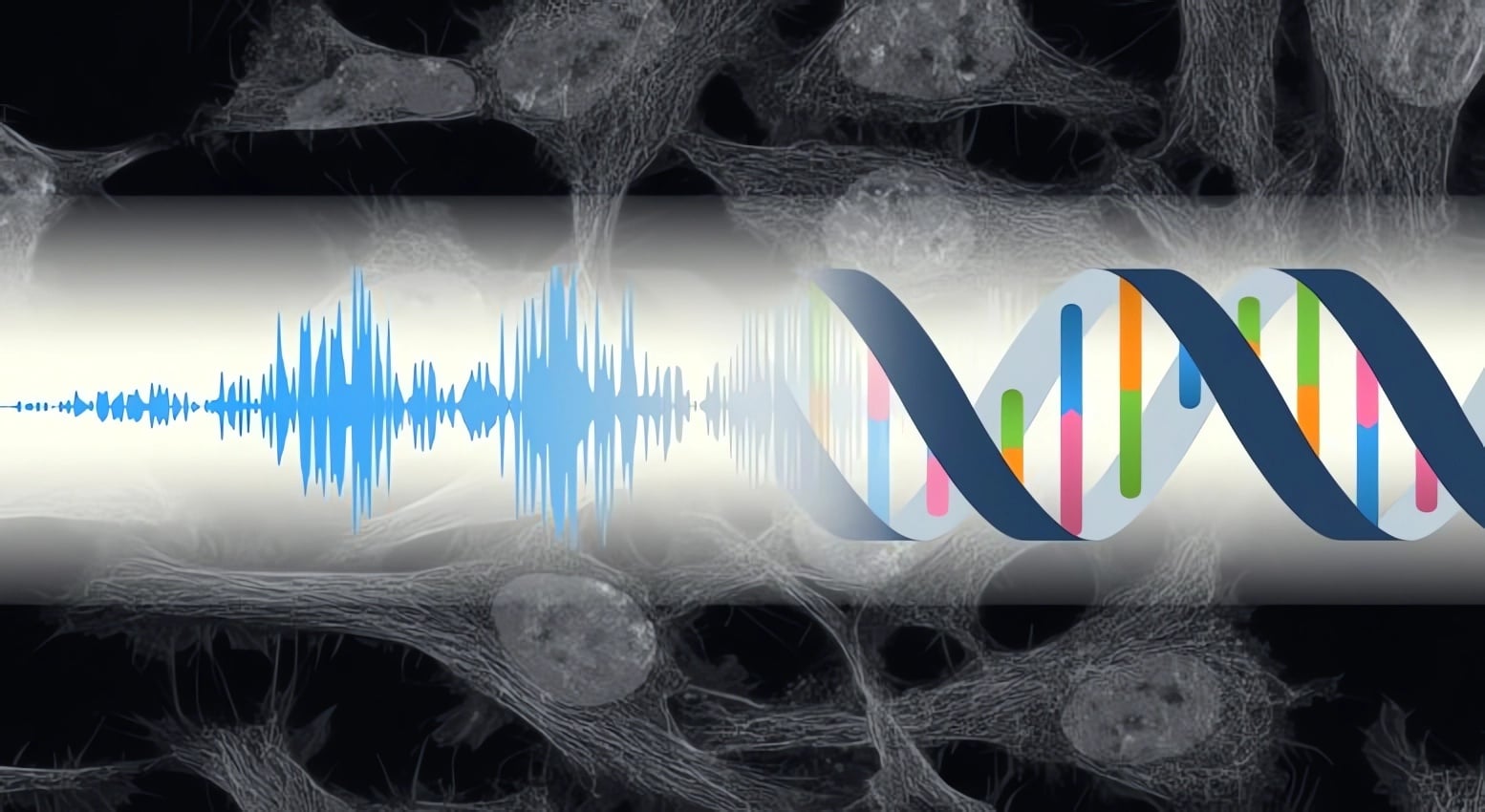





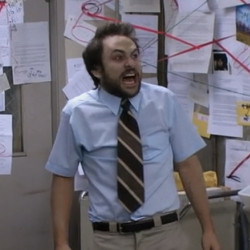
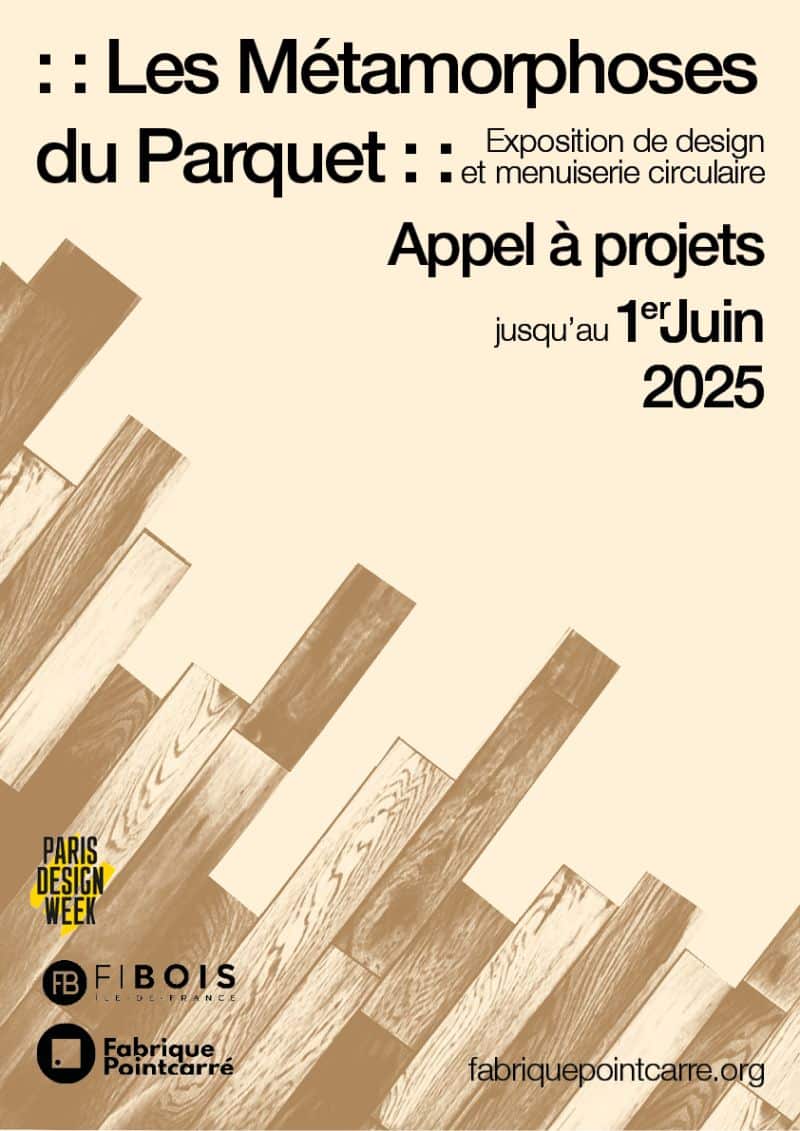













/2025/05/09/capture-d-ecran-2025-05-09-082224-681db6a274696932611712.jpg?#)
