La vitamine D peut-elle aider à prévenir le cancer colorectal ? Voici ce qu’en dit la science
Diverses études ont mis en évidence l’existence d’un lien entre faible taux de vitamine D et risque accru de cancer colorectal. Mais augmenter les doses ne suffit pas à protéger la maladie. Explications.

Diverses études épidémiologiques ont révélé que les personnes ayant des niveaux sanguins plus élevés de vitamine D ont un risque réduit de développer un cancer colorectal. Si ce constat suscite l’espoir, car il suggère qu’une simple qu’une augmentation du niveau de vitamine D, que ce soit en s’exposant davantage au soleil, en modifiant son alimentation ou en prenant des compléments alimentaires – pourrait diminuer le risque de développer cette maladie. Mais la réalité n’est pas si simple.
Le rôle potentiel de la vitamine D dans la prévention et le traitement du cancer colorectal suscite un intérêt croissant – d’autant plus que cette maladie est en augmentation, en particulier chez les jeunes adultes. Il ne s’agit cependant pas d’un nouveau domaine de recherche. En effet, on sait depuis longtemps que de faibles niveaux de vitamine D sont associés à un risque accru de développer un cancer colorectal.
Mis en évidence par les études épidémiologiques, cet effet protecteur n’a en revanche pas été confirmé par les essais randomisés contrôlés mis en place pour vérifier son existence. Quelle conclusion tirer de cette situation en apparence contradictoire ?
Des effets mis en évidence par certains travaux
La vitamine D est synthétisée dans la peau en réponse à la lumière solaire. Elle exerce ses effets biologiques via les récepteurs de la vitamine D (VDR) présents dans tout l’organisme, y compris dans le tissu du côlon (le gros intestin). Lorsqu’ils sont activés, ces récepteurs contribuent à réguler l’activité génétique liée à l’inflammation, la réponse immunitaire et la croissance cellulaire – des processus centraux dans le développement et la progression du cancer.
À lire aussi : Facteurs de risque à éviter, aliments à privilégier… Comment se protéger au mieux du cancer colorectal ?
Des études précliniques ont par ailleurs démontré que la forme active de la vitamine D (appelée calcitriol) peut réduire l’inflammation, renforcer la surveillance immunitaire (la capacité du système immunitaire à détecter les cellules anormales), inhiber la croissance des vaisseaux sanguins tumoraux et réguler la division cellulaire – un facteur clé dans le développement du cancer, comme l’ont récemment démontré mes propres travaux de recherche.
Une large étude, qui a impliqué plus de 12 000 participants, a notamment révélé que les personnes présentant de faibles niveaux sanguins de vitamine D présentaient un risque accru de 31 % de développer un cancer colorectal, par rapport à des personnes dont les niveaux de vitamine D étaient plus élevés. D’autres travaux ont par ailleurs mis en évidence une réduction de 25 % du risque de cancer colorectal chez les individus bénéficiant d’apports alimentaires en vitamine D. L’analyse des données de la Nurses’ Health Study – une étude à long terme menée auprès d’infirmières américaines – indique quant à elle que les femmes ayant l’apport le plus élevé en vitamine D avaient un risque de développer un cancer colorectal réduit de 58 % par rapport à celles ayant l’apport le plus faible.
Une revue de littérature publiée en mars 2025 met elle aussi en évidence le potentiel de la vitamine D dans la prévention et le traitement du cancer colorectal. Cependant, elle souligne également la complexité et les contradictions qui persistent en matière de connaissances sur ce sujet.
En effet, bien que les données observationnelles (qui documentent la consommation de vitamine D par les individus) et les études mécanistiques (qui explorent, en laboratoire, la façon dont la vitamine D fonctionne) suggèrent l’existence d’effets protecteurs, ces derniers ne sont pas confirmés par les essais randomisés contrôlés. Or, ce type d’essai est actuellement la référence en matière d’évaluation de l’efficacité des traitements.
Des résultats mitigés lors des essais randomisés
Les essais randomisés contrôlés consistent à attribuer aléatoirement aux participants un traitement (dans le cas présent, la vitamine D) ou un placebo, puis à comparer les résultats entre les deux groupes. Cette approche aide notamment à éliminer les biais potentiels, et à mettre en évidence les relations de cause à effet.
Malheureusement, les essais randomisés contrôlés menés pour évaluer les effets de la vitamine D sur le cancer colorectal ont produit des résultats mitigés. Ainsi, l’essai VITAL – un grand essai impliquant plus de 25 000 participants – n’a mis en évidence aucune réduction significative de l’incidence globale du cancer colorectal dans le cas d’une supplémentation de 2 000 UI/jour de vitamine D, sur plusieurs années.
Cependant, une méta-analyse de sept essais randomisés contrôlés a de son côté révélé une amélioration de 30 % de la survie face à ce type de cancer grâce aux suppléments de vitamine D. Ce résultat suggère que la vitamine D pourrait potentiellement être bénéfique pour les malades, donc lors des stades ultérieurs de la maladie plutôt qu’en prévention. Mais d’un autre côté, les résultats du Vitamin D/Calcium Polyp Prevention Trial n’ont mis en évidence aucune réduction de la récidive des adénomes (lésions précancéreuses) chez les participants qui ont bénéficié d’une supplémentation en vitamine D, ce qui amène à se demander quels patients pourraient réellement bénéficier de la prise de vitamine D, et quelles seraient les doses efficaces…
S’ajoute à ces incertitudes la question de la causalité : une carence en vitamine D contribue-t-elle au développement du cancer ? Ou bien l’apparition du cancer réduit-elle les niveaux de vitamine D dans l’organisme ? Il est également possible que les bénéfices observés soient en partie dus à une exposition accrue au soleil, qui pourrait avoir des effets protecteurs indépendants de la seule vitamine D.
Acquérir une vue d’ensemble
L’incohérence de ces résultats souligne l’importance de considérer la « totalité des preuves scientifiques existantes », chaque étude n’étant qu’une des pièces d’un puzzle bien plus grand. Il existe bien des effets biologiques qui rendent plausible une activité de la vitamine D. Les études observationnelles et mécanistiques suggèrent bien l’existence d’un lien significatif entre cette molécule et une diminution du risque de cancer colorectal. Cependant, les preuves cliniques ne sont pas encore suffisamment solides pour envisager de recommander de la supplémentation en vitamine D comme unique stratégie de prévention ou de traitement de cette maladie.
À lire aussi : Cancer colorectal : qui doit se faire dépister, et comment ?
Ceci étant dit, s’assurer qu’au sein de la population, les niveaux de vitamine D soient corrects (ce qui signifie au moins 30 ng/mL) peut s’avérer judicieux, car il s’agit d’une mesure de santé publique peu coûteuse et à faible risque. En la combinant avec d’autres stratégies, comme un dépistage systématique et régulier, une alimentation saine, la pratique d’une activité physique et un suivi personnalisé, la vitamine D pourrait jouer un rôle précieux dans la prévention globale du cancer.
Son rôle exact dans le cancer colorectal reste à préciser. Cette molécule ne constitue pas une solution miracle, mais trouve sa place dans un tableau beaucoup plus large. Le cancer colorectal est une maladie complexe, et le combattre nécessite une approche tout aussi nuancée. Pour l’instant, le prévenir passe avant tout par l’adoption d’un mode de vie dont la recherche a établi, sur la base de preuves solides, les bienfaits, ainsi que des dépistages réguliers. Ainsi, bien entendu, que par la veille scientifique, afin de se tenir informé à mesure que de nouveaux résultats sont publiés.![]()
Justin Stebbing ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
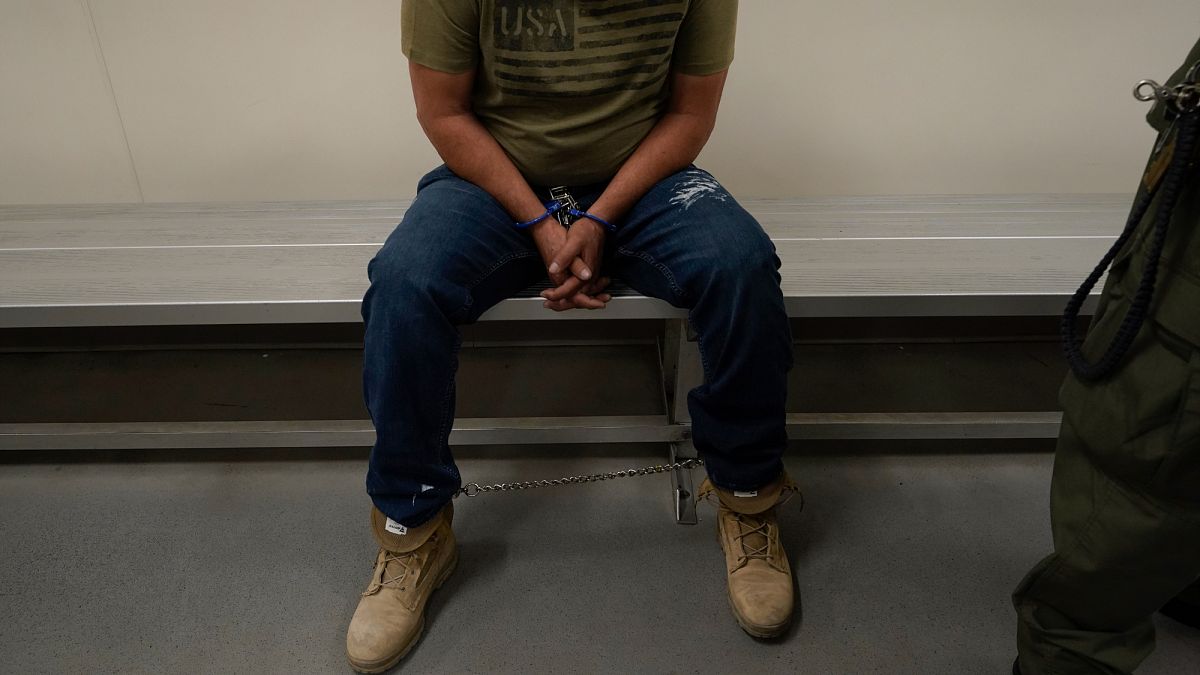





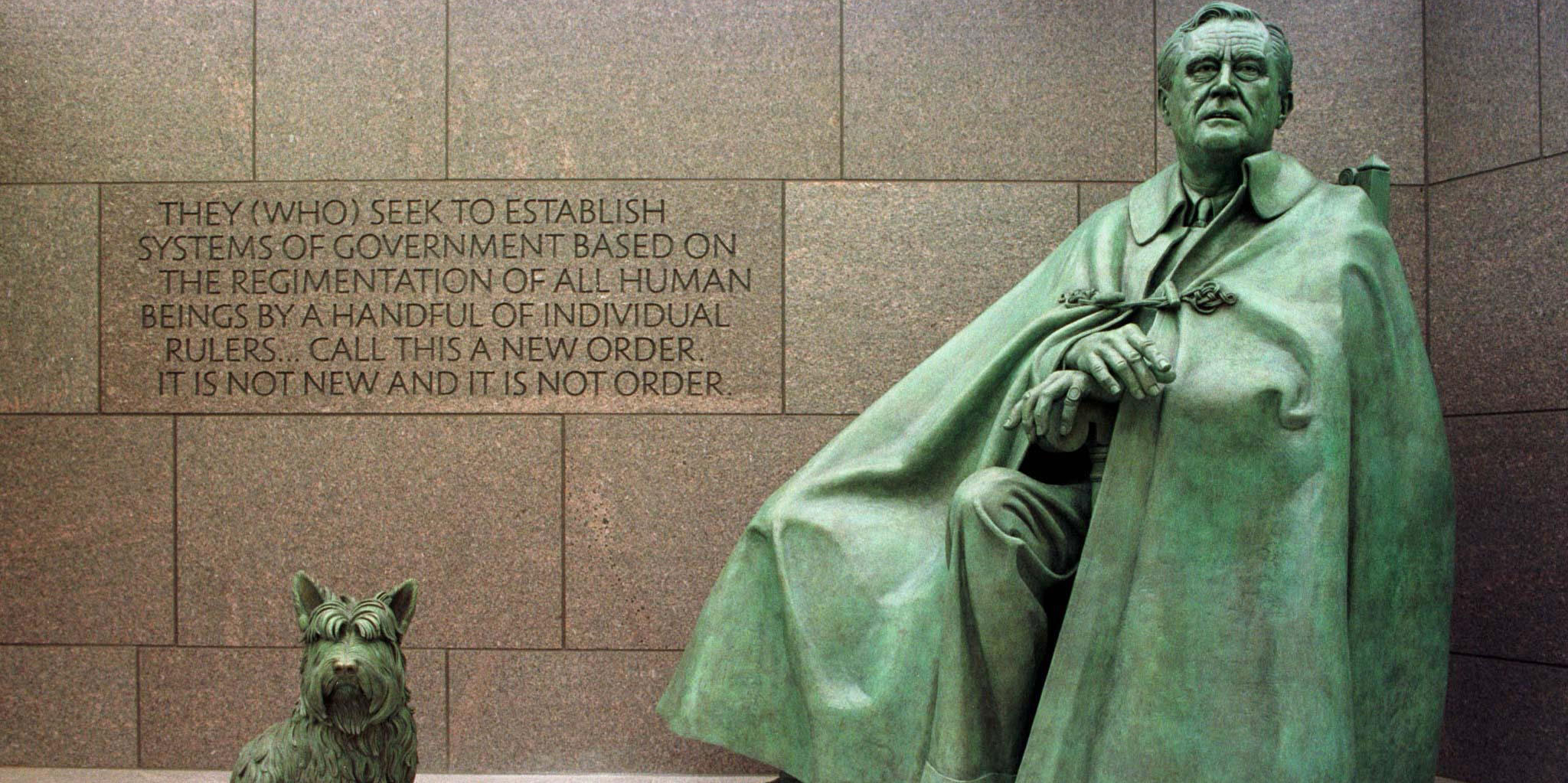
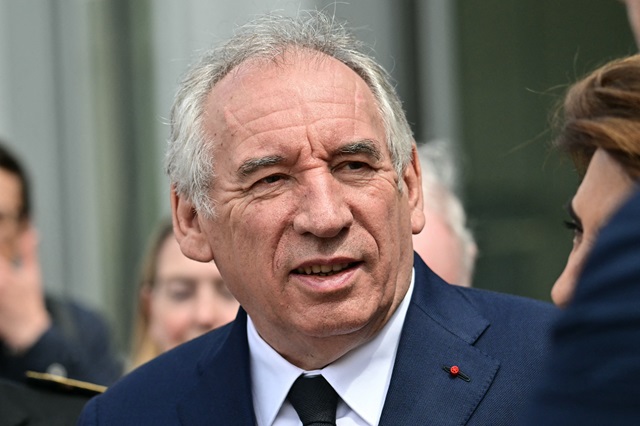




















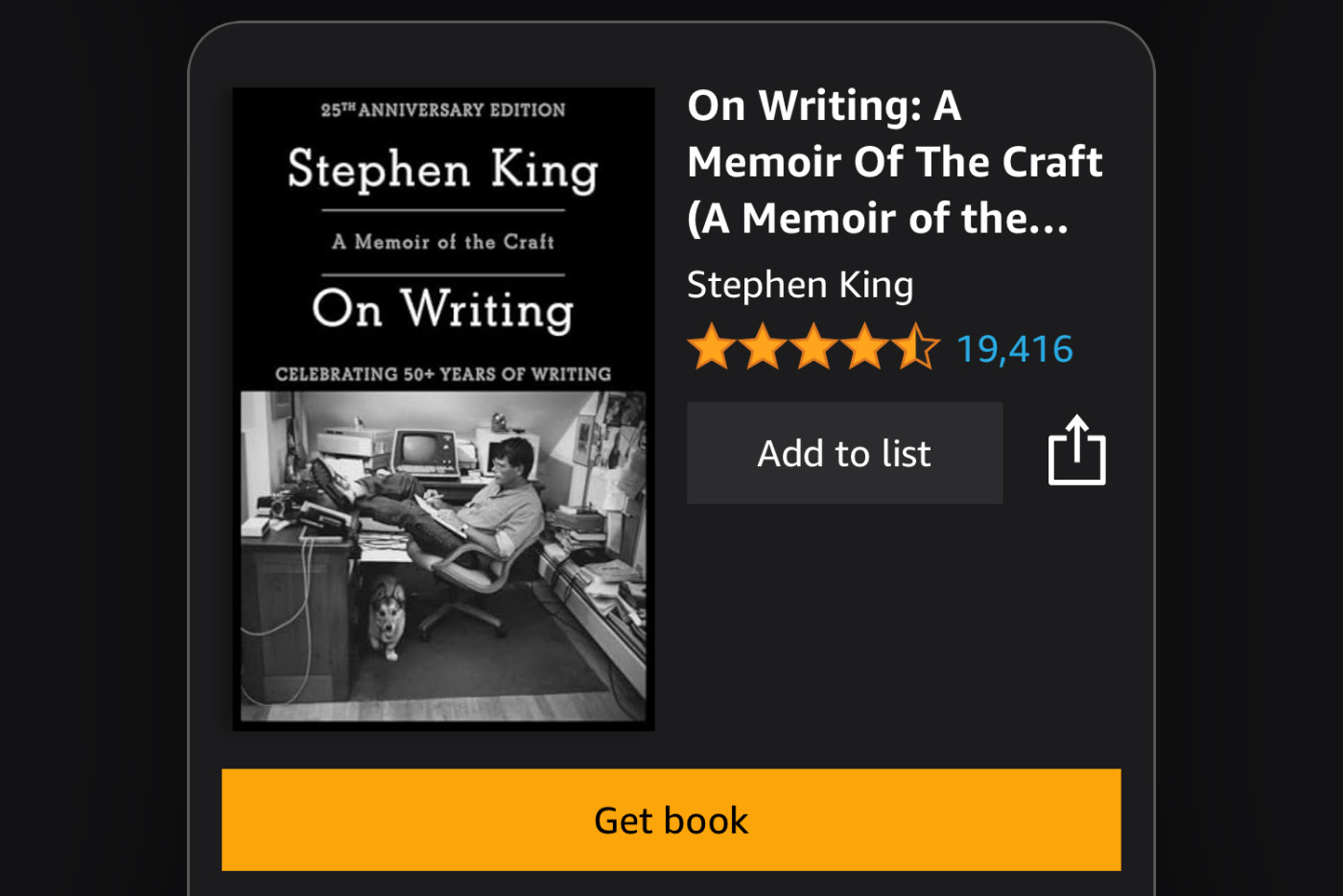









/2025/05/06/v2-florence-seyvos-c-patrice-normand-681a20670109b637542013.jpg?#)
/2025/05/06/000-43v36kd-681a24e5ac974754142745.jpg?#)
/2025/05/06/000-32c4366-681a35f513a42795994441.jpg?#)












/2025/05/04/etats-unis-des-chercheurs-sous-pression-est-menaces-6817c2eb45876085234095.jpg?#)

















