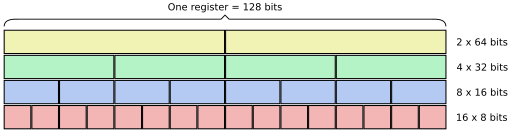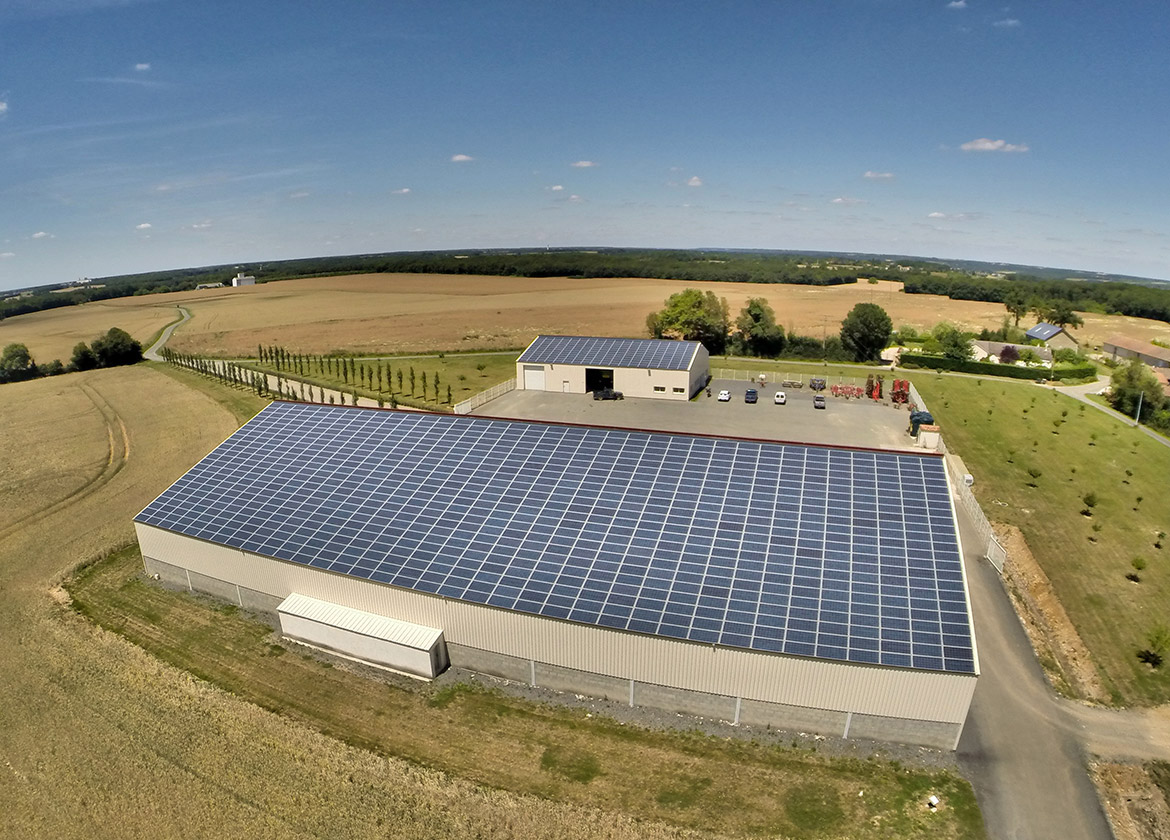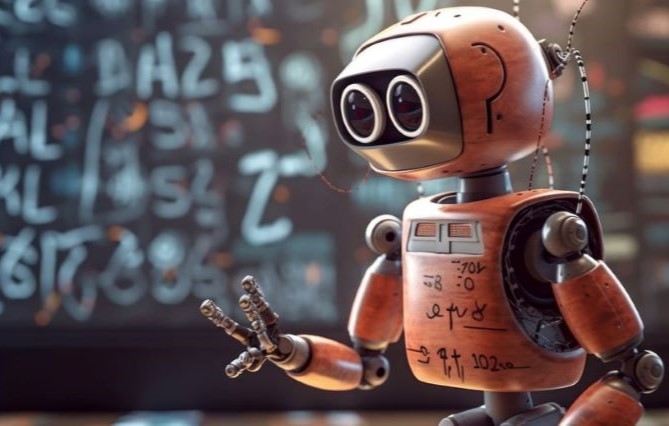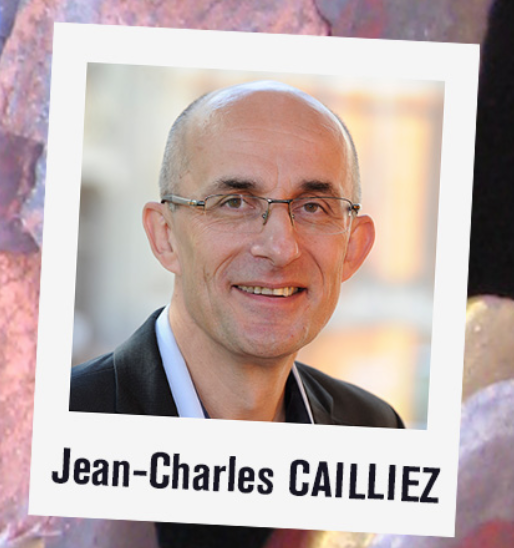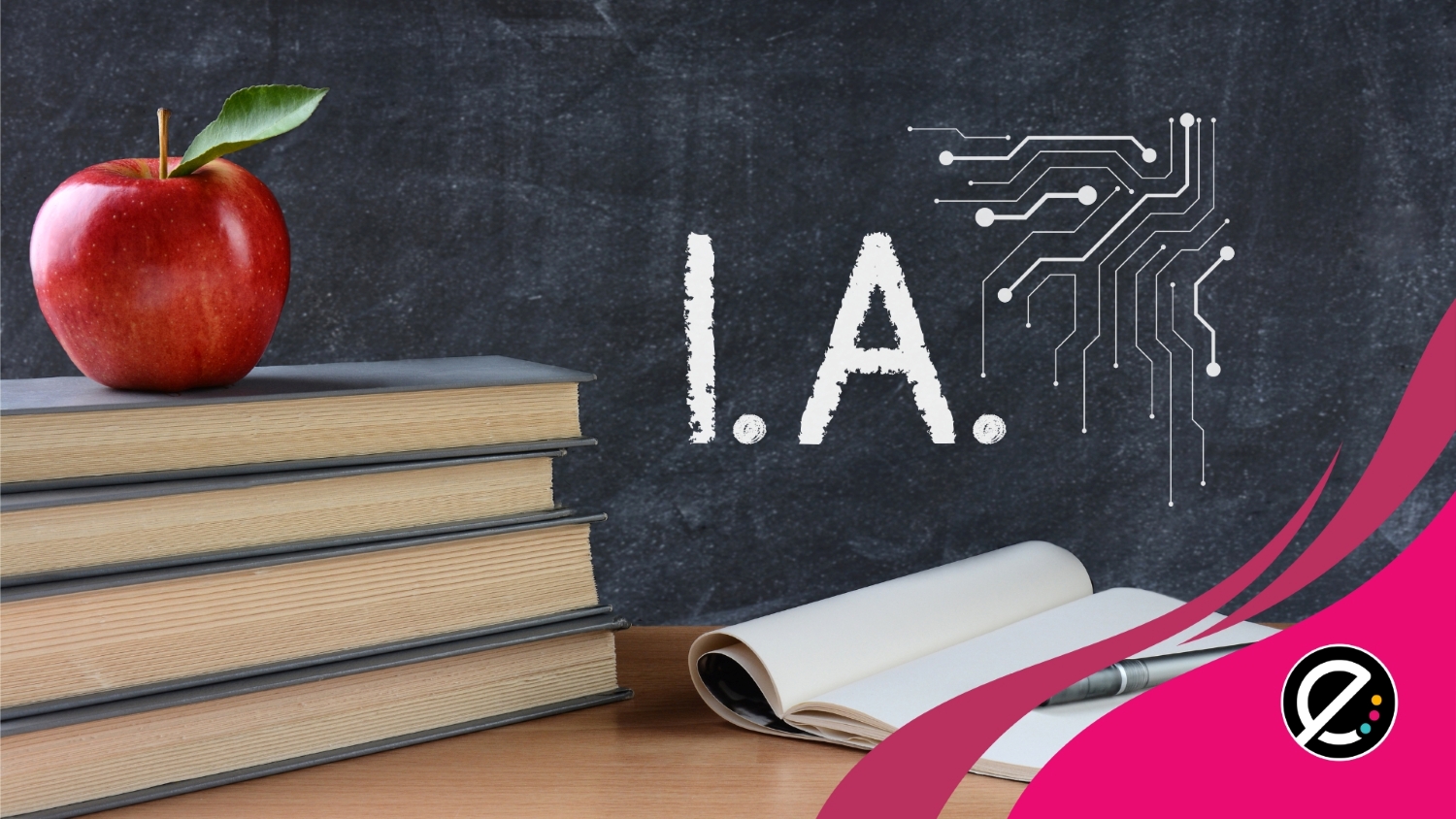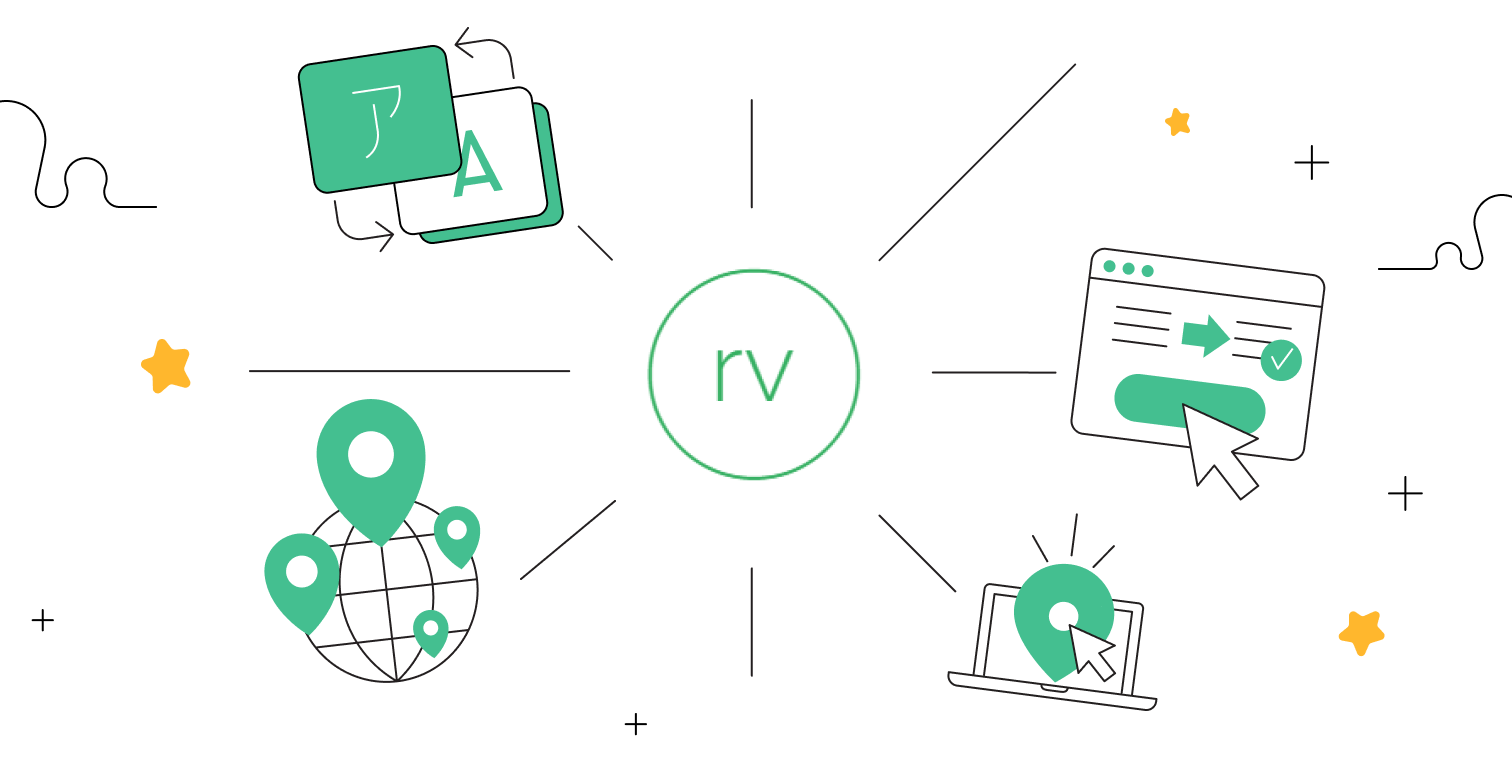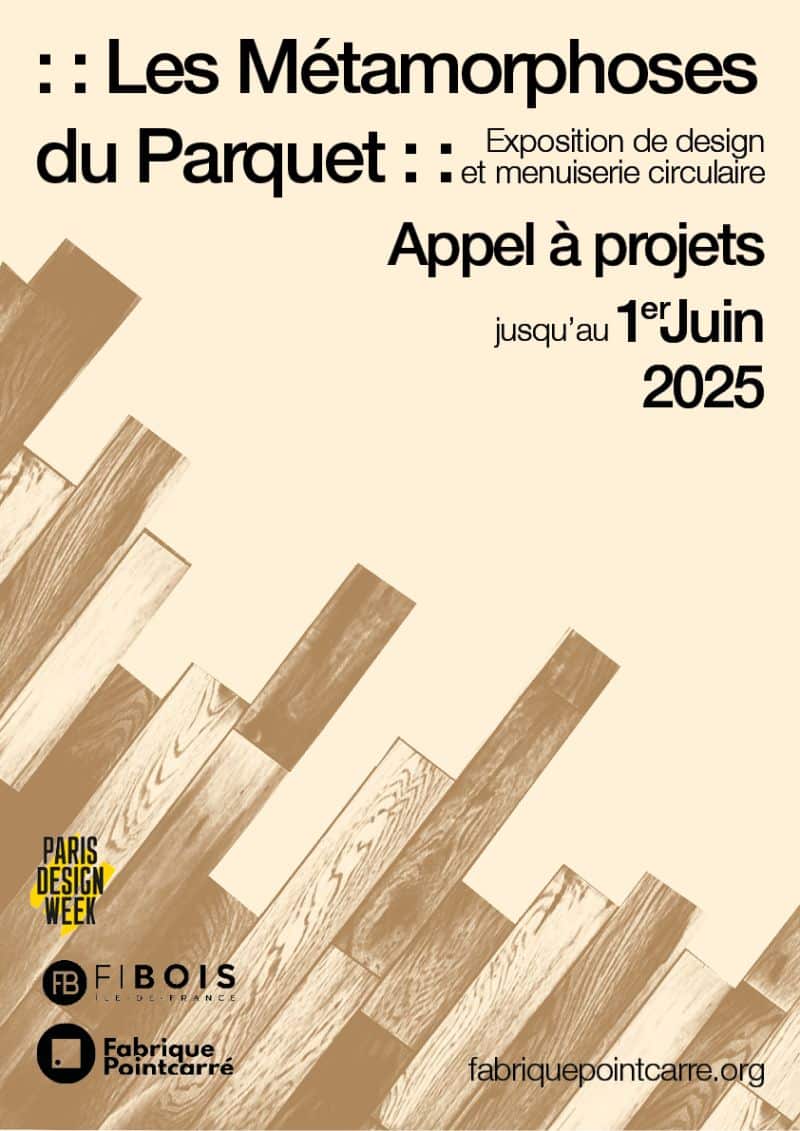Après les camps : les trajectoires de vie des rescapés revenus en France
Présentation des résultats d’une étude portant sur les parcours de vie de 625 survivants des camps de concentration.

Dimanche 27 avril, hommage sera rendu à la mémoire des victimes de la déportation de la Seconde Guerre mondiale. Seules 56 000 personnes sont revenues en France des camps de concentration ou d’extermination nazis. Leurs destinées ultérieures, hormis celles d’une poignée de personnalités, demeurent largement méconnues. Une étude récente vient combler, au moins en partie, ce manque.
Ce 27 avril, Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, est l’occasion de commémorer le 80e anniversaire de la libération des camps de concentration.
Certains survivants rentrés en France en 1945 sont connus : Robert Antelme, Stéphane Hessel, Jorge Semprun, Germaine Tillion, Simone Veil, Elie Wiesel… Mais que sont devenus les 56 000 autres rescapés qui, eux, sont restés anonymes ? Parmi eux, 3 800 avaient été déportés parce qu’ils étaient juifs ; la plupart des autres l’avaient été en tant que résistants. Plus de 70 % d’entre eux étaient de sexe masculin.
Une sociologie qui reste à écrire
L’horreur des camps est connue. « À quelques rectifications mineures près, le débat est clos sur les faits », assurait déjà, il y a trente ans, l’historien François Bédarida. En revanche, on en sait peu sur ce que sont devenus les rescapés après 1945, car leurs témoignages s’arrêtent généralement à leur retour en France. Quant aux études psychologiques et médicales, elles portent surtout sur ceux qui ont émigré en Israël ou aux États-Unis et se focalisent sur les séquelles physiques et mentales.
Pour contribuer à une sociologie des survivants, j’ai analysé le parcours de 625 d’entre eux et étudié les différences avec leurs contemporains.
Une mobilité sociale ascendante
La grande majorité d’entre eux bénéficia d’un temps de convalescence (huit mois en moyenne) avant de reprendre leurs études ou leur activité professionnelle. Ils étaient généralement pressés de se remettre au travail afin de se réinsérer dans la société, si bien que certains retrouvèrent leur emploi malgré des séquelles persistantes. Les plus atteints durent cependant se réorienter vers des métiers moins exigeants physiquement.
Les femmes rescapées présentent un taux d’activité supérieur de 50 % à la moyenne des Françaises à l’époque. Celles (majoritairement juives) dont la famille avait été décimée n’avaient guère d’autre choix que de travailler. Quant aux anciennes résistantes, elles étaient peu désireuses de devenir femmes au foyer.
La majorité des survivants s’est redirigée vers son métier initial ou celui de son père : la continuité prévaut. Une minorité profita toutefois de la possibilité qui lui était offerte de reprendre des études pour changer d’emploi.
Les professions tournées vers autrui, que ce soit dans le domaine médical ou l’enseignement, sont sur-représentées. De même pour les métiers prestigieux (l’art, la recherche, le journalisme…) ou liés à l’honneur (l’armée par exemple) ; on peut y voir une soif de revanche. On note aussi une sur-représentation d’artisans et de commerçants. Cette volonté d’indépendance provient du désir d’une partie d’entre eux d’échapper à la hiérarchie et aux ordres qui leur rappelaient de mauvais souvenirs.
Ils ne laissèrent pas passer l’ascenseur social des Trente Glorieuses puisqu’un tiers d’entre eux connut une nette mobilité ascendante par rapport au milieu social de leurs parents ou à leur situation professionnelle précédant leur arrestation. Seuls 2 % connurent un déclassement.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Moins d’enfants, mais autant de divorces
Leur mise en couple fut assez rapide, aussi bien chez les célibataires que chez les veufs. Les survivantes se marièrent souvent dès 1946. Il faut dire qu’elles avaient du « retard » par rapport à l’âge moyen du mariage qui était autour de 23 ans à l’époque. Certaines témoignent que, pour elles, le premier homme convenable était le bienvenu, car il représentait l’occasion de quitter le domicile parental ou de se réinsérer pour celles dont la famille avait été décimée.
Les rescapées épousèrent généralement des hommes mûrs, car les « jeunets » de leur âge leur semblaient trop insouciants et superficiels pour les comprendre. Les rescapés, eux, attendirent généralement de retrouver une situation professionnelle stable avant de songer au mariage. Les anciens déportés furent deux fois moins nombreux que leurs contemporains à rester célibataires. Ceux qui restèrent célibataires furent essentiellement ceux qui souffraient le plus de séquelles physiques et mentales.
Plus de 10 % des mariages furent entre rescapés. Ces mariages endogames concernaient deux fois plus les anciens résistants que les juifs, sans doute parce que les réseaux de la Résistance puis les associations d’anciens déportés étaient propices aux rencontres.
Paradoxalement, les mariages endogames présentent un taux de divorce deux fois plus élevé que les autres. Si le vécu commun des survivants pouvait les rapprocher, cette base n’était pas nécessairement suffisante pour construire un couple durable.
Plus globalement, le taux de divorce des rescapés se situe dans la moyenne nationale. Les mariages précoces, y compris en secondes noces, ne furent pas toujours heureux. Le quotidien de la vie à deux put rapidement sembler banal et médiocre par rapport au bonheur du retour idéalisé dans les camps. Les rescapés divorcèrent deux fois moins souvent que les rescapées, notamment parce que, d'après les témoignages, les épouses de survivants étaient plus tolérantes aux séquelles que les époux des survivantes.
L’enfantement, par sa symbolique, était souvent vécu comme une victoire sur le nazisme et sur la mort, en particulier chez les juifs. L’empressement à créer une famille ne déboucha toutefois pas sur des familles nombreuses puisque les survivantes eurent en moyenne 1,9 enfant contre 2,4 pour leurs contemporaines. Cet écart s’explique par des mariages plus tardifs que la moyenne, des enfantements qui réveillaient le passé qu’une partie d’entre elles avaient cherché à oublier, mais aussi, tout simplement, par des séquelles telles que le vieillissement prématuré.
Le camp comme catalyseur
Quelle fut l’influence des camps sur les croyances ? « Ni pardon ni oubli » fut la ligne adoptée par la majorité des rescapés.
L’expérience concentrationnaire déboucha rarement sur de l’antigermanisme primaire : celui-ci fut limité et décroissant, malgré des critiques sur la faible dénazification mise en place en Allemagne.
Le ressentiment visait surtout des personnes spécifiques : tel SS ou tel kapo (un déporté chargé de superviser les autres déportés), particulièrement cruel, ou bien encore tel milicien à l’origine de leur arrestation. Une forte minorité de survivants (environ 30 %) semble être retournée sur les lieux de son ancien camp en guise de « travail de mémoire ».
Les plus jeunes d’entre eux qualifiaient parfois leur expérience concentrationnaire d’« université ». Si ce terme peut choquer, il est indéniable que ces quelques mois ou années ont marqué leur esprit. La plupart des survivants ont acquis une vision pascalienne de la condition humaine : ils disent avoir côtoyé le pire, mais aussi le meilleur à l’instar de liens de fraternité exceptionnels noués avec quelques camarades de déportation.
On peut se livrer à l’uchronie : leur vie eût-elle été radicalement différente s’ils n’avaient pas été déportés ? Paradoxalement, si l’on compare le chemin parcouru par les anciens déportés, avant leur arrestation et après leur rapatriement, on note relativement peu de discontinuités. Peu sont tombés dans le nihilisme ou disent que « Dieu est mort dans les camps ».
La déportation semble avoir été un catalyseur plutôt qu’une rupture : elle a renforcé leurs traits de caractère, leurs valeurs et leurs convictions politiques.![]()
Denis Monneuse ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








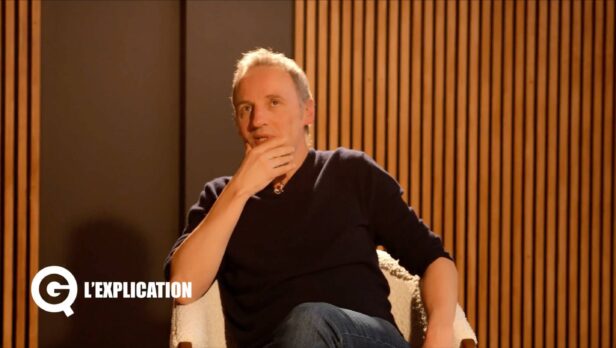


![[ÉDITO] Mort du pape : franchement, elle a bon dos, la laïcité !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/03/800px-square-de-la-laicite-lyon-plaque-616x408.jpg?#)