Méfiez-vous (aussi) des hommes parfaits : réflexion sur les stratégies des agresseurs
Bon père, mari aimant… Dominique Pelicot s’était construit l’image de l’homme parfait. Une stratégie typique des agresseurs pour tromper la vigilance de leur victime et de l’entourage.

Au procès des viols de Mazan, les figures du conjoint formidable et du père exemplaire ont souvent été mises en avant par les proches des accusés. Une « stratégie de l’homme parfait », typique des conjoints violents, qui permet aux agresseurs de tromper la vigilance de leur victime et de l’entourage, assurant ainsi leur impunité.
L’affaire des viols perpétrés par Dominique Pelicot et ses co-accusés a donné lieu à une forme de sidération collective face à ce qui a été largement vu comme un insondable paradoxe : celui du « monstre » derrière ce « Monsieur Tout-le-monde ».
Un « Monsieur Tout-le-monde » aimé et estimé de ses proches, au point que les commentaires émis par Gisèle Pelicot sur son mari lors de sa première convocation par la gendarmerie furent d’abord des éloges : il était un mari formidable et un bon père. Les attentions qu’il lui a portées pendant des années n’ont pourtant rien de paradoxal : elles sont l’arme du crime parfait, qui le plaçait au-dessus de tout soupçon.
Isoler, contrôler, dégrader : une stratégie de contrôle bien huilée
Si Dominique Pelicot préparait les repas et les apportait au lit à son épouse, ce n’était nullement par souci d’équité domestique ni par sollicitude, mais uniquement parce que cela lui permettait de la sédater à son insu, tout en façonnant l’image d’un homme exceptionnel.
De même, l’accompagner systématiquement chez le médecin n’était pas une marque d’attention, mais visait à empêcher le corps médical de poser les questions qui auraient pu mener Gisèle Pelicot à s’interroger sur ce qu’elle ingérait – stratégie qui s’est avérée payante. Il l’accompagnait jusque dans le cabinet du gynécologue : il lui fallait en effet éviter qu’une recherche de maladie sexuellement transmissible lui soit prescrite, car cela aurait immanquablement révélé un problème, voire le problème. En accompagnant son épouse chez le gynécologue, Dominique Pelicot a empêché le gynécologue de prescrire une recherche d'IST à sa patiente. Une telle prescription aurait sous-entendu l'existence de relations extraconjugales. Or, il est très peu probable qu'un médecin s'autorise à sous-entendre l'existence possible d’adultère avec une patiente en présence de son conjoint.
Cette omniprésence qui passait pour l’attention d’un mari aimant, était en réalité l’un des rouages d’une stratégie de contrôle bien huilée, se traduisant par une intrusion dans tous les aspects de la vie de sa victime.
Tel un « pompier pyromane », il a volontairement porté atteinte à la santé de son épouse, non seulement pour la réduire à l’état d’objet sexuel, mais aussi pour se poser en sauveur, alors qu’il était en train de la tuer à petit feu.
Faire perdre toute agentivité à la conjointe est une stratégie classique du compagnon violent. La faire passer pour folle, ou sénile, en est une autre. Si elle s’était souvenu de quoi que ce soit, qui aurait cru une femme qui perd la tête ? Si elle avait succombé aux sévices de son conjoint, qui aurait suspecté autre chose que l’issue inexorable d’une maladie dégénérative ? Qui aurait soupçonné ce mari si présent pour son épouse en perte d’autonomie, dans un monde où le risque d’être quittée en cas de maladie grave est six fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes ?
Dominique Pelicot a déployé une large gamme de l’arsenal stratégique typique des conjoints violents, et tout particulièrement celles relevant du « contrôle coercitif » : isoler son épouse, contrôler le moindre détail de son existence, dégrader son estime de soi, sa santé, la rendant ainsi dépendante et peu crédible.
Des procédés ni paradoxaux ni hors norme
Pas plus qu’ils ne sont paradoxaux, ces procédés ne sont hors norme. Nombre de ses co-accusés ont également été dépeints comme des conjoints et pères « normaux » ou « idéaux ».
Parmi les autres affaires médiatisées récemment, on pourrait citer des dizaines d’hommes s’étant soigneusement forgé une image de « saint-n’y-touche », à commencer par l’abbé Pierre, personnalité préférée des Français pendant près de vingt ans, dont 57 victimes ont fait connaître leur témoignage.
Citons également Jacques Salomé, chantre du développement personnel et de la communication non violente, accusé d’agressions sexuelles et de viols par cinq femmes, ou Pierre-Alain Cottineau, assistant familial agréé, président d’une association de défense des droits des personnes LGBT et membre d’un collectif de lutte contre les violences conjugales et familiales, mis en examen pour « viols avec actes de torture ou de barbarie » sur des enfants – dont une fillette handicapée de quatre ans – qui lui avait été confiés par les services sociaux.
Ces cas, systématiquement qualifiés de « hors norme », en raison du nombre de victimes connues et de la capacité des mis en cause à duper l’entourage, ne sont probablement que quelques arbres qui cachent la forêt des agresseurs anonymes, souvent violeurs en série, perçus comme « des hommes bien sous tous rapports ».
Or, un problème individuel de masse est un problème sociologique.
Docteur Jekyll et Mister Hyde, les deux faces d’une même médaille
Cette stratégie est bien connue des spécialistes des violences conjugales. La psychologue Lenore Walker, qui fut la première à décrypter le cycle de la violence conjugale, Lundy Bancroft, expert des conjoints maltraitants, ou encore Evan Stark, sociologue à l’origine du concept de « contrôle coercitif », ont souligné que la dualité « Docteur Jekyll et Mister Hyde » constitue la norme chez ces hommes.
La façade « Docteur Jekyll » leur permet de gagner la confiance de leur cible, de l’entourage et, le cas échéant, de l’opinion publique. Cette vitrine d’homme sensible et attentionné, parfois fragile, bienfaiteur de la communauté, leur offre simultanément le sésame pour la commission des violences et leur impunité, car la victime passera souvent des années à tenter – en vain – de faire sens de ce « paradoxe » et, si elle parvient à s’en dépêtrer et à le dénoncer, l’entourage aura d’autant plus de mal à la croire que la magie de l’homme parfait aura opéré.
Aujourd’hui, dans un contexte de réprobation croissante du machisme, les hommes violents ont davantage recours aux procédés de mise sous emprise généralement labellisés « perversion narcissique ». À l’ère post-MeToo, les agresseurs ont intérêt à davantage recourir à des procédés comme la soumission chimique, qui semble ainsi se diffuser, car ils leur évitent de recourir à la violence physique pour contraindre leurs victimes. La soumission chimique n’est ainsi qu’une tactique de plus dans la panoplie du contrôle coercitif.
Elle leur permet de surcroît de brouiller, si ce n’est d’effacer, les souvenirs de leurs crimes. Le masque de « l’homme parfait » peut ainsi continuer à être exhibé, sans dévoiler le visage de l’homme violent – pas même à la victime. Pas vu, pas pris !
Cinquante nuances de guet-apens
Loin de se limiter aux violences conjugales, la stratégie de « l’homme parfait » arbore, telle une hydre, d’innombrables visages.
Proposer du soutien moral, ou de l’aide matérielle, à une femme ou un enfant en difficulté fait partie des stratégies d’agressions sexuelles. Elle est par exemple utilisée par les proxénètes pour amener des adolescentes à la prostitution, ou par les pédocriminels adeptes du « cybergrooming ».
Raccompagner une femme après une soirée en prétextant vouloir s’assurer de sa sécurité dans l’objectif de créer l’opportunité du viol – voire du féminicide – repose sur des logiques analogues.
À l’instar de Dominique Pelicot, certains agresseurs jouent les pompiers pyromanes en créant de toutes pièces le problème qu’ils offrent de résoudre, dans le seul but de passer à l’acte. C’est ce qu’ont fait les violeurs et assassins de Priyanka Reddy, jeune vétérinaire indienne, en crevant les pneus de son scooter avant de lui proposer de la dépanner.
La tactique consistant à mettre en scène une détresse ponctuelle pour tendre une embuscade, comme l’a fait l’homme qui a violé la journaliste Giulia Foïs, ou à se faire passer pour vulnérable afin de susciter la pitié de leur cible, est une variante de la stratégie de l’homme parfait, en ce qu’il s’agit de tromper la vigilance de la victime.
S’engager pour les droits des femmes, des enfants ou d’autres groupes opprimés est une autre variante de la stratégie de l’homme insoupçonnable, qui fait florès depuis #MeToo. Harvey Weinstein avait lui-même soutenu publiquement des films féministes et promu des réalisatrices.
Lors de la vague féministe Ni Una Menos (« Pas une de moins ») en Amérique latine, un homme avait fait le buzz en défilant torse nu lors d’une manifestation à Santiago, au Chili, avec une pancarte « Je suis à moitié nu entouré du sexe opposé… Je me sens protégé, pas intimidé. Je veux la même chose pour elles ». Les posts de son ex-compagne le dénonçant pour violences conjugales et paternelles avaient fait nettement moins de bruit.
Toujours dans le cadre de Ni Una Menos, en Argentine, un homme avait aussi battu le pavé aux côtés de sa compagne avant de l’assassiner de 30 coups de couteaux deux ans plus tard.
Loin d’être victimes de pulsions inexplicables, ces hommes agissent au contraire de manière rationnelle et stratégique : s’ils s’adonnent aussi largement à ce double jeu, c’est parce qu’il est éminemment rentable pour eux, affirme ainsi Lundy Bancroft.
Dans son sillage, nous aimerions « que les gens ne soient pas si surpris. […] La plupart des agresseurs cultivent une image publique positive, ce qui conduit régulièrement à des cas où les observateurs disent : “Oh, j’en doute, il n’a pas du tout l’air d’être ce genre de personne.” Se donner une bonne image publique est le genre », écrit-il dans ce post de blog sur Eric T. Schneiderman, ancien procureur général de l’État de New York ayant démissionné après avoir été accusé de violences par d’anciennes compagnes.
En somme, il va falloir s’habituer aux procès « hors norme ».![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
























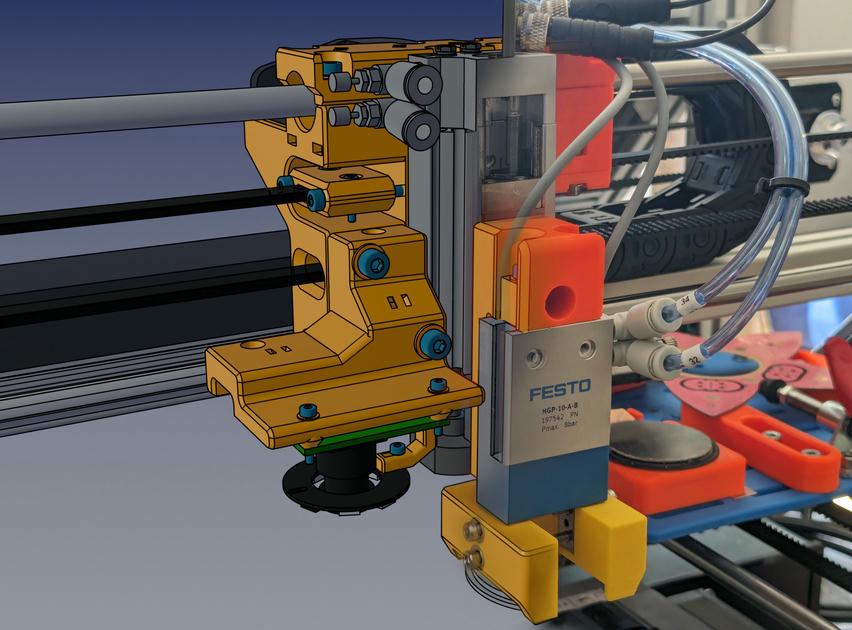



















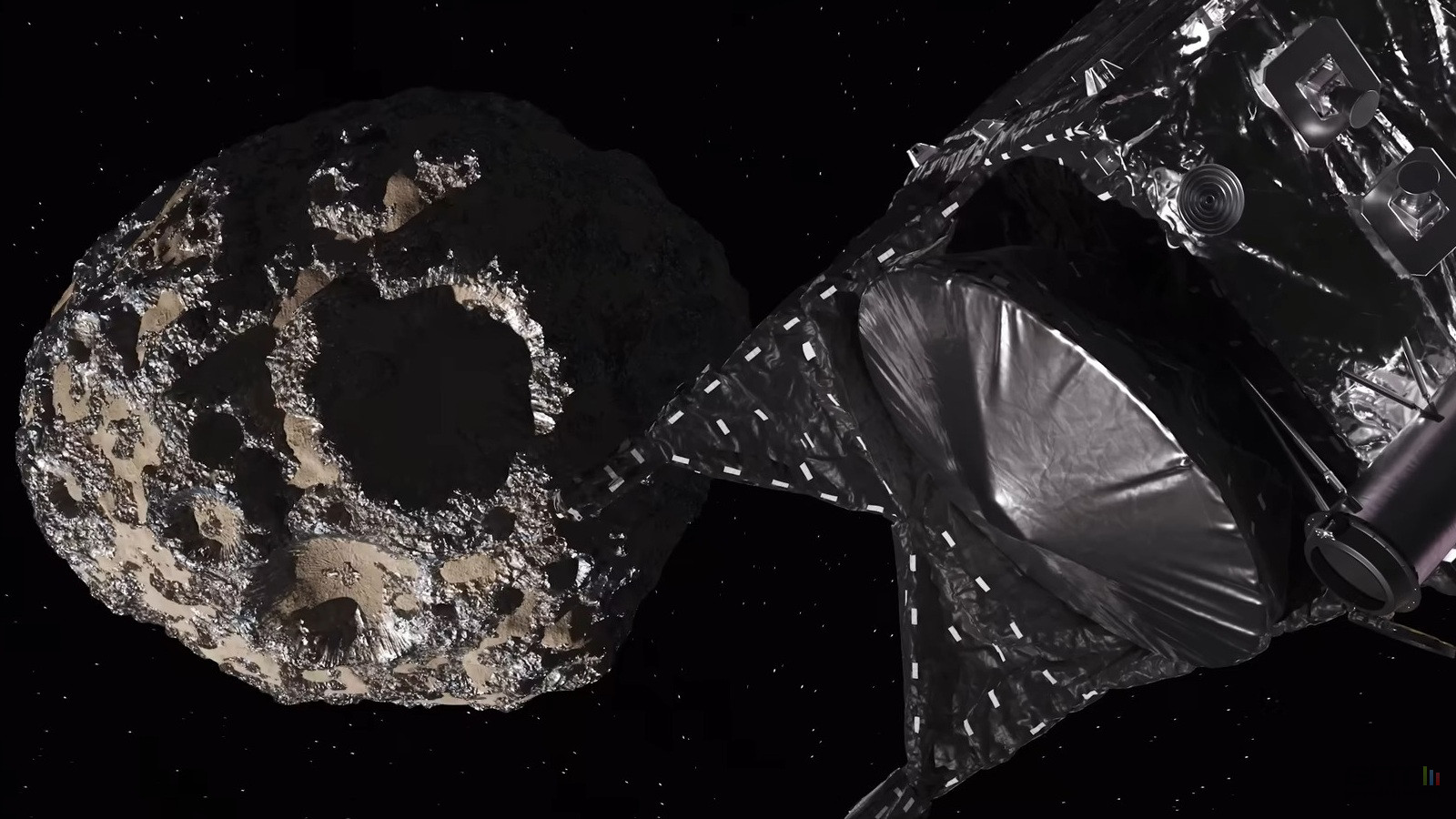

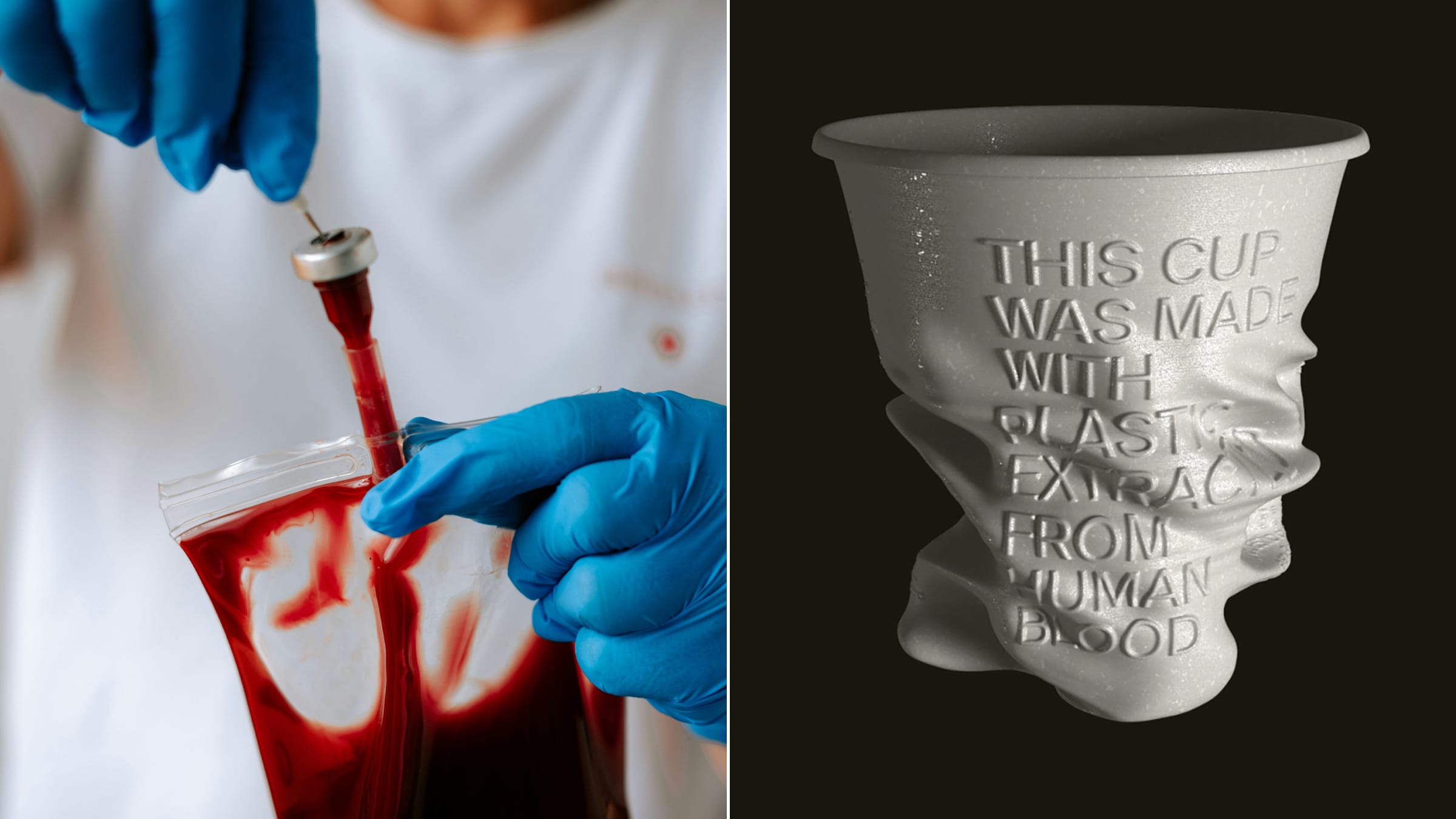

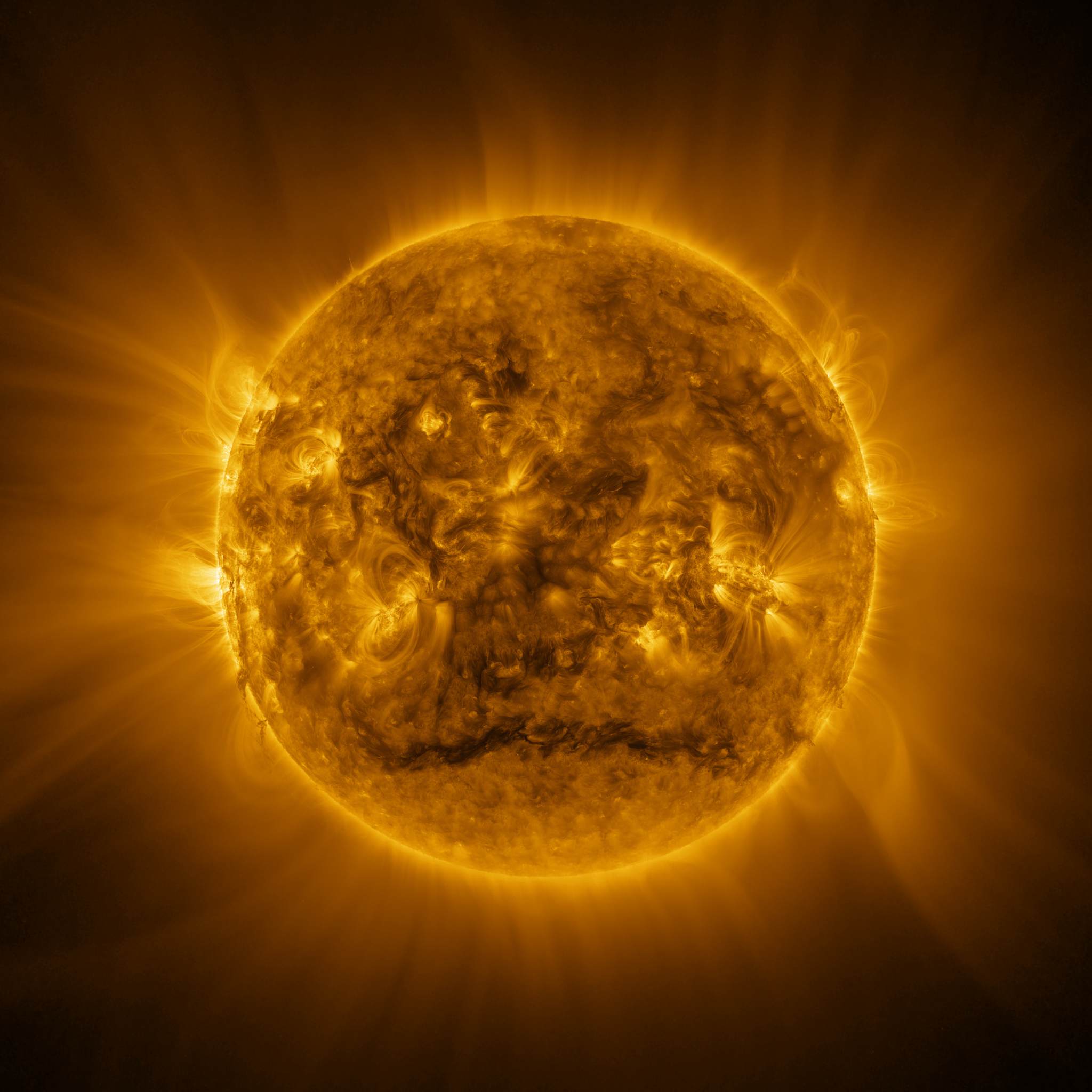



/2025/05/02/haumont-6814cd7ec0d4b492962924.jpg?#)






/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)















