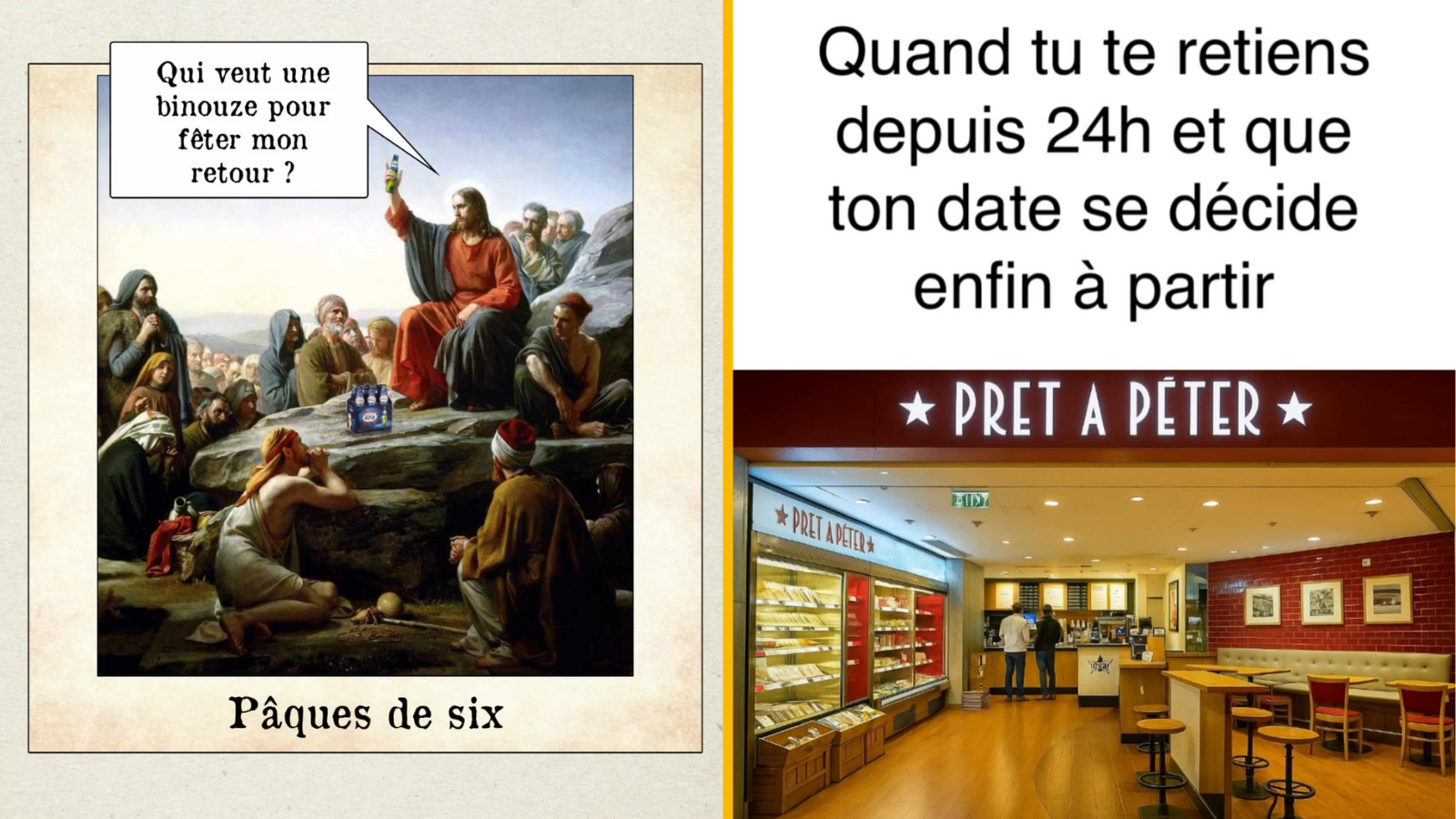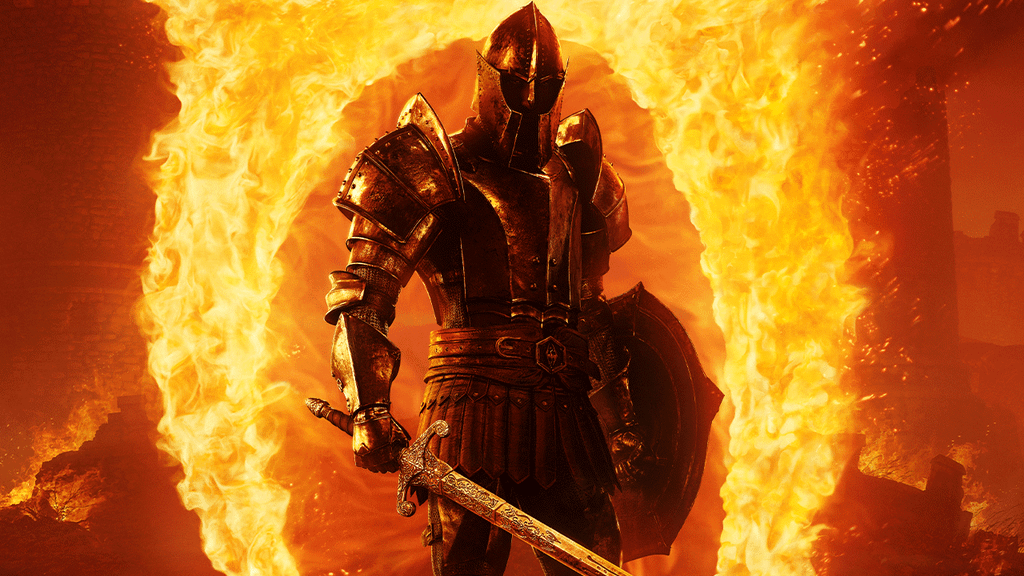L’US Army selon Trump : purge idéologique, désengagement stratégique
L’armée des États-Unis, aussi bien dans sa dimension organisationnelle qu’en sa qualité d’outil de politique étrangère, connaît des changements rapides et profonds dont les conséquences seront majeures.


Coupes budgétaires, scandales, limogeages, licenciements à l’intérieur ; désengagement progressif de théâtres majeurs à l’extérieur, accompagné de menaces de déploiement massif face à des alliés, comme au Groenland ou à la frontière du Mexique : avec Donald Trump, la politique militaire des États-Unis connaît une transformation fulgurante qui suscite moult interrogations et inquiétudes, au pays comme ailleurs dans le monde.
Cent jours après son retour au pouvoir, Donald Trump a entamé une reconfiguration brutale et idéologique de l’appareil militaire des États-Unis. Loin d’un simple ajustement stratégique, c’est une transformation profonde de la défense nationale qui est à l’œuvre : coupes budgétaires massives, marginalisation de figures clés du Pentagone, recentrage des priorités sur des zones jugées politiquement rentables et retour assumé à une armée plus « loyale » que compétente.
Cette stratégie s’accompagne de scandales internes, de dérives autoritaires et d’un affaiblissement du moral des troupes. Le bilan des cent premiers jours touche bien au-delà de la sphère militaire : il pose une question centrale sur l’avenir de l’armée dans un État de droit fragilisé. L’opinion publique reste divisée entre ceux qui voient dans ces mesures un assainissement nécessaire et ceux qui dénoncent la dénaturation d’une institution républicaine.
Une réduction budgétaire sans précédent
Malgré l’annonce d’un budget record de 1 000 milliards de dollars pour Le Pentagone, les premières mesures de l’administration Trump 2 sont marquées par des coupes ciblées : les dépenses baisseront de 8 % par an pendant cinq ans sur les lignes jugées secondaires. Sont épargnées la modernisation de l’arsenal nucléaire, les technologies de surveillance et les opérations frontalières.
En revanche, des contrats majeurs avec Accenture ou [Deloitte](https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(audit_et_conseil) ont été révoqués, et près de 61 000 postes civils sont appelés à disparaître. Le message est clair : il s’agit à la fois de réduire les coûts et de restaurer l’efficacité, même au prix de la stabilité interne.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Cette logique touche durement la logistique et l’entretien, ralentit la modernisation des systèmes et affecte directement l’entraînement des troupes. Pete Hegseth, le nouveau secrétaire à la défense, a ordonné la révision des standards physiques pour toutes les unités de combat, au nom d’une « culture du guerrier ». Priorité affichée : létalité et discipline. Réalité : une armée qui perd en cohésion et en compétences, déstabilisée par des choix idéologiques plus que fonctionnels.
La menace du gel des programmes de formation conjointe avec les alliés, divulguée par les médias suédois, a été démentie, mais reste une possibilité.
Les coupes budgétaires affectent aussi la recherche et le développement dans les domaines cyber, spatial et de l’intelligence artificielle, mettant en péril la compétitivité technologique des États-Unis dans des secteurs clés de la guerre du futur. Plusieurs experts militaires craignent un effet retardé, où les gains à court terme en efficacité budgétaire se paieront d’une perte de supériorité décisive dans une dizaine d’années. Ce pari sur le temps long, fondé sur une confiance idéologique dans la résilience de l’appareil militaire, pourrait s’avérer risqué dans un environnement stratégique aussi instable.
Une purge silencieuse mais réelle
En parallèle de cette rationalisation budgétaire, la structure hiérarchique de l’armée est bouleversée par une série de renvois spectaculaires de hauts gradés : Timothy Haugh (directeur de l'agence américaine de renseignement, la NSA), Shoshana Chatfield (représentante à l’Otan), Charles Q. Brown Jr (chef d’état-major interarmées), Susannah Meyers (responsable de l’unique base américaine au Groenland)… Tous perçus comme critiques, non alignés, ou coupables d’avoir manifesté des doutes sur la ligne imposée depuis la Maison Blanche. Le Pentagone assume : il s’agit de restaurer la loyauté.
Mais les profils ciblés ne trompent pas : femmes, officiers issus de minorités, responsables attachés aux alliances multilatérales. L’offensive contre les politiques DEI (diversité, équité, inclusion) a d’ailleurs pris un tour systématique. Clubs dissous à West Point, livres retirés des bibliothèques militaires, suppression puis restauration de références historiques aux Tuskegee Airmen (les premiers aviateurs militaires afro-américains des États-Unis) ou aux Navajo Code Talkers (soldats issus du peuple navajo ayant mis au point un code indéchiffrable durant la Seconde Guerre mondiale) : c’est une mémoire militaire alternative que l’administration tente de configurer.
Les militaires eux-mêmes expriment de plus en plus leur malaise face à ce qui est perçu comme une croisade idéologique.
Les initiatives autour du mentorat, du soutien psychologique ou de la médiation ont été supprimées, car jugées « non prioritaires ». Le climat se durcit, et les départs anticipés sont à craindre, ce qui pourrait avoir des effets de longue durée. Ce phénomène pourrait durablement affaiblir la capacité de commandement intermédiaire, déjà sous pression.
Retrait partiel, recentrage idéologique
Sur la scène internationale, l’administration Trump adopte une logique de repli sélectif. L’aide à l’Ukraine est brièvement suspendue en mars 2025. En avril, quand les villes ukrainiennes de Soumy et de Kryvyï Rih sont frappées par des missiles russes, la réaction des États-Unis est pour le moins évasive. Le 4 avril, après la frappe sur Kryvyï Rih, qui tue 11 adultes et 9 enfants, l’ambassadrice à Kiev Bridget Brink déplore les vies perdues sans citer la Russie, suscitant de vives critiques de Volodymyr Zelensky (elle pointera d’ailleurs la Russie du doigt après la frappe sur Soumy, le 13 avril, qui a fait plus de 30 victimes). Keith Kellogg, conseiller spécial de Trump pour la Russie et l’Ukraine, parle à propos de Soumy d’une « attaque au-delà de toute décence », sans plus de conséquences concrètes. Trump, pour sa part, se contente d’accuser… Volodymyr Zelensky et Joe Biden d’être à l’origine de la guerre. La volte-face des États-Unis vis-à-vis de l’Ukraine se ressent de plus en plus clairement.
Mais le désengagement ne s’arrête pas là. La promesse d’intégration de l’Ukraine à l’Otan est abandonnée. Les relations avec les alliés européens sont tendues. Contre l’avis du général Cavoli, commandant des forces des États-Unis en Europe (Eucom), Washington menace de retirer 10 000 soldats d’Europe.
En Asie-Pacifique, la doctrine est floue : alors que la Chine intensifie ses pressions sur Taïwan, les États-Unis gardent le silence, mais des rumeurs persistent notamment sur une réduction des effectifs stationnés en Corée du Sud.
En revanche, le pouvoir se redéploie ailleurs : Panama, la frontière du Mexique, le Groenland.
Moins d’alliés, plus de contrôle politique : c’est une géopolitique de l’entre-soi qui se dessine, déconnectée des alliances traditionnelles et source d’incertitude.
Une armée fragilisée, une société fracturée
Les effets de cette stratégie se font sentir à tous les niveaux. Le retrait logistique de Pologne et les retards de maintenance affaiblissent l’aptitude à réagir rapidement en cas de besoin (« readiness »). Le moral des troupes décline. L’incertitude sur les déploiements, les coupes dans les effectifs civils et les révisions de standards alimentent une forme de désillusion.
Les écoles des bases militaires voient apparaître des mobilisations d’élèves contre la suppression de clubs ou de manuels. À Stuttgart, une cinquantaine d’élèves ont quitté leurs cours en signe de protestation, lors d’une visite de Pete Hegseth. Chez les anciens combattants, la colère monte : les associations comme VoteVets dénoncent la trahison des promesses faites aux militaires.
Parallèlement, des fuites sur les méthodes de communication non sécurisées exposent l’improvisation de l’équipe dirigeante. Un journaliste aurait été ajouté par erreur à un groupe discutant d’opérations classifiées au Yémen (Signalgate).
Un climat de peur paralyse toute contestation au sein du commandement. La loyauté prime sur la compétence, au détriment du professionnalisme. Des officiers anonymes évoquent une purge politique permanente. Cette culture du silence, accentuée par l’absence de stratégie claire, aggrave le malaise et affaiblit l’efficacité opérationnelle.
Le décrochage américain
Le refus de Trump de se rendre à Dover (Delaware) pour accueillir les corps de soldats morts lors d’un accident en Lituanie est plus qu’un symbole : il incarne un abandon du pacte moral entre la nation et son armée. La fracture civilo-militaire se creuse, tout comme la méfiance entre institutions. Des généraux en retraite, des diplomates, et même certains élus républicains comme le président de la commission des forces armées du Sénat, le sénateur républicain Roger Wicker, du Mississippi, commencent à exprimer publiquement leurs inquiétudes.
Au niveau mondial, la stratégie trumpienne crée un vide. L’imprévisibilité de Washington affaiblit les alliances, brouille les doctrines et laisse le champ libre aux puissances révisionnistes. Le leadership des États-Unis, déjà contesté, sort durablement amoindri de ce tournant idéologique et partisan.
L’armée américaine, longtemps pilier du système international, se retrouve instrumentalisée et isolée, au moment où le monde aurait besoin de clarté, de cohérence et de stabilité. Dans les capitales alliées, le doute s’installe : les États-Unis sont-ils encore un partenaire fiable ?![]()
Elizabeth Sheppard Sellam ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.










![[CHRONIQUE] Le pape est mort, vive le pape](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/cercueil-pape-francois-616x341.jpg?#)





























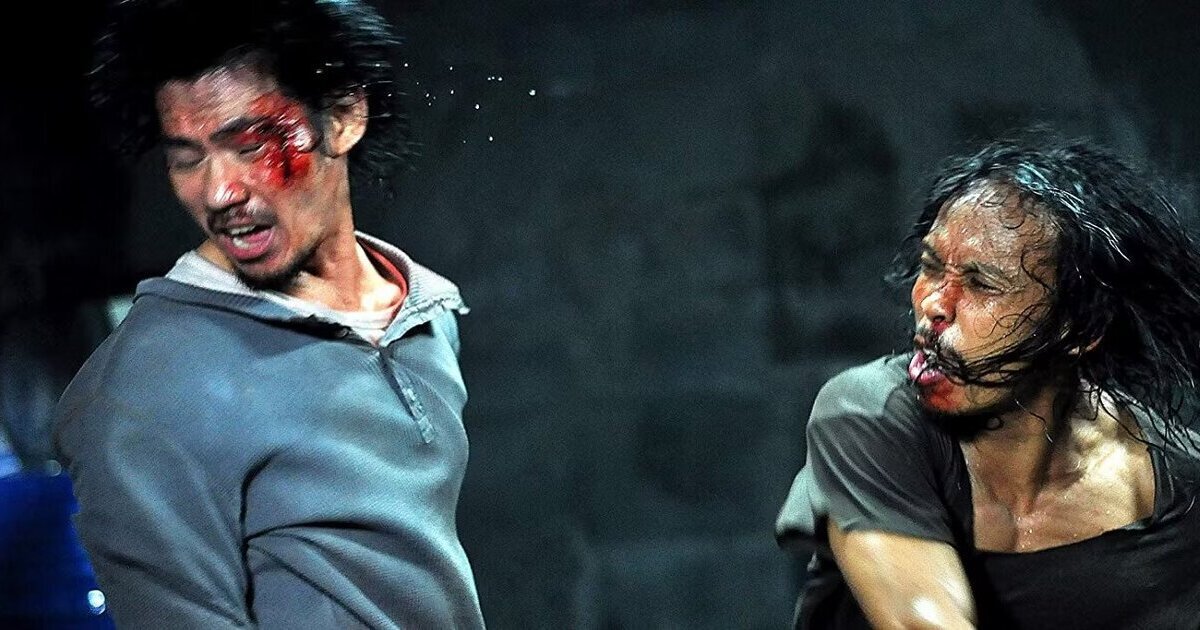
/2025/04/27/polnareff-680e31ac68051745918644.jpg?#)