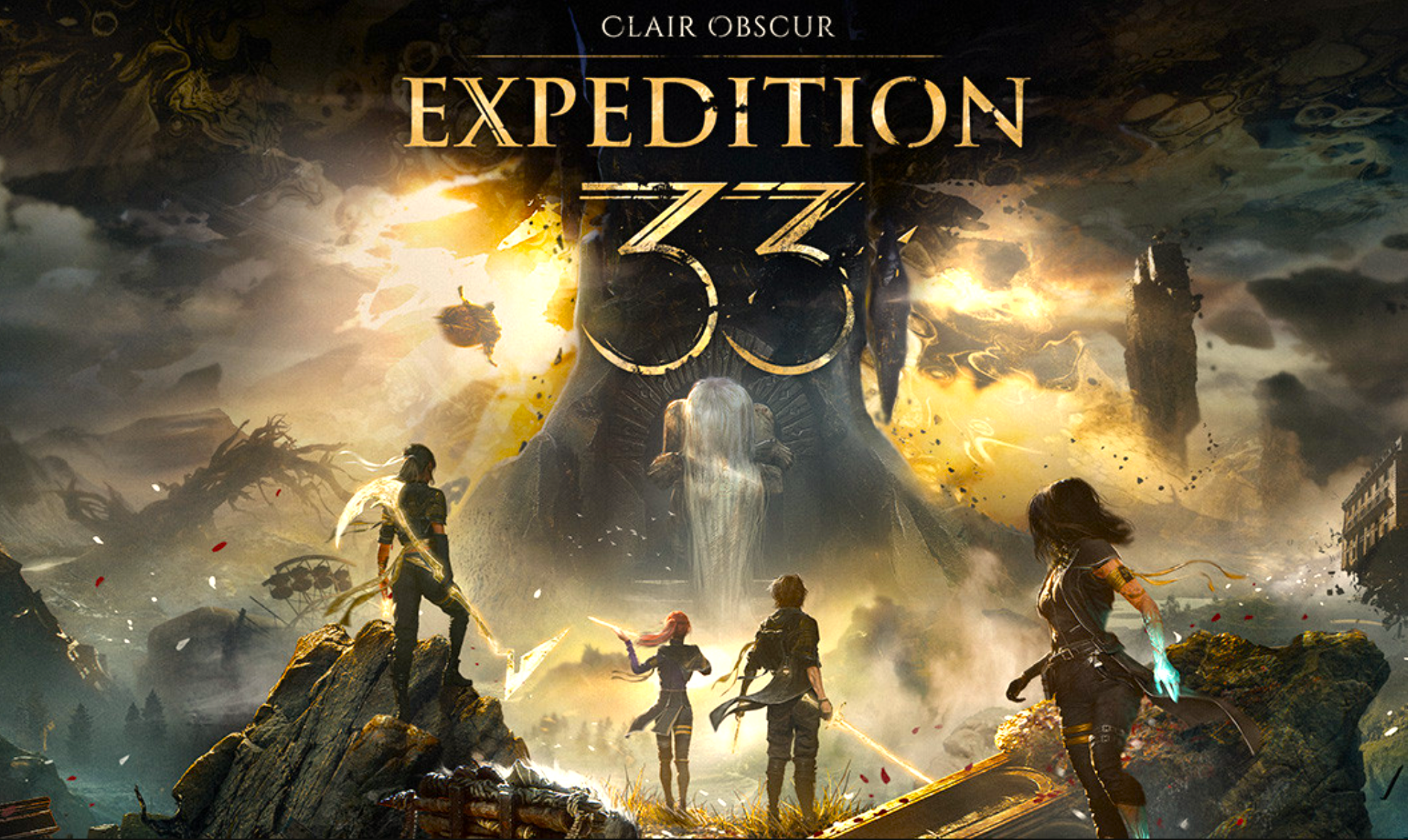Les micro-violences éducatives ordinaires : un impensé de l’institution scolaire ?
Certaines paroles tenues en classe ou certaines attitudes d’enseignants peuvent durablement blesser des élèves sans forcément être perçues comme des violences. La recherche éclaire cet angle mort.

Sans être forcément perçues comme des formes de violence, certaines paroles tenues en classe ou certaines attitudes de professeurs peuvent durablement blesser des élèves. Des chercheurs se penchent sur cet angle mort de l’institution scolaire qui interroge les logiques de gestion de groupe et la formation au métier enseignant.
Lorsqu’on parle de violences à l’école, on pense aux brutalités physiques ou au harcèlement entre élèves. Mais il existe aussi des violences bien plus insidieuses, que les chercheurs qualifient de micro-violences éducatives : de petits actes ou paroles du quotidien qui portent atteinte à la dignité d’un élève, sans être forcément perçus comme une forme de violence.
Que penser de ce phénomène, à la fois actuel et difficile à percevoir, qui émane principalement des enseignants à l’égard de leurs élèves ?
De nombreux témoignages d’anciens élèves illustrent pourtant son ampleur. Julie, par exemple, aujourd’hui en formation d’enseignant, se souvient qu’en classe de quatrième, un professeur lui a « lancé » :
« Dans ton cerveau, c’est le désert, tu n’arriveras jamais à rien. »
Cette humiliation publique l’a dévastée : Julie explique y avoir cru, au point de décrocher scolairement dès la fin du collège. Il lui a fallu des années pour se reconstruire.
Paul, aussi, étudiant dans la même formation, dira d’une enseignante :
« Elle me faisait sortir de la classe à chaque leçon de mathématiques et m’envoyait en CP, sans avertir mes parents. J’avais honte. Et pendant les contrôles, elle disait aux autres de faire des murs de classeurs pour que je ne copie pas. »
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Ce type de micro-violences scolaires est de nature à marquer durablement et fortement celui qui est en position de ne pas pouvoir y répondre. L’élève visé n’est pas nécessairement exclu de l’école, mais il est en risque de se retrouver « isolé de l’intérieur ». La confiance en soi s’effrite, le lien aux autres se distend, l’envie d’apprendre s’étiole.
Victime d’une violence banalisée – qui n’est d’ailleurs pas incriminée en faute et ne reçoit pas la qualification juridique de violence – et provenant d’une personne digne de confiance, l’enfant peut se couper des apprentissages et du groupe, en silence.
Quand l’institution scolaire ne veut pas voir
Pourquoi de tels comportements passent-ils inaperçus, voire sont-ils perpétués ?
D’abord, et surtout, ils sont ancrés dans la culture scolaire et dans le fonctionnement même de l’institution scolaire « susceptible en lui-même », nous dit le défenseur des droits en 2019, « d’induire ou d’amplifier les violences faites aux enfants dont elle a la charge ».
Ensuite, il ne faut pas oublier que l’enseignant, débordé et à court de solutions dans un système pensé pour gérer les flux, peut utiliser ces « techniques » par habitude et comme outil de contrôle de son groupe classe. Elles peuvent être verbales (par un refus de parole, une interruption brutale, une remarque sèche, une subtile moquerie…), physiques (un tirage de bras, de pull, un repositionnement…), spatiales (un mur de classeur, une exclusion de l’activité…), mais aussi se manifester par une marque d’isolement (un refus d’attention, une non-réponse aux demandes, une absence de regard, des soupirs aux réponses…).
Enfin, les futurs enseignants apprennent d’abord et surtout à maîtriser des disciplines, mais la dimension relationnelle du métier n’est prépondérante ni dans les épreuves du concours ni dans les parcours qui les y préparent.
Faute de formation et d’évaluation sur l’impact de leurs mots et attitudes, nombre de professeurs reproduisent des attitudes auxquelles ils ont été confrontés quand ils étaient enfants. Or, réfléchir à ses pratiques et mesurer l’effet de ses paroles et de ses gestes gagnerait à faire partie intégrante et première du métier. À ce jour, cet aspect reste toujours un angle mort ou minoré de l’institution scolaire.
Des « micro-attentions » pour relier plutôt qu’isoler
Lutter contre ce type de violence n’encourant le plus souvent ni réprobation sociale ni sanction administrative, disciplinaire ou judiciaire, suppose un changement de culture. Mais en attendant que les institutions publiques se rendent compte des violences produites par leur forme d’organisation, plusieurs chercheurs appellent à cultiver le contrepoint des micro-violences : les micro-attentions éducatives.
Il s’agit de petits gestes ou de mots ordinaires, qui montrent à l’élève qu’il est à sa place et que l’on est attentif à ce qu’il dit et fait. Ici aussi, le pouvoir d’un simple signe de reconnaissance est aussi fort que celui porté par les micro-violences. Par exemple, une professeure de collège a remarqué l’isolement d’Emma et l’a aidée, selon ses dires, à s’intégrer dans un groupe – cette initiative a empêché l’adolescente de rester en marge.
Un autre témoin se souvient que son instituteur a dit un jour à sa mère devant lui : « Sam réussira toute sa vie et ira très loin. » Cette phrase (prononcée pourtant en maternelle) « est restée gravée en moi », confie-t-il. Ces micro-attentions éducatives ont agi, pour cet ancien élève, comme un miroir d’ouverture à la vie, à l’opposé des micro-violences. Elles renforcent le lien de reliance entre l’élève, le maître, l’école et le désir d’apprendre.
Mais, pour que ces pratiques se généralisent, elles doivent être protégées et soutenues par l’institution. Or, ce n’est pas le cas à ce jour et les apports de ce type, quand ils existent, restent périphériques au système ordinaire.
Nos voisins allemands pourraient peut-être nous inspirer sur ce point. Le principe fondamental de la « dignité humaine » (Menschenwürde), inscrit dans leur Constitution (Article 1er : « La dignité de l’homme est intangible. La respecter et la protéger est l’obligation de tous les pouvoirs publics. »), conduit à une vigilance particulière face aux comportements pédagogiques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des élèves.
Là où, en France, la relation enseignant-élève est marquée par une sévérité éducative légitimée, l’Allemagne privilégie une intervention institutionnelle protectrice. Des mécanismes administratifs permettent d’agir, en effet, avant que les situations ne dégénèrent en procédures pénales.
En rendant visible cet espace de sévérité légitimée, mais aussi d’attentions, du système scolaire, l’enjeu est bien d’engager une réflexion politique et pédagogique de fond, collective, pour prévenir durablement des situations douloureuses.
Une enquête sur les micro-violences à l'école et à l'université est en cours et accessible ici![]()
Jean-Michel Perez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
















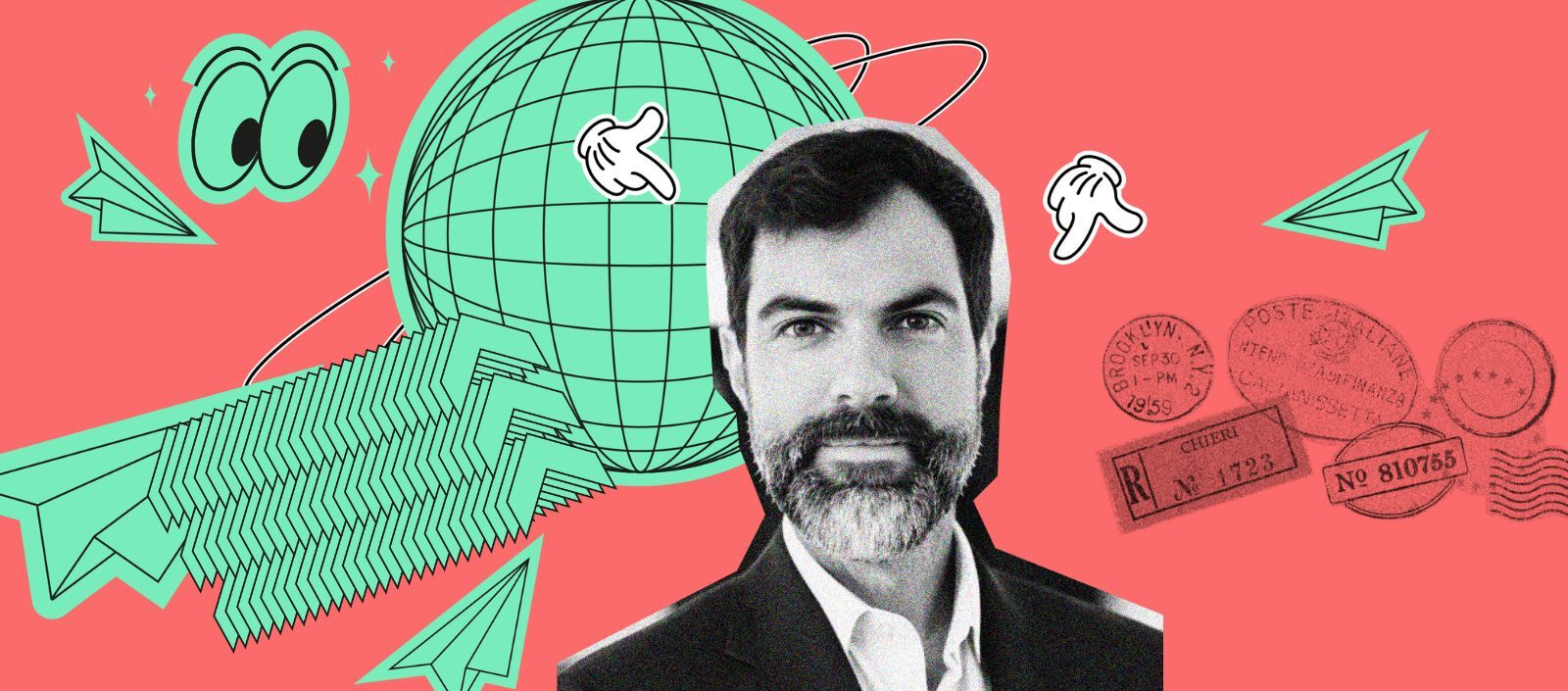




























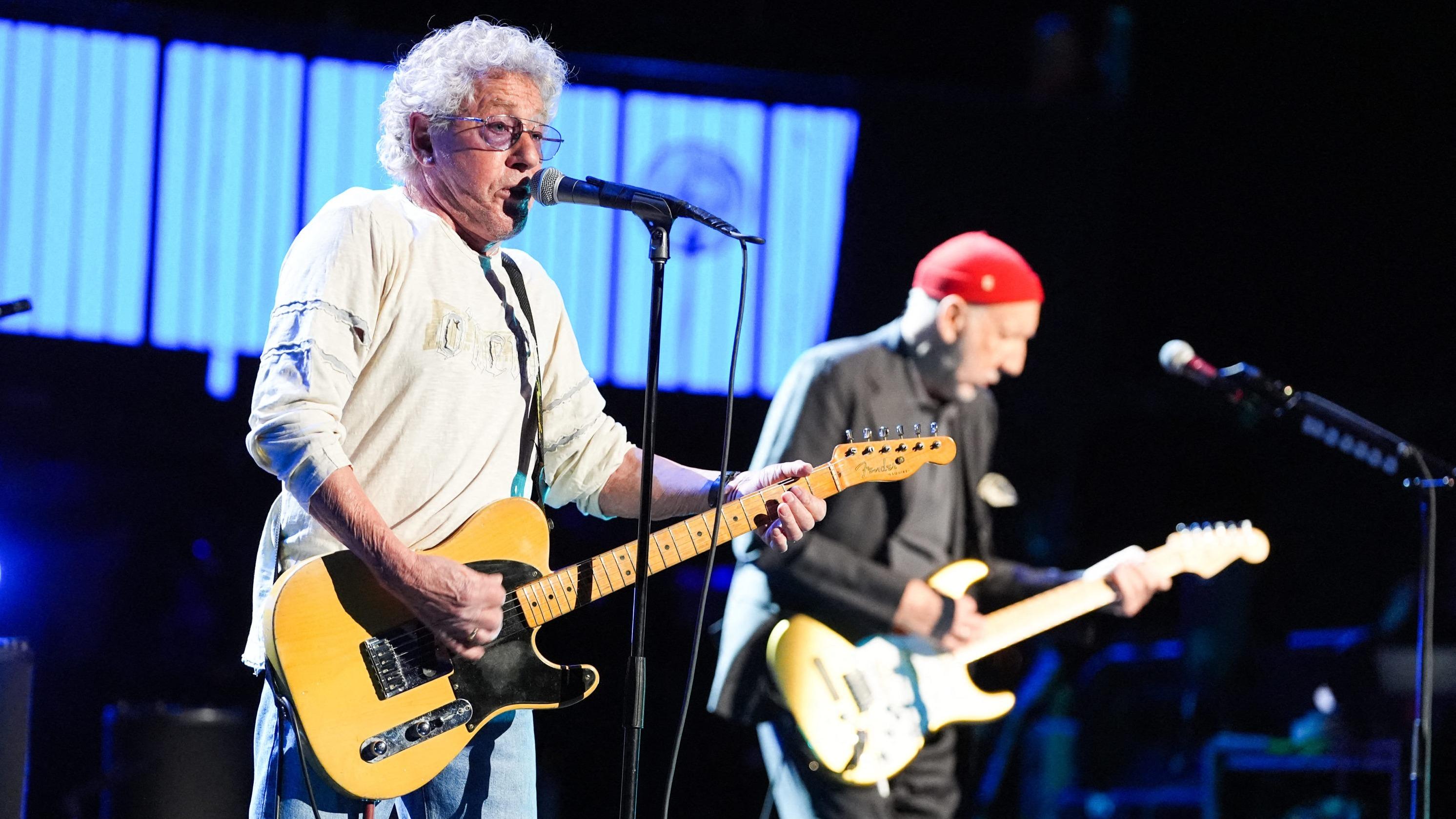


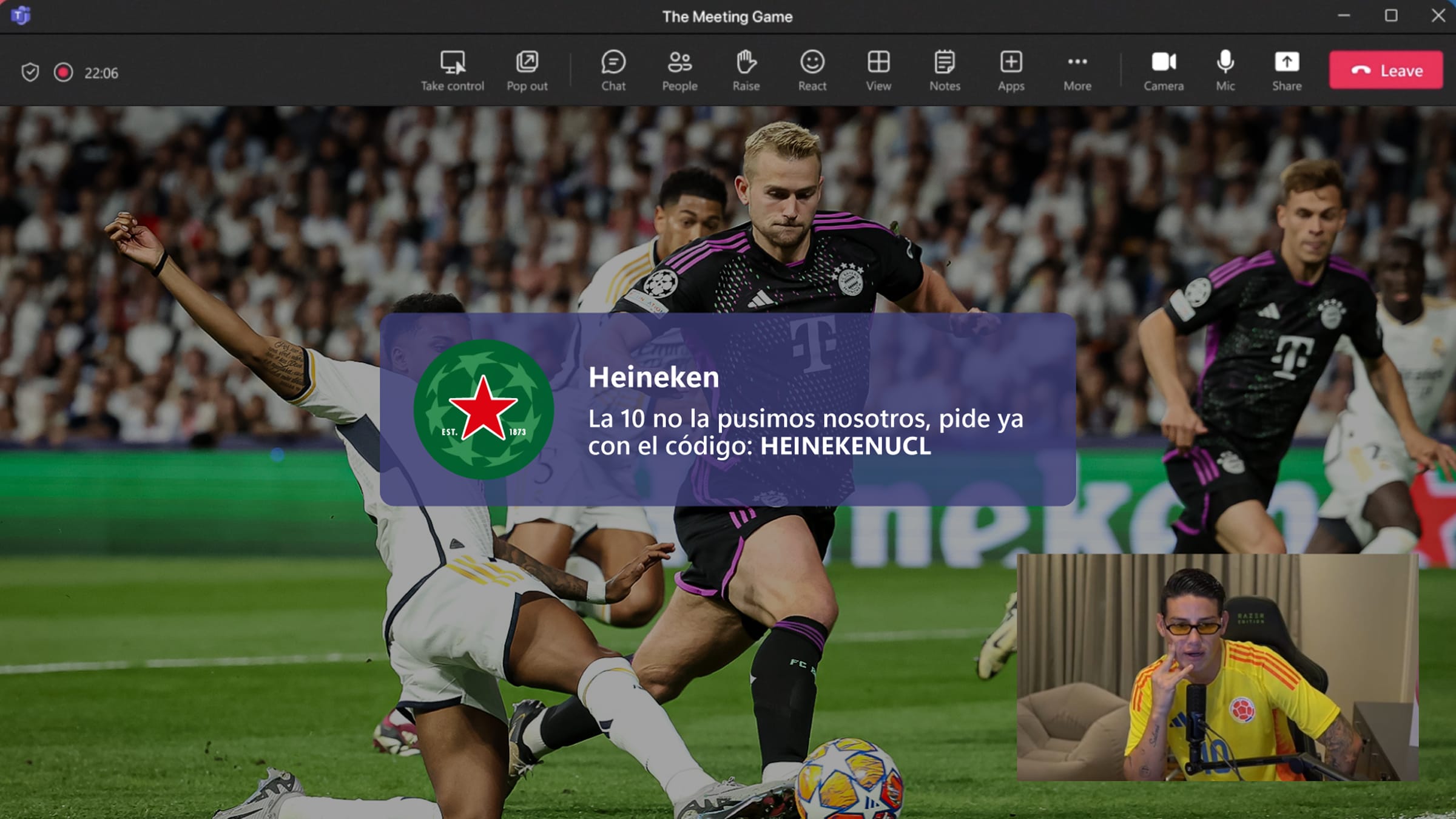

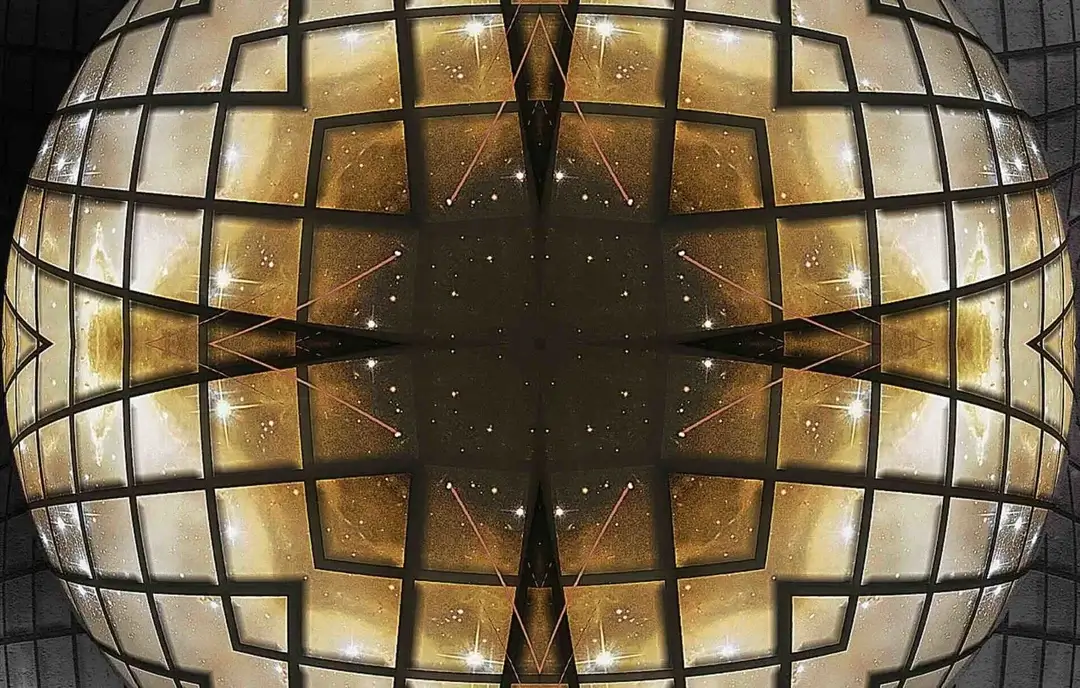
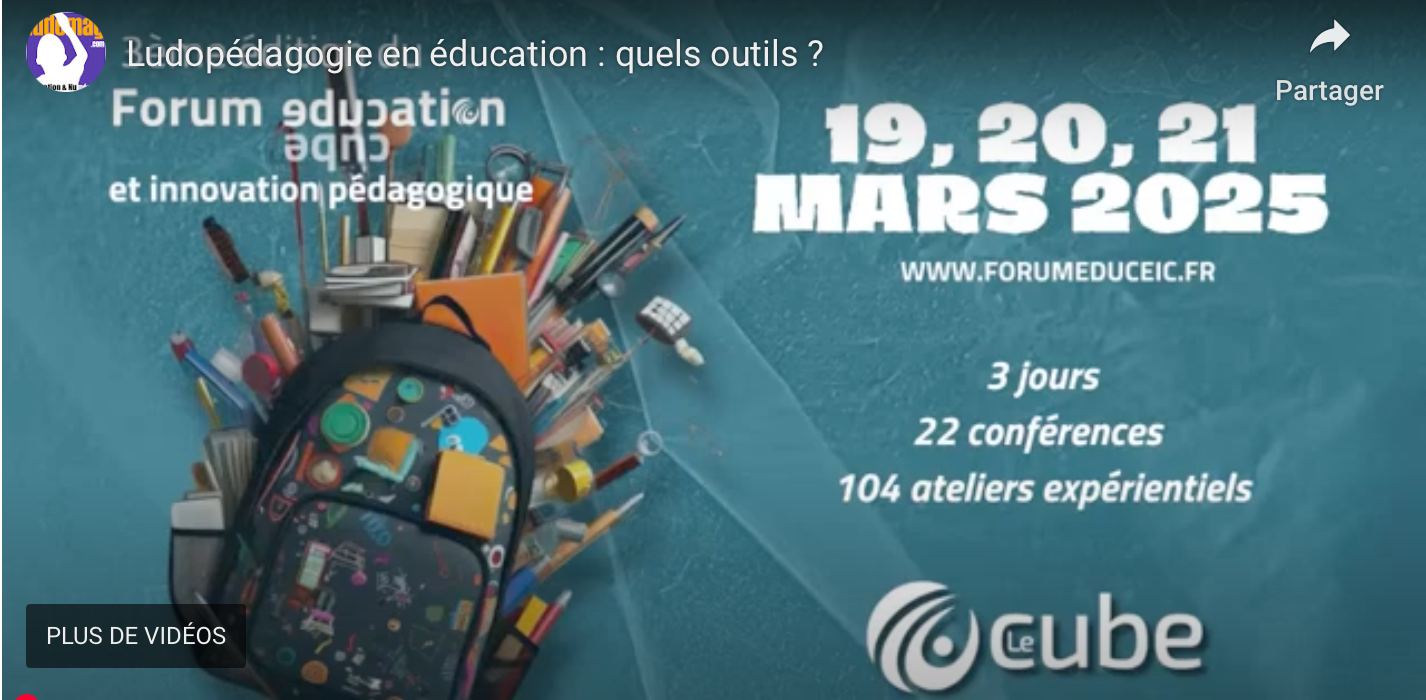
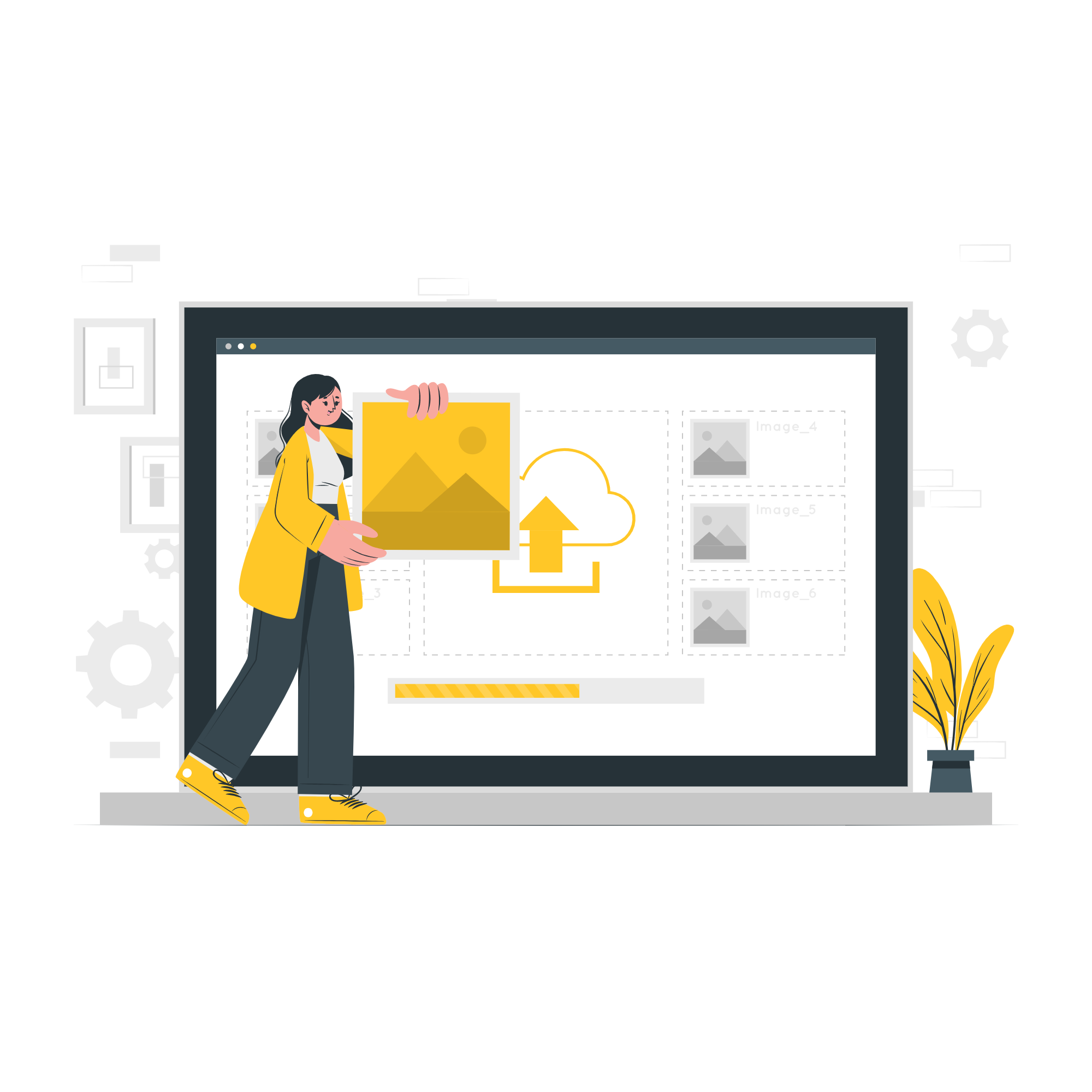








/image%2F0535633%2F20250511%2Fob_99adb5_350923261-262956939623899-919156463266.jpg)