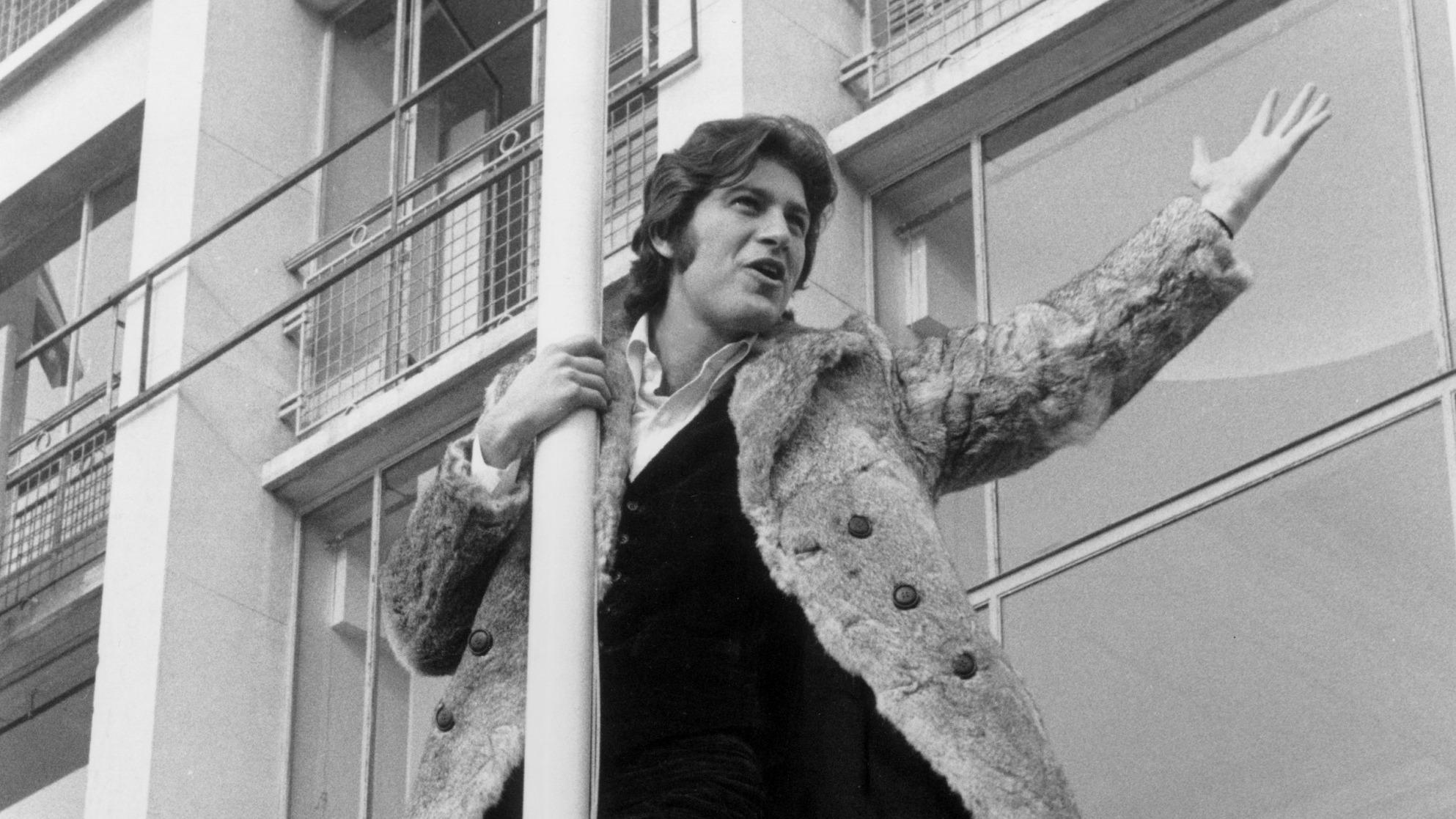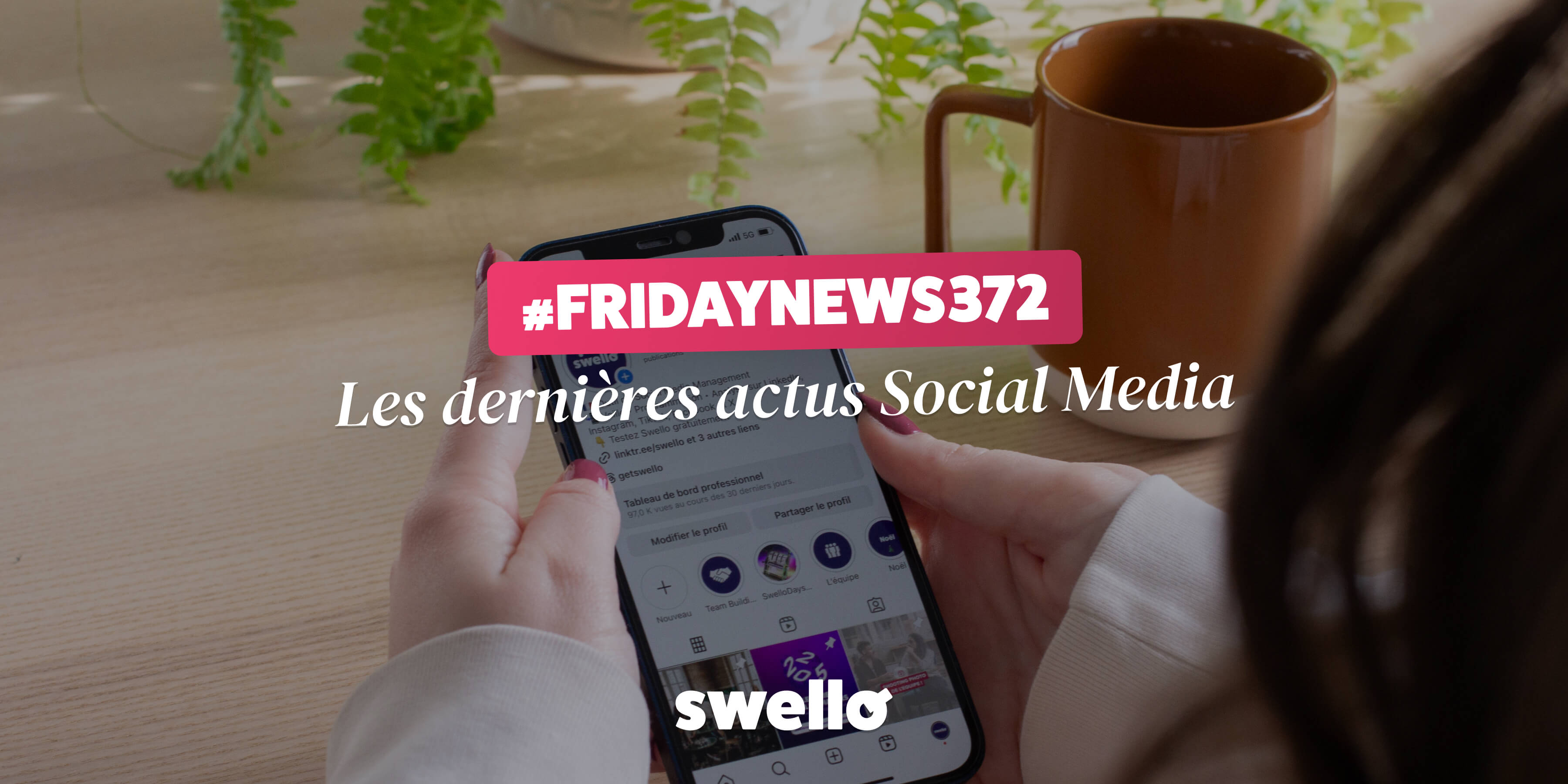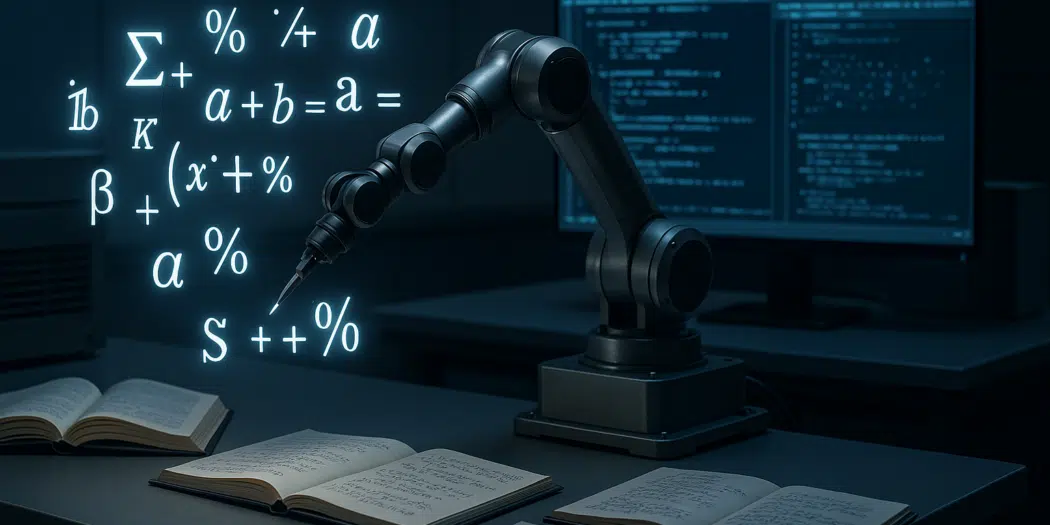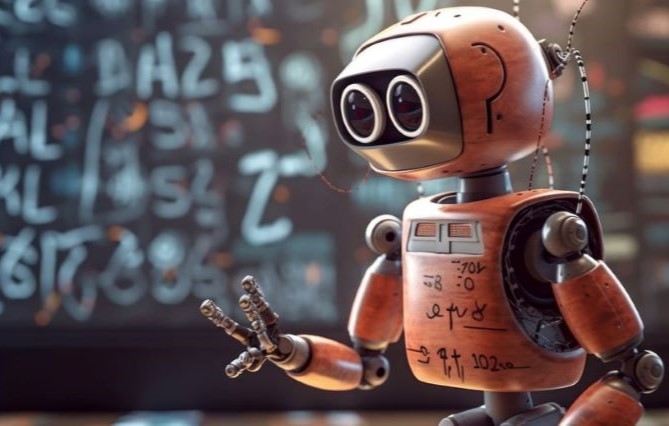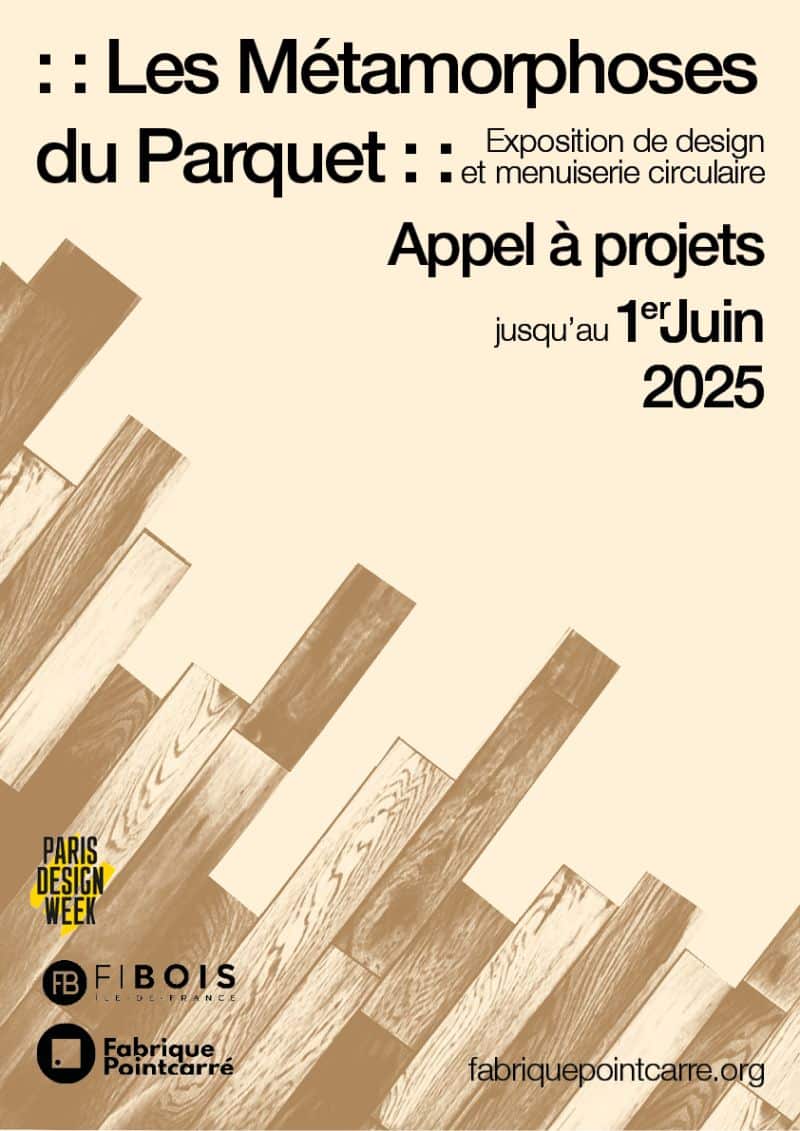Les guerres d’Israël et la question de la morale
Extraits choisis du récent ouvrage de Samy Cohen, « Tuer ou laisser vivre : Israël et la morale de la guerre », qui vient de paraître aux éditions Flammarion.

Entouré dès sa naissance en 1948 de nombreux ennemis déterminés à le faire disparaître, frappé par de multiples actes terroristes, Israël a rapidement mis sur pied un système militaire d’une redoutable efficacité… tout en affirmant son attachement à une forme d’éthique dans la conduite de la guerre et allant jusqu’à présenter son armée, Tsahal, comme étant « l’armée la plus morale du monde ». Alors que sa réaction au massacre commis par le Hamas le 7 octobre 2023 lui vaut l’opprobre d’une large partie de la communauté internationale et des accusations de génocide, il est particulièrement éclairant de se plonger dans l’ouvrage que le politologue Samy Cohen, directeur de recherche émérite à Sciences Po, auteur de plusieurs livres consacrés à l’État hébreu, vient de publier chez Flammarion, Tuer ou laisser vivre : Israël et la morale de la guerre, qui revient avec finesse et érudition sur l’évolution de la société et de l’armée d’Israël, de la formation de l’État à nos jours, et dont nous présentons ici des extraits tirés de la conclusion.
Quelles leçons tirer sur la place qu’occupe la question éthique dans la société et l’armée israéliennes ? Certains auteurs pensent que la haine et la violence sont intrinsèques à toute guerre et qu’il est vain de se poser la question de la « morale de la guerre », « la guerre pulvérise les valeurs et les lois ». Cette affirmation est discutable. Des soldats, en Israël comme ailleurs, sont en mesure de réfléchir à leurs actes, de distinguer le licite de l’illicite et de faire preuve d’humanité. C’est se dispenser de toute réflexion, surtout en cette période où le droit international humanitaire est « de moins en moins respecté ». C’est justement parce que la guerre engendre les pires sentiments, qu’il faut s’interroger sur les conditions rendant le comportement des armées moins inhumain.
Mais qu’est-ce qui est « moral » et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Un « comportement moral » n’implique pas de s’abstenir de faire la guerre dans un milieu peuplé de civils. Il y a des moments où des opérations militaires, mettant la population ennemie en danger, doivent quand même être menées, pour protéger les siens. Une armée en guerre contre le terrorisme peut être confrontée à des choix difficiles.
Un « comportement moral », surtout dans les conditions de la guerre asymétrique, s’évalue avant tout par la volonté de témoigner un minimum d’humanité aux populations civiles, par le refus d’obéir à des ordres manifestement illégaux, par la réflexion, le doute : tuer ou laisser vivre ? Des précautions sont-elles prises au moment de planifier les opérations, pour minimiser les pertes civiles ? Le système judiciaire sanctionne-t‑il les combattants qui violent la loi ? La formation donnée aux combattants en matière d’éthique est-elle suffisante ? La société civile s’érige-t‑elle en rempart contre les atrocités commises par son armée, ou au contraire laisse-t‑elle faire ? Le leadership politique, les partis, condamnent-ils les violations flagrantes des codes moraux par leurs soldats ? Au regard de ces critères, comment la société israélienne et son armée se sont-elles comportées ?
La réponse n’est pas univoque. Dans son histoire, Israël a oscillé entre brutalité et retenue. Sa trajectoire éthique comporte quatre grandes périodes, quatre grands âges : la première (1948-1960) est celle de la lutte pour la création de l’État, dans un contexte de « guerre de survie ». Elle combine faible culture démocratique et sentiment de péril national. La « pureté des armes » est ignorée par les combattants, alors que c’est justement pour cette guerre qu’elle a été inventée. Certaines unités se sont livrées à des atrocités qui n’étaient justifiées que par celles commises par l’ennemi, par pure vengeance la plupart du temps, et parfois pour terroriser une population dont on espérait le départ. Les codes moraux étaient pratiquement inexistants. Les combattants ignoraient volontiers le droit international. Il n’existait aucun mécanisme de sanctions susceptible d’inhiber les soldats tentés de se faire justice. Dans de nombreux cas, ils se livraient à des exactions sans en avoir reçu l’ordre. Par moments, rien ne distingue le comportement des forces juives de celui des milices et armées arabes, le « bon » du « méchant ». Le commandement israélien n’osait guère sévir. La société civile suivait passivement les événements à travers une presse patriotique. La direction politique au courant des crimes commis a manqué de courage et finalement a laissé faire.
[…]
La deuxième séquence (1960-2000) tranche avec le passé de manière significative. Des évolutions internes et internationales vont favoriser l’éclosion d’une nouvelle culture, d’une véritable conscience morale. Depuis la victoire de juin 1967, le contexte sécuritaire régional s’est apaisé. Les combattants qui expriment leurs « dilemmes moraux » lors d’une guerre sont perçus comme des héros. La justice internationale s’invite dans les affaires intérieures des États, ce qui n’est pas sans impacter l’armée israélienne. La haute hiérarchie militaire, s’inspirant des armées occidentales, devient plus sensible au droit international. Celui-ci est enseigné dans les écoles d’officiers. L’armée se dote d’un code éthique. La démocratie se consolide, la société s’autonomise par rapport au politique, les associations se multiplient, la population acquiert une capacité de jugement critique, ne faisant plus confiance aveuglément au gouvernement.
La guerre du Kippour en 1973 voit éclore un mouvement de protestation chez des soldats qui osent réclamer des comptes aux dirigeants, et vont obtenir leur démission. La question éthique surgit de manière éclatante avec une manifestation gigantesque contre la guerre du Liban et le massacre des camps de Sabra et Chatila. C’est à cette époque qu’apparaissent des figures morales telles que le colonel Gueva et les objecteurs de conscience. Tous refusent d’obéir à des ordres imposant à la population ennemie des souffrances inutiles. Les familles de soldats n’acceptent plus le sacrifice aveugle de leurs enfants. Elles veulent savoir pourquoi leur pays part en guerre. Les ONG de défense de droits de l’homme se multiplient et portent à la connaissance du public toute violation de la loi. Le système judiciaire gagne en indépendance. La brutalité gratuite, les sévices, voire la torture, comme ceux qui se sont manifestés pendant la première Intifada, ne sont plus acceptés de la même manière. Ils sont d’ailleurs notablement freinés par des généraux refusant les appels de la droite à la répression violente. Les journalistes se sont faits, eux aussi, plus critiques.
Le troisième acte coïncide avec l’apparition des attentats-suicides de la seconde Intifada. Il devient difficile de ne pas répliquer à des actes barbares par des actions similaires. Le discernement tend à disparaître, les civils palestiniens sont associés à la cause terroriste. Apeurés, les soldats sur le terrain ne savent pas si l’homme (ou la femme) qui s’avance vers eux est un terroriste ou un civil inoffensif. Les délais de réaction se réduisent. On tire volontiers pour éviter tout risque. Le droit international est mis au banc des accusés, au motif qu’il ne protège pas les démocraties contre le terrorisme. […]
La régression par rapport aux décennies précédentes est palpable, sans renouer pour autant avec les années 1940-1950. Les massacres ne sont plus de mise. Tsahal n’a jamais adopté les méthodes des groupes terroristes. Elle ne veut pas se trouver au banc des accusés pour crimes de guerre. Elle n’entend toutefois pas se laisser totalement brider par le droit international. Elle fait le nécessaire pour montrer autant que possible qu’elle est une armée « morale », mais ses efforts s’arrêtent là où commencent les risques pour ses soldats. Elle module sa riposte en essayant de tenir compte de ces deux contraintes.
Le terrorisme va détruire les codes moraux et déstabiliser la démocratie, créant un climat psychologique nouveau dans l’armée comme dans la société. L’opinion publique connaît une dérive tangible vers la droite. Un processus qui va s’accentuer avec les attaques du Hezbollah et les roquettes du Hamas entre 2005 et 2010. L’éthique du combat, l’humanisme, la protection des populations civiles lors des conflits armés, le respect du droit international humanitaire, toutes ces règles qui s’imposent aux démocraties en guerre comme autant d’exigences morales, qui dans le passé étaient au cœur du débat public, se sont effritées.
Dans la société, les questions éthiques ne font plus débat. Ceux qui osent les aborder sont très minoritaires et vite accusés de trahison. Achever un terroriste blessé – rendu inoffensif – devient pour beaucoup d’Israéliens une « obligation morale ». C’est l’ère des soldats qui « tirent et qui ne pleurent pas ». Quant à leurs familles, elles se mobilisent afin que l’armée ne fasse prendre aucun risque à leurs enfants. Tout comportement « moral » est perçu comme inadéquat. L’objection de conscience se fait rarissime.
[…]

La quatrième et dernière période renvoie à la guerre dans la bande de Gaza due à l’agression du Hamas, le 7 octobre 2023. Le contexte n’est pas celui d’une attaque terroriste classique, comme celles que les Israéliens connaissent bien, mais celle d’une agression qui vise l’extermination. Des dizaines de milliers d’habitants ont dû être évacués, ce qui n’était pas arrivé depuis la guerre d’Indépendance en 1948. Il s’agit pour Tsahal d’« en finir » avec cette menace. La société meurtrie, traumatisée, réclame vengeance. L’envie d’en découdre domine fût-ce au prix de vastes destructions. Le nombre impressionnant de pertes civiles dans la bande de Gaza n’intéresse pas les citoyens israéliens. Tsahal a une dette particulière envers ses citoyens qu’elle n’a pas su protéger.
Contrairement aux slogans répétés avec insistance, il n’y a pas eu de « génocide ». Mais la rage emporte tout – les dilemmes, les hésitations, les précautions – et brouille les repères entre la démocratie et les organisations terroristes. Il faut frapper fort, vite, au mépris de la souffrance endurée par les civils. Aucun volet humanitaire n’a été mis en place. « Qu’ils se débrouillent ! », pourrait être le mot d’ordre de Tsahal. C’est aussi le retour aux bombes lourdes qui ne laissent aucune chance à ses destinataires.
La démocratie israélienne a subi un revers. Une démocratie doit marquer clairement la frontière qui la sépare des groupes terroristes, qui s’attaquent délibérément à des populations civiles. Israël a pris le risque de brouiller cette frontière. En tuant des civils, une démocratie délégitime sa propre lutte et fait oublier la cause qu’elle défend.
[…]
L’« armée la plus morale au monde » ?
L’expression « Tsahal, l’armée la plus morale au monde » est un non-sens. On ne peut utiliser une qualification aussi lapidaire sur une période de plus de soixante-quinze ans, et compte tenu des nombreuses violations du droit. Tout dépend des périodes considérées, de la nature de la menace, du type d’opérations conduites. C’est une notion indéfendable, par ailleurs, tant la comparaison avec d’autres armées est difficile. La plupart des Israéliens sont convaincus que Tsahal se comporte mieux que les armées américaine, britannique et française.
Aucune étude comparative sérieuse, prenant en compte l’ensemble des données utiles, le contexte géostratégique, les particularités du terrain, le risque encouru par les soldats, les circonstances dans lesquelles des civils sont tués, n’a été entreprise pour étayer une pareille affirmation.
Dans les « jeux olympiques de la morale », la société israélienne s’est attribuée d’office la « médaille d’or », sans préciser à qui reviendraient l’argent et le bronze. Le célèbre militant de la paix, Uri Avnery, écrivit ironiquement que s’il devait classer les armées, il dirait que « Tsahal est plus morale que l’armée russe et moins que l’armée suisse. La seule armée morale est celle qui ne combat pas. »
Cette notion est d’autant plus vaine que Tsahal ne constitue pas, sociologiquement, un ensemble homogène. Il conviendrait de parler « des » Tsahal au pluriel, chaque grande unité étant dotée de sa propre sous-culture. Les unités versées dans la haute technologie, comme l’armée de l’air et les services de renseignement, se distinguent de l’infanterie, au contact quotidien de la population palestinienne qu’elle s’efforce de contrôler. L’armée de terre elle-même est traversée de multiples courants. Du côté des « good guys », les parachutistes, le Nahal, composés d’éléments plus disciplinés et sensibles aux questions éthiques. À l’autre bout de la chaîne, Golani, Guivati, la brigade Kfir et Magav, souvent commandés par des officiers issus du sionisme religieux, peuplés de militaires originaires des couches défavorisées ou de colons. Entre les deux, des unités dont le comportement dépend de la personnalité du commandant et de la dangerosité du secteur d’affectation.
Ceux qui ne jurent que par l’« armée la plus morale au monde » ignorent la complexité de Tsahal. C’est un mythe qui sert à étouffer tout débat sur la question de l’éthique. Il ne faut pas toucher à l’armée, vache sacrée de la société. Ce cri émerge d’ailleurs chaque fois que Tsahal se retrouve sur la sellette. Un véritable bouclier se lève alors pour défendre sa réputation.
Ce mythe ne s’éteindra pas à la publication de ce livre. Il résistera d’autant mieux qu’il renvoie à des croyances profondément enracinées, celle de la « supériorité morale » d’Israël sur les autres nations, qu’a analysée Daniel Bar-Tal, mais aussi à celle de la tradition biblique juive, source de l’« humanisme » du peuple juif. De plus, il favorise la cohésion sociale. Il autorise l’amnésie, le déni des moments pénibles. Il est une glace dans laquelle la société aime se regarder. Surtout, Tsahal « ce sont nos enfants, notre père, notre frère, notre sœur », des amis proches, qui « ont perdu leur vie pour nous protéger ». Bref, c’est la société israélienne. L’amour pour Tsahal interdit d’imaginer que « nos soldats » soient capables de transgresser des interdits. Tout élément de preuve en sens contraire est considéré comme « injuste », visant à délégitimer l’existence d’Israël.
La force de ce mythe, son aptitude à surmonter l’épreuve du temps, tient à sa capacité à forger une conscience collective, et au rôle qu’il joue dans la construction identitaire du pays.![]()
Samy Cohen a reçu un financement de son laboratoire de recherche, le CERI/Sciences Po, pour sa mission de terrain en Israël, en novembre 2022.







































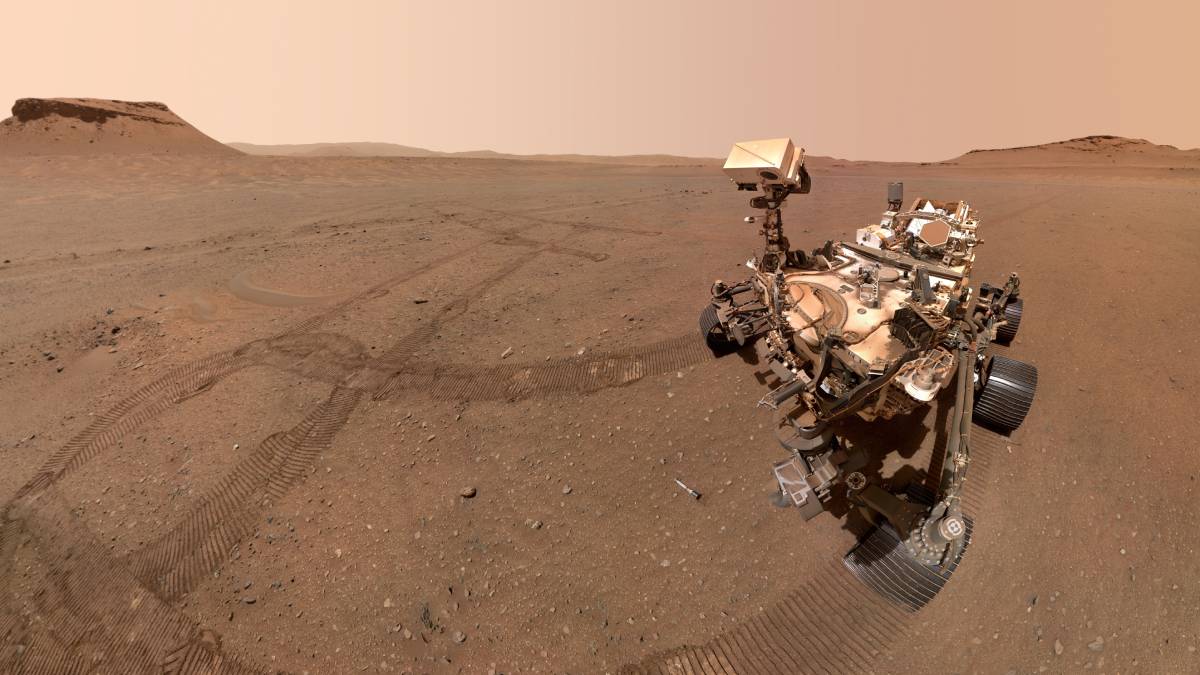



/2025/04/24/polna-680a6ee317657915678049.jpg?#)
/2025/04/25/000-43eq6cq-680b2f4a6bc8d910477204.jpg?#)