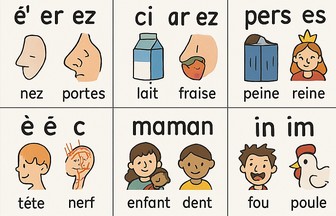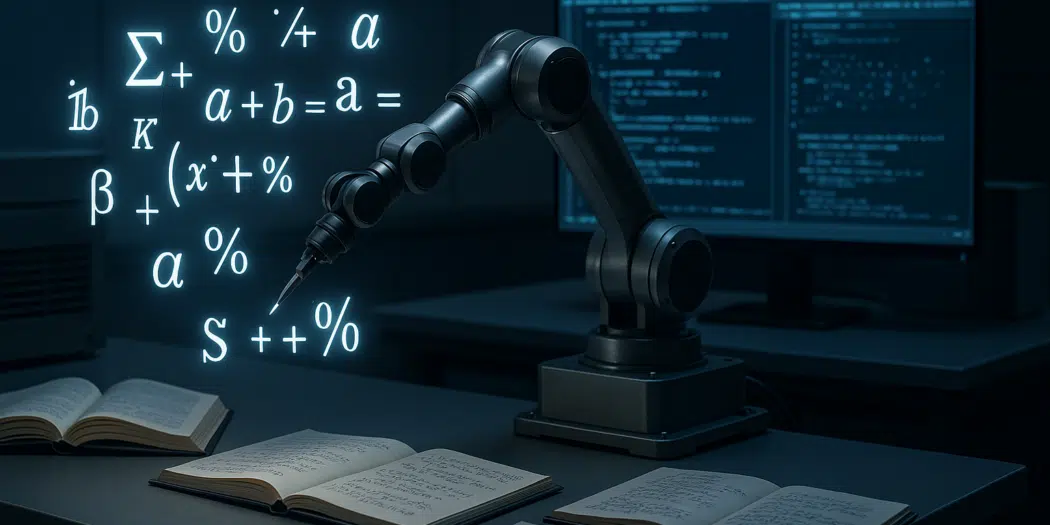L’élevage français en quête d’avenir : accès au foncier, financement, aménagement…
De plus en plus d’éleveurs partent à la retraite sans toujours trouver des successeurs. Pour attirer de nouveaux venus dans le secteur, des aménagements importants sont nécessaires.

Pourra-t-on, à terme, assurer la souveraineté alimentaire française en produits d’élevages (produits laitiers, œufs et viandes) ? Face à un renouvellement générationnel insuffisant, des solutions innovantes sont à trouver d’urgence pour améliorer l’accès à la terre agricole et au financement. Reconfigurer le maillage territorial et financiariser davantage les systèmes d’élevage : ces deux actions pourraient permettre d’aboutir à une filière duale qui associerait exploitations de grande envergure et filières territorialisées.
Les attentes sociétales sont fortes envers les différentes filières d’élevage : qualité gustative, qualité environnementale, typicité, respect du bien-être animal, transparence… Or ces attentes ne peuvent être comblées que dans un contexte territorial favorable, où se rencontreraient initiatives réglementaires fortes, entrepreneuriat, innovations technologiques et organisationnelles. Assurer le renouvellement générationnel des responsables d’élevages français et européens, c’est assurer aux consommateurs-citoyens français et européens qu’ils pourront continuer à manger des viandes, œufs et laits qui satisfont leurs attentes de durabilité environnementale et sociétale. À cette exigence d’une souveraineté alimentaire de la qualité, s’ajoute celle d’une souveraineté alimentaire protéinique, afin qu’elle ne soit pas déléguée aux pays du Mercosur, à l’Amérique du Nord ou à la Chine.
D’ici à 2030, plus d’un tiers des exploitants agricoles atteindront l’âge de la retraite, selon les Chambres d’Agriculture de France. Or un exploitant sur trois ne serait pas remplacé, selon le Centre d’études et de prospective du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Des problèmes structurels menacent en effet le renouvellement générationnel des filières agricoles à long terme, les filières d’élevage ne faisant pas exception. La pérennité de la production de viandes, laitages et œufs français est pourtant cruciale pour la souveraineté protéinique de la France.
Le protectionnisme à l’ère Trump II
Au lendemain d’une paralysie sans précédent du commerce mondial en temps de pandémie, et avec le protectionnisme affiché du nouveau gouvernement Trump II, cette souveraineté protéinique est cruciale, et encore plus stratégique que la souveraineté énergétique ou numérique.
À lire aussi : Céréales, élevage ou énergie ? Les terres agricoles attisent les appétits
Il est souvent question de manque d’attractivité pour des métiers d’élevage réputés difficiles, à la fois peu rémunérateurs pour leurs exploitants au vu des investissements nécessaires, et nécessitant une astreinte importante pour s’occuper du vivant « animé ». De surcroît, ces métiers se trouvent depuis quelques années sous le feu de critiques sociétales qui ont tendance à se cristalliser autour d’interrogations sur le bien-être animal. Certes légitimes, ces préoccupations témoignent néanmoins aussi d’une incompréhension liée à un certain éloignement de la société vis-à-vis de l’agriculture et des élevages. Selon les chambres d’agriculture de France, deux exploitations sur trois ne trouveraient pas de repreneur et, niveau emploi en filières d’élevages, 80 000 équivalents temps plein (ETP) auraient été perdus entre 2010 et 2020. La question se pose alors : quels sont les modèles qui régissent actuellement les transmissions ? Et quels sont les freins, leviers et facteurs permettant d’assurer une transmission réussie ?
Dans le cadre d’une chaire sur les mutations des filières d’élevages & enjeux sociétaux développée en partenariat par UniLaSalle et le Groupe Avril, des enseignants-chercheurs et étudiants d’UniLaSalle ont interrogé un panel de parties prenantes des filières d’élevage sur les questions de renouvellement générationnel. L’étude s’est attachée à comprendre les freins et leviers pour différents contextes de transmission, dont certains gagnent en importance. En effet, si la transmission d’exploitations agricoles dans le cadre familial demeure majoritaire, la proportion de transmissions hors cadre familial a fortement progressé depuis quinze ans, passant à 34,3 % depuis 2010 contre 22,7 % avant 2010.
D’importants investissements pour le repreneur
Le renouvellement générationnel passera donc aussi par la reprise d’exploitations hors cadre familial, avec les barrières que cela représente (achat du foncier et de l’infrastructure, absence d’expérience familiale, manque de réseau…). De fait, même dans le cadre familial, d’importants investissements de modernisation peuvent s’avérer nécessaires, et ce dans plusieurs domaines :
les bâtiments et les infrastructures (amélioration des conditions de vie des animaux, automatisation de l’alimentation)
les technologies de surveillance et de gestion (capteurs de surveillance des animaux, contrôle climatique)
les équipements de traitement des effluents et gestion de l’environnement (fosses de stockage améliorées, gestion de l’air)
l’automatisation et la robotisation (distribution de l’alimentation, tri des animaux).
Ces investissements dans des innovations technologiques et numériques sont significatifs, pouvant représenter jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros pour une exploitation. De fait, chaque exploitation est unique, dans ses capacités techniques et financières, dans son histoire et ses valeurs, ainsi que par son contexte géographique. Les modèles de transmission ne peuvent donc être standardisés, car les exploitations sont trop diverses.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Réinventer les modèles des entreprises agricoles
Cela dit, au-delà de cette diversité, deux difficultés ressortent systématiquement : l’accès au foncier et le problème du financement. L’ensemble des acteurs et parties prenantes des filières d’élevage, l’État et les collectivités compris, ne devraient-ils pas s’atteler à créer des modèles innovants qui viseraient un nouvel aménagement du territoire et une financiarisation accrue des exploitations ?
L’une des pistes pourrait être d’intégrer davantage d’associés non-exploitants au sein de groupements d’agriculteurs. Les investissements pourraient venir, notamment, de placements financiers commercialisés sous l’angle du soutien aux exploitations. En effet, une partie de l’épargne française pourrait être en partie « re fléchée » en faveur de la souveraineté alimentaire et protéinique de la France.
La mise en place de nouveaux produits d’épargne pourrait ainsi être encouragée par les pouvoirs publics, avec des mesures fiscales incitatives. Naturellement, une telle politique pose un risque de rétention foncière si de tels mécanismes financiers ne font pas l’objet d’un contrôle par l’ensemble des parties prenantes (par exemple si des terres sont achetées par des banques et mises hors marché en attendant le bon moment pour vendre et en tirer une plus-value importante).
Délocalisation des systèmes d’élevage
Concernant le foncier, une autre problématique concerne le maillage territorial d’exploitations et d’infrastructures industrielles de distribution (coopératives) et de transformation (industries laitières) dans certaines régions du Grand Ouest, Bretagne et Normandie en tête. Si la compétition foncière y est exacerbée, une partie des candidats à la reprise pourrait être orientée vers des régions qui connaissent des abandons massifs d’exploitations, telle que la région Centre. Une telle action suppose, toutefois, un important travail de concertation, de coordination et d’aménagement entre tous les maillons des filières laitières et viandes, pour que de nouvelles unités de distribution et de transformation puissent y être installées ou réinstallées, constituant ainsi un écosystème suffisant pour faire vivre les élevages et réduire leurs contraintes logistiques.
En outre, un tel écosystème ne saurait se constituer sans prendre en charge le risque croissant de désertification vétérinaire dans les territoires ruraux. Cela nécessiterait d’impliquer les collectivités et les agences de santé pour améliorer l’attractivité de la profession, à travers, notamment, des mécanismes de compensation de l’astreinte inhérente au métier de vétérinaire rural.
Le rôle clé de l’État
Seul l’État, de concert avec les régions et collectivités concernées et les organisations professionnelles agricoles (OPA), semble en mesure de conduire une telle opération de délocalisation des systèmes d’élevages. Par ailleurs, la régénération du lien au sol (par la production propre d’alimentation destinée aux animaux de la ferme) permettrait aux éleveuses et éleveurs de s’affranchir en partie des fluctuations des marchés des matières premières agricoles.
De ce fait, des projets de reprise incorporant une partie du foncier dévolue à la production propre d’aliments pour leurs animaux permettraient aux candidats de développer des élevages potentiellement plus résilients, offrant des gages de stabilité pour améliorer leur accès aux crédits bancaires. Or c’est justement dans les régions où le foncier est plus abordable, plus disponible, et le moins en compétition avec d’autres cultures (céréaliculture, notamment), que cette possibilité de recréer ces liens aux sols paraît la plus aisée. Nous voyons donc que financement et foncier/lien au sol sont intimement liés. Agir simultanément sur ces deux leviers nous semble être une piste d’avenir pour assurer la survie et le maintien de filières d’élevages… à la française, et pour l’Europe.![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.








![[MIEUX VAUT EN RIRE] Tout est de la faute de la méchante police !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/mver-221-copie-616x347.jpg?#)















![Comment Synology combine solutions matérielles et logicielles pour assurer la protection de vos données [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2025/04/img-dsm-feature-hyper-backup.jpg?resize=1600,900&key=4d057135&watermark)




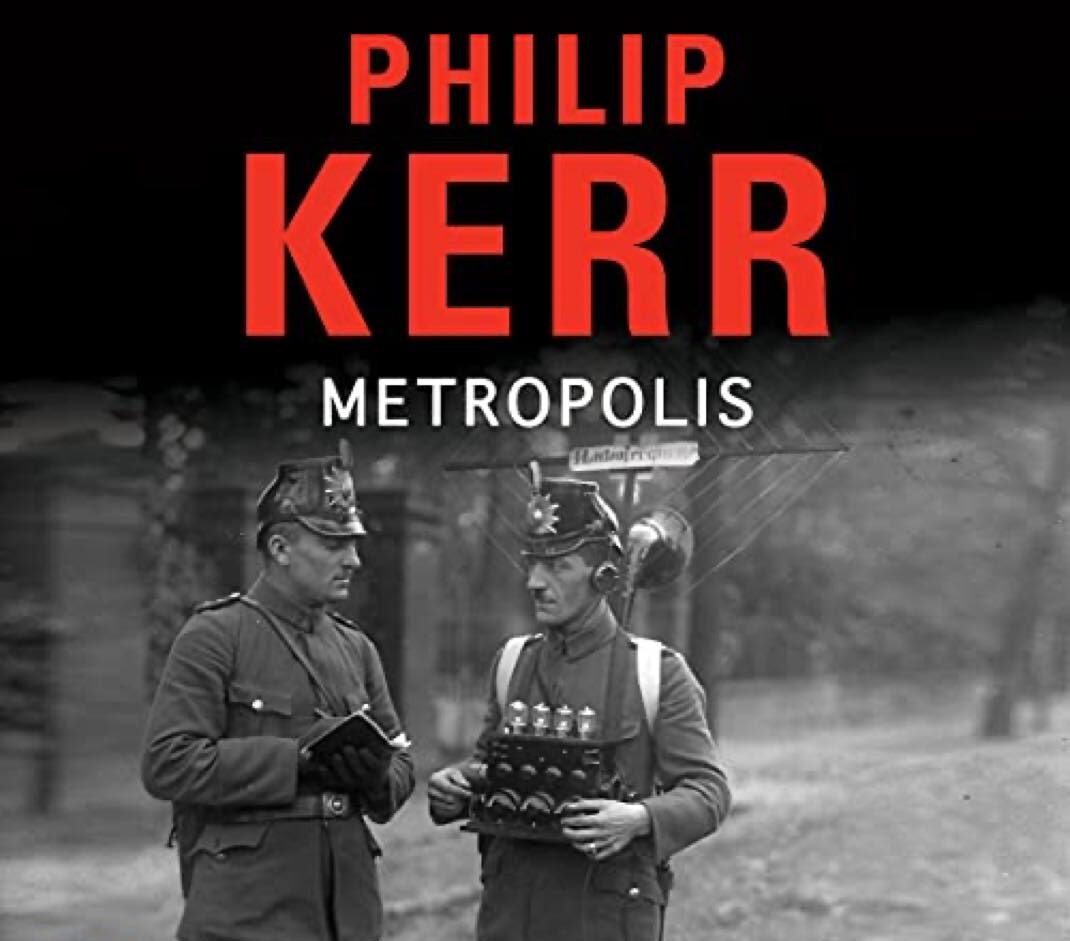












/2025/04/25/000-43eq6cq-680b2f4a6bc8d910477204.jpg?#)
/2025/03/25/bis-atelier2023-8328-mr-c-fredlahache-67e288787c5ed092215422.jpg?#)
/2025/04/25/000-43a37np-680b6d84e0a22012872781.jpg?#)
/2025/04/25/dents-de-la-mer-680b6a48e2e20606972686.png?#)



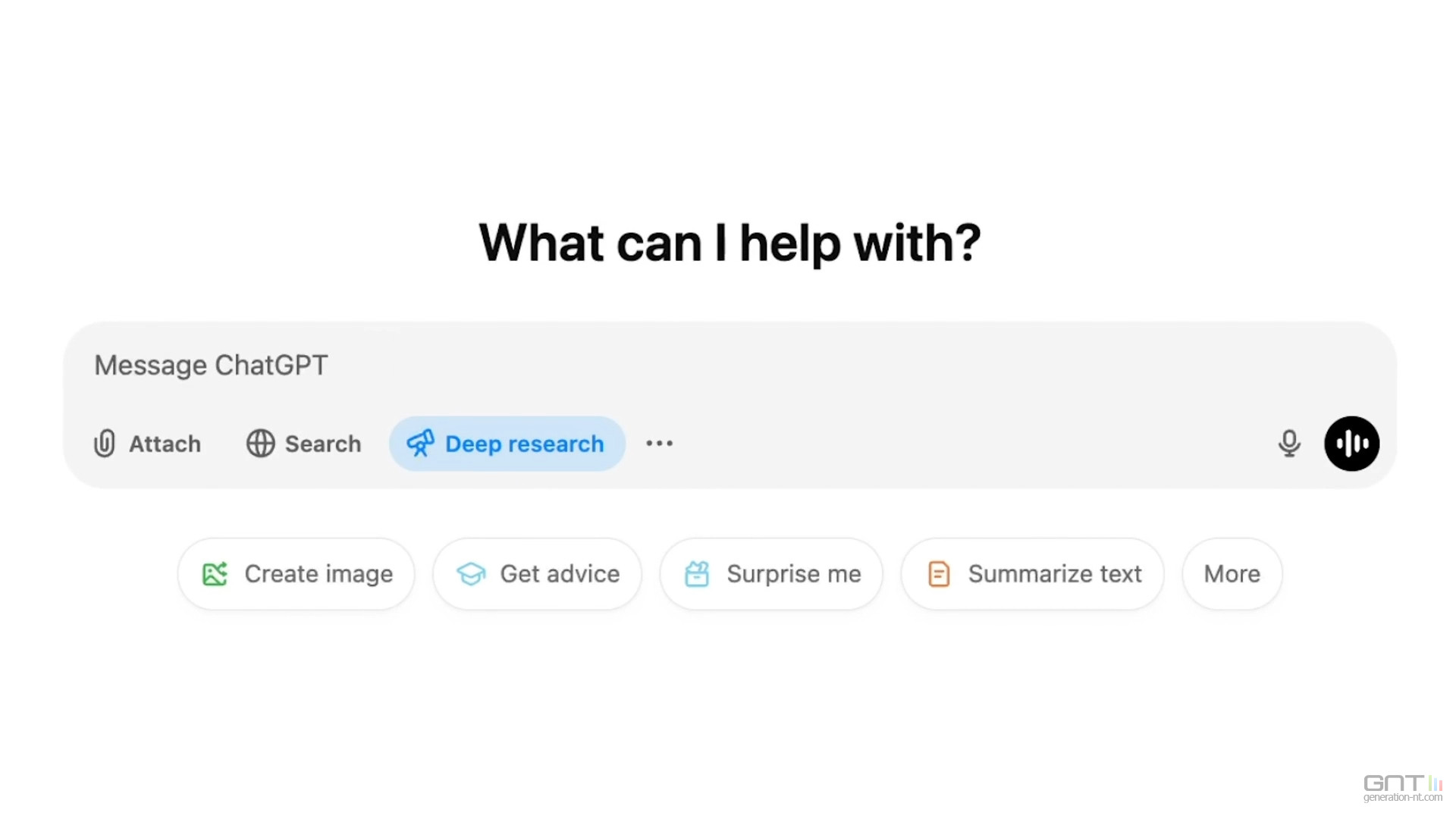




/2025/04/25/gettyimages-1329535365-680b1274cb481283684566.jpg?#)
/2025/04/25/capture-d-ecran-2025-04-25-105854-680b4edbac4e3157238485.png?#)


![Solaire résidentiel : la France ressemble « de plus en plus au reste de l’Europe » [Otovo]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/04/image001-3-scaled.jpg)