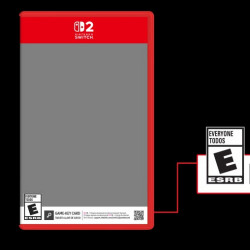Le porte-avions « Charles-de-Gaulle », vitrine des ambitions françaises en Indo-Pacifique
Le « Charles-de-Gaulle », outil militaire d’envergure, est devenu en quelque sorte un ambassadeur français hors norme dans la région Indo-Pacifique.

Le porte-avions Charles-de-Gaulle et son groupe aéronaval reviennent d’une mission en Indo-Pacifique, région où la France cherche à développer son influence. Illustration concrète de la stratégie mise en œuvre par Emmanuel Macron depuis 2018, ce déploiement démontre la capacité de la France à projeter une puissance aéromaritime à des milliers de kilomètres de ses côtes hexagonales.
« Un porte-avions, c’est 100 000 tonnes de diplomatie », aurait affirmé l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger (1923-2023). Apocryphe ou non, cette expression reste d’actualité tant ces navires constituent un atout majeur pour les États qui en disposent.
Déployer un porte-avions, outil opérationnel sans équivalent, constitue autant un message d’affirmation stratégique qu’un moyen d’asseoir sa crédibilité diplomatique. Dernier exemple en date : en octobre 2023 à Gaza, trois jours après le début de la guerre, l’USS Gerald R. Ford naviguait en Méditerranée orientale pour tempérer toute velléité iranienne d’intervenir dans le conflit.
Traduction française de l’adage kissingerien, les 42 000 tonnes du porte-avions Charles-de-Gaulle (CDG), navire amiral de la Marine nationale, sont un avantage hors norme pour la France. Parti de Toulon en novembre dernier, le CDG est actuellement en mer dans le cadre de la mission Clemenceau 25, un déploiement résolument tourné vers l’Indo-Pacifique, une région où la France cherche à tisser son influence, en toute autonomie.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Un porte-avions n’est donc pas seulement un moyen de projection militaire essentiel, c’est aussi un appui crédible de la stratégie Indo-Pacifique française, nouvel espace géopolitique de référence où la France cherche à faire valoir ses intérêts.
Un outil opérationnel hors norme
L’utilisation du porte-avions comme outil opérationnel a parfois divisé la communauté d’experts stratégiques, notamment quand il convient de faire des choix budgétaires.
Coût prohibitif ; absence de permanence à la mer sans « sister ship » ; vulnérabilité en cas de guerre de haute intensité ; défis posés par les stratégies de déni d’accès et d’interdiction de zone (stratégies A2/AD), et par des missiles à longue portée de plus en plus performants : autant de critiques régulièrement formulées à l’encontre de l’emploi du CDG.
Pourtant, le porte-avions demeure un instrument largement utilisé et convoité au XXIe siècle. On observe un essor des flottes de porte-avions dans le monde, car elles sont perçues par de nombreux pays comme l’outil de souveraineté absolue qui leur confère la capacité à se projeter loin et longtemps.
Dans le cadre de la mission Clemenceau 25, le CDG, accompagné de son groupe aéronaval (GAN) – constitué d’une trentaine d’aéronefs et de cinq navires de guerre – mobilise près de 3 000 militaires, déployés pendant 150 jours de la Méditerranée jusqu’aux confins du Pacifique occidental.
Opérant depuis la haute mer – espace de liberté et sanctuaire stratégique –, le CDG est à la fois une base aérienne embarquée, une centrale nucléaire et un centre de commandement. Le tout est un mécanisme parfaitement synchronisé capable de catapulter, puis de faire apponter en pleine mer, des dizaines d’aéronefs par jour.
Véritable ville flottante, le porte-avions CDG est néanmoins un instrument mobile, il peut parcourir près de 1 000 km par jour et engager le feu à plus de 2 000 km. De plus, ses divers senseurs (radars, sonars, satellites) assurent une bulle informationnelle pour agir efficacement dans tous les champs et milieux de conflictualité (mer, terre, air, fonds marins, cyber, espace).
L’ensemble de ces capacités permettent aux marins français de remplir un large éventail de missions : défense aérienne et antimissile, combat naval, frappe contre la terre, opération amphibie, lutte anti-sous-marins, interception maritime, protection du transport maritime, entre autres. Outil souple et polyvalent, le CDG est le symbole de l’autonomie stratégique française ainsi qu’un instrument crédible qui facilite les coopérations avec des nations partenaires.
Un instrument de coopération crucial
En service depuis 2001, les déploiements du GAN sont systématiquement l’occasion d’interactions avec les marines et armées étrangères. À cet égard, la mission Clemenceau 25 a porté à un niveau inédit les partenariats de la Marine nationale en Indo-Pacifique, structurés autour de trois moments clés : l’exercice de sécurité maritime La-Pérouse 25, mené avec huit nations riveraines de la région dans les détroits d’Asie du Sud-Est (Malacca, Lombok, Sonde) ; l’exercice trilatéral Pacific Steller aux côtés des États-Unis et du Japon ; et l’exercice annuel franco-indien Varuna.
Symbole des bonnes relations qu’entretient la France dans la région, le CDG a, pour la première fois de son histoire, fait escale aux Philippines (Subic Bay), en Indonésie (Lombok, où le ministre Sébastien Lecornu s’est rendu) et a fait une étape remarquée à Singapour.
Agrégateur de coopération maritime en temps de paix, pierre angulaire des flottes modernes, permettant une montée en puissance des forces partenaires et renforçant la confiance et l’interopérabilité, le GAN peut également être en facteur de désescalade politique en temps de crise. Outre le déploiement américain en Méditerranée mentionné plus haut, un autre exemple date de 1995, quand les États-Unis avaient déployé deux porte-avions dans le détroit de Formose en réponse à des tirs de missiles lancés par Pékin dans les eaux territoriales taïwanaises.
Le GAN est donc un puissant levier politique que la France exploite pour affirmer ses ambitions en Indo-Pacifique.
Stratégie Indo-Pacifique, au-delà du narratif
À partir de mai 2018, Emmanuel Macron, a formalisé une stratégie Indo-Pacifique française pour légitimer et crédibiliser le statut de la France en tant que puissance régionale.
À travers l’exercice de la souveraineté dans les collectivités de la zone, ce nouveau narratif est une opportunité pour la diplomatie française de valoriser ses attributs de puissances diplomatiques, culturelles, économiques et surtout militaires dans cette vaste région.
Ainsi, la France cherche à promouvoir une vision singulière, celle d’un espace Indo-Pacifique libre, ouvert, respectueux du droit international et favorisant une approche multilatérale. Et refusant toute logique de bloc, le président Macron encourage l’ensemble des partenaires à être libres de la coercition chinoise sans pour autant s’aligner systématiquement sur les États-Unis.
Pour le ministère des armées, les déclinaisons opérationnelles de la stratégie Indo-Pacifique impliquent la protection de 1,8 million de Français résidant dans les collectivités françaises de la zone. Il s’agit également de contribuer aux opérations nationales et européennes en mer Rouge et dans l’océan Indien, afin de renforcer la sécurité maritime dans ces régions.
En complément des forces prépositionnées en permanence dans les collectivités françaises de la région et des missions régulières de la Marine nationale et de l’Armée de l’air et de l’espace dans la zone, le déploiement du CDG constitue ainsi un signal stratégique fort, qui crédibilise la stratégie portée par l’État.
Un gage de crédibilité… et de rentabilité ?
Déployée en autonomie malgré la tyrannie des distances, notamment grâce à une escorte complète de frégates et à la présence du bâtiment ravitailleur Jacques-Chevallier, la mission Clemenceau 25 a permis de démontrer la capacité de la France à utiliser sa force aéromaritime loin du territoire hexagonal pendant plusieurs mois.
Le GAN est aussi la vitrine de l’excellence française à travers la diversité des technologies et des armements mis en œuvre. Le Rafale M F4.1, le sous-marin nucléaire d’attaque de classe Suffren, ou encore les frégates multimissions sont autant de « porte-étendards » et de potentiels contrats à l’exportation pour l’industrie française de l’armement.
En 2024, la France est devenue le deuxième exportateur mondial d’armements, et certains de ses plus gros clients, comme l’Inde, l’Indonésie et les Émirats arabes unis, sont des nations de l’Indo-Pacifique. Le déploiement du GAN relève donc aussi du soutien à l’exportation de la base industrielle et technologique française.
Instrument crédible, multimodal et polyvalent, dont les fonctions dépassent le strict cadre militaire, le GAN est un atout de première main pour la France. En attendant la mise en service du nouveau porte-avions (à l’horizon 2038), le Charles-de-Gaulle restera le « meilleur ambassadeur » français dans la zone Indo-Pacifique.![]()
Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








































/2025/04/07/chocolat-67f431d88656c483505018.png?#)






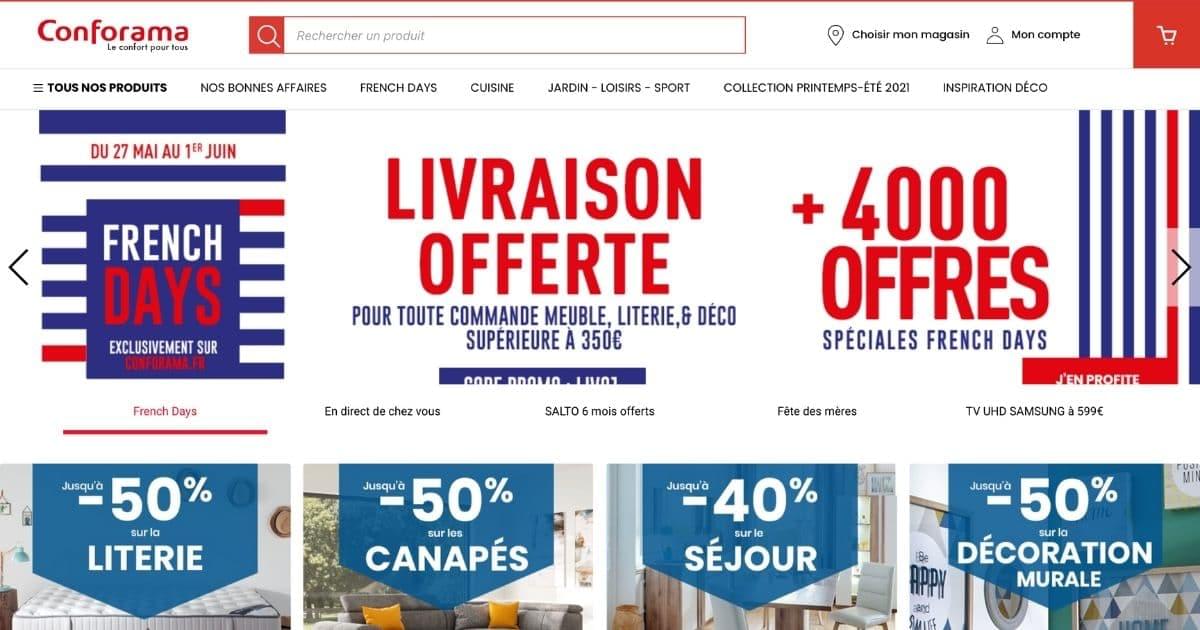









![« Il faut publier la PPE au plus vite » [Fedene]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2024/09/®.Gilles.Delacuvellerie-1072-scaled-1-e1726071212970.jpg)