Être jeune dans un monde incertain : la résilience, une qualité à redéfinir
Faire preuve de résilience, qu’est-ce que cela veut dire ? Certaines attitudes chez les jeunes, qui pourraient au premier abord être jugées défaitistes, peuvent s’avérer des formes de résistance.


Des manières d’agir qui pourraient au premier abord être considérées comme des échecs peuvent s’avérer des formes de résistance.
Les jeunes d’aujourd’hui sont en proie à des niveaux croissants d’incertitude. Confrontés à la volatilité des marchés de l’emploi et du logement, ils doivent également faire face à un avenir qui sera probablement très marqué par la crise climatique. Les données révèlent également une forte détérioration de leur santé mentale. Les inciter à développer leur résilience est souvent présenté comme une clé.
La résilience est généralement définie comme la capacité à surmonter l’adversité, ce qui tend à signifier qu’il faudrait se conformer aux normes sociales – rester à l’école, garder un emploi, persévérer quoi qu’il arrive. On l’envisage comme une vertu individuelle, mettant l’accent sur la responsabilité personnelle et l’autonomie.
Mais cette interprétation conventionnelle de la résilience peut passer à côté de stratégies d’adaptation et de survie plus discrètes. Elle ne tient pas compte d’alternatives telles que la résistance, le désengagement ou l’inaction.
En redéfinissant la résilience, pour y inclure ces différentes formes d’adaptation, ainsi que le soutien apporté par l’entourage, nous pouvons mettre en place une approche plus pragmatique de gestion de l’incertitude.
Des formes discrètes de résistance
Dans une recherche menée avec des collègues, j’ai exploré ce côté non conventionnel de la résilience. Ce travail se fonde sur des entretiens menés avec 92 jeunes de 4 pays européens et sur des discussions de groupe. Elle s’inscrit dans le cadre d’une étude européenne plus vaste portant sur des jeunes défavorisés dans dix pays.
Pour comprendre les expériences de ces jeunes, nous avons passé du temps avec eux sur leur propres terrains – centres de jeunesse, groupes de protestation, communautés en ligne…
Nous avons organisé des entretiens individuels au cours desquels les jeunes ont fait part de leurs expériences personnelles, de leurs réflexions et de leurs difficultés. Et nous avons travaillé avec eux de manière créative, souvent dans le cadre d’ateliers ou d’échanges en groupe, afin qu’ils puissent contribuer à l’élaboration de la recherche.
Grâce à ce travail, nous avons découvert que certaines de leurs actions qui auraient pu normalement être considérées comme des échecs s’avèrent des formes masquées de résistance et d’adaptation. Elles invitent à considérer de manière plus large et plus nuancée la notion de résilience.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Prenons l’exemple de Liam, un jeune Britannique de 15 ans pris en charge dans un centre et qui purge une peine d’intérêt général. Pour lui, l’école était un environnement toxique plein de conflits et de pressions venant de camarades ou de professeurs. Même s’il souhaitait obtenir des diplômes et y voyait une source de fierté, Liam a décidé d’arrêter d’aller en cours.
En quittant son établissement, Liam a réduit le risque d’être attiré par des groupes de pairs problématiques et de dériver vers un comportement criminel. Alors que certains pourraient considérer le fait de quitter l’école comme un abandon, du point de vue de Liam, il s’agissait d’un moyen de se protéger.
Samantha, âgée de 24 ans, a été négligée par ses parents et a manqué de soutien de la part des travailleurs sociaux. Elle a souvent eu le sentiment de ne pas être entendue et d’être jugée injustement par les personnes qui se trouvaient en position d’autorité, telles que les travailleurs sociaux et les éducateurs.
Au lieu de les contredire, ce qui risquait de lui causer beaucoup de contrariétés et de conflits, Samantha se mettait discrètement en retrait des conversations, en quittant physiquement la pièce, en réorientant la discussion vers un sujet neutre ou, simplement, en se désengageant émotionnellement et en restant silencieuse.
Ce qui pouvait ressembler à un abandon était, pour elle, une forme de résilience qui la protégeait d’autres préjudices face à un système qui l’avait laissée tomber à plusieurs reprises.
Apprendre à naviguer dans l’incertitude
En faisant la promotion de la résilience chez les jeunes, on compte les aider à mieux gérer leur vie dans un monde incertain. Mais ils sont souvent confrontés à des problèmes qu’il leur est impossible de surmonter par leurs propres moyens.
Il peut s’agir d’un accès inégal et limité à une éducation de qualité ou à des opportunités d’emploi stables. Dans certains cas, ils vivent dans la pauvreté et dans un logement précaire, ils peuvent aussi être victimes de discrimination dans le cadre de leur formation, de leurs recours à l’aide sociale ou du système de justice pénale. Dans d’autres cas, ils ne bénéficient pas du soutien nécessaire en matière de santé mentale ou souffrent de difficultés à leur sortie des dispositifs de prise en charge, par exemple en n’ayant pas été assez préparés à l’autonomie.
À cela s’ajoute souvent un accès limité à des réseaux de soutien – espaces ou programmes destinés aux jeunes de milieux défavorisés – un manque de mentorat ou d’aide à l’orientation dans les écoles, un accès restreint à des activités extrascolaires financièrement accessibles comme à des aides au logement ou à des bourses. Prendre sur soi ne suffit pas à relever ces défis.

Encourager la résilience peut donc revenir à créer des environnements permettant d’explorer en toute sécurité des options sur la manière la plus réaliste et durable possible de gérer des défis, de faire des erreurs et d’apprendre à s’adapter sans craindre d’être jugés.
À 16 ans, Paco, originaire d’Espagne, s’est retrouvé dans un club autogéré où les jeunes décident des animateurs qu’ils emploient, des activités proposées et de la manière de s’engager dans le quartier. L’objectif était de soutenir ceux qui, comme lui, n’étudiaient pas ou ne travaillaient pas.
Plutôt que de lui dicter ce qu’il devait faire ou de s’arc-bouter sur des objectifs rigides ou de se contenter de lui dire ce qu’il fallait faire, le personnel et ses pairs ont été à l’écoute de ses réflexions et de ses idées. Contrairement à d’autres lieux où il se sentait jugé, cet endroit lui a donné la possibilité d’explorer des pistes, sans craindre une critique trop sévère.
Cette approche s’est concentrée sur l’instauration d’un climat de confiance, permettant à Paco d’opérer des changements progressifs, à son propre rythme. Paco a été encouragé à reprendre ses études, ce qu’il a fait avec enthousiasme, et il s’est montré confiant dans sa capacité à reprendre sa vie en main.
Cette conception plus souple de la résilience, qui laisse place à ce qui pourrait ressembler à un échec ou à l’aide des autres, remet en question la conception de la résilience prônée dans la pensée néolibérale, centrée sur la responsabilité individuelle et l’autosuffisance.
Au lieu d’attendre des jeunes qu’ils « rebondissent » et s’épanouissent dans l’adversité, nous devrions les aider à explorer des réponses durables et adaptatives aux défis de la vie.
Pour leur donner les moyens de naviguer dans un monde rude et incertain, nous devons reconnaître la valeur de ces formes non conventionnelles de résilience. Cette dernière doit être plutôt envisagée comme un processus développé en réponse à des inégalités structurelles, plutôt que comme un idéal uniforme ancré dans l’effort individuel.![]()
Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de l'accord de subvention n° 693221. Cette publication reflète uniquement les opinions de l'auteur ; la Commission européenne et l'Agence exécutive pour la recherche ne sont pas responsables des informations qu'elle contient.








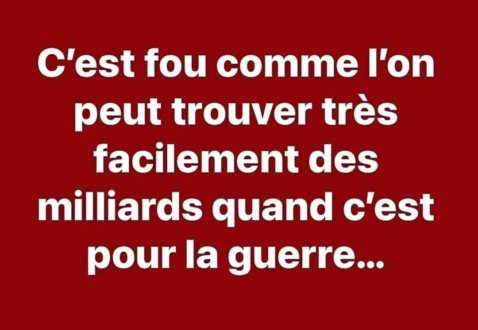


/2025/03/29/075-economou-notitle250320-npjca-67e824bf30904268794310.jpg?#)








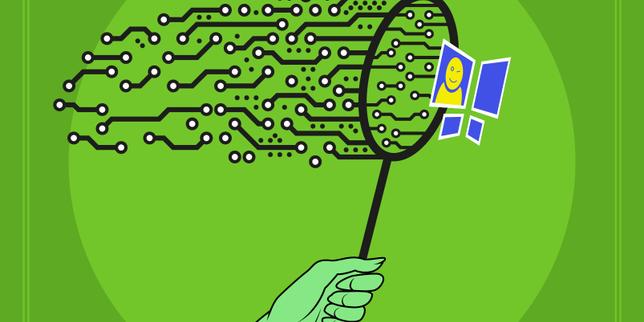


















/2025/03/18/deux-soeurs-2-67d99472b8f18040478796.jpg?#)


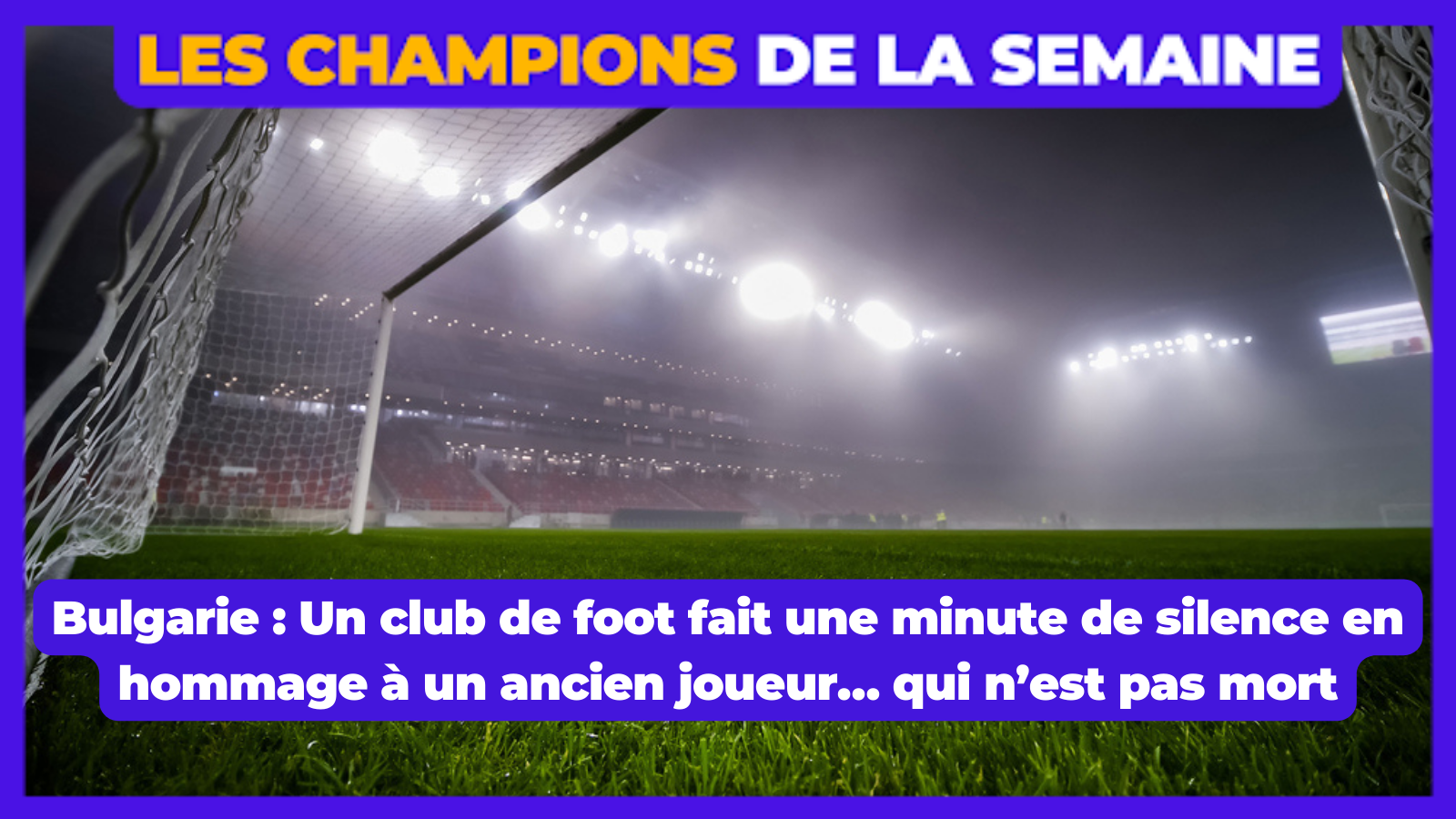

/2025/03/30/gettyimages-585201924-67e9638374896003219187.jpg?#)


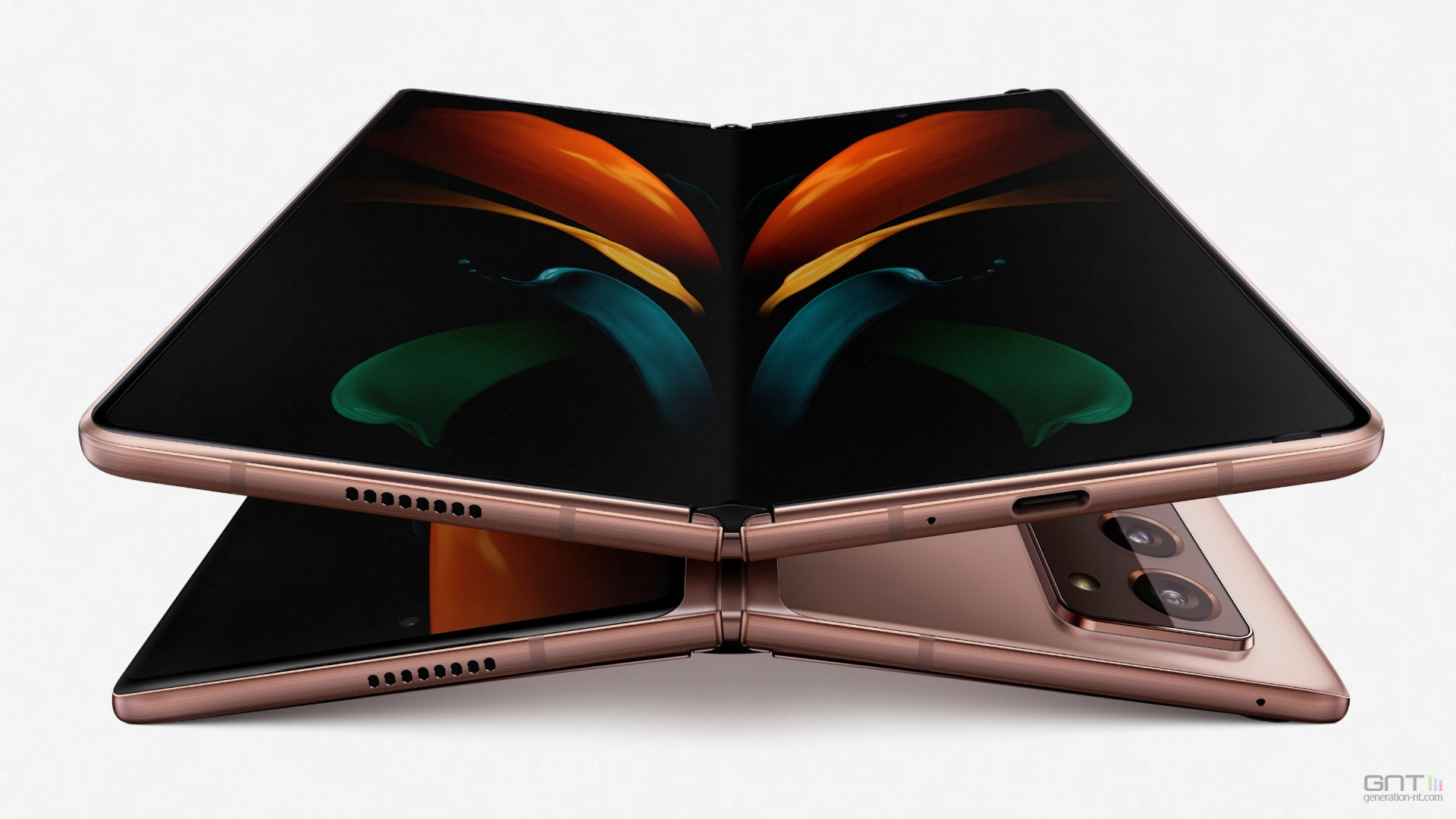


/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F58WzbKTJNWI%2Fhqdefault.jpg)






.png?#)

















