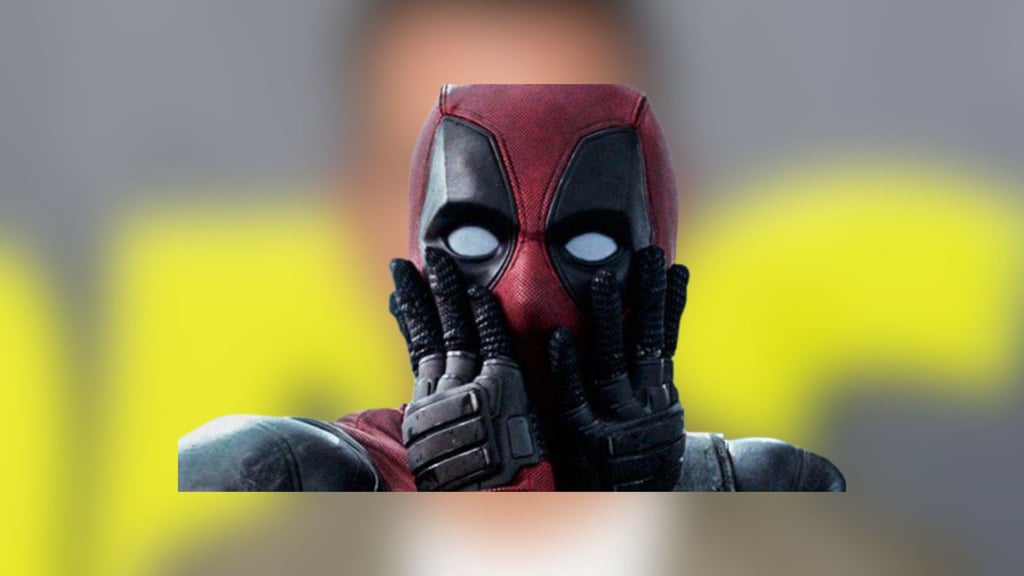Et si la sobriété n’était pas si économe ?
Loin d’être la solution, la sobriété individuelle pourrait bien être un problème. Si dépenser moins semble une bonne idée, la question de l’utilisation du surplus devient essentielle.

Dans la Face cachée de la sobriété (éditions de l’Aube), Florent Laroche s’interroge sur les limites de la sobriété, cette stratégie le plus souvent individuelle pour consommer moins. C’est tout le paradoxe de notre situation : la sobriété contemporaine de l’urbain vivant dans une société de consommation n’a rien à voir avec celle de l’ermite d’autrefois. Nous vous proposons de lire un extrait de cet ouvrage.
Face aux enjeux du XXIe siècle et aux limites planétaires, le concept de sobriété est érigé en solution au consumérisme. Il est reconnu que la technologie ne pourra pas tout faire sans une inflexion notable des modes de vie vers la réduction des consommations, le retour à l’essentiel. Le concept de sobriété incarne cette idée loin d’être nouvelle. Une simple recherche dans le dictionnaire rappelle que la sobriété a toujours été liée à une certaine vertu, qu’elle se trouve chez le paysan qui vit simplement « de pain et d’eau » comme l’écrit Zola ou chez l’ermite qui s’exclut du monde et de son confort matériel pour se rapprocher du divin.
Qu’elle soit choisie ou subie, la sobriété n’a cessé de fasciner nos sociétés pour être défendue en ce début de siècle comme une vertu au chevet de la planète. Prônée comme « heureuse » par Pierre Rabhi ou Jean-Baptiste de Foucauld, elle pourrait être salutaire pour sauver les hommes des périls de la consommation. Encore faut-il qu’elle puisse massivement les convaincre. On se trouve bien loin de renoncer à toutes choses pour vivre chichement dans une cabane sans presque aucun revenu comme a pu le faire à son époque Henry David Thoreau, les ermites des premiers monastères ou les zadistes des temps modernes. Et c’est toute la question : que se passe-t-il quand on fait de la sobriété que l’on pourrait appeler partielle ? Que se passe-t-il quand on réduit une ou deux consommations par bonne conscience sans toucher à l’ensemble et que, pour la grande majorité, les revenus ne diminuent pas, voire continuent d’augmenter ?
Économiser d’un côté pour consommer plus de l’autre ?
Face à la crise énergétique de 2022, des solutions ont été trouvées pour réduire la sensibilité aux prix de l’énergie : kit éthanol, GPL, voiture électrique, pompe à chaleur, isolation, panneaux solaires, chauffage au bois… En définitive, il y a fort à parier que toutes ces actions, dont l’achat d’un pull, permettent aujourd’hui et dans les années à venir de gagner de l’argent. Cet argent que l’on n’aura pas à dépenser en énergie, qu’en fait-on ?
À lire aussi : La face cachée du vrac
La question peut être appliquée à de nombreux autres domaines. On a souvent plaisir à cultiver la terre, entretenir un potager, voir pousser des fruits rouges dans le jardin. Mais quelle satisfaction, un samedi d’été, de passer à côté du rayon fruits et légumes dans son supermarché sans avoir à acheter ces mêmes fruits rouges à un prix exorbitant ! On en profite pour acheter de la crème chantilly ou peut être quelques yaourts supplémentaires, à moins de les faire soi-même. Dans ce cas, les économies seront d’autant plus grandes et garantiront l’espérance d’autres consommations.
La sobriété vorace
D’un point de vue plus formel, la sobriété est souvent pensée comme un mode de vie total sans aucune possibilité de profiter des économies générées par la modération de ses consommations et le retour à l’essentiel. Malheureusement, elle s’applique rarement de cette manière dans un monde plutôt riche où la plupart des besoins les plus basiques sont couverts par l’abondance. À vouloir faire des économies sans modifier fondamentalement son mode de vie et son niveau de revenu, on risque ainsi de tomber inéluctablement dans le piège de la sobriété vorace.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Interrogée sous l’angle de l’économie, la sobriété appliquée à une ou plusieurs consommations dans un contexte de richesse ne fait que produire de la richesse supplémentaire à disposition et contribue très certainement à accroître, au final, les consommations ; consommer moins pour consommer plus. Les économistes connaissent assez bien ce phénomène pour l’avoir qualifié « d’effet rebond ». Il a été démontré pour la première fois en Angleterre en 1865 par l’économiste William Stanley Jevons qui a observé une situation très paradoxale où la consommation de charbon augmentait alors même que les locomotives les plus récentes en consommaient moins par unité pour rouler.
L’explication se trouve dans la présentation du problème. Les nouvelles locomotives consommant moins de charbon, il devenait possible de transporter plus pour le même prix ce qui contribuait à accroître l’offre avec en définitive la capacité d’acheter plus de charbon pour faire rouler plus de locomotives. Faire acte de sobriété pourrait ainsi contribuer à relâcher les contraintes pour obtenir l’effet inverse de celui souhaité. Le phénomène est connu depuis plus d’un siècle et c’est pourtant cette même sobriété que l’on dresse aujourd’hui comme principale solution face à l’impuissance annoncée de la technologie pour répondre aux enjeux écologiques et énergétiques du XXIe siècle. Pour comprendre l’écueil qui se dresse face à nous, il est important de rappeler que la sobriété des mystiques n’est pas celle d’une société riche.
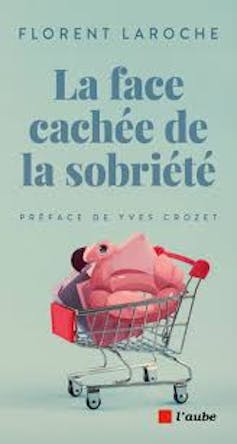
Qu’est-ce que la sobriété dans une économie développée pour des personnes qui n’entendent pas voir leurs revenus baisser ? Il est à parier que sans modification majeure de son niveau de vie, toute économie réalisée sur un poste de dépense permet nécessairement, par ré-allocation de ce qui est gagné (le surplus), d’accroître la consommation sur un autre poste voire de permettre une nouvelle consommation, participant ainsi à l’accroissement global des consommations et en définitive des productions. La sobriété dans une économie riche appellerait donc et surtout donnerait les moyens de consommer avec toujours plus d’appétit, d’être toujours plus voraces au grand dam des objectifs de développement durable.![]()
Florent Laroche ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.


![[CHRONIQUE] Le pape est mort, vive le pape](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/cercueil-pape-francois-616x341.jpg?#)



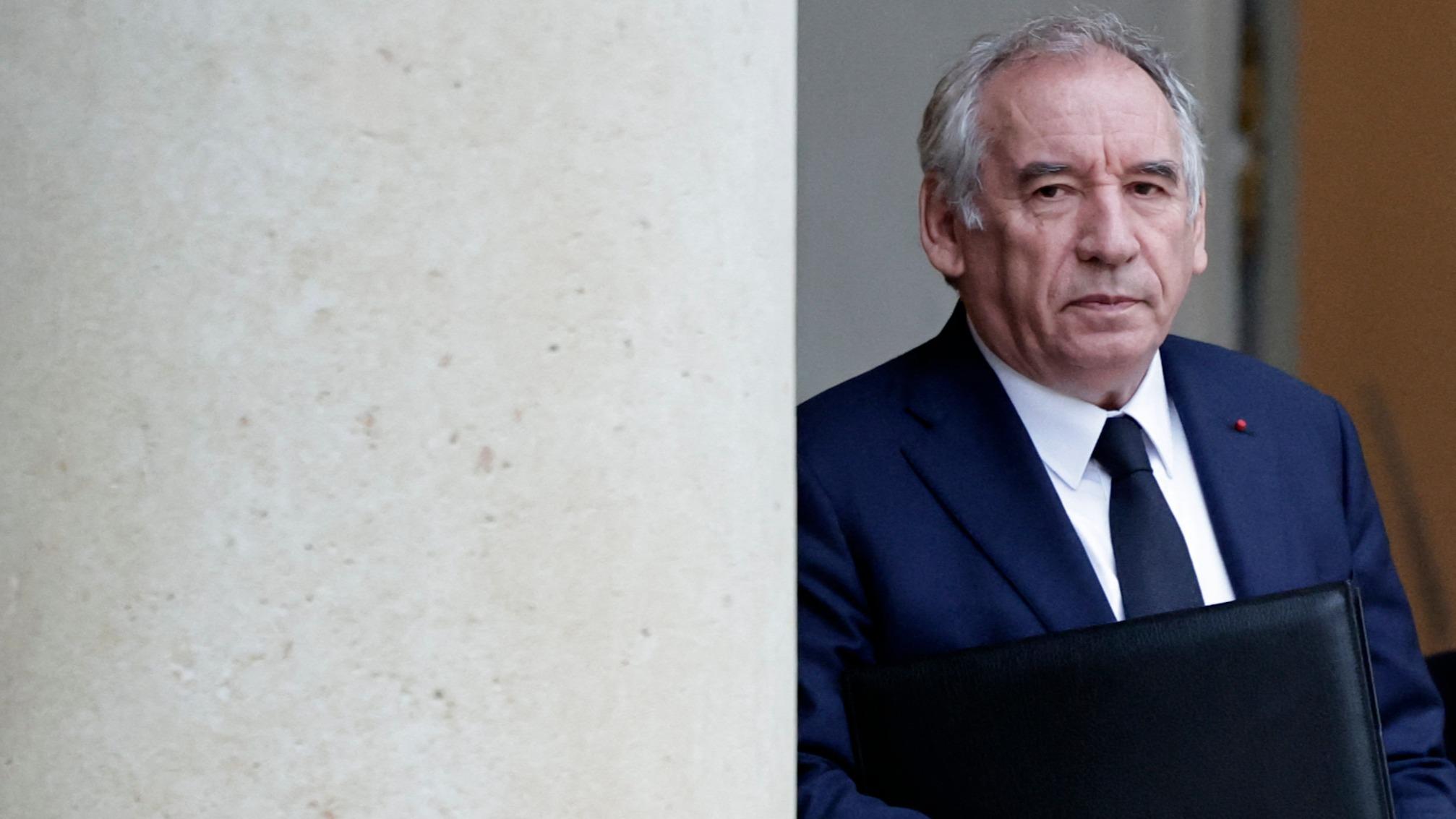
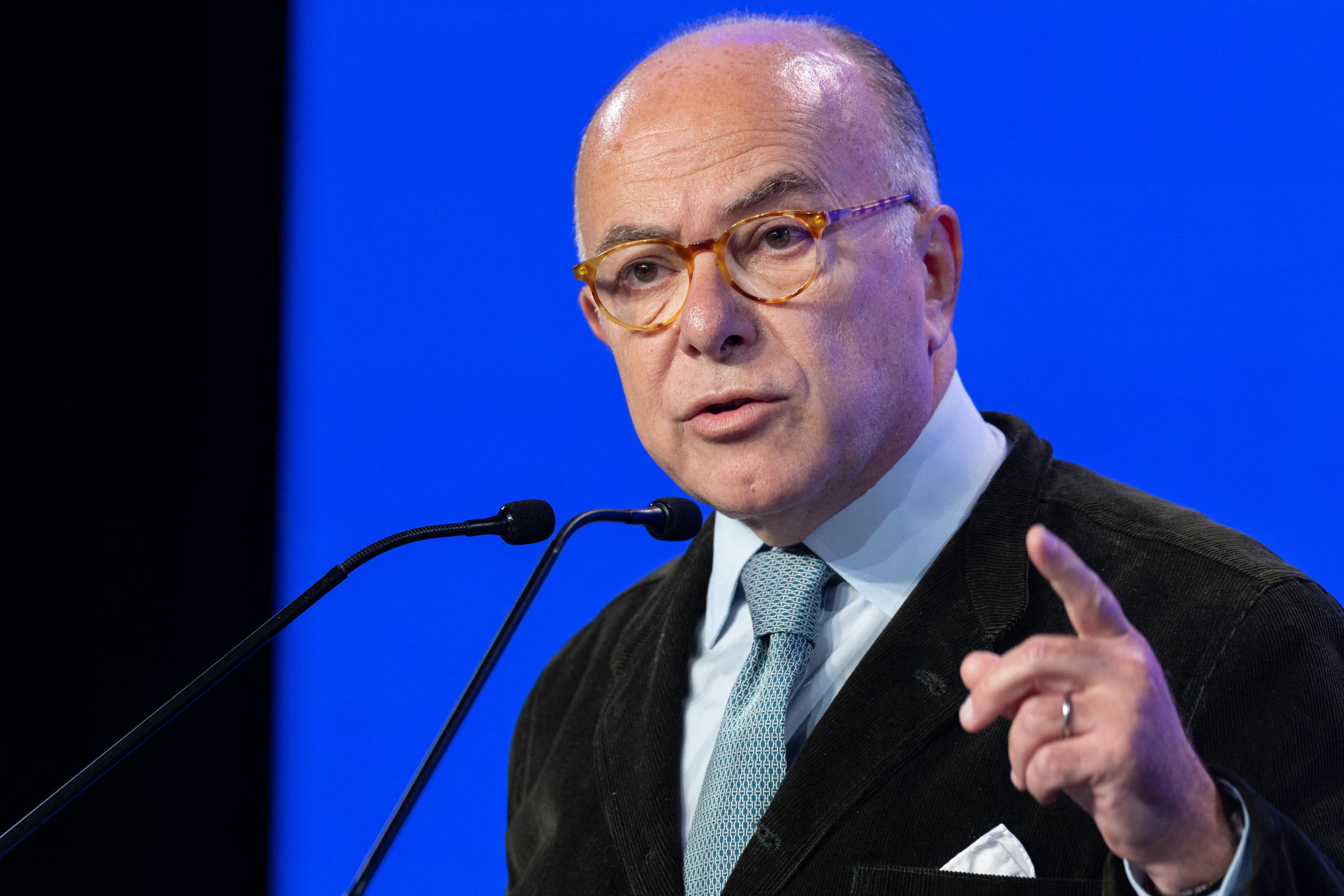

































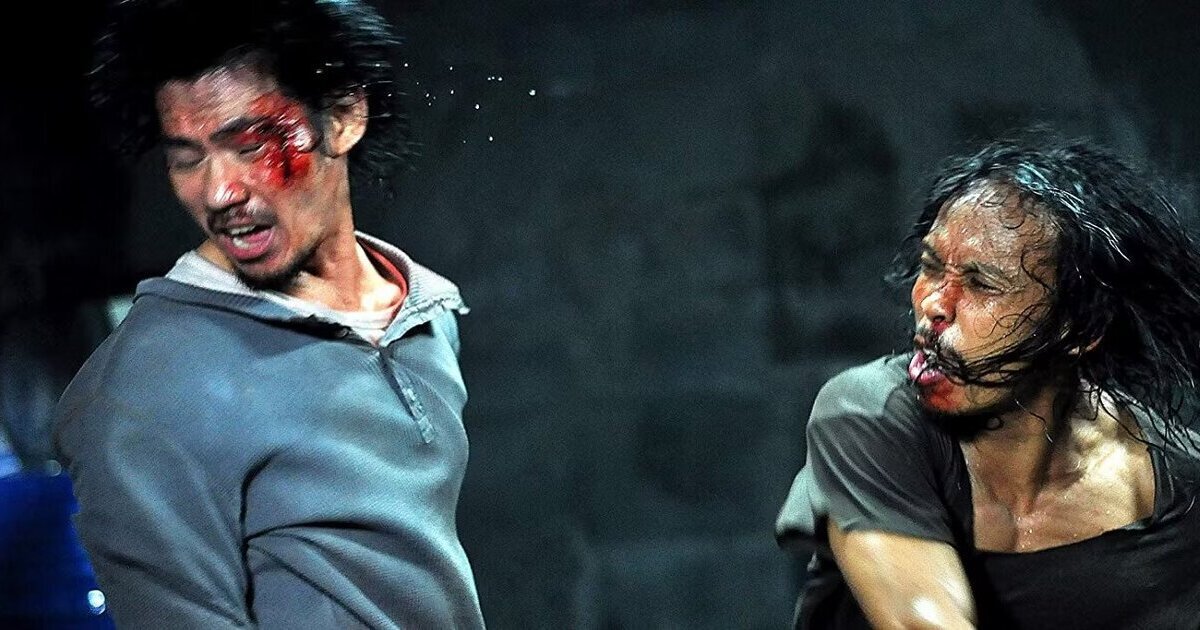
/2025/04/27/polnareff-680e31ac68051745918644.jpg?#)






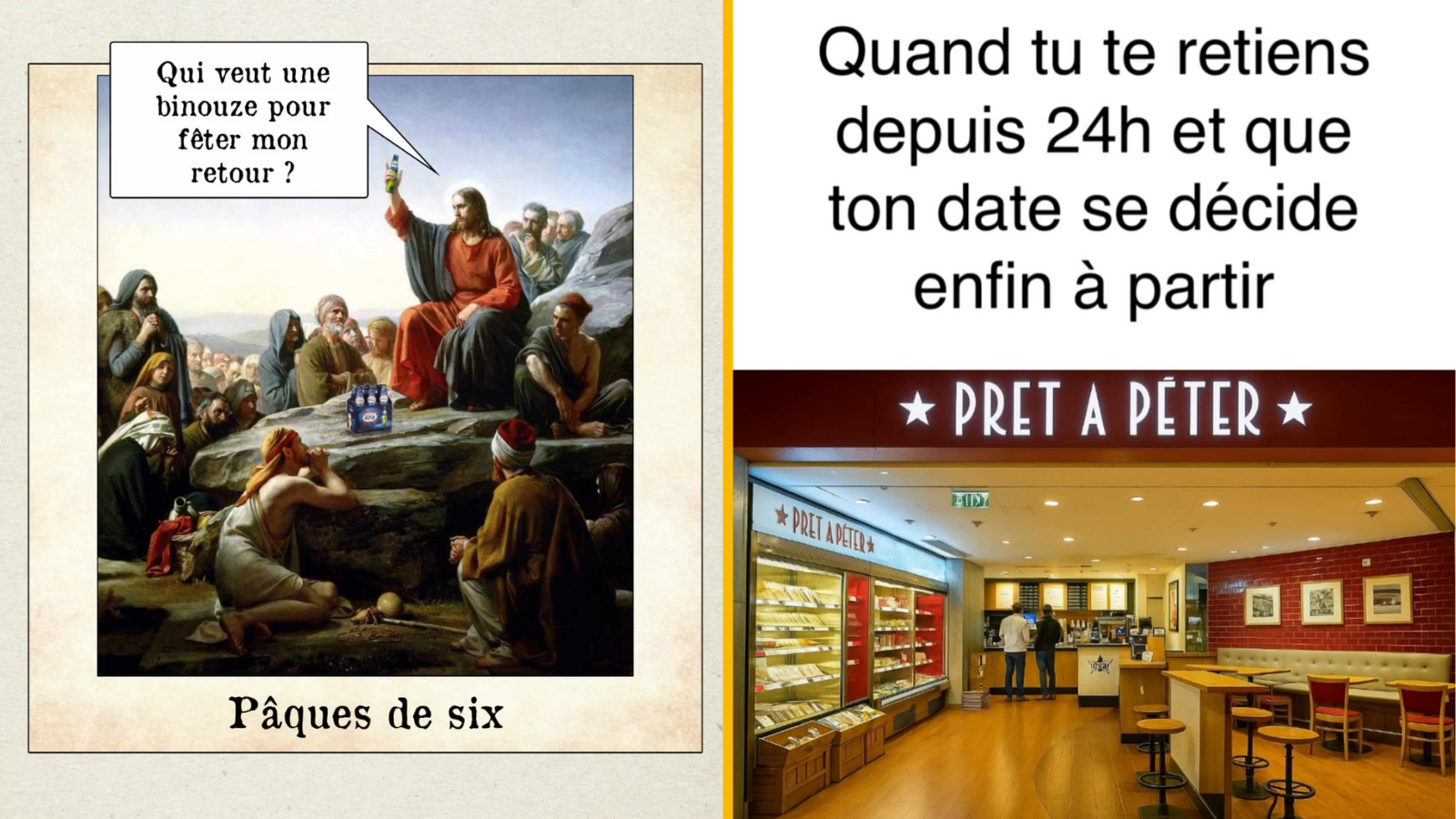












![[TEST] KARMA: The Dark World : une incroyable aventure dans les méandres de la pensée](https://s3.nofrag.com/2025/04/Karma-4.jpg)