Déconstruire les idées reçues sur les violences conjugales par l’anthropologie
L’anthropologie appréhende les violences conjugales comme un problème social complexe mêlant crise du modèle patriarcal, conditions de vie subies, problématiques de santé mentale, normes érotiques et affectives sexistes.

L’anthropologie permet d’appréhender les violences conjugales comme un problème social complexe touchant tous les milieux. Plusieurs problématiques sont souvent associées : crise du modèle patriarcal, exclusion sociale, santé mentale, représentations érotiques et affectives sexistes… La violence des hommes appartenant à des milieux privilégiés reste un défi pour la recherche, la justice et les politiques publiques.
Le procès du féminicide de Chahinez Daoud, commis il y a quatre ans par celui qui était alors son mari, place à nouveau au cœur de l’actualité l’aboutissement le plus tragique des violences conjugales, perpétrées par des hommes sur des femmes avec lesquelles ils sont mariés ou avec qui ils vivent. Ce type de crime, dont la visibilité tend à augmenter, est légion en France et ailleurs.
Aux côtés d’autres formes de violences, celles dites conjugales s’érigent progressivement dans nos sociétés comme intolérables au sens moral : elles relèvent de plus en plus de l’inacceptable et de l’insupportable. Si nombreux sont les penseurs – tels Hobbes, Rousseau ou encore Freud – à avoir mis en avant la violence comme un phénomène proprement humain, consubstantiel au sujet vivant, libre et conscient, les institutions apparaissant alors comme décisives pour « maîtriser » les phénomènes de violence. Mais les travaux d’anthropologues contemporains, basés sur des enquêtes de terrain approfondies, signalent d’autres pistes pour penser et comprendre la violence conjugale : elle constitue une production sociale.
Dans la recherche en sciences sociales, elle est comprise de façon plutôt consensuelle en lien avec les questions de genre, apparaissant comme une forme de contrôle social qu’exercent des hommes sur des femmes. Le sexisme ordinaire constitue la principale cause sociale de cette violence : les hommes se percevant comme supérieurs aux femmes, ils s’autoriseraient à adopter à leur égard une attitude violente, en vue de les dominer.
En outre, de nombreux travaux montrent que cette violence ne peut être définie par un geste physique seul. Elle est constituée d’un ensemble d’éléments qui convergent : relation d’emprise ; cumul de diverses formes de violences (verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques) ; répétition des épisodes de violence ; gravité de leurs conséquences.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Toutefois, d’autres aspects que le genre entrent en ligne de compte, comme l’imbrication profonde de la violence conjugale avec d’autres formes de violence structurelle, qui alimentent l’exclusion sociale et l’humiliation ; ces violences se trouvent au cœur des rapports de classe, de racialisation, et de colonialité. Comprendre les violences conjugales pour ensuite proposer des cadres de prise en charge aux personnes concernées invite donc à tenir compte de leurs ancrages socio-économiques et de leurs statuts, très divers.
Cette diversité va à rebours de l’idée préconçue selon laquelle il y aurait un profil privilégié d’agresseur ; autrement dit, qu’il y aurait plus de violence de la part d’hommes racisés des classes populaires, souvent issus de l’immigration, quand les enquêtes quantitatives montrent que les viols sont commis dans tous les milieux sociaux.
À lire aussi : Existe-t-il des profils types d’auteurs de violences conjugales ?
On constate par contre une condamnation plus importante d’agresseurs en situation économique précaire. Les positions sociales, et les rapports de pouvoir qui leur sont liés, ont leur importance au moment du (dé) voilement judiciaire de ces violences, quand on considère que « la plupart des hommes des milieux favorisés n’apparaissent nullement impressionnés par l’appareil judiciaire et bataillent au sens propre du terme pour se défendre, servis en cela par d’évidentes ressources (financières et intellectuelles notamment) que leur fournit leur position sociale », comme le montre la sociologue Véronique Le Goaziou. À ce titre le procès des viols de Mazan ouvre une brèche importante dans la condamnation d’agresseurs davantage insérés socialement.
Comprendre les violences conjugales à partir d’enquêtes localisées
Bo Wagner Sørensen a mené il y a une trentaine d’années une recherche de terrain dans la capitale du Groenland, Nuuk, pour s’intéresser aux façons par lesquelles, dans les cas de violences conjugales, les habitants percevaient la violence et l’expliquaient. Selon eux, celle-ci risquait d’éclater quand la femme menaçait « la position sociale de son mari en tant qu’époux, père ou homme dans la famille, aussi bien que sa masculinité et son honneur ».
L’anthropologue y voyait l’un des effets de la modernisation de la société locale s’exprimant au cœur de la vie intime : les places occupées par les hommes et les femmes s’en trouvaient bouleversées, ces dernières accédant à une autonomie financière et adoptant des comportements s’éloignant d’une forme de docilité attendue. Pour ces hommes, l’usage de la violence était perçu comme une façon de rétablir les frontières de genre. Phénomène sexué, la violence conjugale à Nuuk devait être comprise par Sørensen comme un « geste planifié dans l’ordre social ».
Toutefois ce qui se joue dans les années 1990 dans la société groenlandaise n’est pas si différent d’autres contextes socioculturels. Des mécanismes communs sont ainsi mis en évidence par les chercheurs.
La violence conjugale comme production sociale
Les anthropologues contribuent à construire un savoir à rebours de plusieurs « justifications sociales » de la violence conjugale, qui contribuent d’ailleurs à la rendre invisible ou à l’euphémiser. Ces justifications sont de deux ordres : la naturalisation et la pathologisation. La première repose sur l’idée que les hommes sont naturellement violents, et traduit une conception particulière de certaines émotions, comme la colère. Elles exerceraient en eux une pression si forte qu’irrépressiblement, la violence surgirait tel un débordement non intentionnel. La seconde justification sociale commune de la violence conjugale est la pathologisation des agresseurs : elle serait le résultat d’un déséquilibre mental, et donc le symptôme d’un mal-être masculin.
Pour s’éloigner de ces justifications, les chercheurs se mettent à l’écoute du vécu des acteurs de la violence conjugale. C’est le cas de Dolorès Pourette qui a recueilli en 2002 en Polynésie française des récits d’hommes astreints à un suivi psychiatrique suite à un jugement pour ce type de violences. Elle signale que ces actes sont liés pour eux à une remise en question de l’autorité masculine dans le couple, dans une société colonisée aux rôles masculins et féminins bien démarqués jusqu’alors.
Ces différents travaux mettent en lumière les rapports complexes entre masculinités, changement social et santé mentale, dans des contextes où le modèle patriarcal se trouve mis à mal non pas à l’issue de luttes collectives, mais de par des conditions de vie souvent subies. Faisant notamment référence à une recherche sur les trafiquants de drogue portoricains immigrés à New York, Marie-Elisabeth Handman écrit : « quand les hommes sont dominés, que ce soit par la colonisation ou la relégation dans des banlieues qui cumulent les handicaps sociaux, ils sont privés des attributs [socialement] conférés à la masculinité (entre autres, être les pourvoyeurs de fonds des familles) et ce sont les femmes qui paient le prix fort de cette dévirilisation ». Au cœur de la violence conjugale, il y a bien des enjeux de pouvoir mais aussi des enjeux normatifs.
S’inscrivant dans le sillon foucaldien, les psychanalystes Laurie Laufer et Thamy Aiouch ont montré que les rapports de pouvoir s’articulent au sein de l’intime, à partir d’un dispositif de « reproduction des normes de genre et des stéréotypes des rôles sexués », et que les conflits qui peuvent dégénérer en violences sont souvent déclenchés par ce dispositif.
Que peut-on espérer ?
Traiter la violence conjugale comme un problème social et non comme un problème moral a des implications. Plusieurs pistes de travail se dégagent, et sont investies différemment par les acteurs de la société civile. La question de la prise en charge des acteurs de violence en est une, importante et nécessaire, bien que cette voie demeure encore peu « attrayante » socialement – on attend davantage une réponse uniquement punitive – peu pensée, et donc peu audible.
Une autre piste, plus structurelle, consiste en un travail de « transformation des normes érotico-sociales », comme l’évoquait déjà Freud en son temps, notamment par un suivi clinique. Cela implique aussi de se mettre à l’écoute des chercheurs en sciences sociales qui mettent le doigt sur la complexité des rapports entre le social, le normatif et l’affectif, et apportent ainsi des éléments pour redéfinir les normes de la masculinité encore dominante, en-dehors des injonctions à la virilité.
L’anthropologie est certainement la discipline la plus encline à dissiper la confusion que cette complexité peut créer, « grâce à la présence prolongée des chercheurs sur le terrain, à leur écoute attentive des différents acteurs ». Elle a un rôle important à jouer en se saisissant du sujet des violences conjugales, encore trop peu étudié de nos jours. Surtout, « la violence des hommes blancs des classes moyennes et supérieures demeure largement impensée ». Il faut s’en emparer pour œuvrer à une plus grande compréhension de ce phénomène, à rebours des préjugés et de la production sociale d’un silence imposant sur le sujet.![]()
Rougeon Marina ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

/2025/04/18/nicolas-valery-maire-de-secondigne-sur-belle-deux-sevres-vous-mangez-mairie-vous-dormez-mairie-et-au-bout-d-un-moment-vous-etes-sature-6802a1f640946243000274.jpg?#)








![[SATIRE À VUE] Liberté, Égalité, Virilité : le retour de bâton qui fait mâle](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/pexels-anush-1229356-463x482.jpg?#)
![[REPORTAGE] Procession de la Sanch, l’immuable Passion du Christ à Perpignan](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/whatsapp-image-2025-04-18-at-203727-616x347.jpeg?#)






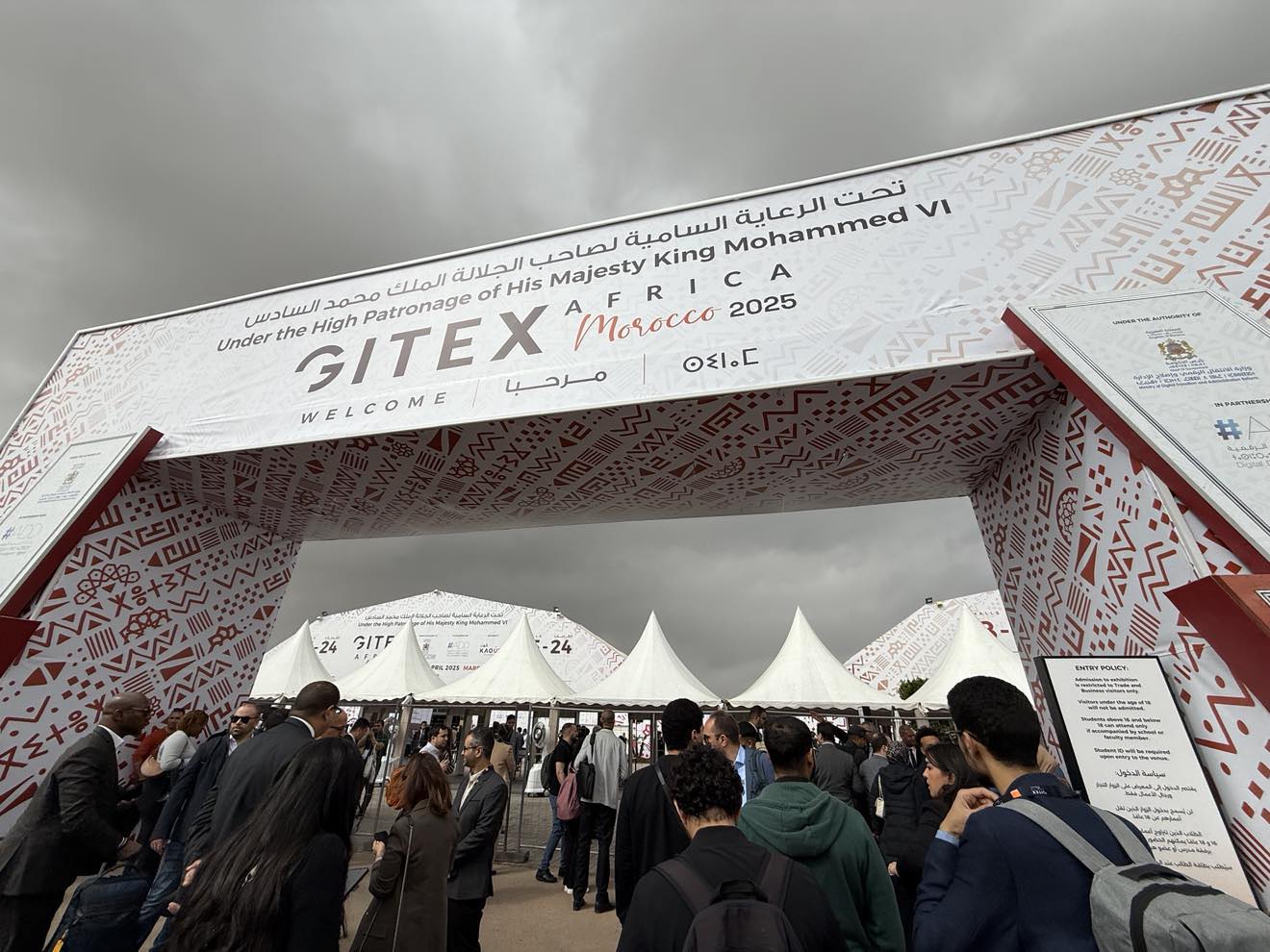
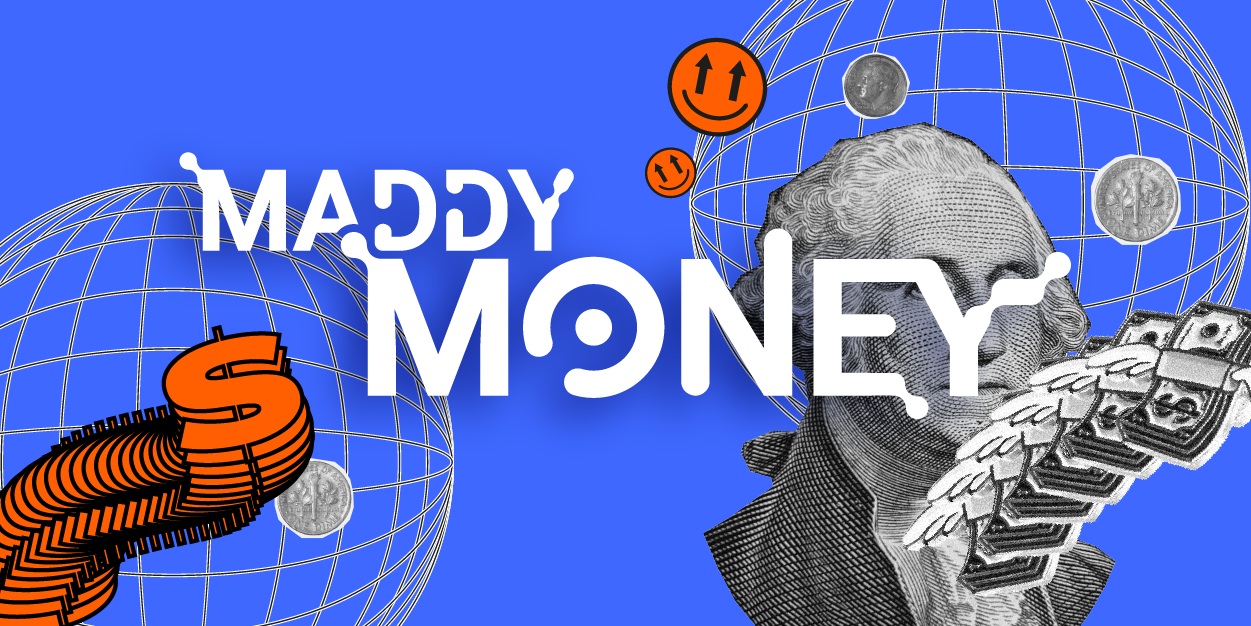






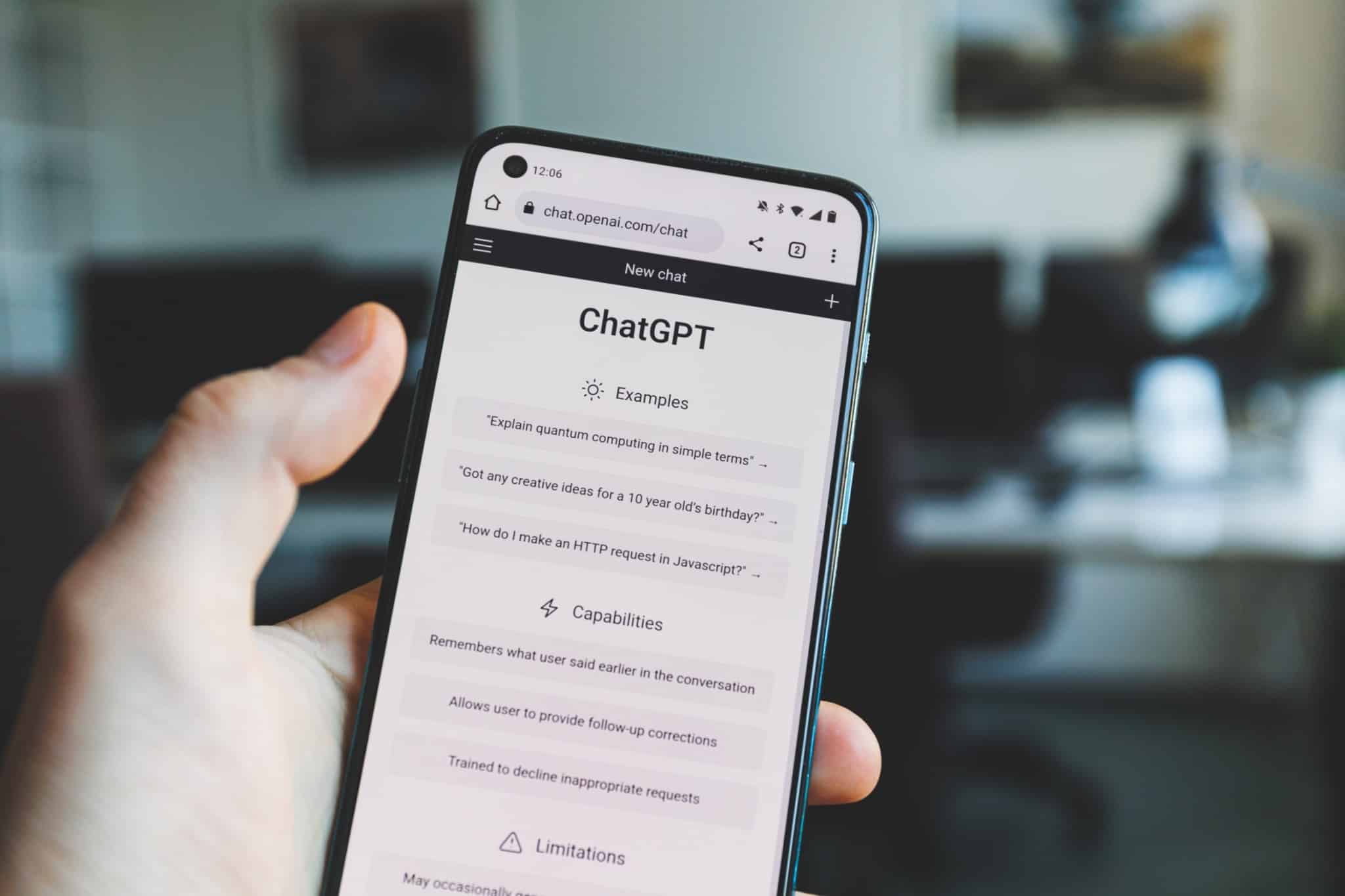
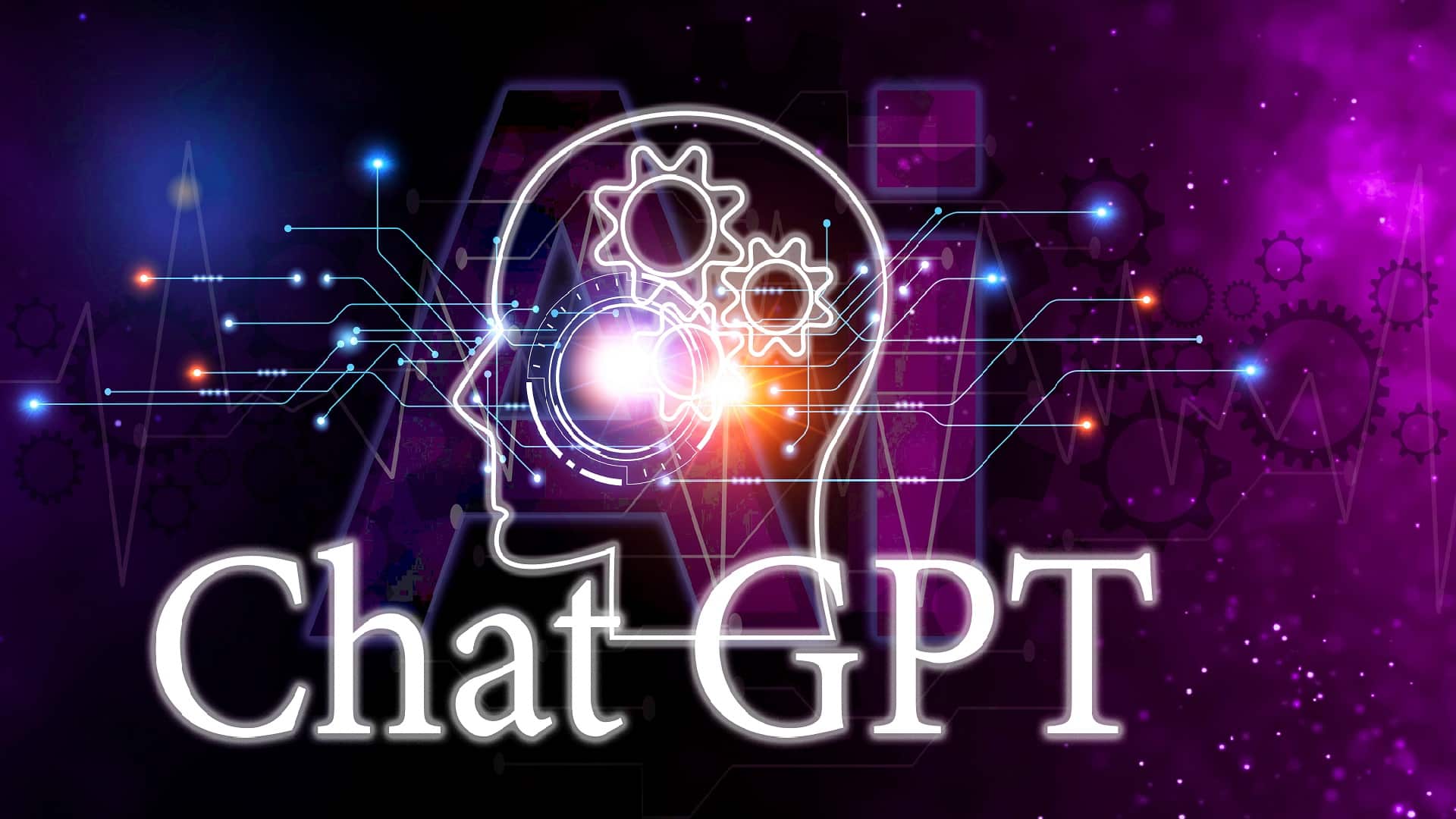

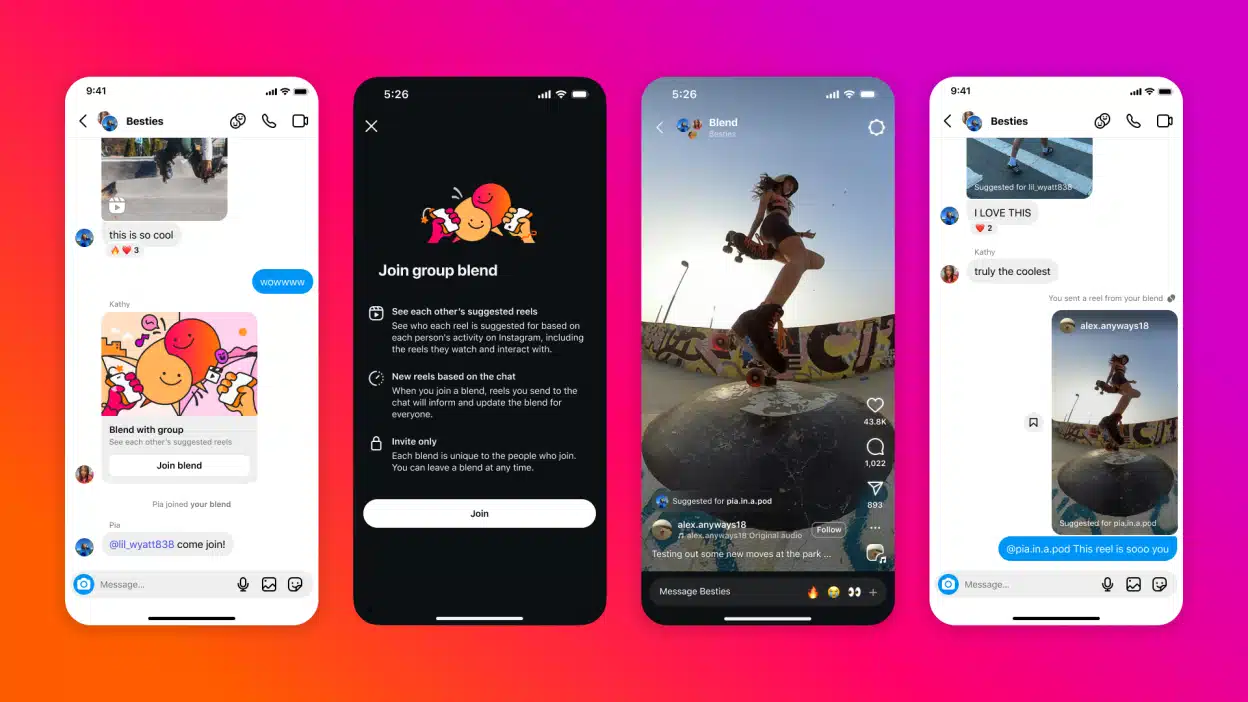








/2025/04/18/maxpeopleworldtwo225792-6802b6a3810c3517293538.jpg?#)
/2025/04/18/gastronomie-ces-restaurants-qui-choisissent-de-ne-mettre-qu-un-seul-plat-a-la-carte-6802b902920c7808914750.jpg?#)
/2025/04/18/musique-les-clips-eclipses-par-les-videos-6802c4327423e896485966.jpg?#)






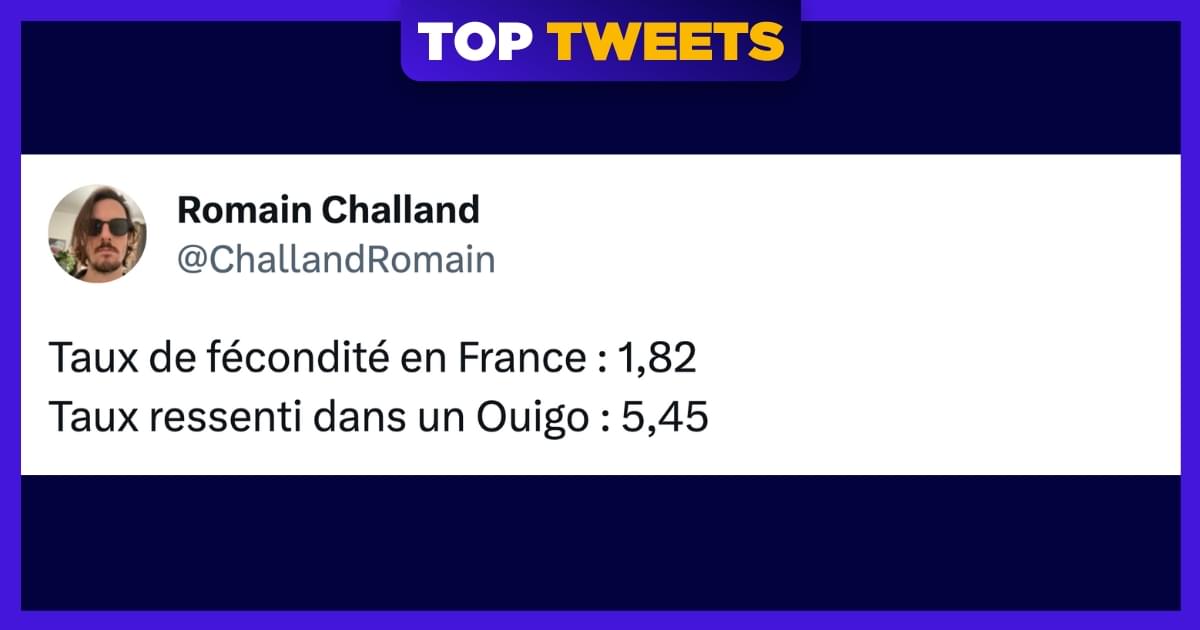




/2024/11/21/descartes-673f58af57fe1805144576.jpg?#)



![En France, « nous ne nous fixons pas de limites » [Octopus]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/04/Octopus_Assets_Renewables_3-scaled.jpg)
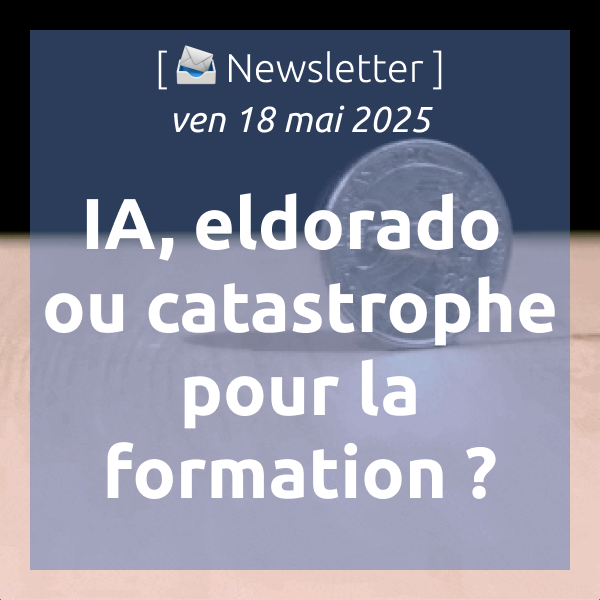











![[TEST] Kingdom Come: Deliverance II : de prince à roi, il n’y a qu’un pas](https://s3.nofrag.com/2025/03/Kingdom-Come-Deliverance-II-25.jpg)
