Conclave catholique : quel pape, pour quelle Église ?
Jamais un conclave n’a réuni une assemblée aussi hétérogène du point de vue de l’origine géographique des cardinaux. Une diversité qui reflète l’évolution au long cours de l’Église catholique.

La désignation du prochain pape est un processus complexe dont l’issue indiquera la voie que l’Église suivra au cours des prochaines années : celle tracée par François, qui conférait notamment une large place à des sujets jusqu’alors peu traités par le Vatican, comme la protection de l’environnement, ou un retour à une position plus traditionnelle.
Le conclave qui vient de s’ouvrir, ce 7 mai, pour désigner le nouveau pape de l’Église romaine devra résoudre cette quadrature du cercle : quel homme pour quelle Église, et quelle Église pour quel monde ?
Devant la complexité apparente du meilleur « choix », on comprend que les 133 cardinaux amenés à choisir l’un des leurs pour prendre (aussi) la tête du Vatican invoquent l’Esprit saint avant d’entrer dans la chapelle Sixtine où, de façon anonyme, ils coucheront un nom sur le papier jusqu’à ce que l’un d’entre eux se dégage et obtienne en quelques scrutins (quatre tours par jour) les voix du quorum canonique.
Dans le sillage du conclave, des catholiques du monde entier ont développé des réseaux de prière visant à optimiser les décisions cardinalices, accompagnés désormais par des applications ad hoc qui ont beaucoup de succès.
Ouverture
Aussi, ce temps paré de rituels immémoriaux – quoique les historiens en relativisent la continuité – est à la fois très festif, très populaire, mais aussi presque dramatique : la pression des médias, qui le couvrent avec grand sérieux, lui donne une forme de vérité définitive, qui a fini par amplifier son enjeu et le rendre planétaire.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Les profils des « papabiles » – une vingtaine – sont scrutés à la loupe dans les projections et conjectures parfois très savantes des vaticanistes. Leurs qualités et compétences sont vraiment diverses. Bien sûr, aucun ne les possède toutes. À vrai dire, sont-elles toutes nécessaires pour gouverner l’Église ? Chaque pontificat est marqué par la personnalité même de son pontife. Le seul critère de départ est que le cardinal qui deviendra pape (aucune candidature officielle n’est annoncée au préalable) soit choisi sans interférence extérieure, qu’il s’agisse des puissances politiques comme des factions les plus militantes au sein de l’Église.
Mais les sabotages de réputation, à l’heure de la manipulation numérique par les spécialistes de la déstabilisation, sont plus faciles qu’avant, d’autant que, ces dernières décennies, les scandales – financiers, politiques, sexuels – se sont succédé, désacralisant les fonctions et les ordonnancements, faisant chuter le nombre de déclarants fiscaux dans les pays où la dîme est toujours étatisée, comme l’Allemagne, et surtout faisant disparaître les pratiquants, parfois de manière drastique.
Dans ce contexte incertain, que Donald Trump fasse encore le clown en postant une photo où il apparaît en tenue de pape, qu’il raconte que le cardinal Dolan de New York serait le meilleur candidat de tous les temps, que le ministre français des affaires étrangères évoque l’archevêque de Marseille le cardinal Aveline et que les Marseillais de France se mobilisent en faveur de ce dernier tiendrait presque de l’anecdotique.
Universalité
Cent trente-trois votants, dont 108 nommés cardinaux par le pape François (2013-2025), dont certains sont issus de « nouvelles chrétientés » des périphéries, de pays jamais représentés, de pays en guerre, de pays où les catholiques sont minoritaires et de pays en situation de grande pauvreté : le collège de ce conclave est le plus universel, le plus multiracial et le plus polyglotte de tous les temps.
L’égalité démographique n’est pas encore atteinte, mais les représentants de la vieille chrétienté européenne, toujours riche en diocèses et en structures de tout genre malgré sa forte sécularisation, forment moins de la moitié des votants actuels. Ils seront bientôt réduits au quart dans l’équilibre des représentations continentales.
En misant sur François en 2013, les cardinaux avaient lancé un signal fort : ils l’avaient choisi pour réformer l’Église et c’est ce qu’il a fait, non sans provoquer des grincements de dents. Le conclave précédent a obtenu bien plus qu’il ne l’espérait, trop selon certains. Le pape « du bout du monde » a retourné le Vatican, transformant les logiques de centralité romaine et de cléricalisme. Il a réformé la curie, le gouvernement central de l’Église, en promulguant une nouvelle Constitution. Le souverain pontife a complètement revu les finances et la communication du Saint-Siège. Au Vatican, de nombreux Italiens ont dû céder leur place à des hommes – et ces derniers mois à des femmes – venus de loin.
Mais François a fait plus que prévu. Il a mis au centre de l’attention de l’Église des sujets encore marginaux pour elle, du moins au début des années 2010, comme l’immigration et l’écologie. Il a dénoncé (à l’avance ?) la violence d’une « troisième guerre mondiale », qui se déroulait « par morceaux » à travers le globe. Tout au long de son pontificat, il a favorisé l’émergence de figures religieuses nouvelles, s’inscrivant dans sa ligne. Il est « descendu de la chaire », pour incarner une Église au contact, dans un monde justement de plus en plus connecté par le sans-contact, où les frontières se ferment, les sociétés se fracturent et les gens sont apparemment indifférents les uns aux autres et au devenir de leur société.
Quadrature du cercle
Quel homme, donc, pour quelle « image » de l’Église ? La couleur de peau est presque essentielle pour signifier qu’elle ne l’est pas. Un pape noir (Ambongo, Turkson, Gregory, Sarah) ou asiatique (You, Tagle, Ranjith, Goh, Maung Bo) ? Un pape états-unien (Gregory encore, Cupich, Presvot, Tobin, Farrell) ? Un pape venu d’une grande Église nationale dans un pays majoritairement catholique (Erdö, Krajewski, Zuppi) ou un pape venu d’une Église minoritaire (Brislin, Berhouet, Arborelius, Eijk) ? Un pape d’un pays qui n’est pas chrétien (Vesco, Koovakad, Marengo), voire d’un pays qui opprime sa minorité catholique (Maung Bo) ? Faut-il qu’il ait une longue expérience épiscopale ? Une longue expérience curiale ? Qu’il parle italien ou plusieurs langues ? Quelle direction est la plus urgente en interne : continuer l’Église « ouverte » chère à François ou la « remettre sur les rails » ?
Quatre types de questions se posent qui départagent le clivage entre progressistes et conservateurs dans l’Église, sachant que la plupart des cardinaux sont un peu des deux et que le pape lui-même a, selon la tradition apostolique-catholique, « le pouvoir des clefs » (Matthieu, XVI, 19) qui lui permet de rendre central ce qui, hier, était progressiste et de déplacer aussi les lignes du conservatisme.
Faut-il poursuivre ou non les réformes dans l’Église pour consolider son implantation globale ? Si oui, le cardinal Hollerich est le plus progressiste. Si non, le cardinal Müller est le plus le plus conservateur. Faut-il persévérer ou non dans la préséance de la charité sur le rappel de la doctrine ? Si oui, le cardinal Zuppi est le plus pastoral ; si non, le cardinal Filoni est le plus traditionnel et les deux sont Italiens. Faut-il porter ou non la priorité des efforts sur le développement des chrétientés de demain, notamment en Asie ? Dans ce cas, le cardinal Tagle, des Philippines, est le grand favori. S’il faut repartir dans l’évangélisation catholique des pays sécularisés, bien souvent les plus développés d’Europe et d’Amérique, alors Tolentino de Mendonça, préfet du Dicastère pour la culture et l’éducation, homme de lettres et théologien, est un bon candidat.
Enfin, faut-il ou non continuer les injonctions « sudistes » du pape François face aux injustices et à la cruauté du monde, à travers un prisme encore plus caritatif ? Avoir une grille de lecture encore plus sociale, voire plus économique ou carrément plus politique sur les effets de la prédation, de l’avidité, des rapports de force sur la nature, dans la société et entre les États ? Si oui, les cardinaux africains Turkson ou Ambongo ont un profil idéal.
Faut-il continuer à faire du migrant et du réfugié l’idéal-type du prochain à secourir ? Les cardinaux états-uniens Cupich, Tobin, Presvot sont les plus audibles et prêts à affronter leur gouvernement sur la question. Faut-il plus que jamais dénoncer l’oppression des pouvoirs, la prédation territoriale, l’appétit de la guerre et de l’intimidation, en un mot prêcher la paix et la justice pour les peuples ? Les cardinaux diplomates Parolin, mais aussi Pizzaballa, Gugerotti, Zuppi et Turkson, sont parmi les plus qualifiés.
Corps du pape
On le voit, il ne manque pas de profils dans cette course aux priorités de l’Église catholique. Elle-même est si diverse et présente des aspects si contradictoires, que peut-être son dernier paradoxe est que le bon choix du conclave réside moins dans les compétences du futur pape que dans son charisme relationnel.
En effet, ce sont avant tout la personnalité chaleureuse et le truchement itinérant du corps pontifical qui favorisent aujourd’hui l’universalité catholique. À la fois sédentaire par excellence et nomade perpétuel, par ses voyages, rencontres, rassemblements et moments de convergence romaine (jubilés, années saintes, Semaine sainte, etc.), il est tangiblement le « Vicaire du Christ ». C’est dans l’expérience physique de sa rencontre collective que se forge aujourd’hui le sentiment de la communion catholique. Et cette particularité relationnelle « globale » a été l’un des grands changements du catholicisme institutionnel au XXe siècle.![]()
Blandine Chelini-Pont ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








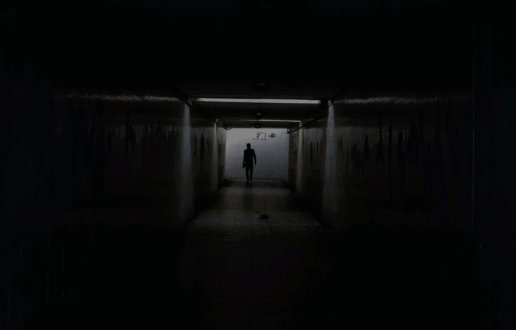

















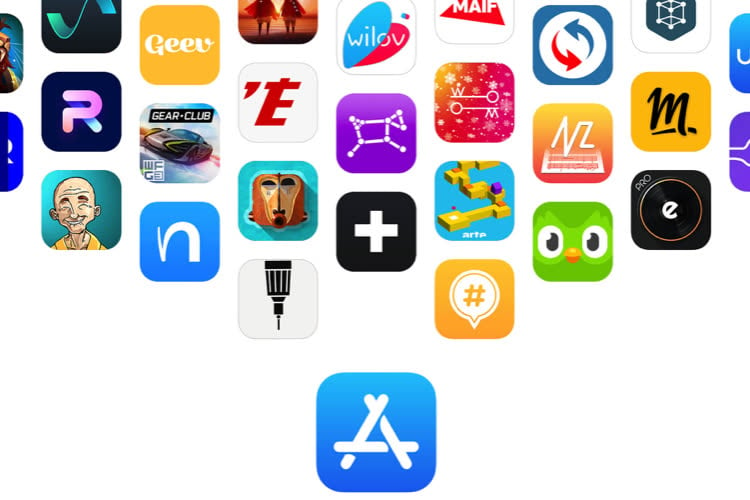












/2025/05/07/balle-perdue-3-681b6d052d404080454089.webp?#)

/2025/04/04/papy-collabo-67f01428a80c0049441017.png?#)
/2025/05/04/portrait-manuel-legris-2-68179d3172bcf176214333.jpg?#)


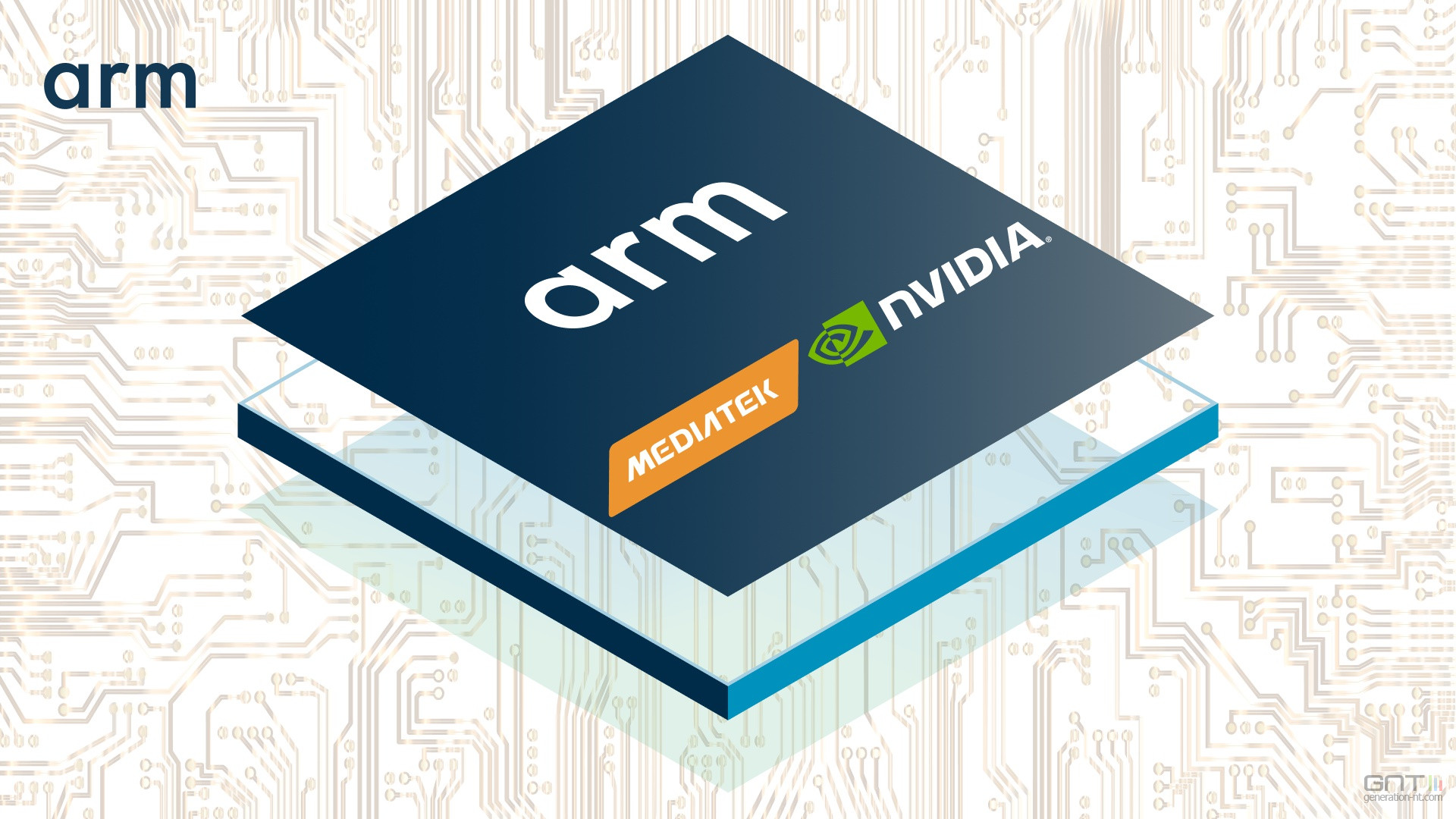


/2025/05/08/gettyimages-1607096507-681c4fed2afea440731994.jpg?#)




















