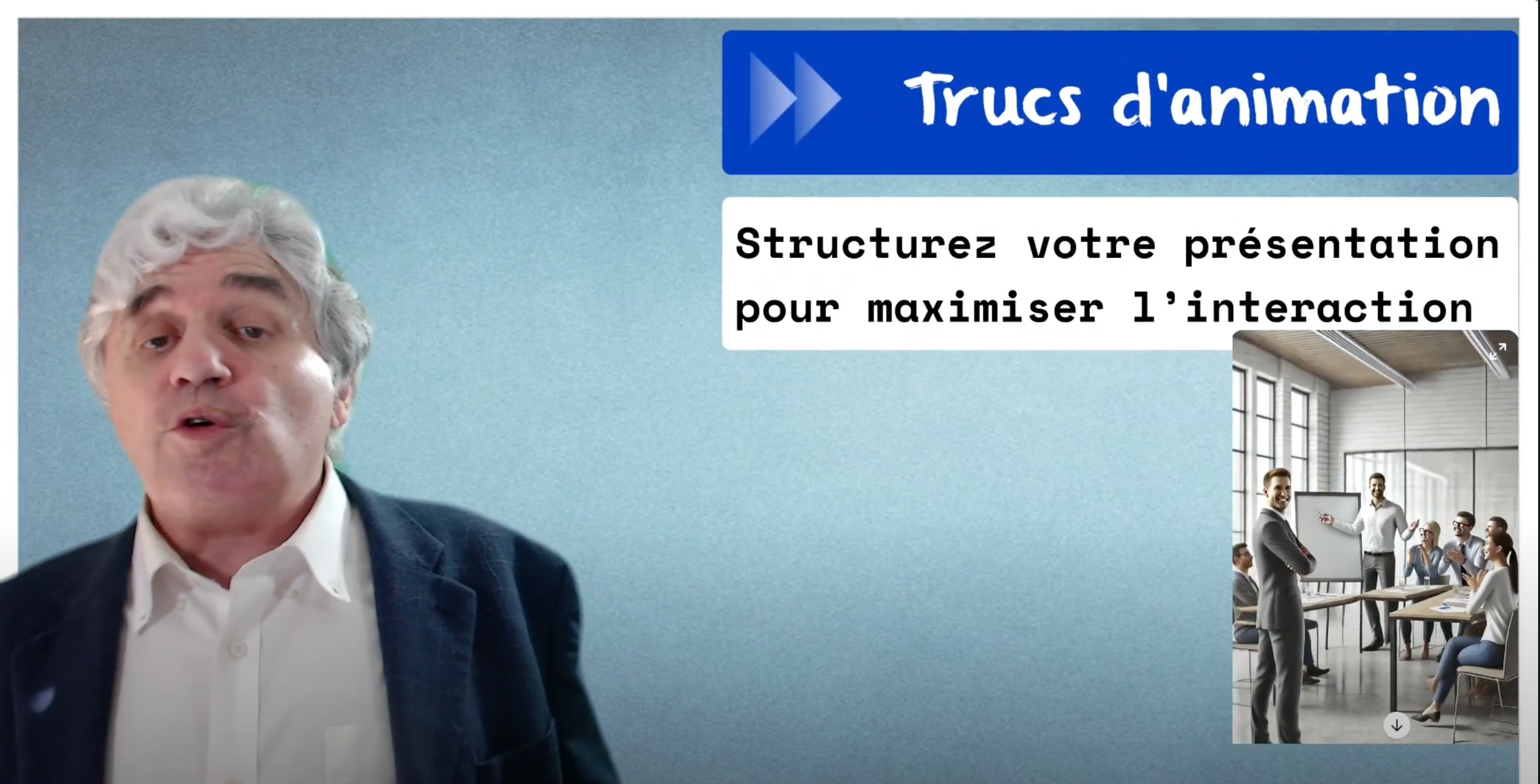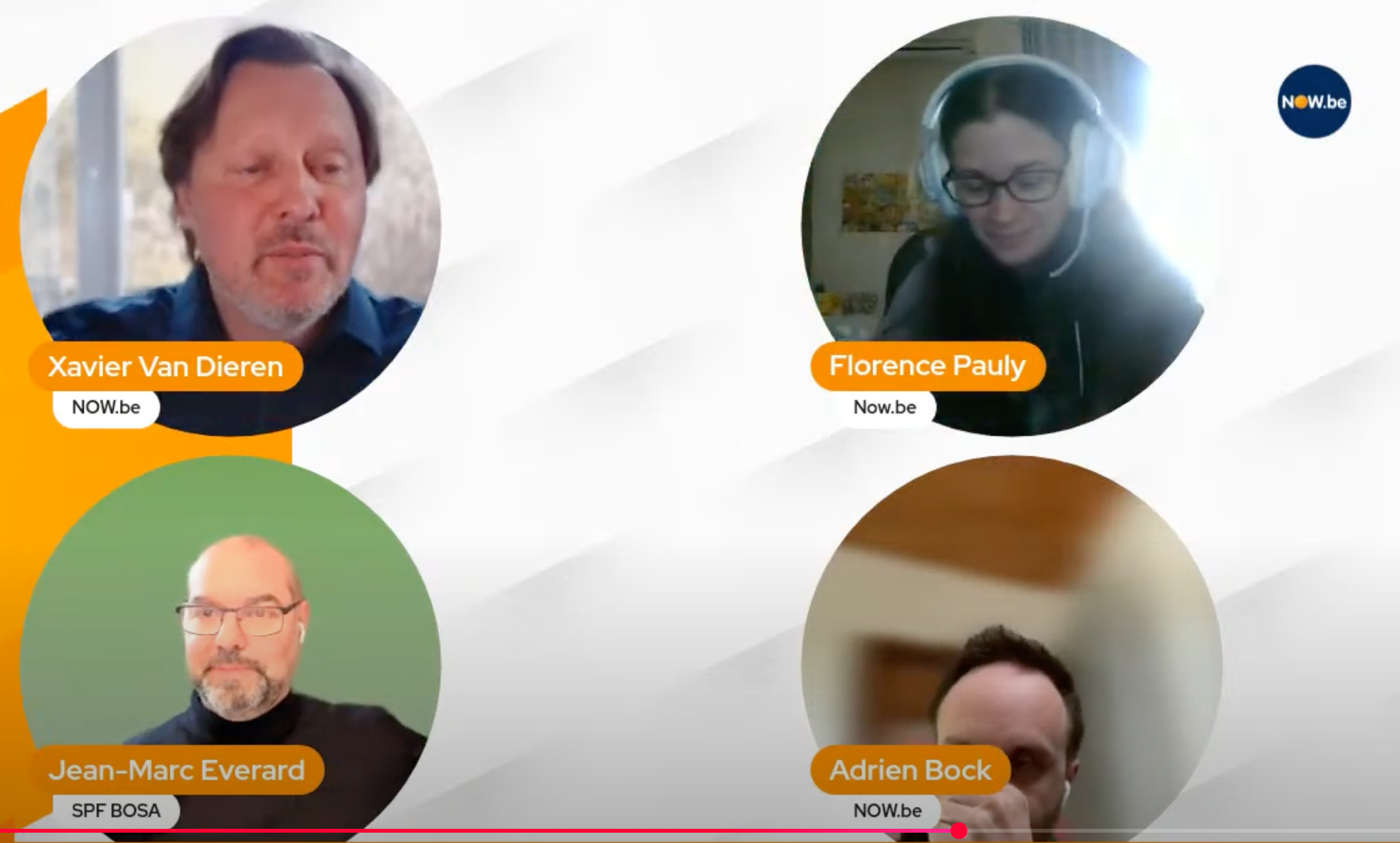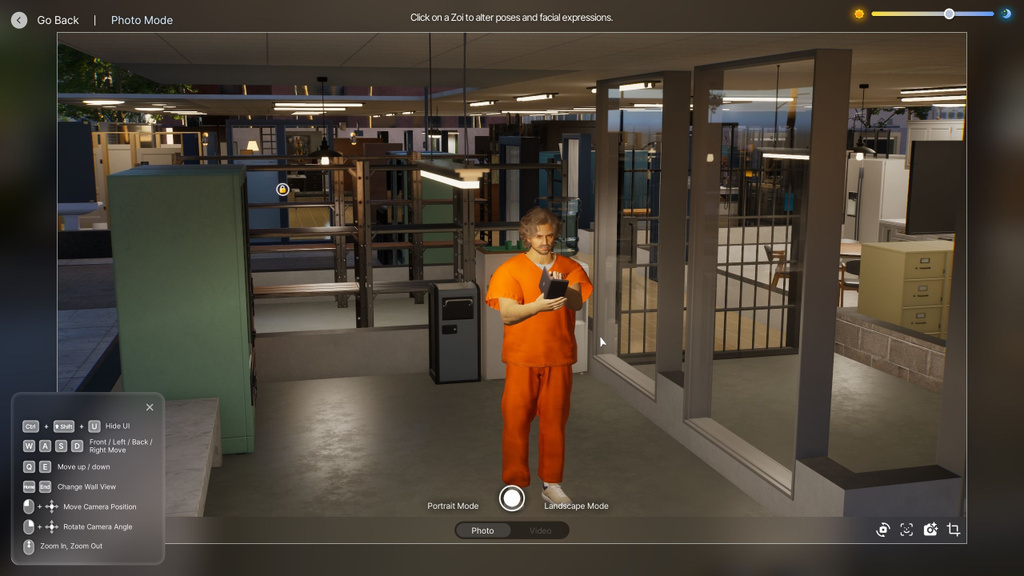Vivre plus longtemps, mais moins bien ? Les inégalités qui pèsent sur le grand âge
L’allongement de la vie ne correspond pas toujours à une amélioration de la qualité de vie, du fait d’inégalités socioéconomiques et d’une variabilité de la qualité des soins, en particulier en Ehpad.

L’allongement de la vie ne correspond pas toujours à une amélioration de la qualité de vie quand les seniors perdent leur autonomie. Des travaux menés à partir de données européennes montrent que les inégalités socioéconomiques ainsi qu’une variabilité dans la qualité des soins, en particulier en maison de retraite, entrent en ligne de compte.
Avec l’allongement de l’espérance de vie, de nouvelles questions émergent quant à la qualité de cette vie prolongée. Alors que l’on pourrait s’attendre à ce que la longévité soit synonyme de meilleure qualité de vie, nous avons mené plusieurs recherches, en nous appuyant sur une base de données européenne, qui démontrent une réalité bien plus complexe et contrastée.
Nous avons étudié des paramètres qui impactent la qualité de vie quand on avance en âge, comme les inégalités socioéconomiques et la variabilité dans la qualité des soins qui sont prodigués dans les maisons de retraite en Europe. Nous nous sommes également intéressés à la perception que les personnes âgées pouvaient avoir de leur lieu de vie, qu’elles résident à leur domicile ou en maison de retraite.
Une combinaison d’inégalités pour les plus pauvres
Dans une recherche publiée dans la Revue française d’économie, nous nous concentrons sur l’impact du statut socioéconomique sur la perte d’autonomie à un âge avancé. Cette étude révèle des disparités profondes et persistantes entre les groupes socioéconomiques, au détriment des personnes issues de milieux socioéconomiques défavorisés.
L’une des découvertes clés de cette recherche est l’existence d’une « triple peine » pour les individus les plus pauvres.
D’abord, ces personnes pâtissent d’une espérance de vie plus courte (selon les pays, l’écart peut aller de 4 à 7 ans d’espérance de vie). De plus, elles passent plus de temps dans un état de dépendance et, enfin, elles rencontrent davantage de difficultés en fin de vie (comme être capable de s’habiller, se laver ou se faire manger seules).

Chaque mardi, le plein d’infos santé : nutrition, bien-être, nouveaux traitements… Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui.
Cette combinaison d’inégalités est particulièrement préoccupante. Elle signifie en effet que les personnes issues de milieux défavorisés vivent non seulement moins longtemps, mais aussi que leur qualité de vie en fin de parcours est significativement dégradée par rapport à celles des groupes socioéconomiques plus aisés.
À noter que dans nos travaux de recherche, nous avons utilisé des données provenant d’une grande enquête longitudinale : « Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe » (SHARE). Ces données permettent d’analyser les trajectoires de santé des individus au fil du temps, ce qui est crucial pour comprendre l’évolution de la perte d’autonomie.
Vivre chez soi ou en maison de retraite : quelle perception des personnes âgées ?
Alors que nous constatons que l’accès aux maisons de repos diffère selon le patrimoine des personnes interrogées (les personnes les plus riches seraient celles qui évitent davantage la maison de retraite), nous étudions l’impact de ce lieu de vie sur leur bien-être.
En effet, dans une autre étude très récente, nous explorons les préférences des personnes âgées quant à leur lieu de vie. Le désir de vieillir « chez soi » est souvent exprimé par les seniors qui perçoivent la maison de retraite comme une option de dernier recours. Cependant, cette étude révèle une réalité plus nuancée. En analysant les données issues de l’enquête SHARE, nous avons comparé le bien-être subjectif des personnes vivant chez elles à celui des résidents de maisons de retraite.
Initialement, les résultats montrent que les personnes vivant en maison de retraite rapportent un niveau de satisfaction de vie inférieur à celles vivant chez elles, avec une différence de près de 8 %. Cette disparité semble renforcer l’idée que la maison de retraite est liée négativement au bien-être des personnes âgées.
Cependant, après avoir contrôlé par les variables liées à la santé, au statut fonctionnel (être capable de se laver, de s’habiller ou de se faire à manger seul) et aux caractéristiques démographiques telles que l’âge, le sexe ou encore les niveaux d’éducation et de richesse, la différence de bien-être entre les deux groupes devient négligeable.
Mais attention, quand on utilise des méthodes d’appariement, en comparant des personnes similaires dans chacun des deux habitats, le fait d’être en maison de retraite ou de soins semble avoir un impact négatif sur le bonheur.
Ehpad ou domicile : choisir la meilleure option selon son état de santé
A contrario, comme nous avons pu suivre les individus au cours du temps et particulièrement pour ceux observés plusieurs fois, nous avons constaté qu’ils expérimentaient une plus-value après l’entrée en maison de retraite et de soins.
En d’autres termes, les personnes qui se retrouvent en maison de retraite ne sont pas forcément moins heureuses en raison de leur lieu de résidence, mais plutôt à cause de leur état de santé souvent plus précaire.
Cela remet en question certaines idées reçues sur les maisons de retraite. Bien qu’elles soient souvent perçues comme des lieux indésirables, les maisons de retraite offrent, pour certains individus, un environnement plus adapté à leurs besoins de santé. Par exemple, une personne en perte de mobilité ou ayant besoin d’une assistance continue pour les activités quotidiennes peut bénéficier du cadre institutionnel de ces établissements, où des soins appropriés sont disponibles en permanence.
Les résultats suggèrent donc que, pour de nombreux seniors, le choix de vivre en maison de retraite est souvent la meilleure option en fonction de leur état de santé. Plutôt que de considérer la maison de retraite comme un échec ou une contrainte, il est important de reconnaître que ces établissements peuvent améliorer la qualité de vie de ceux qui nécessitent un soutien médical important.
À noter que, dans nos travaux, nous n’abordons pas la question des maltraitances en Ehpad qui ont pu faire l’actualité ces dernières années, notamment en France, ni celles qui peuvent survenir aussi quand une personne dans le grand âge réside à son domicile.
Enfin, les difficultés d’accès aux maisons de retraite pour tous, compte tenu de leurs coûts qui peuvent être prohibitifs, sont également des paramètres qui peuvent peser.
À lire aussi : Des clés pour bien gérer un Ehpad
Surmortalité dans les maisons de retraite en Europe du Nord, même avant le Covid-19
Dans une autre étude, nous examinons la mortalité des résidents en maisons de retraite avant la pandémie de Covid-19 qui a exacerbé les problèmes existants dans ces institutions. Cette recherche s’intéresse aux écarts de mortalité entre les résidents des maisons de retraite et les personnes vivant à domicile dans différents pays européens.
Les résultats révèlent une surmortalité significative dans les maisons de retraite des pays d’Europe du Nord, du Centre et de l’Est, par rapport à ceux d’Europe du Sud comme l’Italie et l’Espagne. Pour la France en particulier, mais avec un échantillon relativement petit, l’effet n’était pas présent.
Ces différences de mortalité s’expliquent en partie par les écarts dans la qualité des soins et l’organisation des maisons de retraite. Dans les pays d’Europe du Nord, les maisons de retraite sont souvent des établissements de grande taille, gérés par des structures à but lucratif. Cela peut influencer la qualité des soins prodigués, les ressources étant parfois insuffisantes pour répondre aux besoins croissants des résidents. En revanche, dans les pays du Sud, où les soins sont plus personnalisés et où les structures familiales jouent un rôle plus important, la surmortalité n’est pas aussi prononcée.
L’étude souligne également la nécessité de réformes structurelles pour améliorer les conditions de vie dans les maisons de retraite. Une augmentation des ressources allouées aux soins de longue durée, des normes de qualité plus strictes et un meilleur soutien aux soignants pourraient aider à réduire cette surmortalité et à améliorer le bien-être des résidents.
Les grands-parents aidants davantage soutenus en cas de dépendance
Jusqu’ici, nous avons évoqué principalement les aides formelles, qu’elles aient lieu en institutions ou à domicile. Or, il est important de rappeler que le principal pourvoyeur d’aide aux personnes dépendantes est la famille.
À lire aussi : Burn-out et fardeau des aidants : de quoi parle-t-on exactement ?
Dans une recherche récente, nous examinons un nouveau motif derrière la « garde » des petits-enfants : la réciprocité en cas de dépendance.
Nous concevons un modèle à deux périodes, c’est-à-dire une première période, où le grand-parent est en bonne santé et capable de s’occuper de ses petits-enfants, et une seconde, où il est en situation de perte d’autonomie, pour analyser l’anticipation de cette réciprocité par les grands-parents.
En utilisant les données de l’enquête longitudinale SHARE, nous confirmons l’idée que les grands-parents qui ont gardé leurs petits-enfants quand ils étaient en bonne santé reçoivent plus d’aide quand leur santé se détériore. Et l’intensité de ce soutien des grands-parents à leurs enfants est importante ! Plus ils aident, plus ils reçoivent du soutien de leurs enfants dont ils gardé la progéniture en cas de besoin.
Réduire les inégalités socioéconomiques et dans la qualité des soins
Les résultats de l’ensemble de nos études montrent clairement que les soins aux personnes âgées, qu’ils soient prodigués à domicile ou en maison de retraite, nécessitent une attention particulière des décideurs politiques. Les inégalités socioéconomiques et les variations dans la qualité des soins entre les pays d’Europe ou encore les structures publiques ou privées créent des disparités importantes et dommageables dans les conditions de fin de vie des seniors.
Il est crucial que les politiques publiques s’attaquent à ces inégalités en améliorant l’accès aux soins, en renforçant les filets de sécurité sociale et en soutenant les structures familiales qui jouent un rôle clé dans de nombreux pays.
De plus, des réformes dans les maisons de retraite sont nécessaires pour garantir que tous les résidents, quel que soit leur lieu de vie, aient accès à des soins de qualité. L’enjeu est de taille : alors que la population européenne continue de vieillir, garantir une fin de vie digne et de qualité pour tous devient une priorité sociale et politique incontournable.
Ce texte a été écrit en collaboration avec Arnaud Stiepen, expert en vulgarisation scientifique.
Retrouvez le podcast « Est-il préférable de vieillir en maison de repos », un entretien avec Jérôme Schoenmaeckers, dans PULSE (un podcast conçu pour mettre en avant les recherches et les idées innovantes issues du corps académique de HEC Liège, l'école de gestion de l'Université de Liège).![]()
Jérôme Schoenmaeckers ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
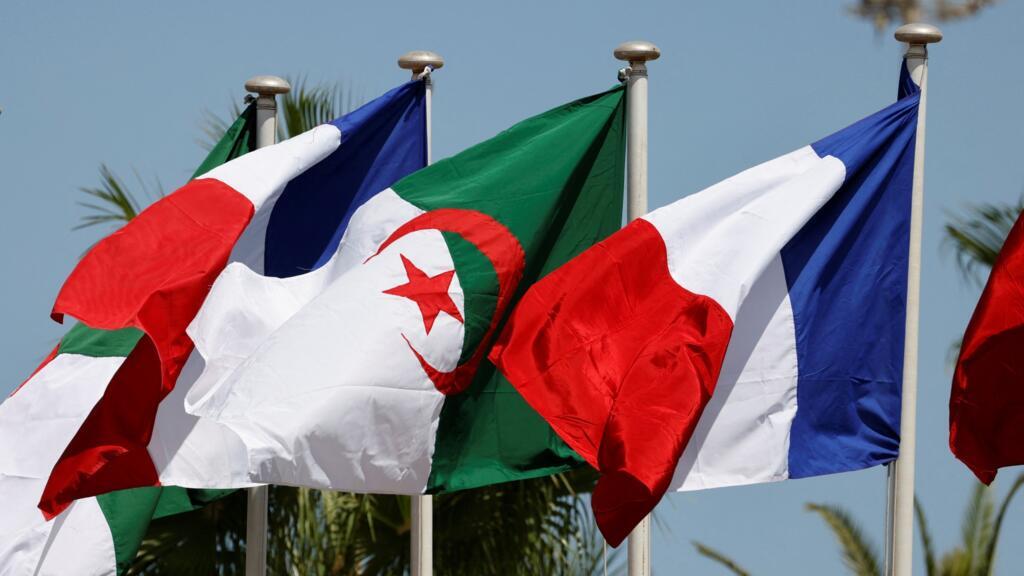






























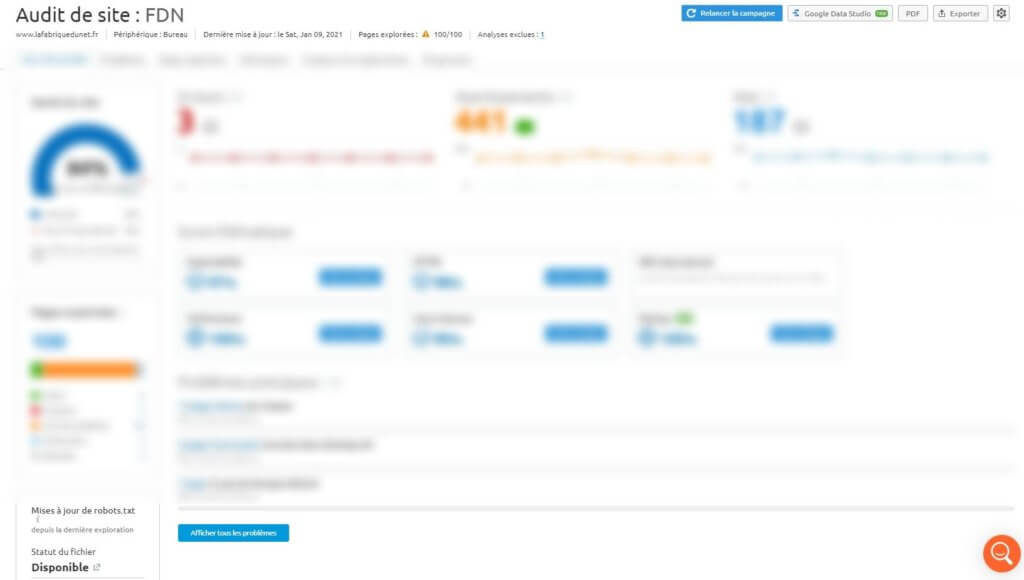







/2025/04/16/robert-doisneau-une-restropective-sur-la-carriere-du-photographe-au-musee-maillol-a-paris-68001259be33b976784690.jpg?#)





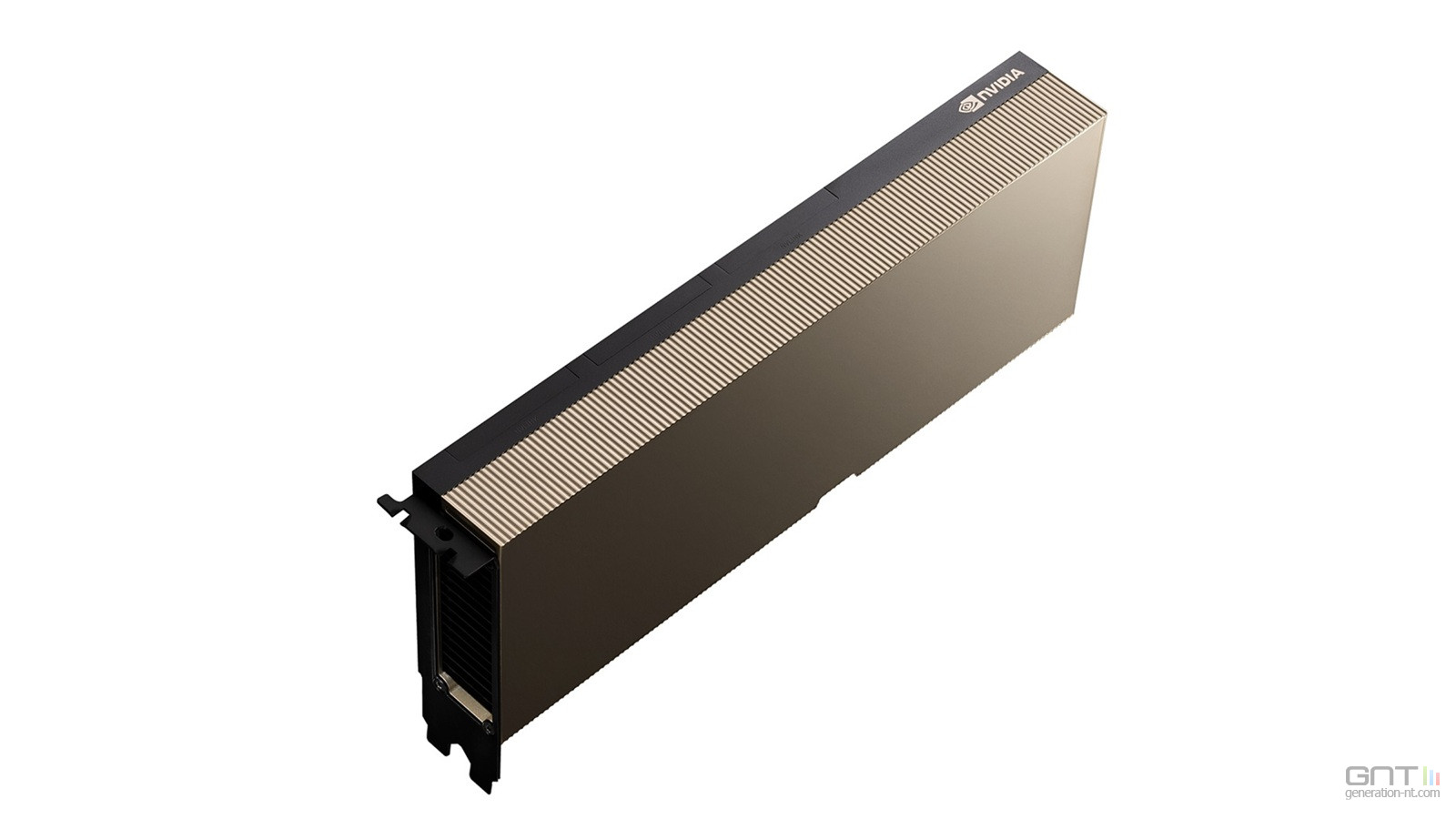

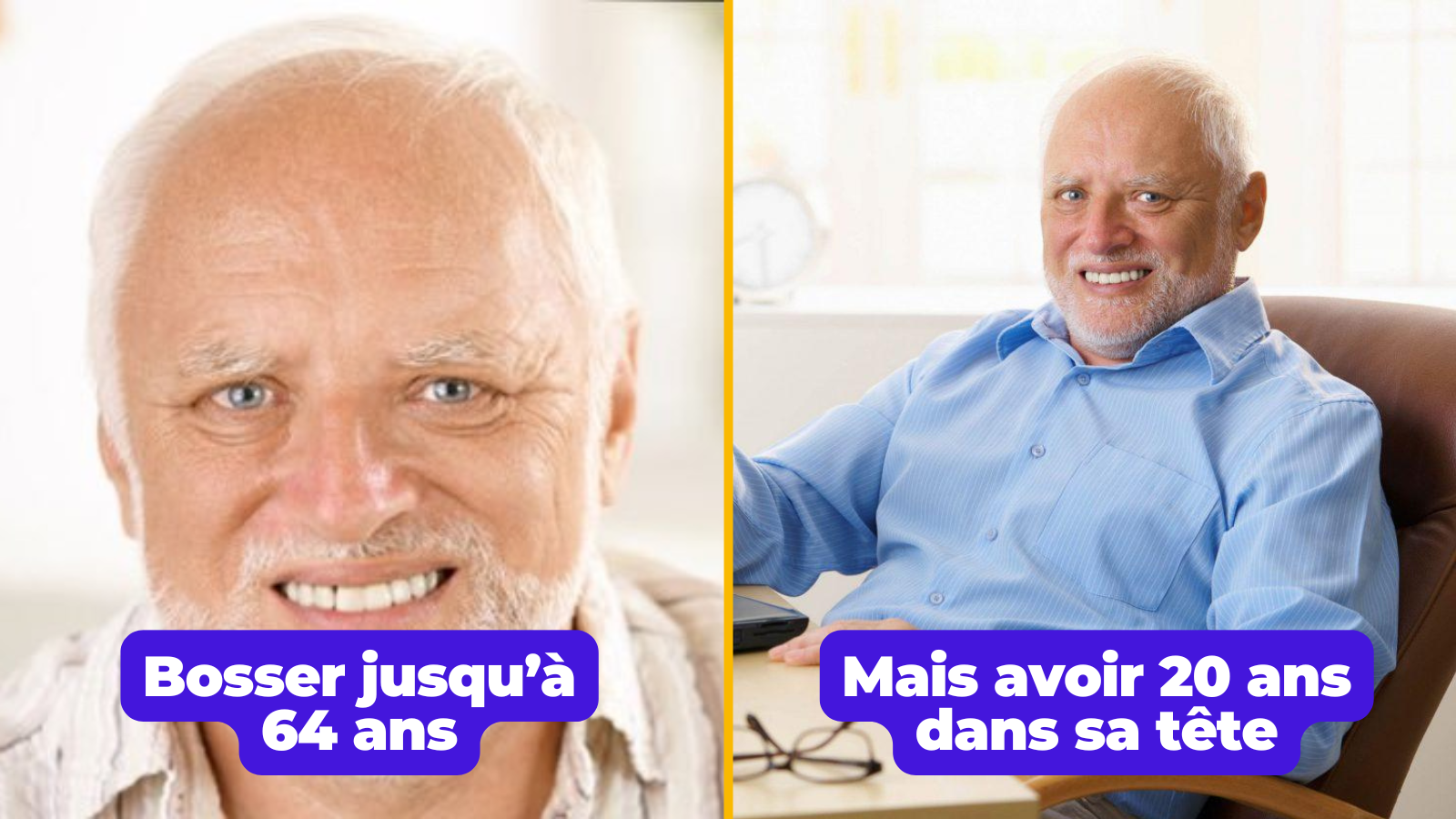






![“Un coup de rabot sur MaPrimeRénov’ en 2026 est une quasi certitude” [GPCEE]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2023/01/CEE.png)