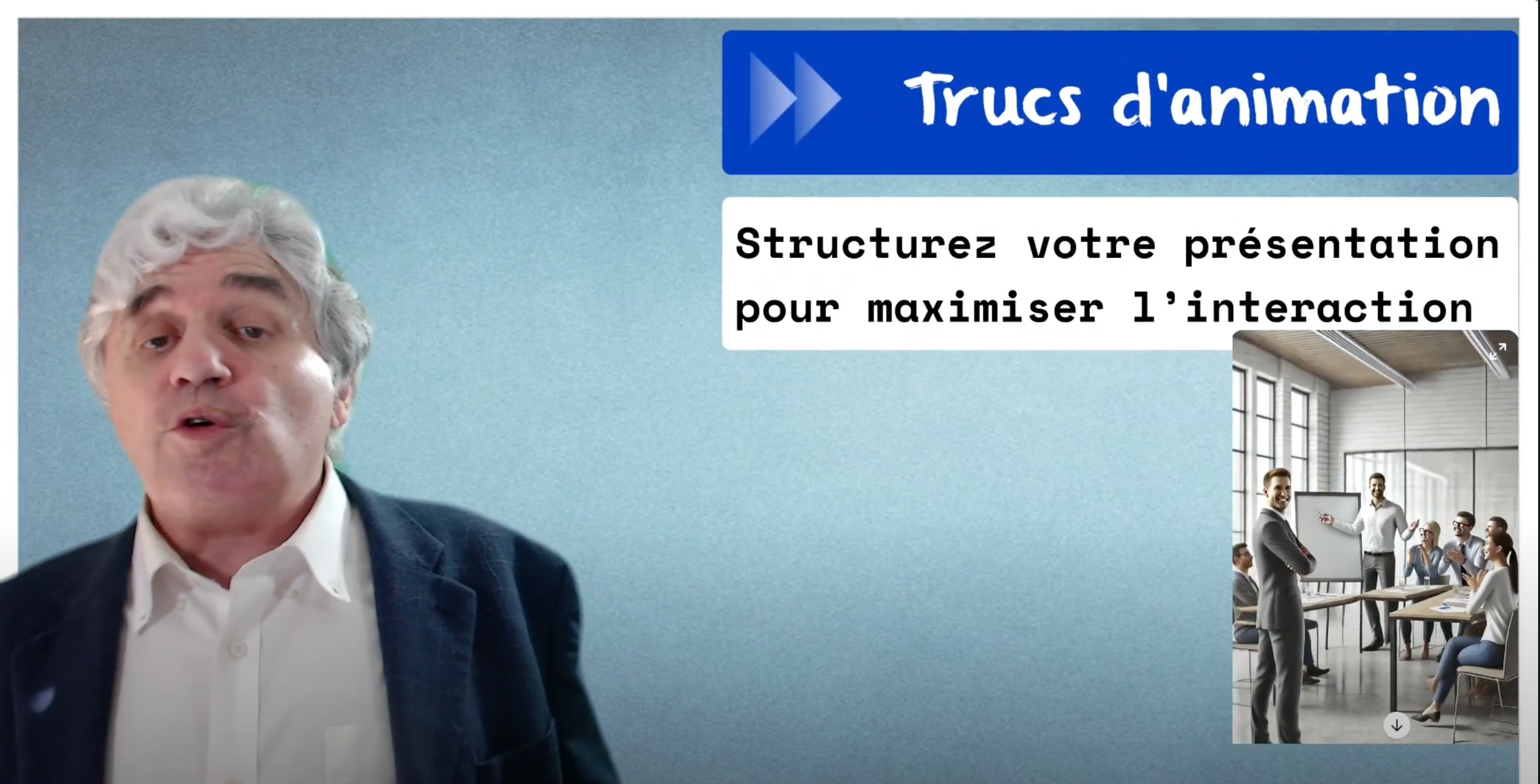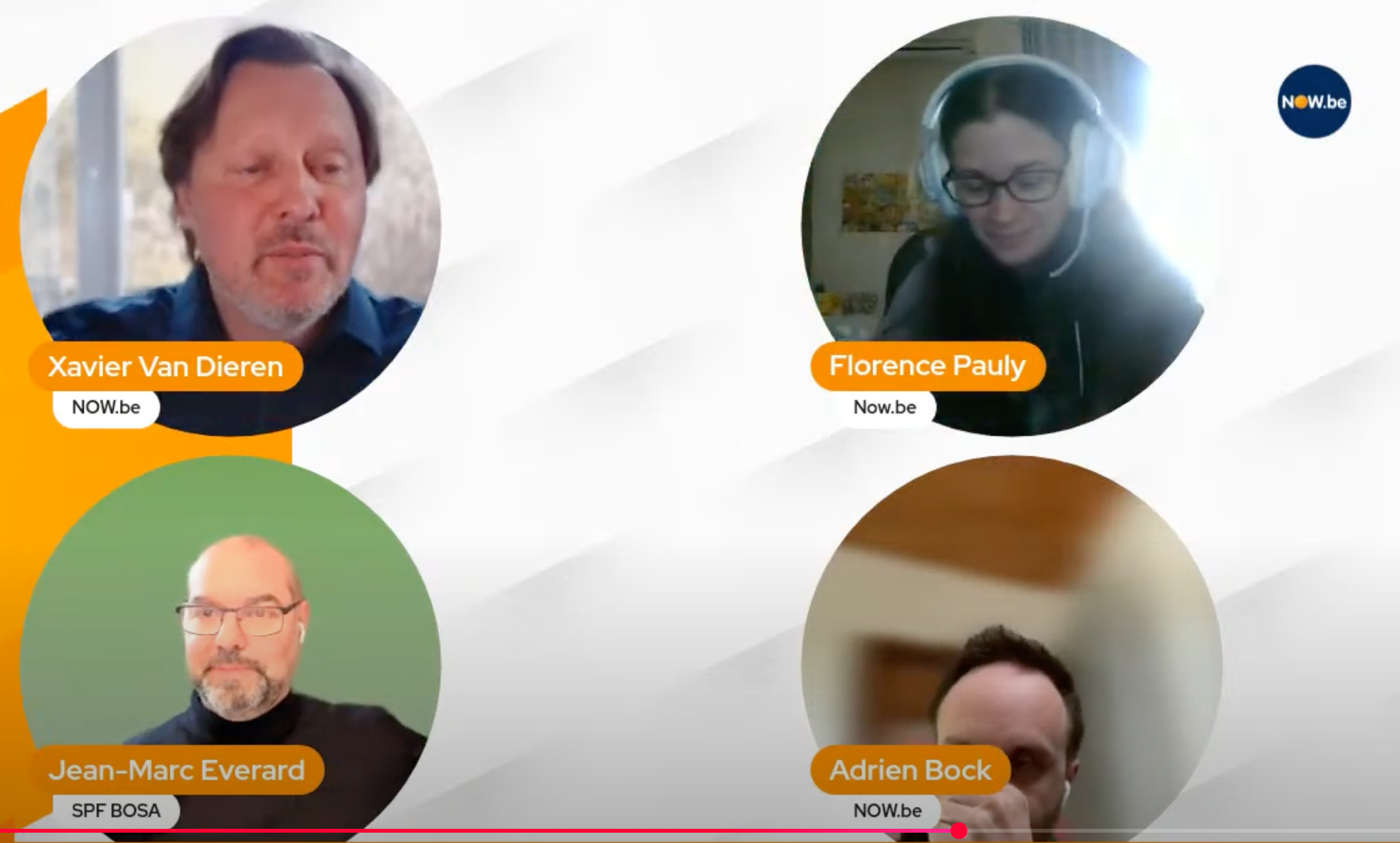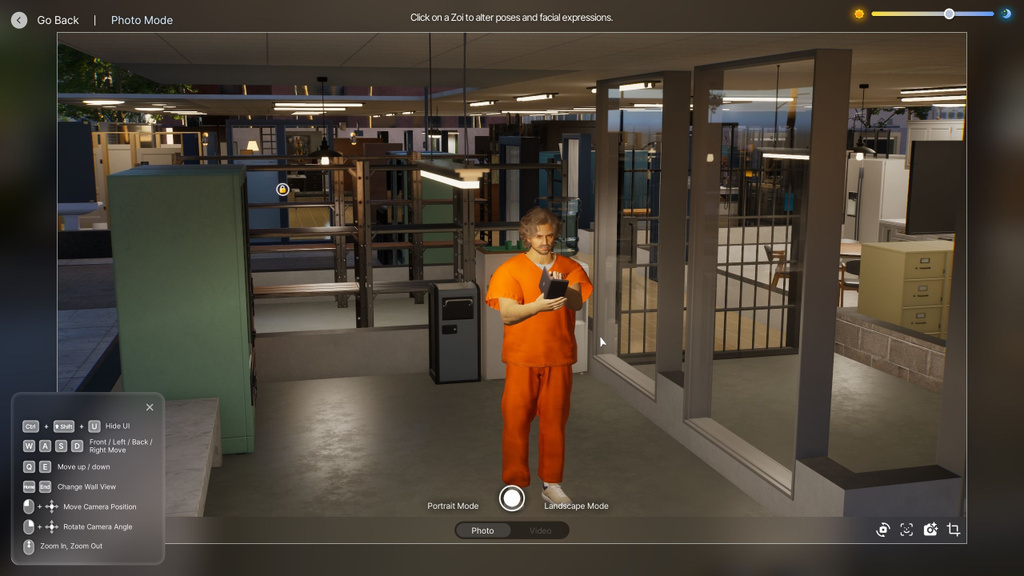Longévité : et si l’environnement et le mode de vie jouaient un rôle plus important que la génétique ?
Et si l’environnement et le mode de vie jouaient un rôle plus important que la génétique dans la longévité ? C’est ce que suggère une étude publiée dans la prestigieuse revue « Nature Medicine ».


L’environnement et le mode de vie – le statut socioéconomique, le tabagisme, le niveau d’activité physique, les conditions de vie… – jouent-ils finalement un rôle plus important que la génétique dans la longévité ? C’est ce que suggère une étude publiée dans Nature Medicine, en s’appuyant sur UK Biobank, une base de données d’environ 500 00O personnes.
L’une des interrogations les plus récurrentes que se posent les êtres humains est de savoir combien de temps ils vont vivre. En découle la question de savoir quelle part de notre durée de vie dépend de notre environnement et de nos choix et quelle part est prédéterminée par nos gènes.
Une étude récente publiée dans la prestigieuse revue Nature Medicine a tenté pour la première fois de quantifier les contributions relatives de notre environnement et de notre mode de vie, par rapport à notre génétique, dans la façon dont nous vieillissons et sur notre durée de vie.
À lire aussi : Nous héritons de la génétique de nos parents, mais quid de l’épigénétique ?
Les résultats sont frappants et suggèrent que notre environnement et notre mode de vie jouent un rôle beaucoup plus important que nos gènes dans la détermination de notre longévité.
Comment les chercheurs ont-ils procédé ?
Cette étude s’est appuyée sur les données de la UK Biobank, une grande base de données du Royaume-Uni qui contient des informations détaillées sur la santé et le mode de vie d’environ 500 000 personnes. Les données disponibles comprennent des informations sur la génétique, des dossiers médicaux, des données d’imagerie médicale et des informations sur le mode de vie.
Dans une autre partie de l’étude, ont été analysées les données issues d’un sous-ensemble de plus de 45 000 participants dont les échantillons de sang ont été soumis à ce que l’on appelle le « profilage protéomique ».
Le profilage protéomique est une technique relativement nouvelle qui étudie la façon dont les protéines du corps changent au fil du temps afin d’identifier l’âge d’une personne au niveau moléculaire. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont pu estimer à quelle vitesse le corps d’un individu vieillissait réellement. C’est ce qu’on appelle l’âge biologique, par opposition à l’âge chronologique (ou nombre d’années vécues).

Chaque mardi, le plein d’infos santé : nutrition, bien-être, nouveaux traitements… Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui.
Les chercheurs ont évalué 164 expositions environnementales ainsi que les marqueurs génétiques de maladies chez les participants. Les expositions environnementales comprenaient les choix autour du mode de vie (par exemple, le tabagisme, l’activité physique), les facteurs sociaux (comme les conditions de vie, le revenu du ménage, la situation professionnelle) et les facteurs liés au début de la vie, tels que le poids corporel pendant l’enfance.
Ils ont ensuite recherché des associations entre la génétique et l’environnement, et 22 maladies majeures liées à l’âge (telles que les maladies coronariennes et le diabète de type 2), la mortalité et le vieillissement biologique (tel que déterminé par le profilage protéomique).
Ces analyses ont permis aux chercheurs d’estimer les contributions relatives des facteurs environnementaux et génétiques au vieillissement et à la mort prématurée.
Qu’ont-ils mis en évidence ?
En ce qui concerne la mortalité liée à la maladie, comme on pouvait s’y attendre, l’âge et le sexe expliquent une part importante (environ la moitié) de la variation de l’espérance de vie. Cependant, la constatation principale est le fait que les facteurs environnementaux expliquent collectivement environ 17 % de la variation de la durée de vie, là où les facteurs génétiques y contribuent pour moins de 2 %.
Ce résultat penche très clairement du côté de l’éducation dans le débat « nature contre éducation ». Elle suggère que les facteurs environnementaux influencent la santé et la longévité d’une manière beaucoup plus importante que la génétique.
Comme on pouvait s’y attendre, l’étude a révélé une combinaison différente concernant la manière dont l’environnement et la génétique influencent respectivement différentes pathologies.
C’est sur les maladies pulmonaires, cardiaques et hépatiques que les facteurs environnement exerçaient le plus grand impact. C’est dans la détermination du risque de cancer du sein, de l’ovaire et de la prostate, ainsi que du risque de démence que la génétique jouait le rôle le plus important.
Les facteurs environnementaux qui ont eu le plus d’influence sur les décès précoces et le vieillissement biologique sont le tabagisme, le statut socioéconomique, les niveaux d’activité physique et les conditions de vie.

Le fait d’être plus grand à l’âge de 10 ans serait associé à une durée de vie plus courte. Bien que cela puisse paraître surprenant et que les raisons ne soient pas éclaircies, c’est ce qu’avançait une recherche antérieure selon laquelle les personnes plus grandes seraient plus susceptibles de mourir plus tôt. (Les résultats de cette recherche qui ne s’appuie pas sur la base de données UK Biobank sont à prendre avec précaution, ndlr).
Le fait de peser plus lourd à l’âge de dix ans et le tabagisme maternel (si votre mère a fumé en fin de grossesse ou lorsque vous étiez nouveau-né) ont également été associés à un raccourcissement de l’espérance de vie.
Le résultat le plus surprenant de cette étude est probablement l’absence d’association entre le régime alimentaire et les marqueurs du vieillissement biologique, tels que déterminés par le profilage protéomique. Cette constatation va à l’encontre du grand nombre de preuves qui montrent un rôle crucial des habitudes alimentaires dans le risque de maladie chronique et la longévité.
Les explications plausibles sont nombreuses. Premièrement, on pourrait avancer l’hypothèse d’un manque de puissance statistique dans la partie de l’étude consacrée au vieillissement biologique. En d’autres termes, le nombre de personnes étudiées était peut-être trop faible pour permettre aux chercheurs d’observer l’impact réel du régime alimentaire sur le vieillissement.
Deuxièmement, les données concernant l’alimentation, qui étaient autodéclarées et mesurées à un seul moment de l’étude, étaient probablement de qualité relativement médiocre, ce qui a limité la capacité des chercheurs à observer des associations. Enfin, la relation entre l’alimentation et la longévité étant probablement complexe, il peut être difficile de distinguer les effets de l’alimentation des autres facteurs liés au mode de vie.
Malgré ces résultats, on peut affirmer que notre alimentation est l’un des piliers les plus importants de la santé et de la longévité.
Quelles autres limites de l’étude considérer ?
Dans cette étude, les expositions clés (comme le régime alimentaire) n’ont été mesurées qu’à un seul moment et n’ont pas fait l’objet d’un suivi dans le temps, ce qui introduit des erreurs potentielles dans les résultats.
De plus, comme il s’agissait d’une étude observationnelle, nous ne pouvons pas considérer que les associations trouvées représentent des relations de cause à effet. Par exemple, le fait que la vie en couple soit corrélée à une plus grande longévité ne signifie pas qu’elle soit à l’origine de l’allongement de la durée de vie. D’autres facteurs peuvent expliquer cette association.
Enfin, il est possible que cette étude ait sous-estimé le rôle de la génétique dans la longévité. Il est important de reconnaître que la génétique et l’environnement n’agissent pas de manière isolée. Au contraire, les résultats en matière de santé dépendent de leur interaction, et cette étude n’a peut-être pas saisi toute la complexité de ces interactions.

À votre niveau, pouvez-vous agir ?
On relèvera que, dans cette étude, un certain nombre de facteurs, comme le revenu du ménage, le fait d’être ou non propriétaire de son logement et le statut professionnel, sont associés aux maladies du vieillissement alors que ces paramètres ne sont pas nécessairement contrôlables par la personne. Cela souligne à quel point il est crucial de prendre en compte les déterminants sociaux de la santé pour garantir à chacun les meilleures chances de vivre longtemps et en bonne santé.
En même temps, ces résultats envoient un message encourageant : la longévité est largement déterminée par les choix que nous faisons. C’est une excellente nouvelle, à moins que vous n’ayez de bons gènes et que vous espériez qu’ils fassent le gros du travail.
Finalement, les résultats de cette étude renforcent l’idée selon laquelle si nous pouvons hériter de certains risques sur le plan génétique, la façon dont nous mangeons, dont nous nous déplaçons et dont nous nous engageons dans le monde semble être plus importante pour déterminer notre état de santé et notre durée de vie.![]()
Hassan Vally ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.































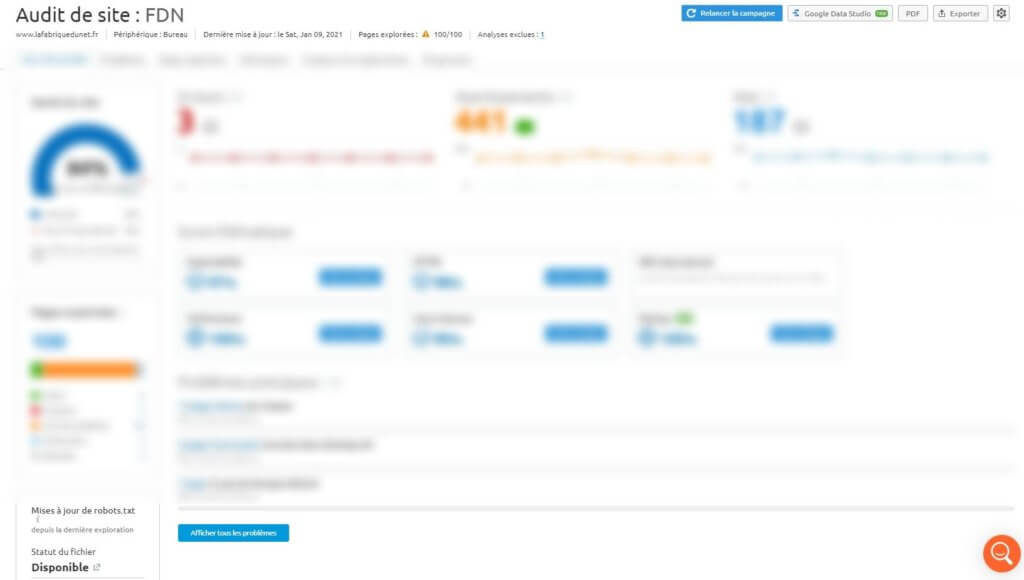






/2025/04/16/robert-doisneau-une-restropective-sur-la-carriere-du-photographe-au-musee-maillol-a-paris-68001259be33b976784690.jpg?#)


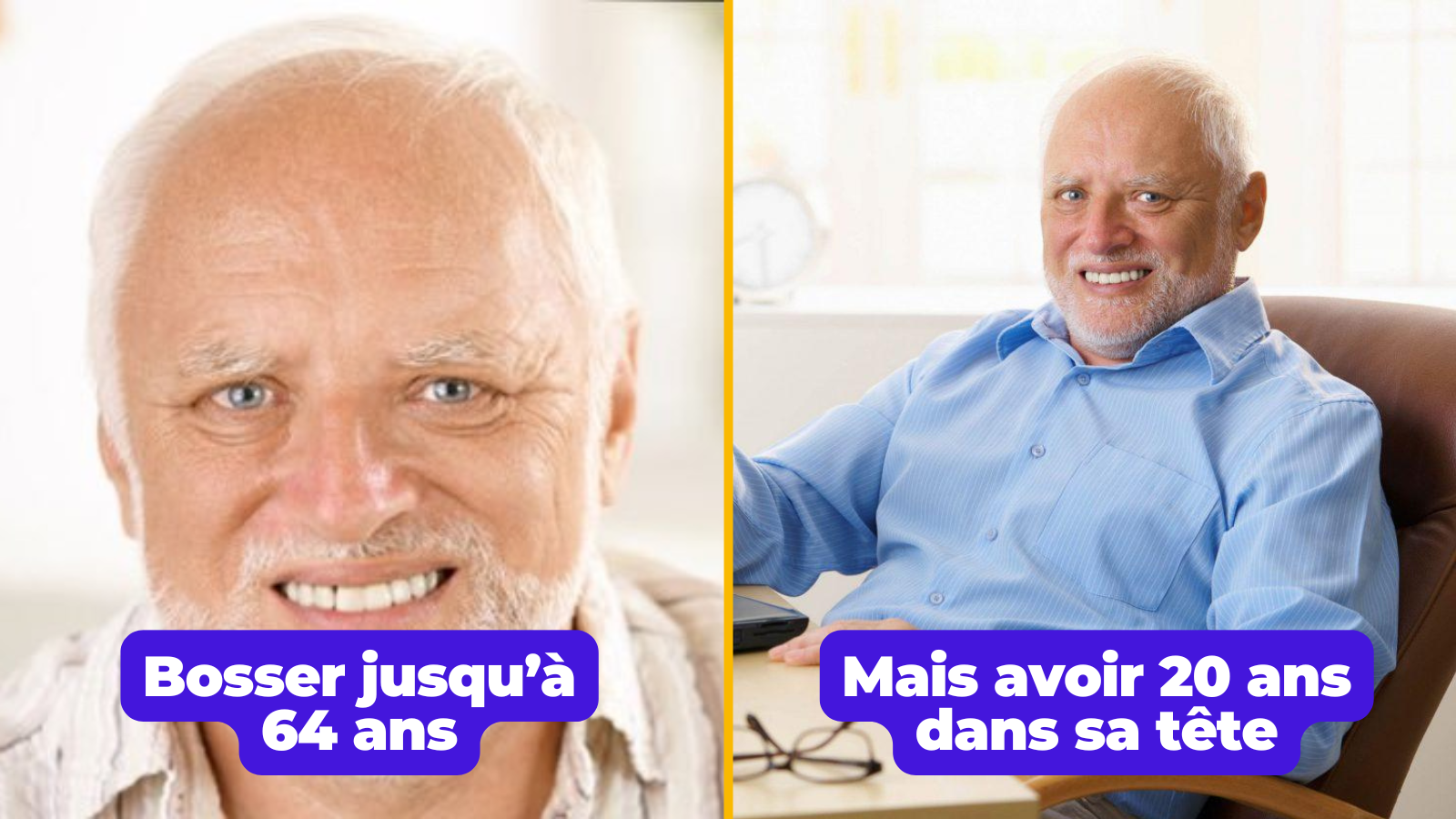

/2025/04/16/sinners-67ff0131c50a3707909745.webp?#)


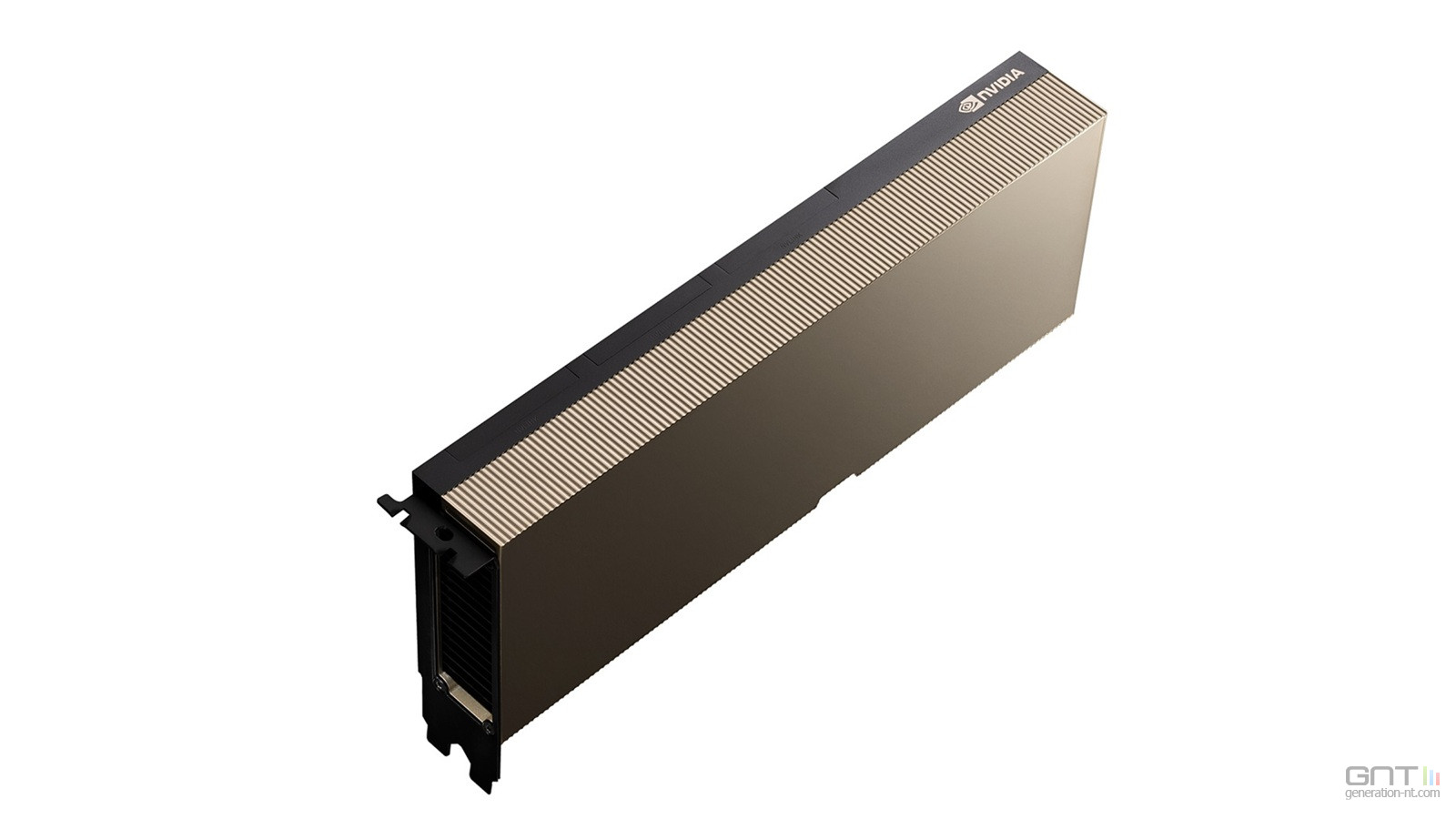







![“Un coup de rabot sur MaPrimeRénov’ en 2026 est une quasi certitude” [GPCEE]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2023/01/CEE.png)