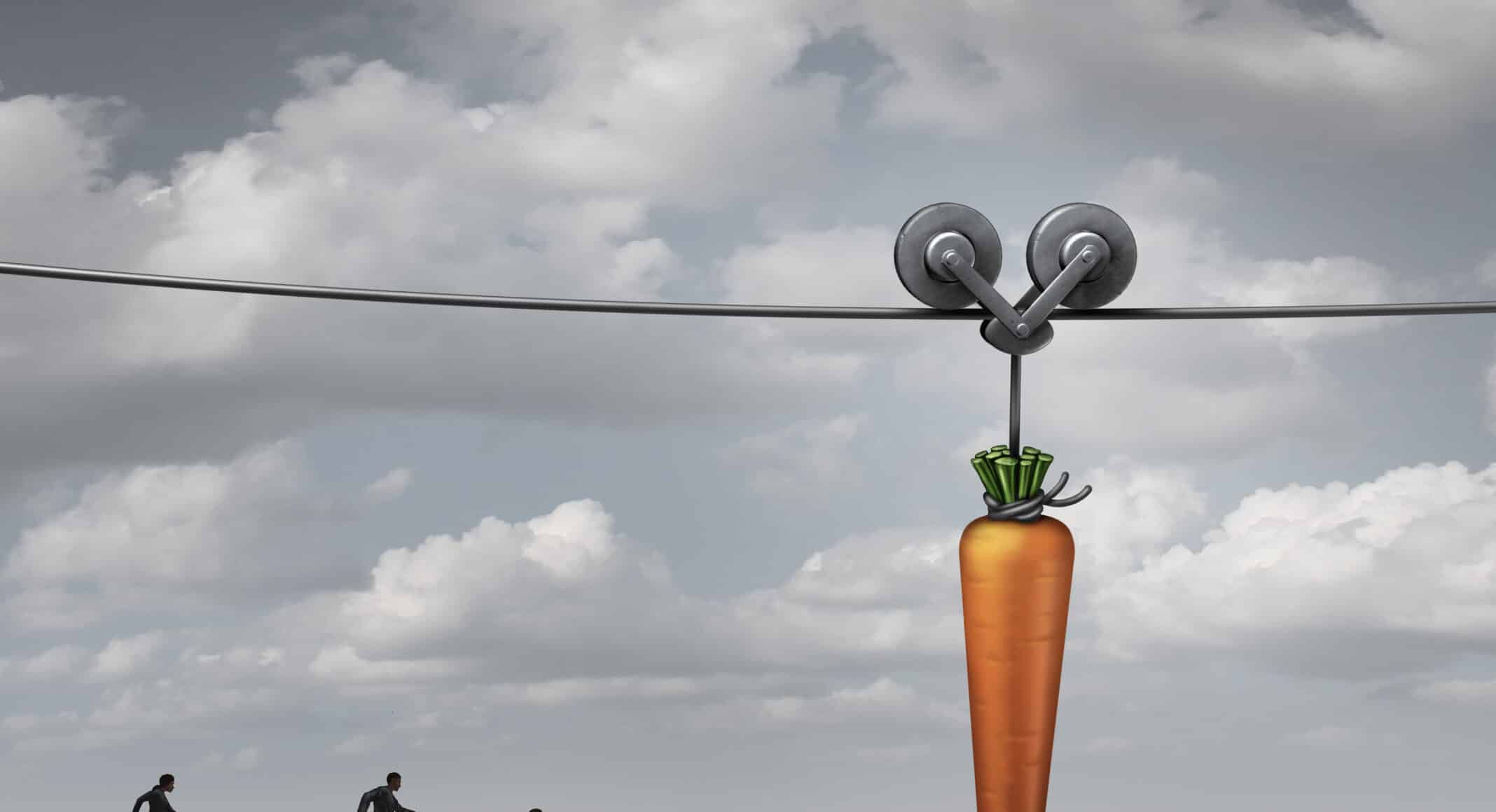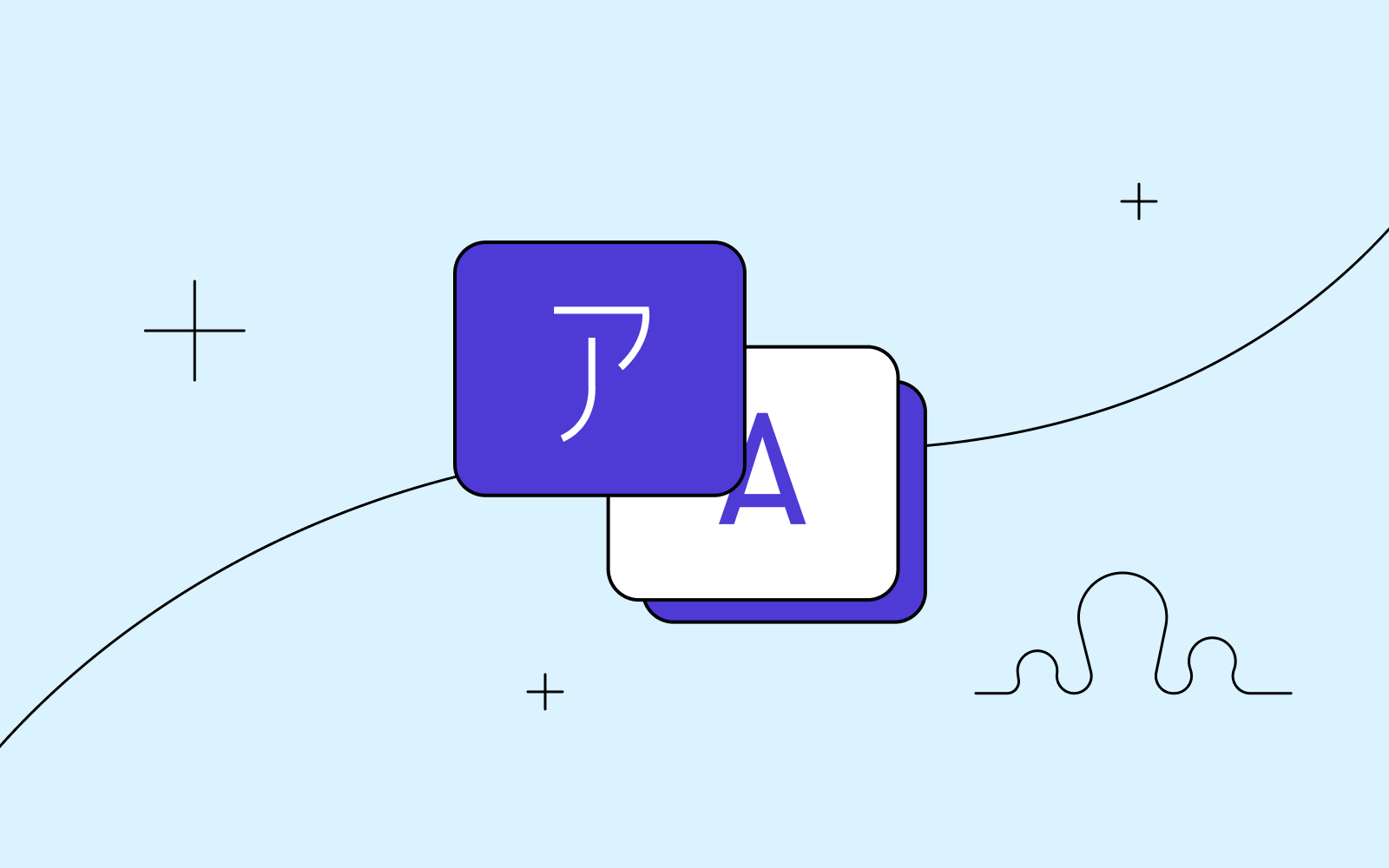Violences sexistes et sexuelles dans la culture : « Mon audition à l’Assemblée nationale »
La chercheuse Marie Buscatto a été auditionnée par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture.


Que se passe-t-il pour nos auteurs après la parution d’un article ? Depuis janvier 2025, The Conversation France répertorie les impacts de ses publications sur la société. Voici l’exemple de Marie Buscatto, professeure de sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-autrice d’un article sur les violences sexistes et sexuelles à l’Opéra, paru en mars 2024. Le 16 décembre 2024, la chercheuse a été convoquée pour être auditionnée par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité.
Le 9 avril 2025, le rapport très sévère de cette commission d’enquête a été présenté par ses deux rapporteurs, Sandrine Rousseau et Erwan Balanant. L’occasion de revenir sur les événements qui ont amené Marie Buscatto jusqu’au Parlement, pour y présenter les conclusions de ses travaux de recherches.
The Conversation : Que s’est-il passé après la publication de votre article sur notre site, en mars 2024 ?
Marie Buscatto : En collaboration avec mes collègues Ionela Roharik (EHESS) et la chanteuse lyrique Soline Helbert (pseudonyme), nous avons mené une enquête empirique dans le monde de l’opéra, dont les principaux résultats ont été relayés par The Conversation. L’article, publié le 6 mars 2024, a eu un fort impact médiatique : j’ai été interviewée sur France Musique et Radio Classique, ainsi que par l’AFP, par la Croix, par 20 Minutes ou encore par le Canard enchaîné. Notre objectif principal était alors de rendre les résultats de notre recherche accessibles au grand public afin de nourrir le débat sur un sujet difficile et brûlant. Et même si je n’en ai aucune preuve, je pense que l’écho médiatique suscité par cet article paru dans The Conversation a été premier dans l’invitation que j’ai reçue.
Cela est d’autant plus remarquable que l’audition à laquelle j’ai participé était la seule où figuraient des universitaires, toutes les autres auditions étant consacrées à des personnes évoluant dans les secteurs concernés.
T. C. : Quelle était la teneur de cet article, dont vous avez rendu compte lors de votre audition ?
M. B. : Lors de notre enquête, l’Opéra est apparu comme un monde professionnel propice à la mise en œuvre de violences sexistes et sexuelles, où règnent à la fois une forte précarité, beaucoup d’incertitude professionnelles, une hypersexualisation des chanteuses, la prépondérance des capacités de séduction physique dans les critères de recrutement et dans les interactions sociales et une tolérance des personnels vis-à-vis de ce qu’on a appelé les dérives des grands noms du spectacle.
Nombreux sont les éléments structurels participant ainsi à produire et à légitimer « un continuum » de violences sexistes et sexuelles récurrentes. En outre, ces violences font l’objet de faibles niveaux de dénonciation et affectent les carrières des femmes artistes, techniciennes et gestionnaires.
T. C. : Estimez-vous, comme la commission d’enquête, qu’il manque des statistiques fiables dans les secteurs visés, depuis l’enquête Virage de 2015 sur les violences et rapports de genre (Ined) ?
M. B. : C’est ce que j’ai indiqué au moment de l’audition, et cela a en effet été repris dans la recommandation 11 du rapport de la commission : nous manquons cruellement de recherches universitaires de qualité menées par des chercheurs, des chercheuses expérimentées sur ce sujet, et ce, faute de financement par les institutions publiques. Notre recherche sur l’Opéra est pionnière et devrait être suivie de recherches dans tous les secteurs artistiques pour nourrir l’analyse et l’action de manière appropriée. Ces recherches qualitatives devraient être complétées par des statistiques fiables menées par des organismes compétents.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
T. C. : Comment avez-vous vécu votre travail avec notre rédaction ?
M. B. : La collaboration a été très enrichissante et fructueuse. Nos échanges ont permis la rédaction d’un article qui, tout à la fois, préserve l’essentiel de notre démarche et de nos résultats et reste accessible aux personnes désireuses de prendre connaissance de nos travaux scientifiques.
T. C. : Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?
M. B. : En lien avec cette première enquête empirique, et en collaboration avec mes collègues Mathilde Provansal (Université de Ludwig-Maximilians, Munich, Allemagne) et Sari Karttunen (Center for Cultural Policy Research-Cupore, Helsinki, Finlande), nous préparons la publication d’un ouvrage scientifique en anglais rassemblant des cas empiriques portant sur les violences de genre dans les arts et la culture en France, au Japon, aux États-Unis, en Finlande et en Angleterre.
Les principales conclusions tirées de ces travaux prolongent, approfondissent et généralisent les premiers résultats tirés de notre enquête à l’Opéra et feront peut-être l’objet d’une nouvelle publication dans The Conversation en juin 2025, au moment de la sortie de l’ouvrage.
Entretien réalisé par Tatiana Kalouguine.
Chez The Conversation, nous considérons que la recherche éclaire le monde et qu’elle peut aussi contribuer à le transformer. Pour cette raison, nous mesurons désormais les répercussions concrètes de nos publications sur la société, la politique, la recherche. En janvier 2025 est paru le premier rapport d’impact de The Conversation France.![]()
Marie Buscatto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.





















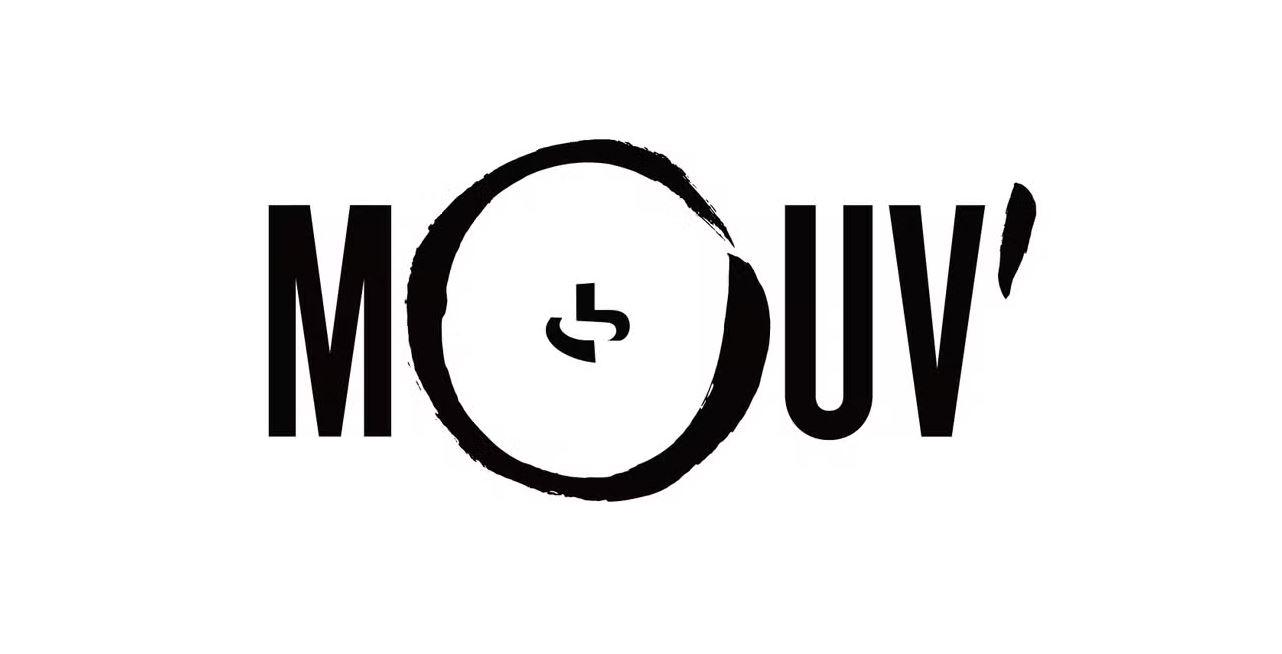


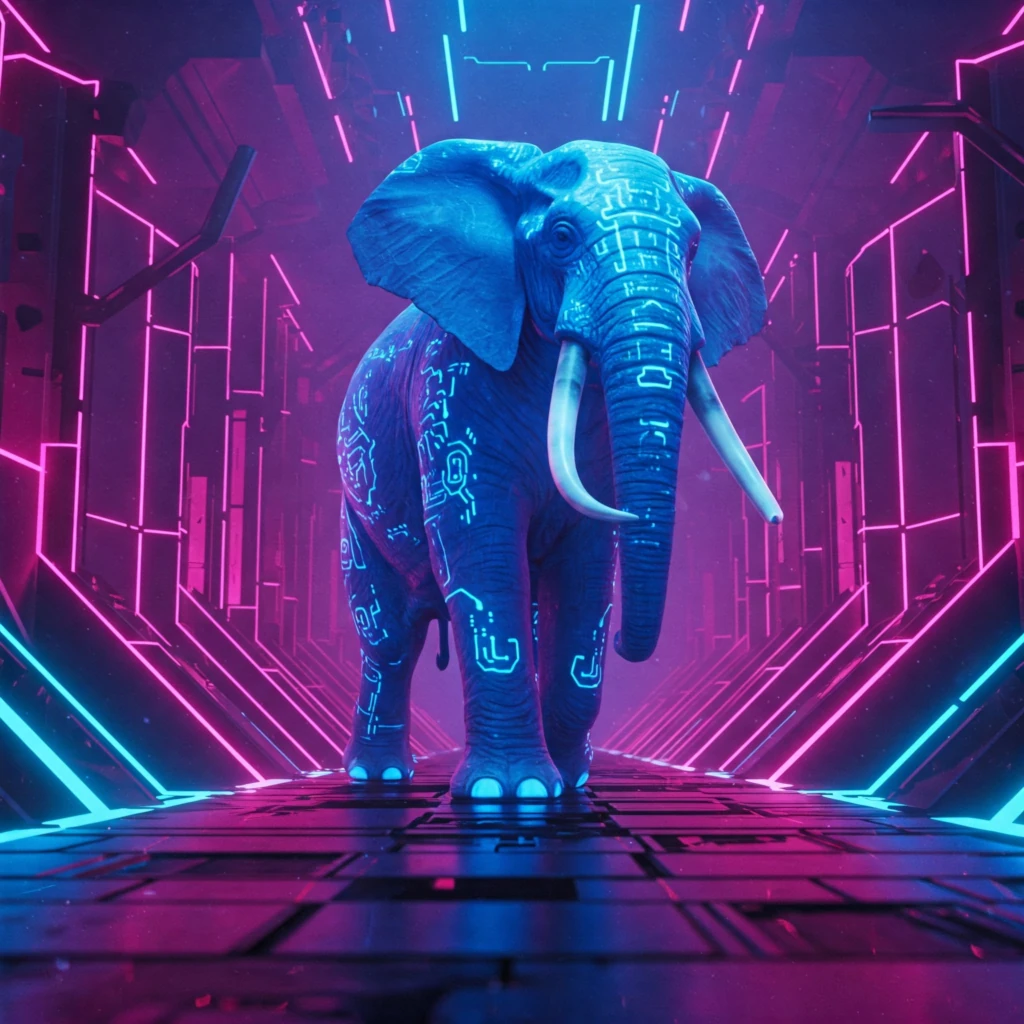

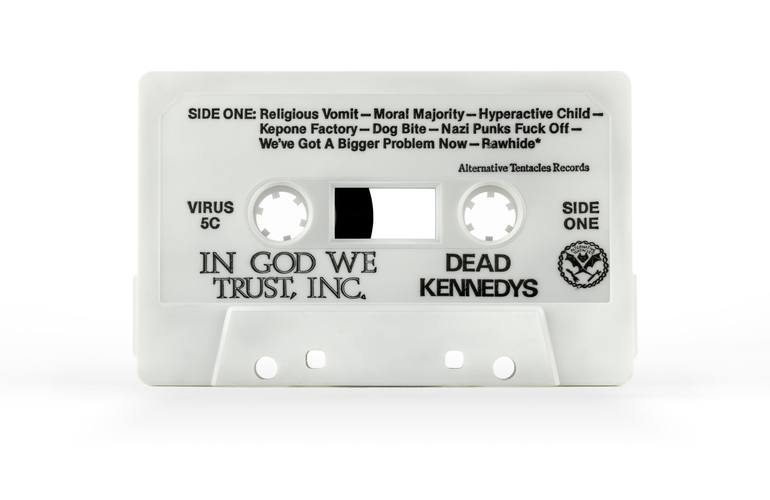














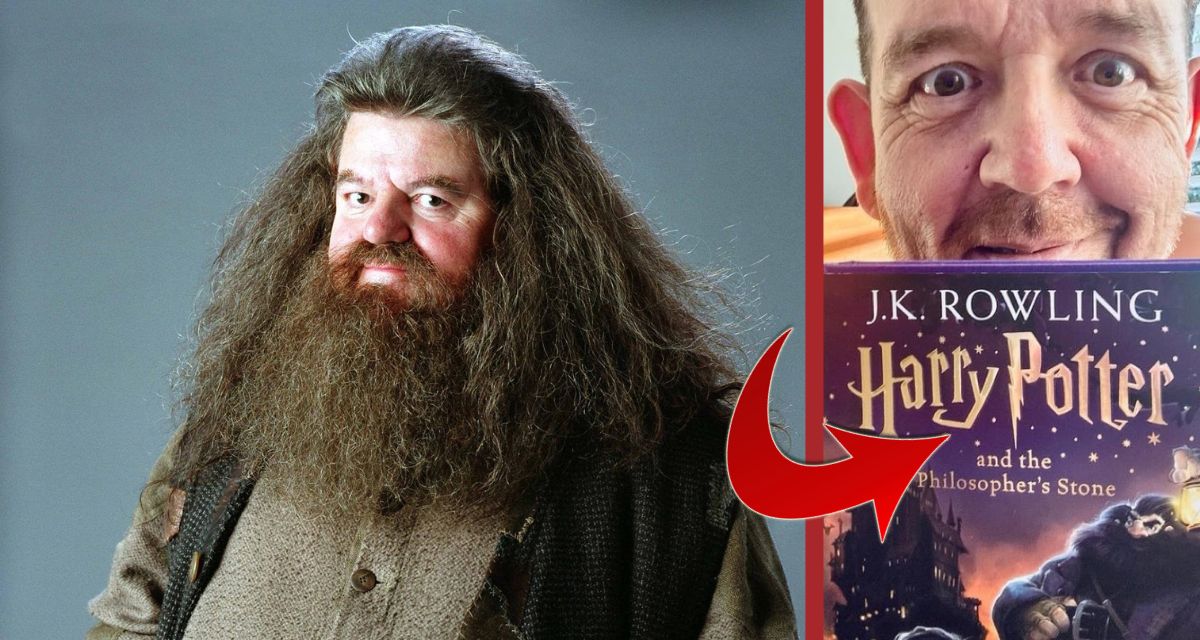

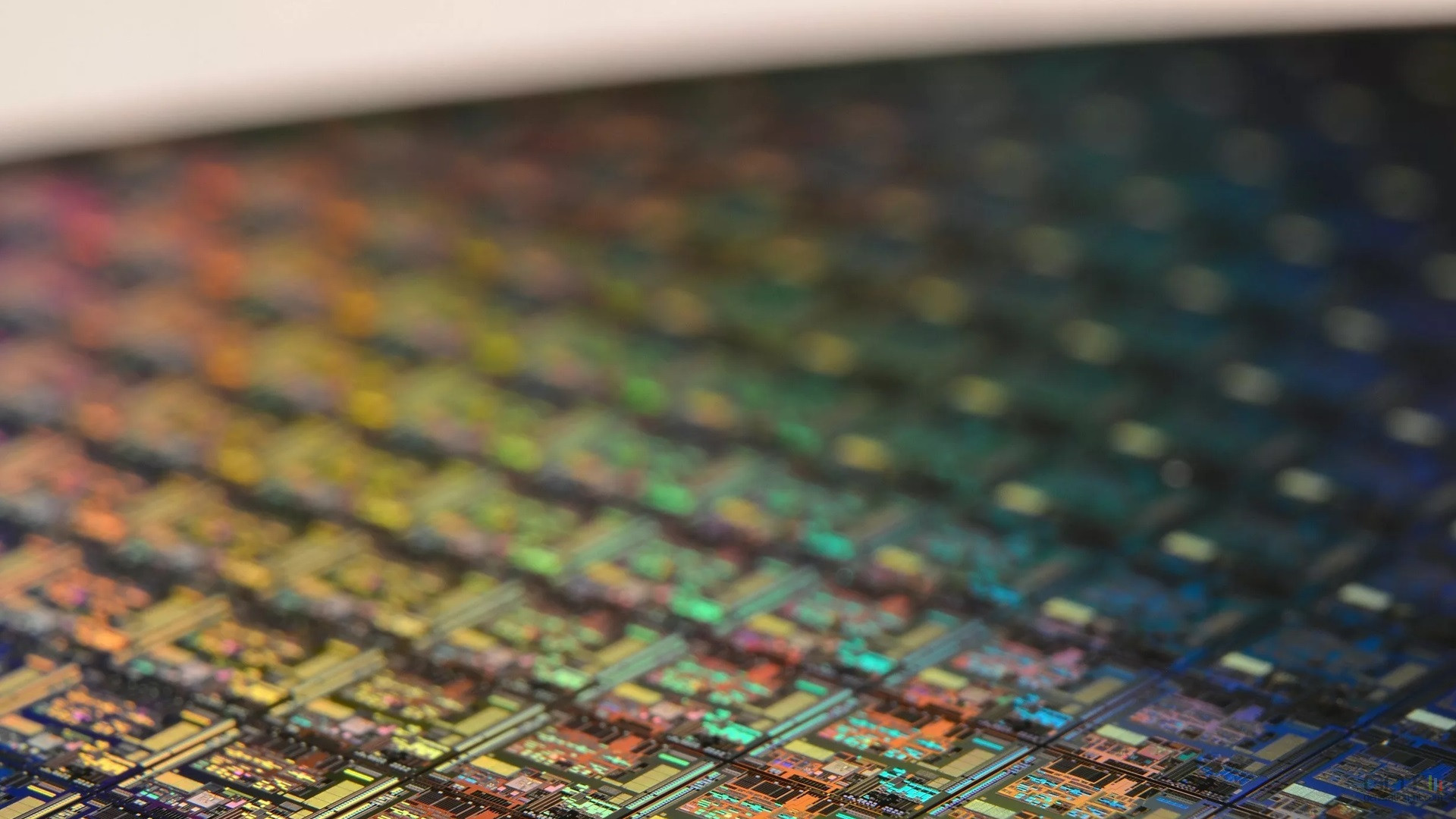


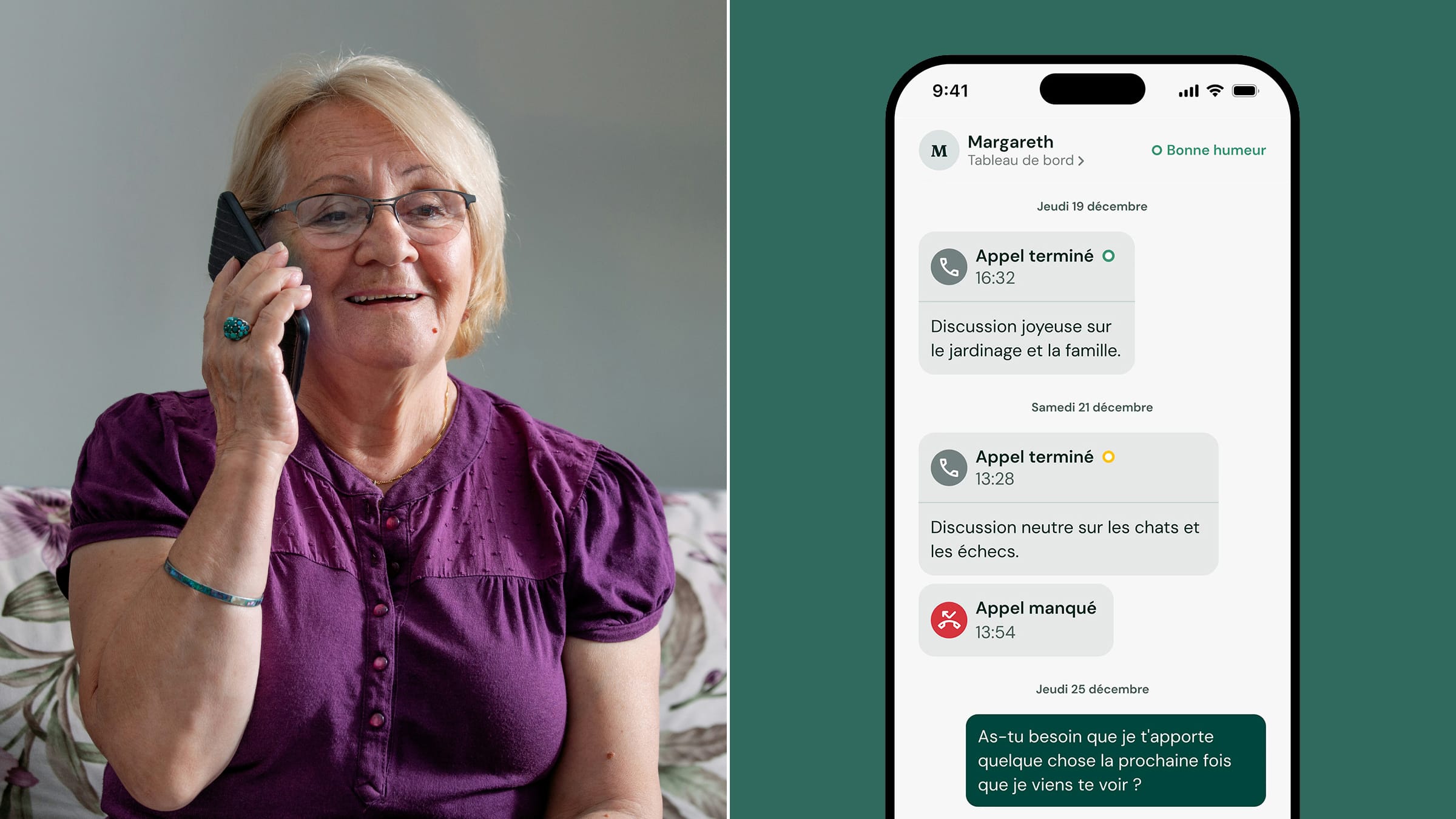


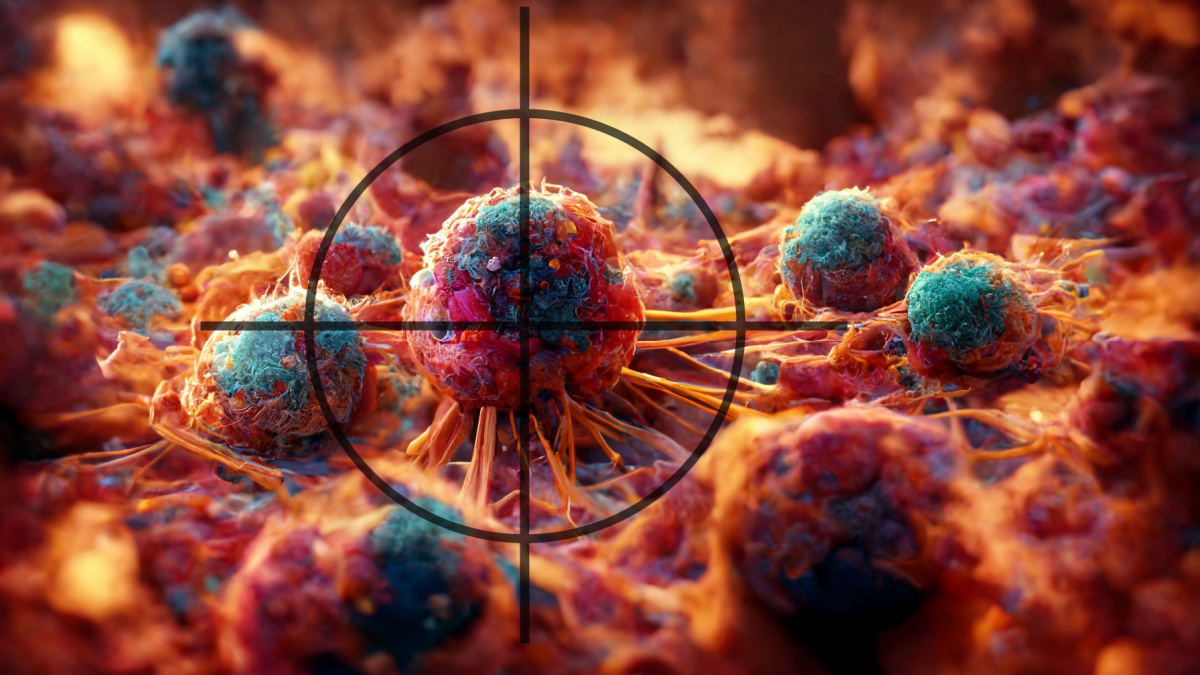


/2023/10/05/univ-651e44b12fbef351532354.jpg?#)
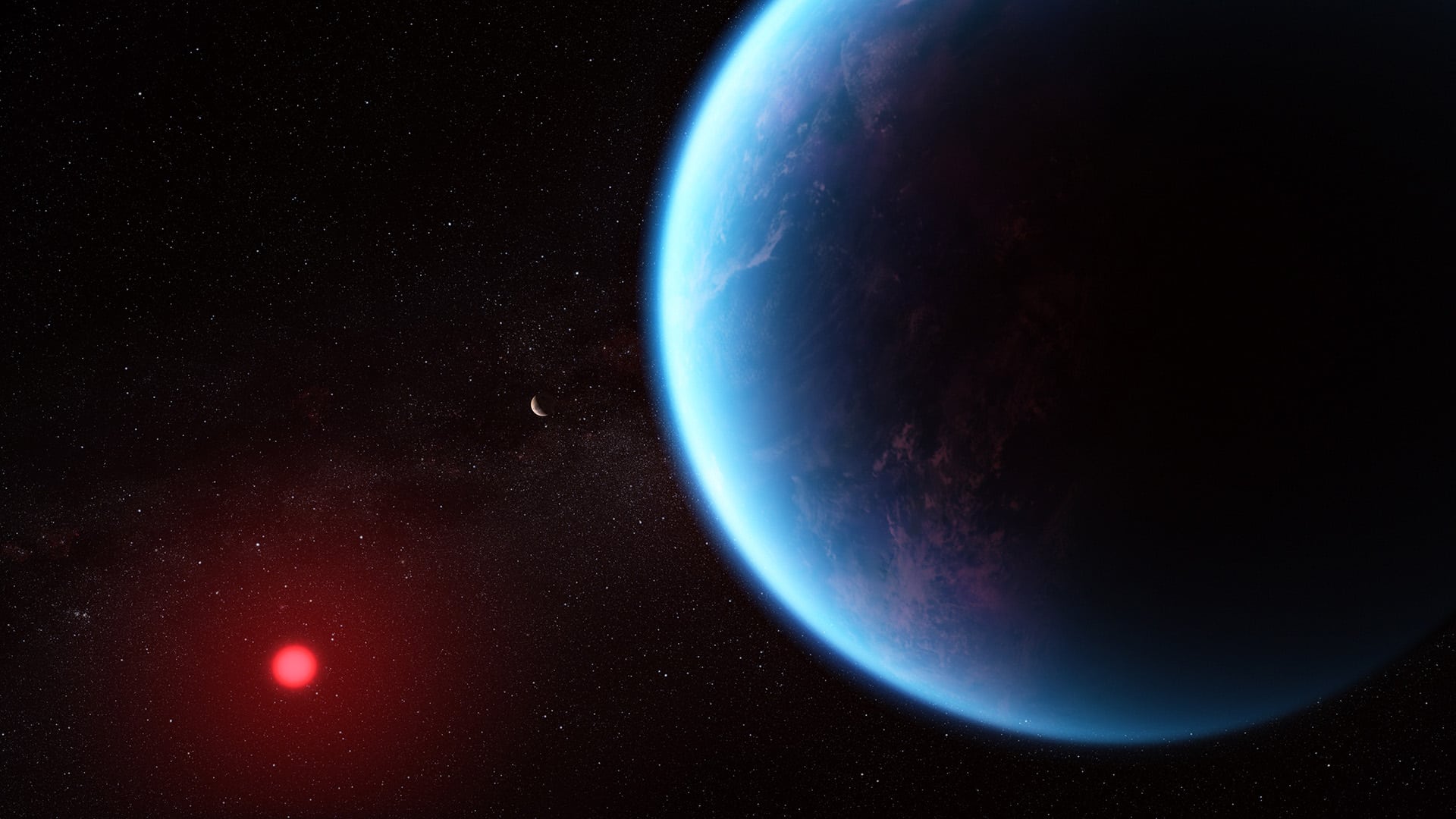
![« La tendance n’est pas à une dégradation des conditions financières » [Société Générale]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/04/image-13.png)