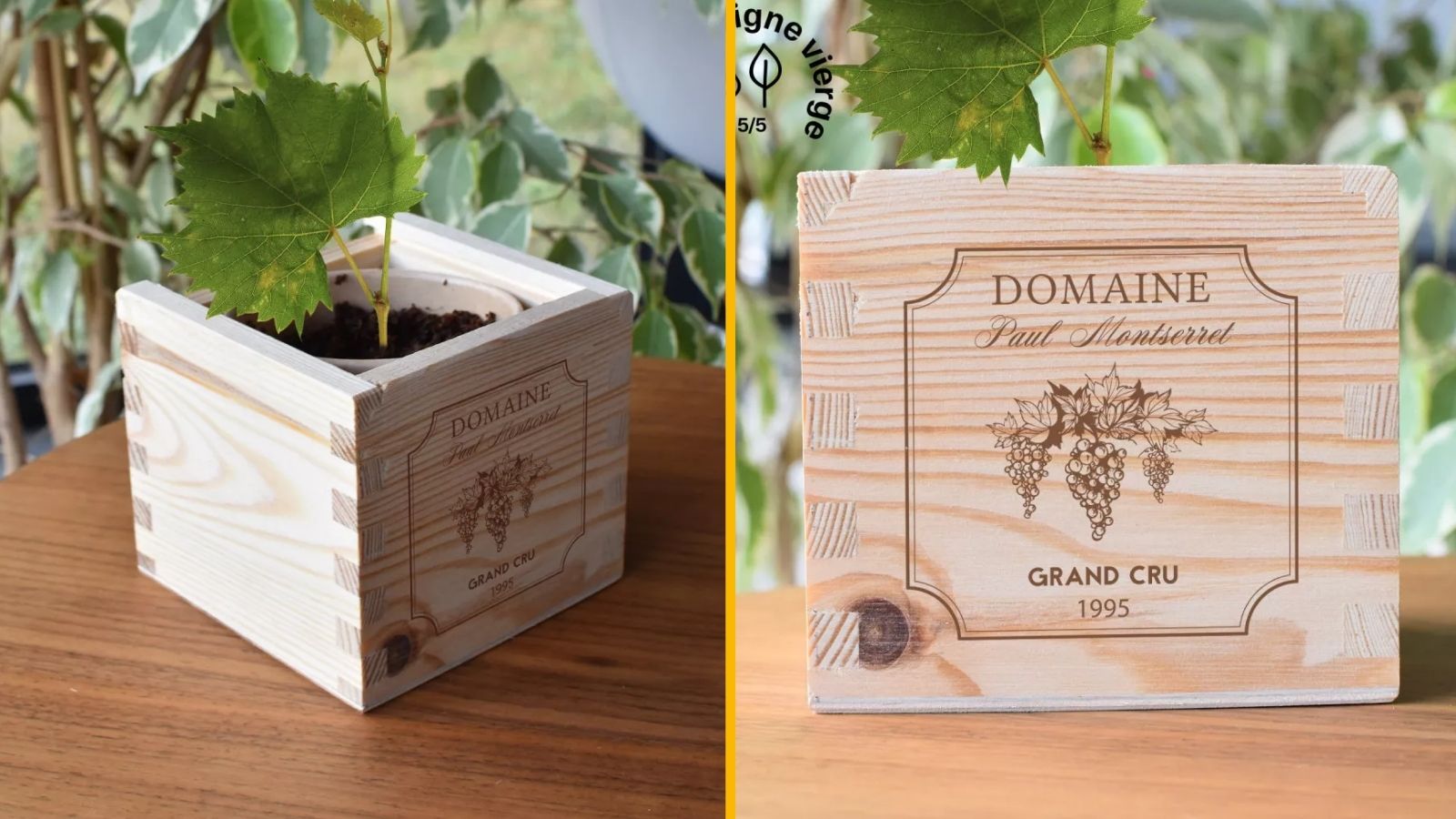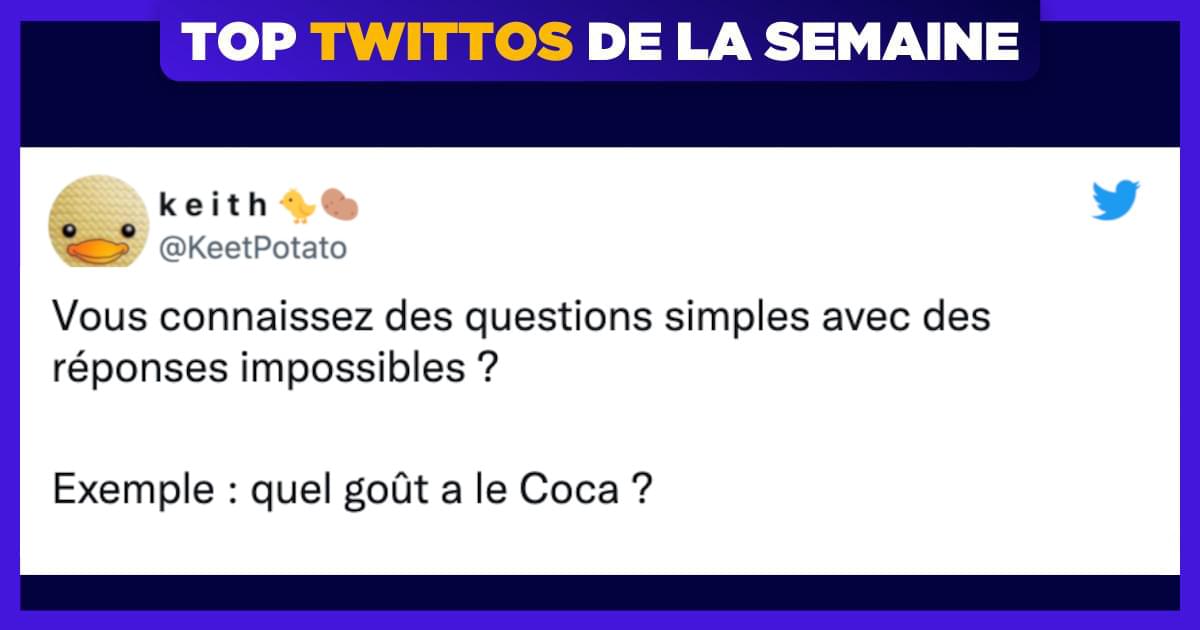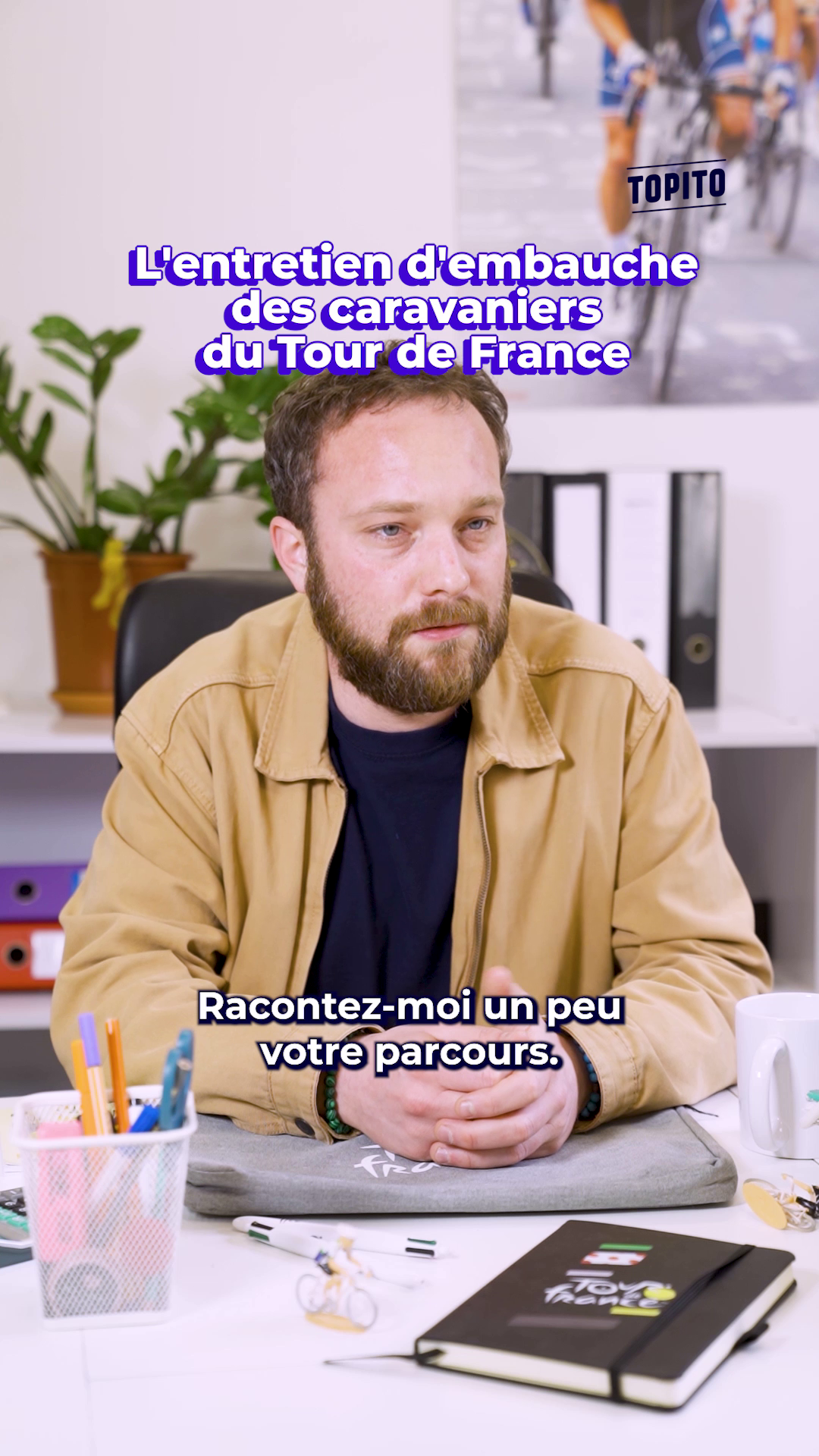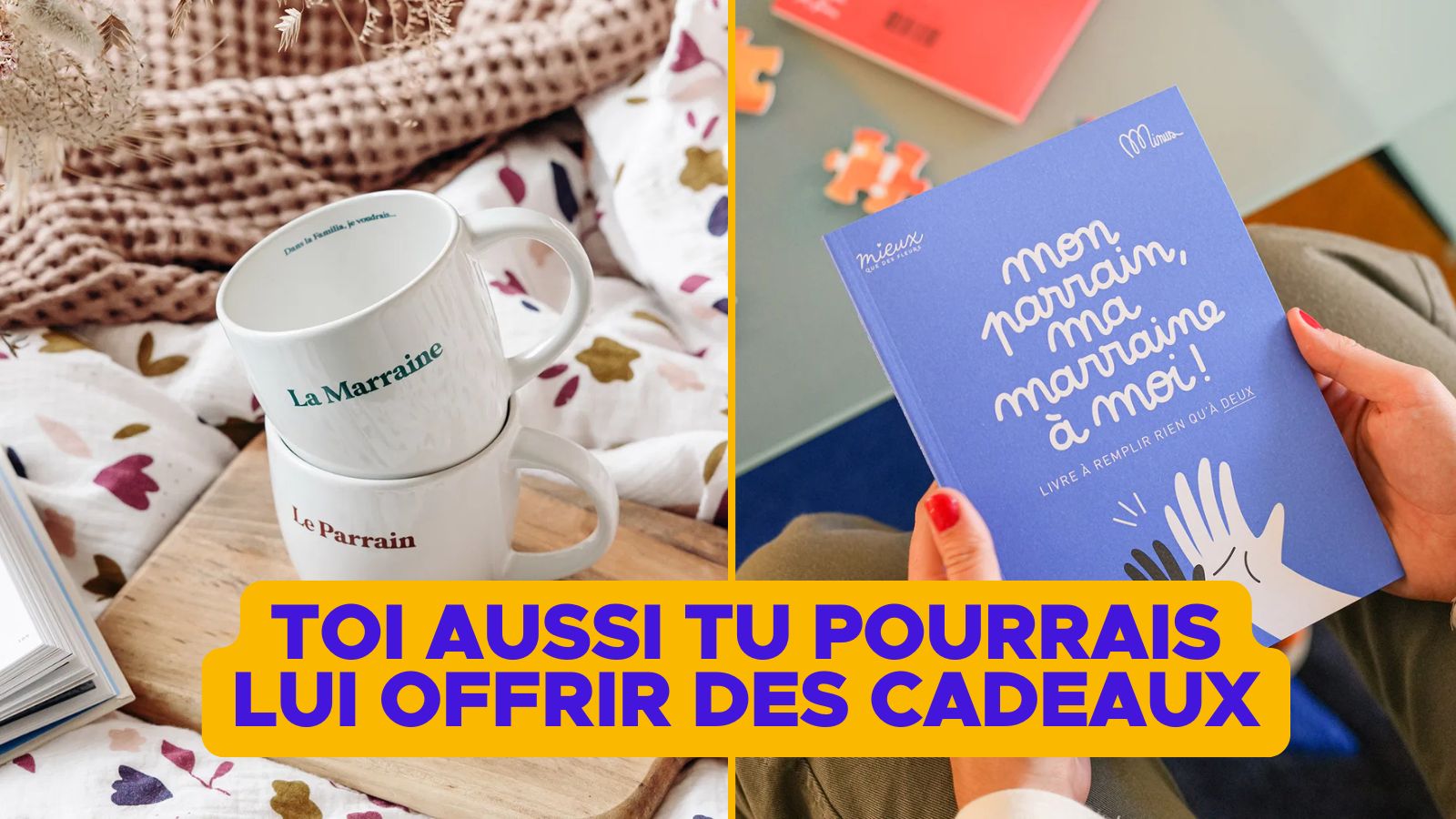Trump contre la liberté académique : les juges, derniers remparts contre l’assaut autoritaire
Donald Trump multiplie les attaques contre l’éducation et l’enseignement supérieur, portant directement atteinte à la liberté académique des universitaires. Les juges peuvent-ils protéger l’État de droit ?

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump multiplie les executive orders, sortes d’« ordonnances » ou de « décrets », contre l’éducation et l’enseignement supérieur, portant directement atteinte à la liberté académique des universitaires. En quoi ces attaques sont-elles inédites ? De quelles ressources les universitaires disposent-ils pour se défendre ?
Le début du deuxième mandat de Donald Trump a été marqué par une série de décisions portant directement atteinte à la liberté académique dont jouissent traditionnellement les universitaires américains.
Plusieurs interrogations émergent alors, allant de l’autorité compétente pour réglementer l’enseignement supérieur et la recherche aux États-Unis, aux sources de la liberté académique, en passant par la façon dont les juges américains peuvent la protéger.
Qui est compétent pour réguler l’enseignement supérieur et la recherche aux États-Unis ?
L’enseignement supérieur et la recherche ne font pas partie des compétences que la Constitution des États-Unis confère expressément à l’État fédéral. En application du dixième amendement, ces domaines relèvent alors du pouvoir des États.
Cela ne signifie pas pour autant que les pouvoirs centraux ne puissent jouer aucun rôle en la matière. Le pouvoir législatif fédéral est d’abord en mesure de décider de l’ampleur des fonds fédéraux accordés à l’enseignement supérieur et à la recherche grâce à la « clause des dépenses » dont bénéficie le Congrès (article 1 de la Constitution).
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Le pouvoir exécutif peut ensuite agir sur l’enseignement supérieur et la recherche par le biais d’agences ou de départements fédéraux qui disposent de compétences partielles en la matière. Créé en 1979, le département de l’éducation a par exemple pour rôle de « garantir l’accès à l’égalité des chances en matière d’éducation », ce qu’il fait par l’allocation d’aides financières aux étudiants.
De même, la National Science Fondation (NSF), qui a inspiré la France pour la création de l’Agence nationale de la recherche (ANR), subventionne largement la recherche états-unienne. C’est notamment en adoptant des mesures touchant à ces organismes fédéraux que l’administration Trump parvient actuellement à agir sur l’enseignement supérieur et la recherche, mais aussi, parfois, en s’affranchissant des règles constitutionnelles de répartition horizontale et verticale des compétences.
Quelles sont les atteintes actuellement portées à la liberté académique aux États-Unis ?
Même si le phénomène n’est pas nouveau et que différents États états-uniens – à l’instar de la Floride – ont déjà largement remis en cause la liberté académique depuis plusieurs années, il s’est amplifié depuis la réélection de Donald Trump. Ce dernier multiplie en effet les executive orders, sortes « d’ordonnances » ou de « décrets », qui sont adoptés directement par le président sans aucun contreseing.
L’un des plus récents, daté du 20 mars dernier, impose au secrétaire à l’éducation de tout mettre en œuvre pour fermer son département, lequel alors ne pourrait plus jouer son rôle essentiel en matière d’égalité des chances. Un autre executive order, du 20 janvier 2025, suspend l’aide étrangère au développement des États-Unis, ce qui a conduit l’Université Johns-Hopkins à supprimer 2 200 emplois à travers le monde.
D’autres décisions interfèrent avec le contenu même des enseignements et des recherches, comme les deux ordonnances imposant de renoncer aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) ou celle visant à « défendre les femmes contre l’extrémisme des idéologues de genre » qui contraint les agences fédérales à retirer toutes les communications qui feraient la promotion ou qui inculqueraient « l’idéologie du genre ».
C’est en exécution de cette ordonnance que l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé (Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ) aurait supprimé d’un site internet un article scientifique de deux professeurs de médecine de Harvard.
À lire aussi : Aux États-Unis, des licenciements massifs avant un démantèlement du ministère de l’éducation ?
En dehors de ces executive orders, les atteintes à la liberté académique peuvent être plus ciblées et concerner des établissements en particulier. C’est ainsi que l’administration de Donald Trump a menacé l’Université de Columbia de suspendre ou d’annuler le versement de fonds fédéraux si elle ne se conformait pas à certaines exigences, comme celle d’engager des poursuites disciplinaires contre les étudiants impliqués dans les manifestations propalestiniennes.
Quand bien même ces injonctions sont manifestement contraires à l’autonomie des universités, l’établissement new-yorkais y a en partie cédé, ainsi qu’en témoigne la publication sur son site internet d’un document recensant toutes les mesures adoptées à la suite de la mise en garde présidentielle. Ces atteintes récentes à la liberté académique nécessitent de s’intéresser à la façon dont elle est protégée aux États-Unis.
Comment la liberté académique est-elle protégée aux États-Unis ?
Comme en France, la liberté académique ne bénéficie d’aucun fondement constitutionnel écrit. Et si la Cour suprême a affirmé en 1967, dans l’affaire Keyishian v. Board of Regents,, qu’elle constituait une « préoccupation particulière du Premier Amendement », les effets de cette jurisprudence isolée sont loin d’être évidents. C’est pourquoi les universitaires préfèrent souvent invoquer la liberté d’expression « de droit commun ».
Une telle situation n’est pas idéale dès lors que la portée du premier amendement, sur lequel repose cette liberté d’expression « de droit commun », est limitée. Il ne s’applique en effet qu’aux mesures émanant des autorités et personnes publiques : il n’est contraignant que pour les universités publiques, et non pour les universités privées.
Les universitaires travaillant au sein d’institutions privées ne sont pas pour autant dépourvus de toute protection. En premier lieu, le premier amendement encadre toutes les mesures étatiques, qu’elles visent les universités publiques ou les universités privées. Il est ainsi toujours possible pour un universitaire d’une institution privée de contester la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret présidentiel qui porterait atteinte à sa liberté d’expression.
En second lieu, les universitaires des établissements privés sont généralement protégés par leur contrat de travail puisque leurs « livrets » (personal manual ou handbook) peuvent comprendre des clauses protégeant la liberté académique, lesquelles reprennent souvent le contenu de la déclaration de l’American Association of University Professors (AAUP) de 1940 sur la liberté académique.
Cette association professionnelle, comme d’autres aux États-Unis, est extrêmement importante dans la défense de la liberté académique, en particulier en raison du rôle qu’elle joue devant les juridictions. Elle peut en effet déposer des amicus brief qui permettent de développer un argumentaire juridique de soutien aux universitaires. C’est ce qu’illustrent différents recours actuellement pendant devant les juridictions américaines.
Sur quels fondements les ordonnances de Donald Trump peuvent-elles être contestées en justice ?
Face aux décisions insensées de Donald Trump, les juges états-uniens apparaissent comme le dernier rempart à même de protéger l’État de droit. C’est ainsi que les recours contre ses executive orders se multiplient, sans que, pour les raisons évoquées ci-dessus, la protection de la liberté académique soit l’argument juridique privilégié.
D’autres moyens, davantage en mesure d’emporter l’adhésion des juges, sont invoqués, comme la méconnaissance de la « clause des dépenses » ou la violation de la liberté d’expression. C’est ainsi que l’AAUP, avec d’autres personnes morales, a obtenu la suspension temporaire d’une partie des décrets « DEI » par un juge du district du Maryland : ce dernier a notamment relevé que les plaignants avaient suffisamment démontré qu’ils avaient des chances de succès au fond en ce qui concerne la violation de la liberté d’expression protégée par le premier amendement.
D’autres affaires sont actuellement pendantes qui n’ont encore donné lieu à aucune décision de justice, comme le recours, fondé sur la violation du premier amendement, des deux professeurs de médecine de Harvard contre la décision de censurer leur article.![]()
Camille Fernandes ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








































/2025/04/03/affiche-expo-matisse-et-marguerite-67ee916901dd4316448105.jpg?#)

/2025/04/04/063-2162603813-67f04d16a75ea861220273.jpg?#)
/2025/04/04/culture-l-histoire-de-l-indemodable-chaise-pliante-67f04440cd7c9176305715.jpg?#)
/2025/04/04/sipa-shutterstock40721796-000003-67f0323a4c4d7352140716.jpg?#)