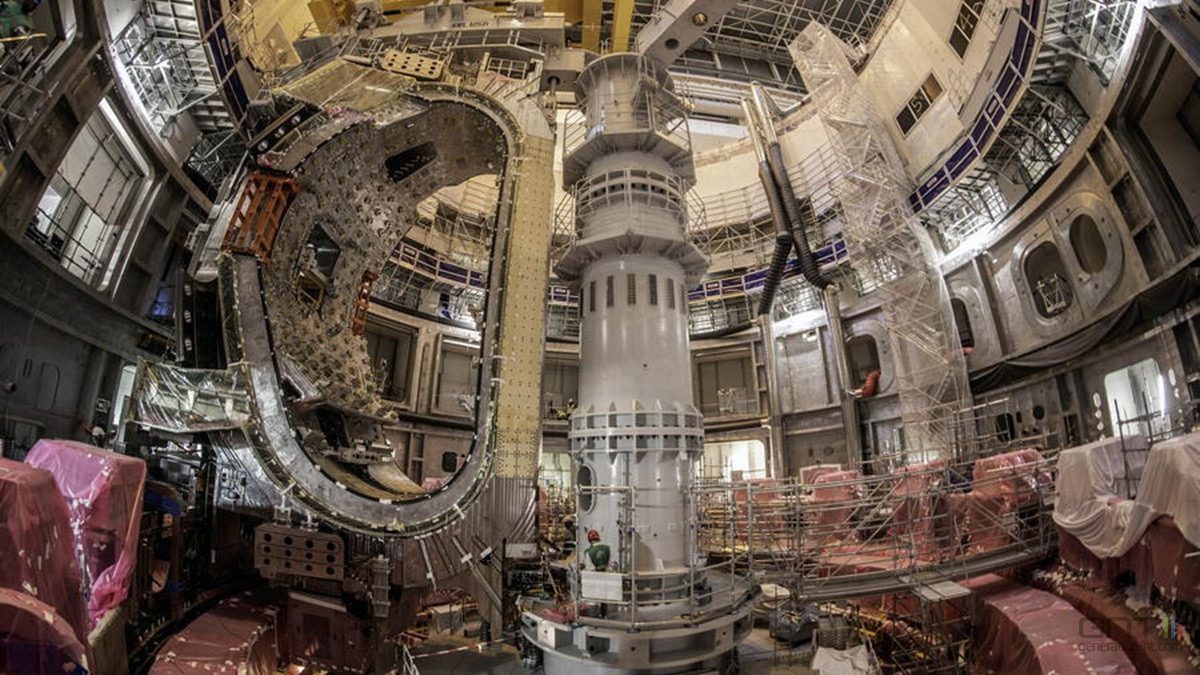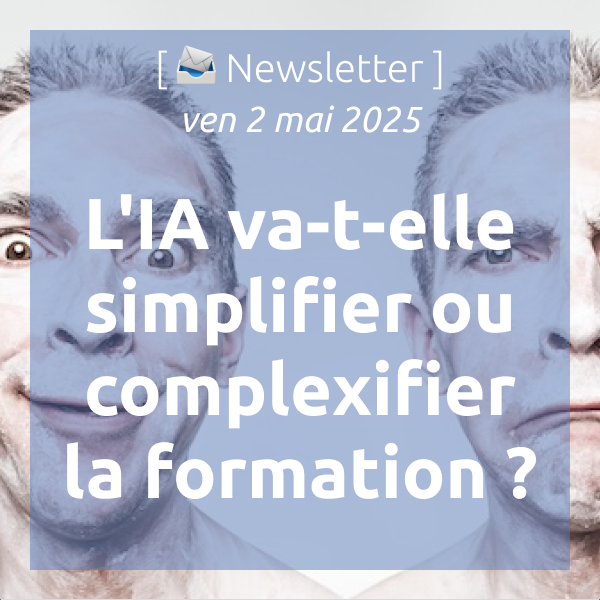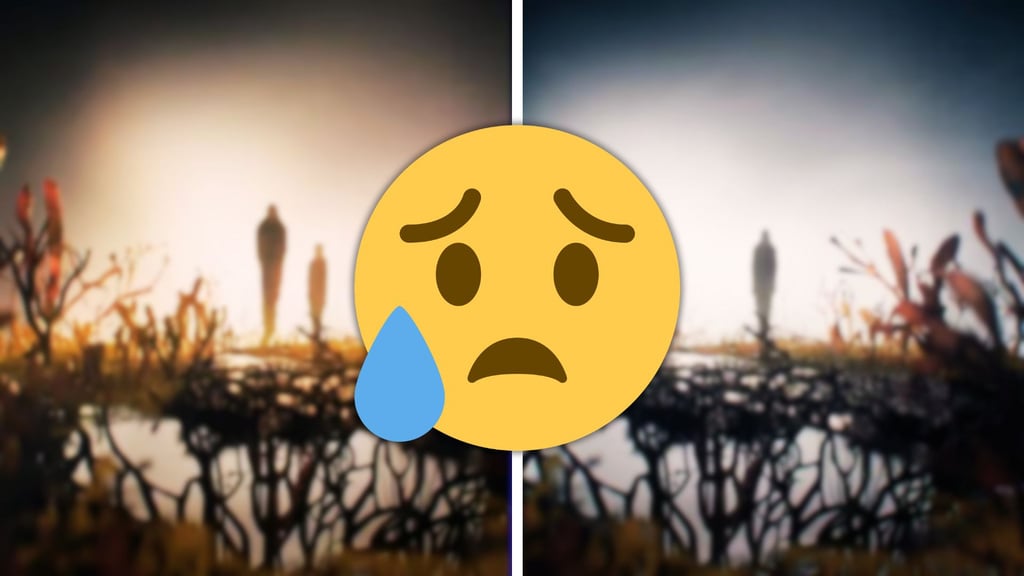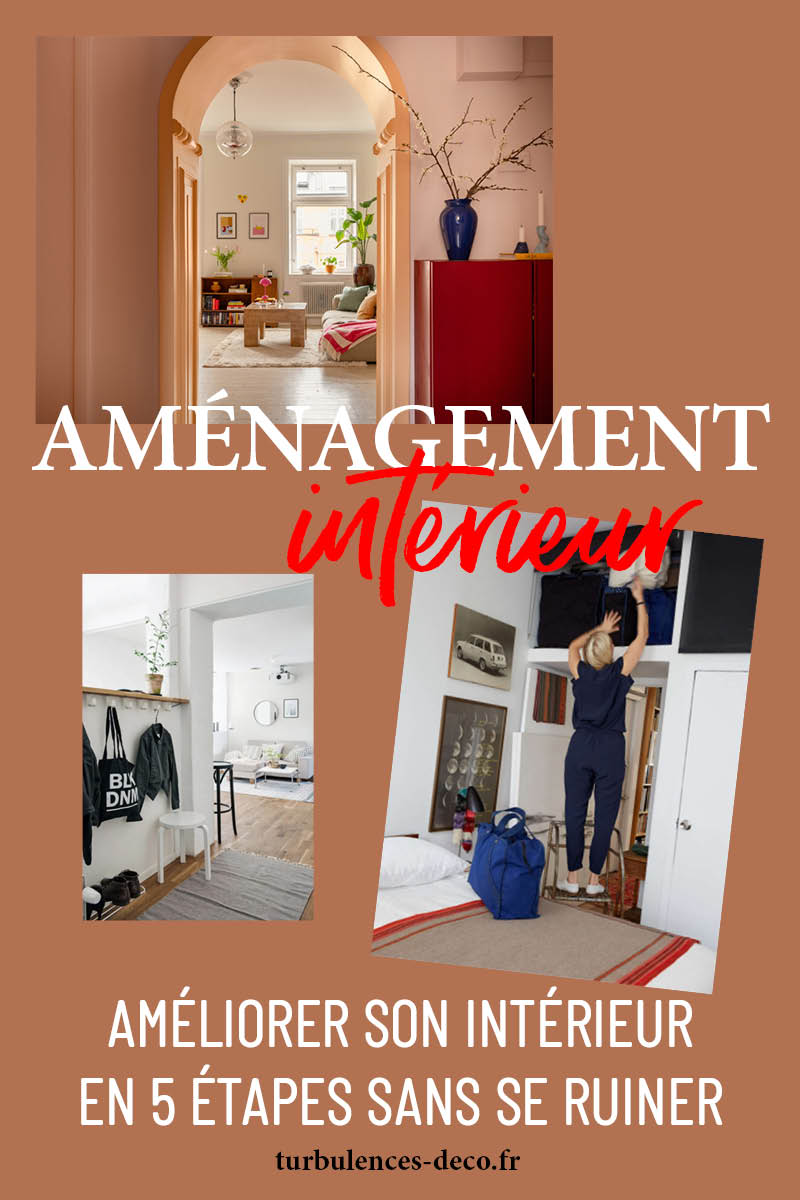Faire de l’école un « sanctuaire » : regard historique sur un leitmotiv politique
Suite à l’attaque au couteau qui a eu lieu dans un lycée le 24 avril est revenue la question de l’installation de portiques qui permettraient de « sanctuariser » les établissements scolaires.

L’attaque au couteau qui a eu lieu dans un lycée nantais, le 24 avril, a reposé la question de la sécurité des établissements scolaires. Au gouvernement, on prône l’installation de portiques pour sanctuariser l’école. À quelles références historiques ce discours nous renvoie-t-il ?
Après l’attaque dramatique au couteau d’un lycéen contre ses condisciples jeudi 24 avril à Nantes, le premier ministre François Bayrou a formulé une « piste » centrale : installer des portiques de sécurité, insistant sur « tout ce qui peut aller dans le sens de la sanctuarisation de l’école », notion « défendue depuis longtemps ».
Effectivement, il y a une trentaine d’années, en février 1996, alors ministre de l’éducation nationale, il avait présenté en ces termes un plan de lutte contre la violence à l’école :
« L’école doit être un sanctuaire. Pendant des décennies, on a plaidé pour une école ouverte […]. Il faut prendre une position inverse, travailler à resanctuariser l’école. »
Et de préconiser alors l’installation de clôtures autour des établissements, en plaidant pour la restauration d’un article de la loi anticasseurs, permettant d’interdire l’entrée dans l’établissement scolaire.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Il s’agit désormais d’installer des portiques de sécurité à l’entrée des établissements scolaires – toujours dans la même ligne, selon laquelle le danger vient de l’extérieur de l’école.
Encore faudrait-il, d’un point de vue pragmatique, préciser s’il s’agit de dispositifs de reconnaissance d’identité (contre l’intrusion de personnes extérieures à l’établissement, mais qui auraient été impuissants en l’occurrence) ou de portiques détecteurs de métaux comme dans les aéroports.
Les portiques détecteurs de métaux, apparemment les plus sûrs, ne sont pas sans failles : ils sont de nature à créer des embouteillages qui ne sont pas exempts de troubles voire de dangers à l’entrée des établissements, et les couteaux en céramiques ne peuvent pas être détectés.
À lire aussi : Sécurité des établissements scolaires : toujours plus de dispositifs de contrôle ?
Par ailleurs, le coût d’installation d’un portique n’est pas négligeable. Il est estimé à au moins plusieurs dizaines de milliers d’euros, et atteint souvent les cent mille. Rapporté aux 58 000 écoles et établissements du second degré, cela ferait une belle somme au total pour une efficacité toute relative.
L’école comme sanctuaire : une image ancrée historiquement
À vrai dire, l’accent mis sur l’extérieur de l’école pour ce qui concerne les violences ayant lieu à l’école détourne le regard de ce qui est pourtant de loin le plus répandu, à savoir les violences entre élèves, les violences de certains élèves contre leurs encadrants voire les violences de certains encadrants contre les élèves. En 1996 comme actuellement…
À lire aussi : Violences à l’école : une longue histoire ?
On peut même soutenir que certaines de ces violences s’enracinent dans une certaine façon d’appréhender l’éducation, « catholique », voire « républicaine ». On peut citer par exemple (sinon en exemple) la valorisation unilatérale de l’obéissance pour ce qui concerne les « Frères des écoles chrétiennes » (issus de la Contre-réforme) qui ont été longtemps une congrégation enseignante phare pour l’Église catholique :
« L’obéissance est une vertu par laquelle on soumet sa volonté et son jugement à un homme comme tenant la place de Dieu. »
Avec toutes les dérives qui peuvent s’ensuivre et dont on a eu de nombreuses révélations ces derniers temps.
Encore convient-il de ne pas se focaliser unilatéralement sur cela, à l’invitation du grand sociologue de l’éducation Émile Durkeim qui attire notre attention sur un point crucial.
Selon Durkheim, l’Église a en quelque sorte « inventé » l’école sous une forme institutionnelle forte (à l’instar d’un « sanctuaire ») parce qu’elle avait « un projet d’emprise universelle sur les âmes ». Pour le sociologue, qui écrit à la fin du XIXe siècle, l’histoire de l’école est celle de la longue « laïcisation » de ce projet de « conversion » dont le contenu (Dieu et l’Église, ou la République une et indivisible) importe moins que la forme (celle du « sanctuaire »).
« Pour nous aussi, l’école, à tous les degrés, doit être un lieu moralement uni, qui enveloppe de près l’enfant et qui agisse sur sa nature tout entière […]. Ce n’est pas seulement un local où un maître enseigne ; c’est un être moral, un milieu moral, imprégné de certaines idées, de certains sentiments, un milieu qui enveloppe le maître aussi bien que les élèves. »
La mise en avant du « respect des valeurs de la République » qui met l’accent sur les devoirs civiques plutôt que sur les droits et responsabilités de la citoyenneté n’irait-elle pas dans ce sens : une version structurellement « catholique » d’une certaine éducation « républicaine » ?
On peut en effet s’interroger si on met cela en regard de la profession de foi républicaine de Ferdinand Buisson, personnellement – lui – dans la mouvance d’un protestantisme sécularisé. Directeur de l’enseignement primaire de 1879 à 1896 et fondateur de la Ligue des droits de l’homme, voici ce qu’il disait au congrès du Parti radical en 1903 :
« Le premier devoir d’une République est de faire des républicains […]. Pour faire un républicain, il faut prendre l’être humain si petit et si humble qu’il soit et lui donner l’idée qu’il peut penser par lui-même, qu’il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c’est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite d’un maître, d’un directeur, d’un chef quel qu’il soit, temporel ou spirituel […]. Il n’y a pas d’éducation libérale si l’on ne met pas l’intelligence en face d’affirmations diverses, d’opinions contraires, en présence du pour et du contre, en lui disant : “Compare et choisis toi-même !” »
Claude Lelièvre ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
















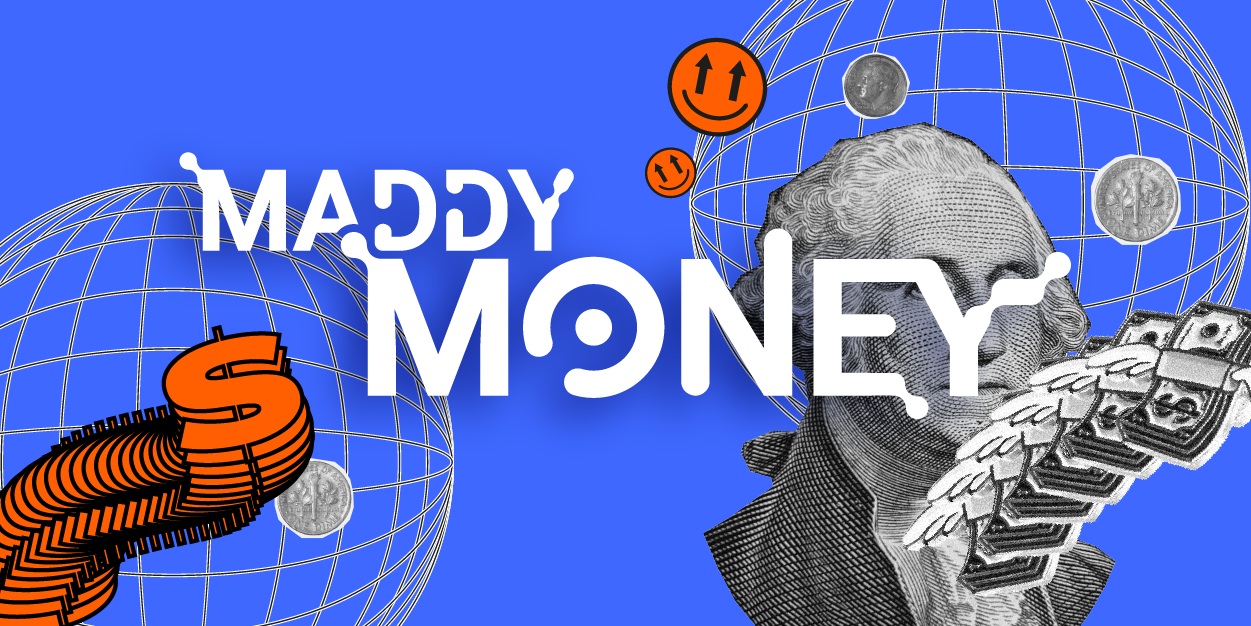








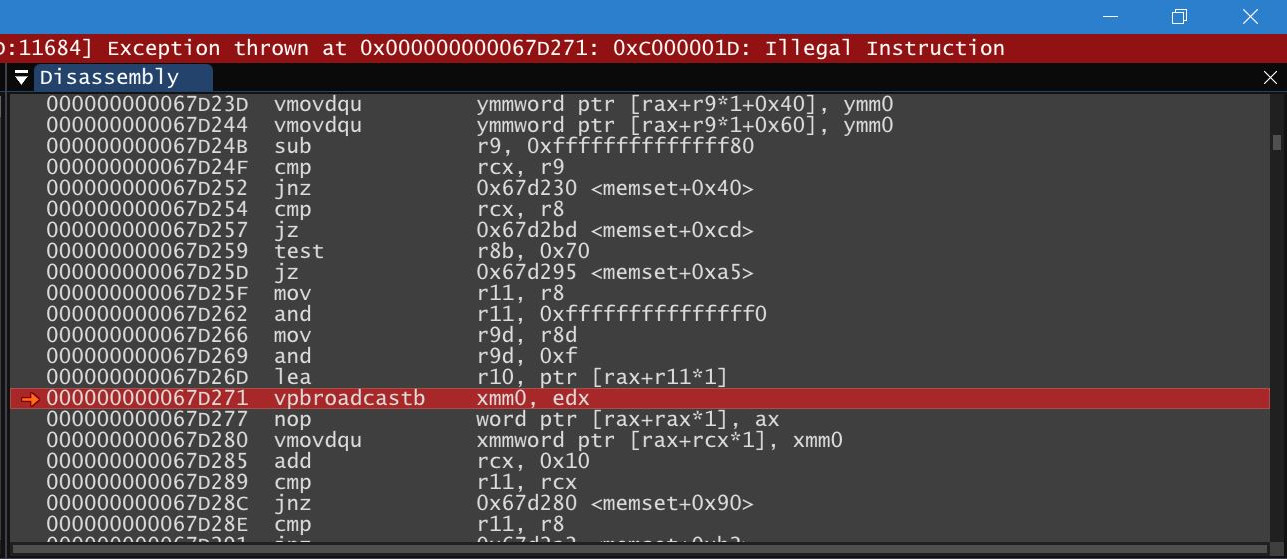













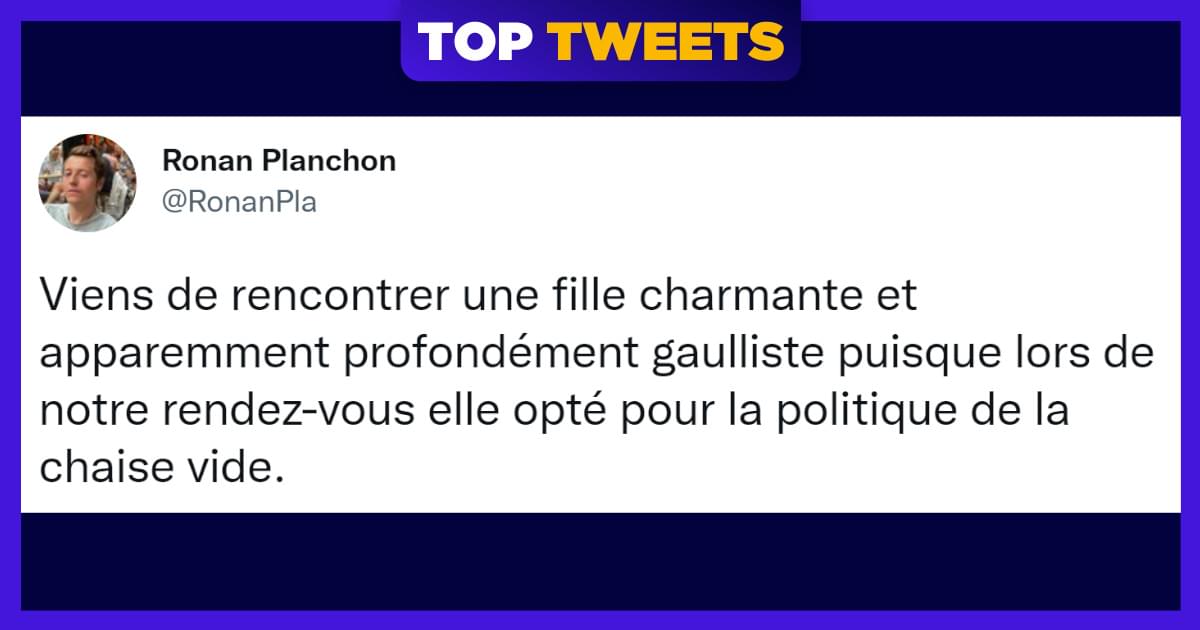



/2025/05/02/vacances-escale-a-sainte-suzanne-joyau-medieval-et-belle-surprise-des-routes-de-mayenne-6814e08901b68736514882.jpg?#)
/2025/05/02/000-ju3fp-edited-6814dbbaed09c798746204.jpg?#)