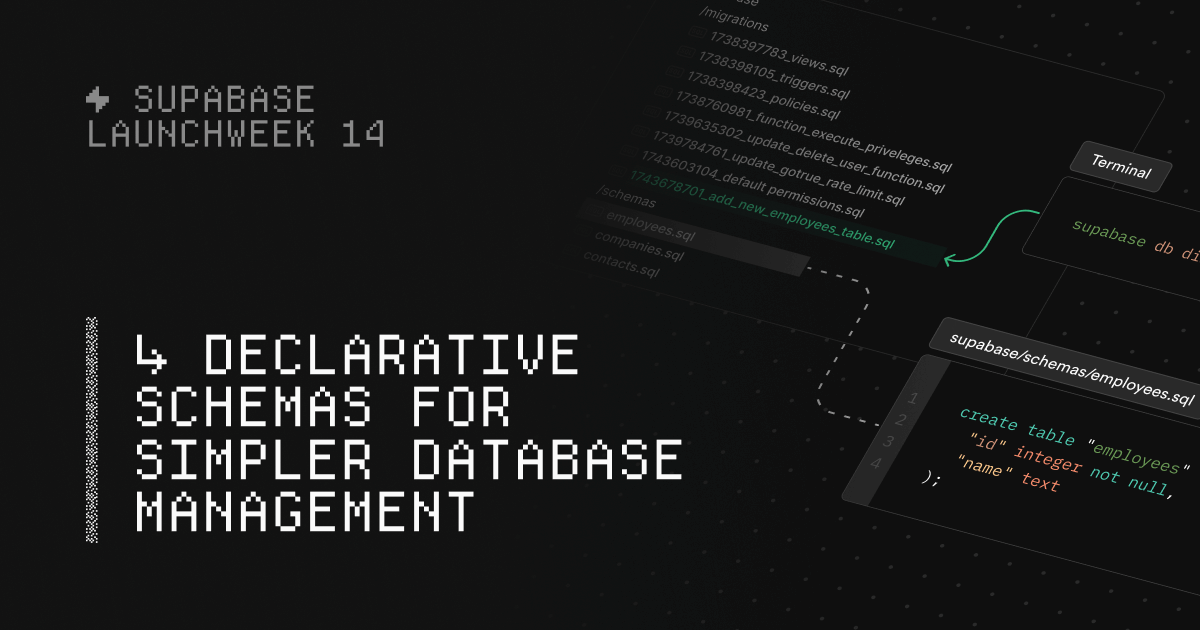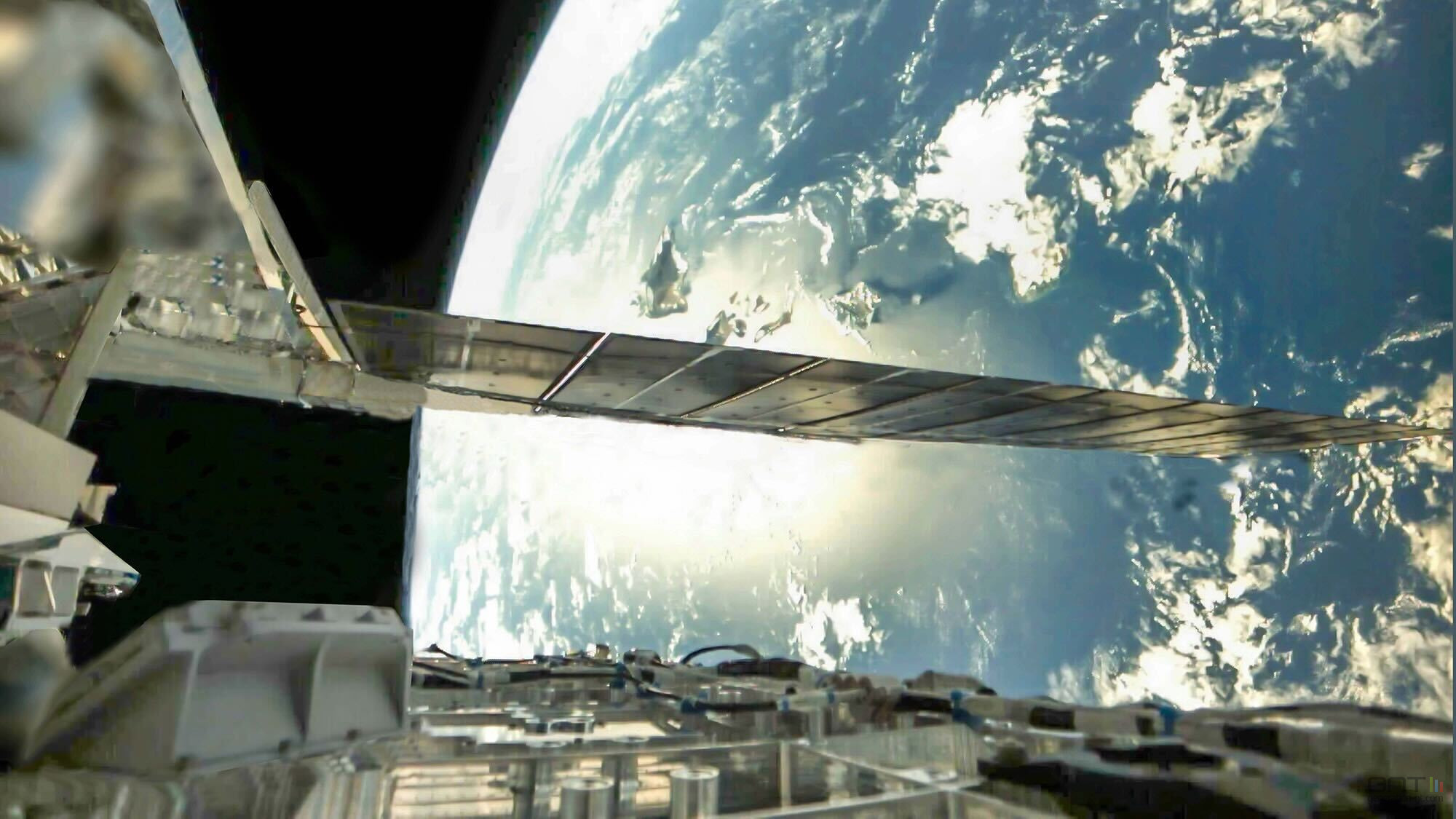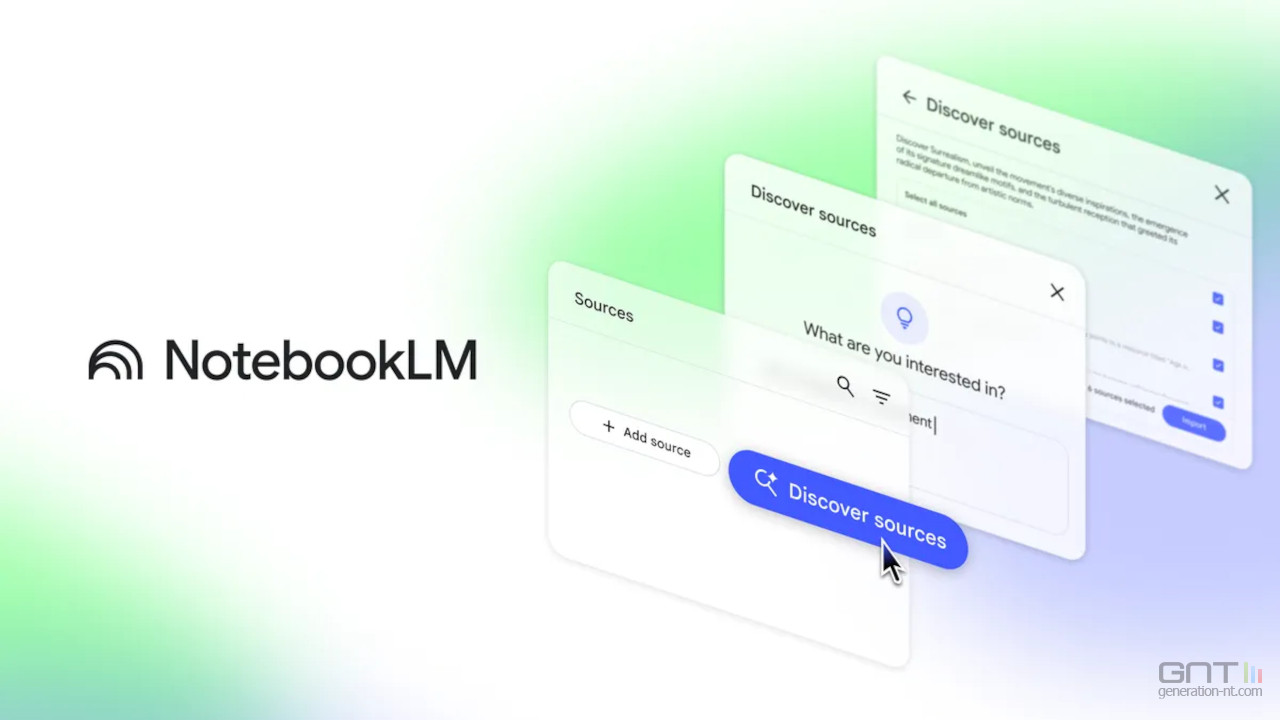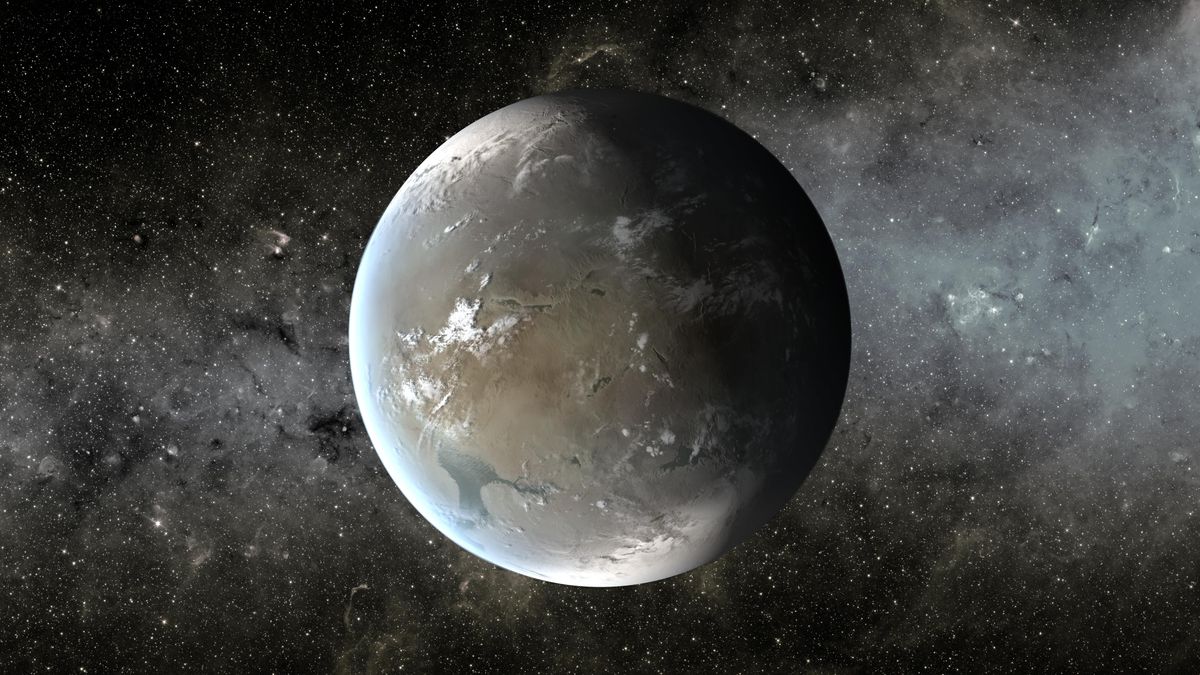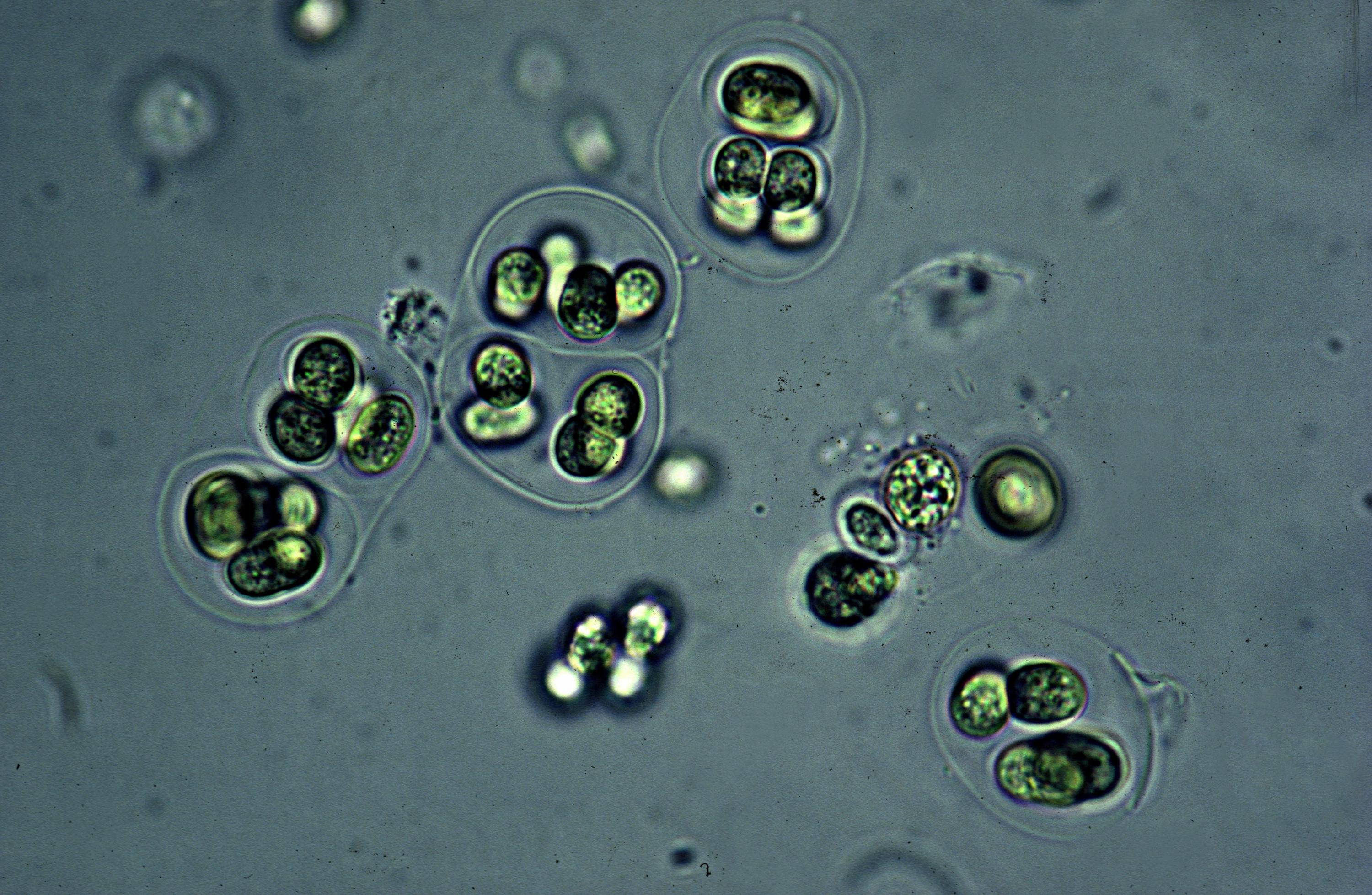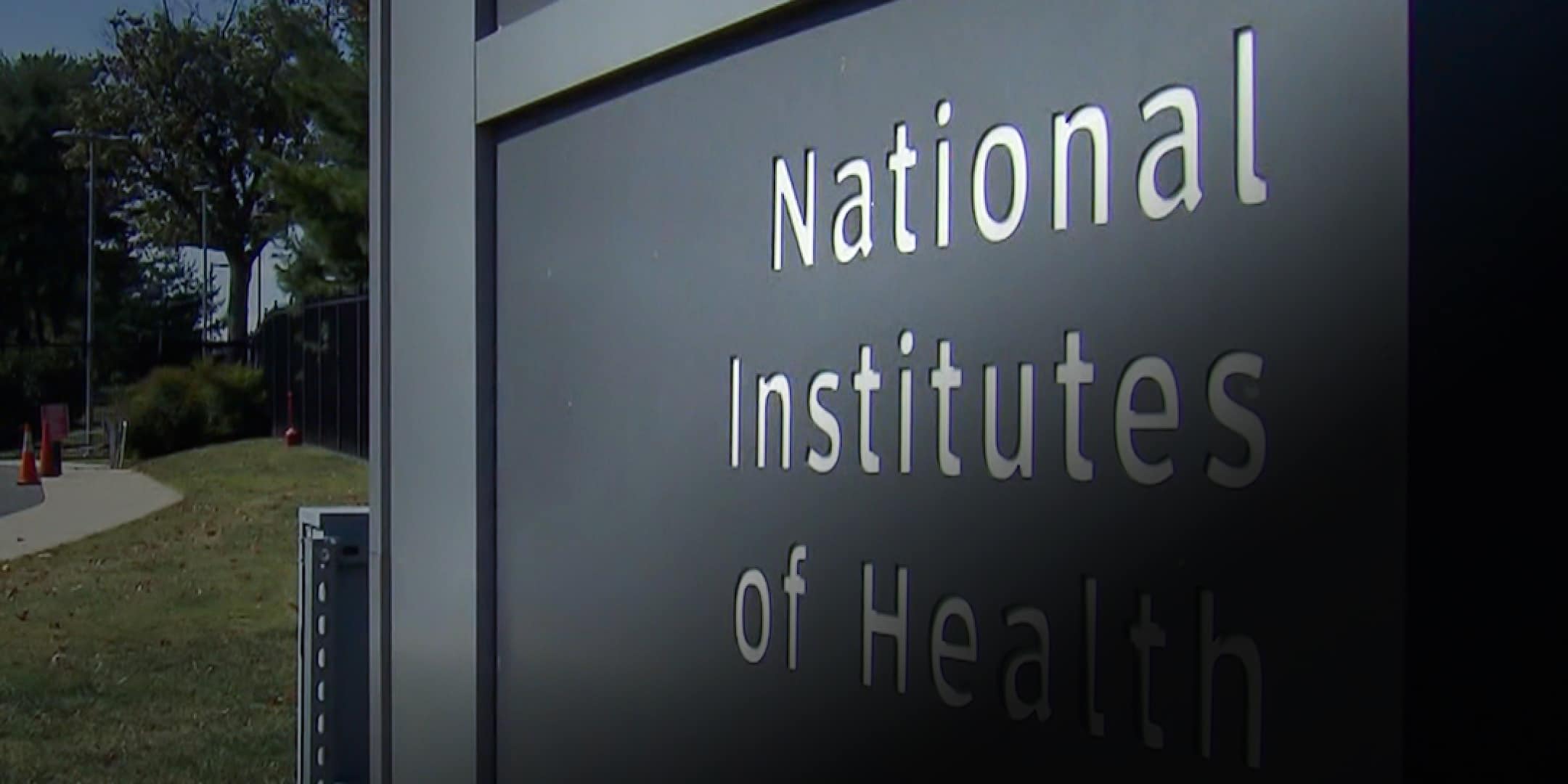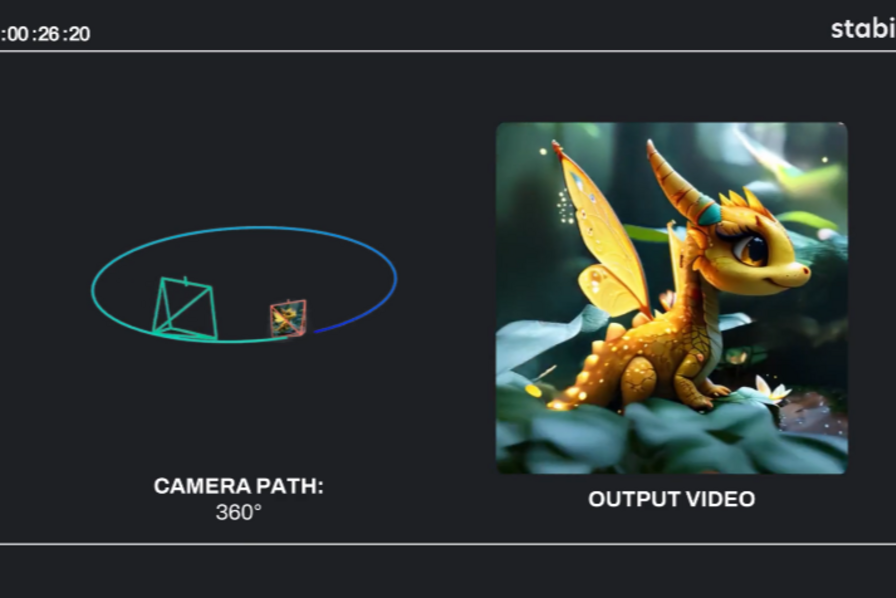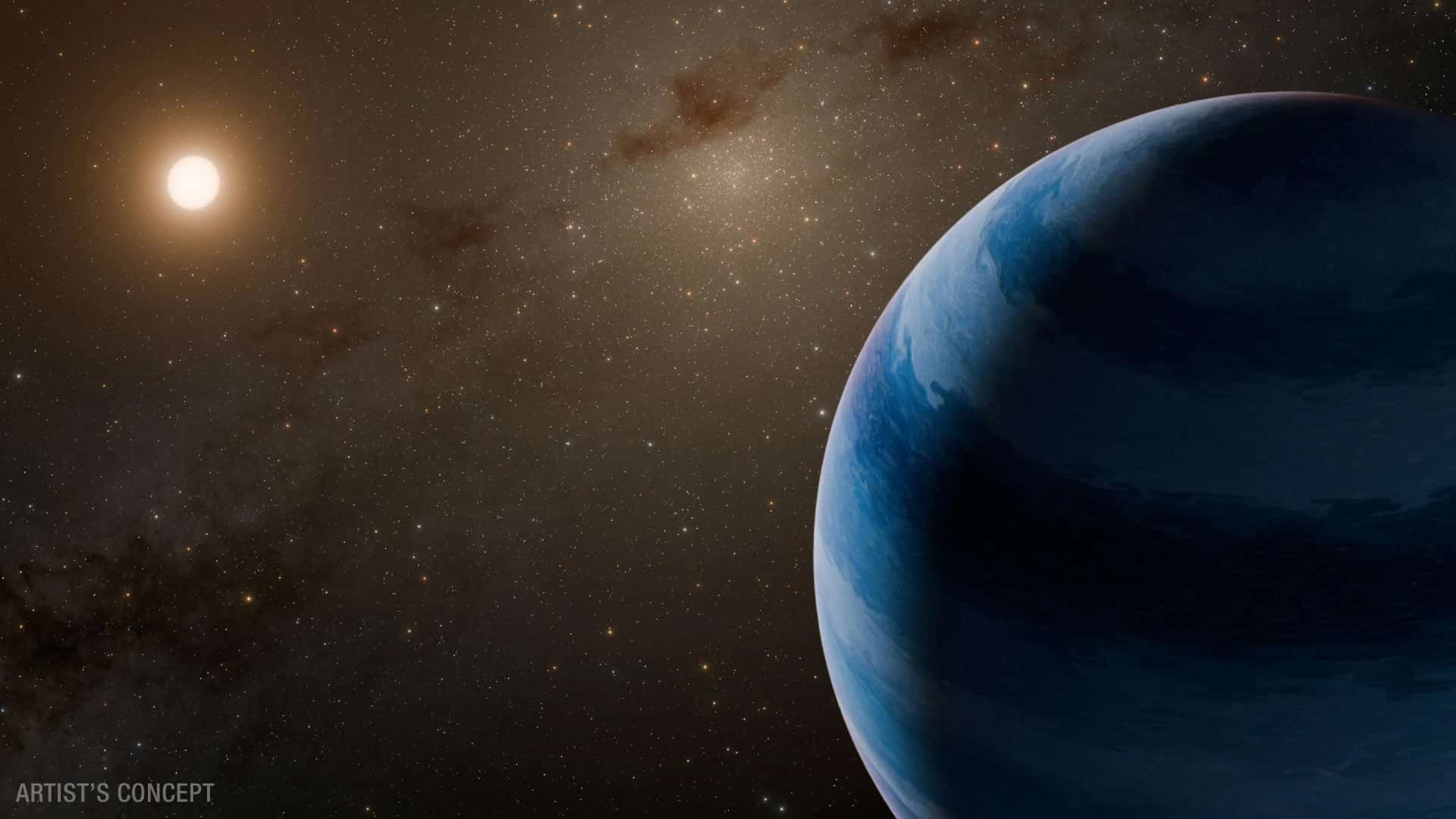Enseignement privé : le contrôle des établissements sous contrat en question
Le scandale de Bétharram soulève la question du contrôle des établissements privés sous contrat. Que disent les textes ? Et sont-ils appliqués ? Que changent les annonces du ministère de l’éducation ?

Le scandale de Bétharram soulève la question du contrôle des établissements privés sous contrat. Que disent les textes ? Et sont-ils appliqués ? Que vont changer les annonces du ministère de l’éducation ?
À Lestelle-Bétharram, derrière les murs de l’imposant établissement scolaire Le Beau Rameau, à la réputation bien établie, que se passe-t-il pour que plus de 150 plaintes aient été déposées auprès du procureur de la République pour violence et viol ?
Depuis que la parole s’est libérée parmi les anciens élèves de l’école, collège et lycée du Béarn, les révélations de faits de violences se multiplient dans d’autres établissements privés, aux quatre coins de la France, posant la question du contrôle des établissements privés sous contrat.
On considérera seulement les établissements catholiques, les plus nombreux (96 % des élèves scolarisés dans le privé). Que dit la règlementation de leur contrôle ? Qu’en est-il réellement sur le terrain ?
Le contrôle lié au caractère privé de l’établissement
Dans les établissements sous contrat, il faut distinguer trois ordres de réglementation, et donc de contrôle. Certains de ces contrôles concernent l’ensemble des établissements privés : ils sont définis par les lois Falloux (1850) et les lois Goblet (1886) complétées en 2018 et 2021 (article 441-1, 2, 3 du Code de l’éducation).
Il existe un contrôle lors de la création ou des modifications apportées à l’organisation de l’établissement : c’est la déclaration d’ouverture. Celle-ci doit être adressée par le futur directeur à l’administration de l’éducation nationale : elle en accuse réception et transmet la demande, au maire, au préfet et au procureur de la République.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Après contrôle du dossier, l’une ou l’autre de ces autorités peut s’opposer à l’ouverture, dans un délai maximum de trois mois. Un refus est motivé selon les critères suivants : intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse, non-respect des conditions prévues par la personne qui ouvre l’établissement (nationalité, diplômes, casier judiciaire vierge, âge des enfants concernés, respect du socle commun des connaissances, diplômes préparés, plan des locaux, conditions sanitaires, harcèlement scolaire), établissement n’ayant pas le caractère d’un établissement scolaire ou technique, ingérence étrangère.
Par ailleurs, tous les ans, l’établissement doit fournir la liste des enseignants et leurs titres et, à la demande des autorités, les documents budgétaires. Des contrôles pédagogiques sont organisés afin de voir si les exigences de la scolarité obligatoire sont remplies.
Si aucune déclaration d’ouverture n’a été faite ou si les délais n’ont pas été respectés, il s’agit dans ce cas d’une école clandestine : le préfet ordonne sa fermeture immédiate, après avis de l’autorité compétente en matière scolaire. Quant à celui qui ouvre illégalement une école, une peine de prison d’un an peut être prononcée ainsi qu’une amende de 15 000 euros et l’interdiction de diriger ou d’enseigner dans un établissement pendant cinq ans ou à titre définitif.
En cas de refus d’ouverture par l’autorité compétente, le déclarant peut faire appel devant la formation contentieuse du Conseil supérieur de l’éducation nationale et saisir les tribunaux.
Le contrôle lié au caractère contractuel de l’établissement
Sous contrat, la législation est plus contraignante et complète celle qui régit tout établissement privé. Il y a un contrôle administratif de l’État en matière de respect de la liberté de conscience et d’accueil de tous les élèves, de discrimination en matière religieuse, sociale ou ethnique.
Le passage sous contrat suppose un contrôle du respect des programmes de l’enseignement public. Les enseignants sont de droit public : nommés par le recteur, ils sont soumis aux mêmes contrôles pédagogiques que dans l’enseignement public. En revanche, les activités extérieures au contrat sont librement organisées par l’établissement (vie scolaire, internat, exercices religieux) sous réserve de respecter les principes essentiels de la liberté de conscience et de non-discrimination.
L’autorité rectorale doit être informée en cas de violence, de harcèlement, d’actes humiliants, d’atteintes sexuelles. Un signalement doit être effectué en cas de doute auprès du procureur de la République par tout membre de la communauté éducative afin qu’une enquête soit diligentée.
À lire aussi : Enseignement privé : près de 18 % des élèves français et une grande diversité d’établissements
Les collectivités compétentes siègent aux conseils d’administration des établissements concernés pour tout ce qui concerne les questions budgétaires et exercent ainsi un contrôle sur l’utilisation des fonds. Une commission académique examine les demandes de contrat ou de leur résiliation par l’autorité académique, elle peut se prononcer sur l’utilisation des fonds publics, la mixité sociale.
Qui peut contrôler un établissement sous contrat ? L’ensemble des inspecteurs de l’éducation nationale, les membres du conseil départemental (hors enseignants), le maire, les délégués, la Cour des comptes, l’inspection générale des finances (IGF) ou les centres des finances publiques.
On le voit : les possibilités de contrôle sont nombreuses et variées : administratif, pédagogique et financier. De plus, les établissements catholiques étant à caractère propre, le droit de l’Église catholique intervient également.
Le contrôle lié à l’origine confessionnel de l’établissement
Le chef d’établissement lorsqu’il est laïque, et à plus forte raison dans les rares cas où il est religieux, est l’objet d’un contrôle. En effet, le Code de droit canonique, promulgué en 1983 par Jean-Paul II, précise que, dans les cas les plus graves, tels que les atteintes sexuelles contre des mineurs de moins de 16 ans, ou des actes de violence, un clerc peut, après jugement, être renvoyé de l’état clérical (canon 1395). Les laïcs peuvent aussi être condamnés et privés de leurs fonctions, si nécessaire.
Par ailleurs, la constitution apostolique « Pascite gregem Dei », promulguée le 23 mai 2021 par le pape François, renforce le contrôle en considérant ces atteintes comme des délits contre la vie, la dignité et la liberté humaine et ajoute à la liste le détournement de mineur ou la possession et l’exhibition d’images pornographiques commis par des clercs sur des mineurs (canon 1398).
Ajoutons que le statut de l’enseignement catholique de 2013 précise quelles sont les instances de contrôle interne dans la mesure où « l’école catholique est attachée au respect de la personne et à la liberté de conscience » (articles 35 à 37).
L’instance de contrôle s’appelle l’autorité de tutelle : elle est exercée par le directeur diocésain ou le supérieur d’un ordre religieux ou leurs délégués. Elle doit visiter les établissements régulièrement et établir un rapport. Sous la responsabilité de l’évêque du lieu, elle contrôle l’action du chef d’établissement et peut proposer son licenciement en cas de faute grave. Elle doit prêter attention au climat relationnel de l’établissement, à la mise en œuvre du projet pédagogique (articles 178 à 180). La tutelle siège de droit au conseil d’administration de l’établissement.
Force est de constater que la loi et l’organisation interne de l’enseignement catholique prévoient bien une série de contrôles et ont créé des structures pour ce faire. Or, nombre d’établissements privés sous contrat ont connu des situations répréhensibles : comment expliquer de telles dérives ?
Comment contrôler réellement ?
Il faut d’abord se rappeler combien en tous domaines, et pas seulement dans les institutions catholiques sous contrat, le silence régnait sur de telles affaires jusque dans les années 2000 : les contrôles rectoraux étaient peu nombreux, faute de personnels en nombre suffisant, comme l’a fait remarquer la Cour des comptes dans un rapport de juin 2023.
La volonté politique n’était pas non plus au rendez-vous. Pour les autorités religieuses, et les familles, il fallait garder le silence pour des raisons de réputation. Au mieux, on déplaçait la personne, les élèves n’en parlaient pas aux parents. Qu’une certaine violence règne dans un établissement scolaire était, au fond admis par les parents, surtout lorsque les résultats scolaires étaient à la hauteur : il s’agissait de dresser, de soumettre des jeunes parfois rebelles.
C’est à partir des années 1990 que la violence à l’école n’est plus admise (circulaire du 6 juin 1991 pour le primaire et circulaire du 3 septembre 2019 pour le secondaire). C’est encore plus récemment dans les années 2010 que les agressions sexuelles sont dénoncées dans l’ensemble des institutions.
L’administration de l’éducation nationale, suite aux débats provoqués par les récentes affaires, a compris que la situation ne pouvait plus durer et a mis à la disposition des rectorats 60 équivalents temps plein pour effectuer ces contrôles sur pièces ou sur place y compris sur le climat scolaire et l’absence de maltraitance. Un guide pratique a été rédigé. Une commission parlementaire a été créée sur les violences scolaires et a commencé ses auditions.![]()
Bruno Poucet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.