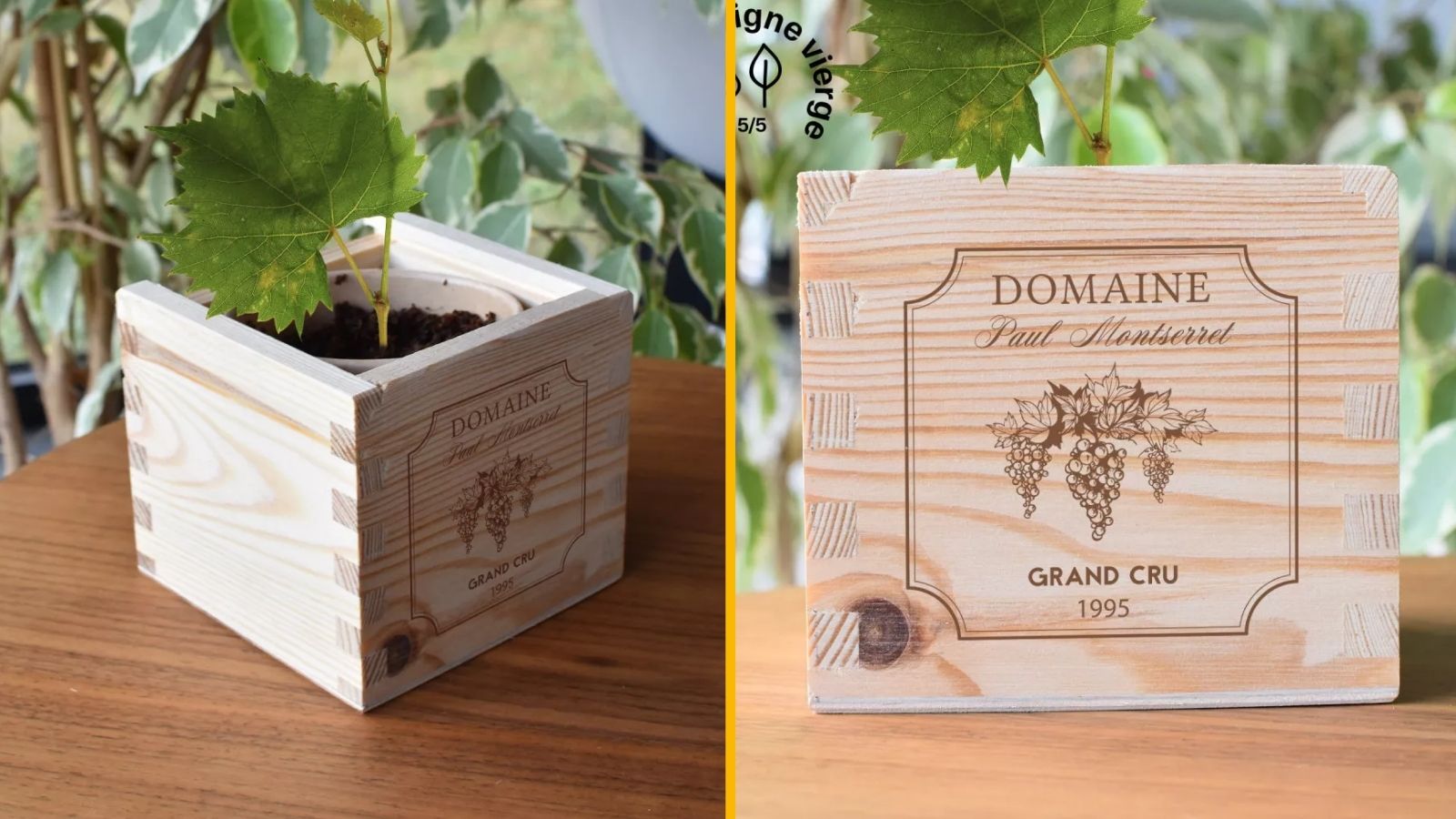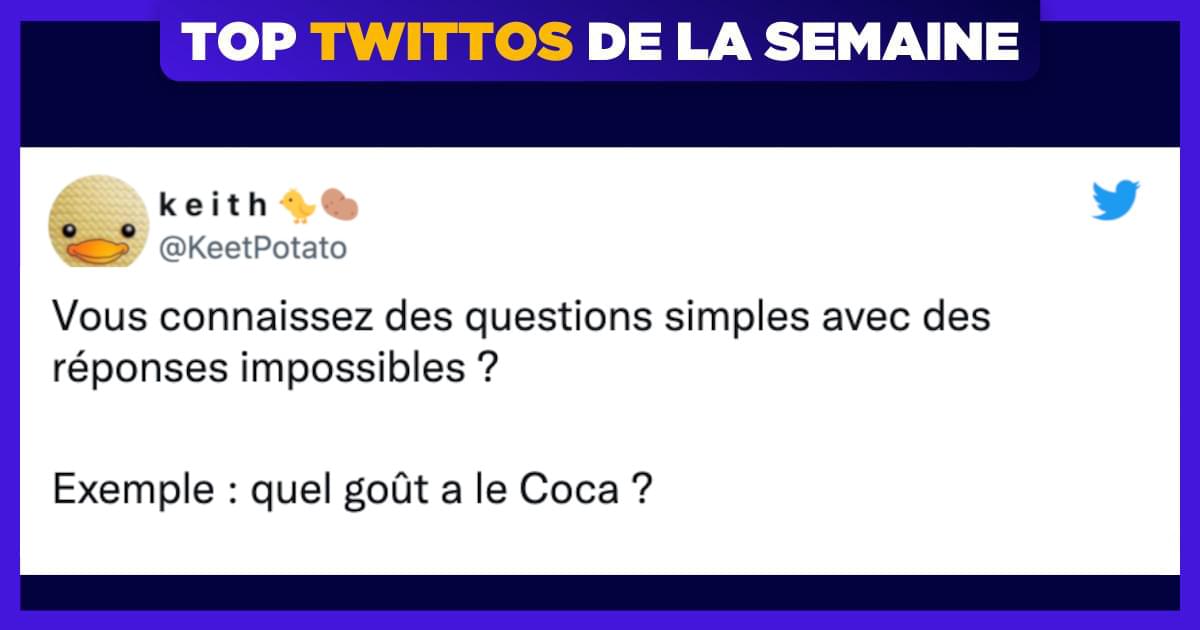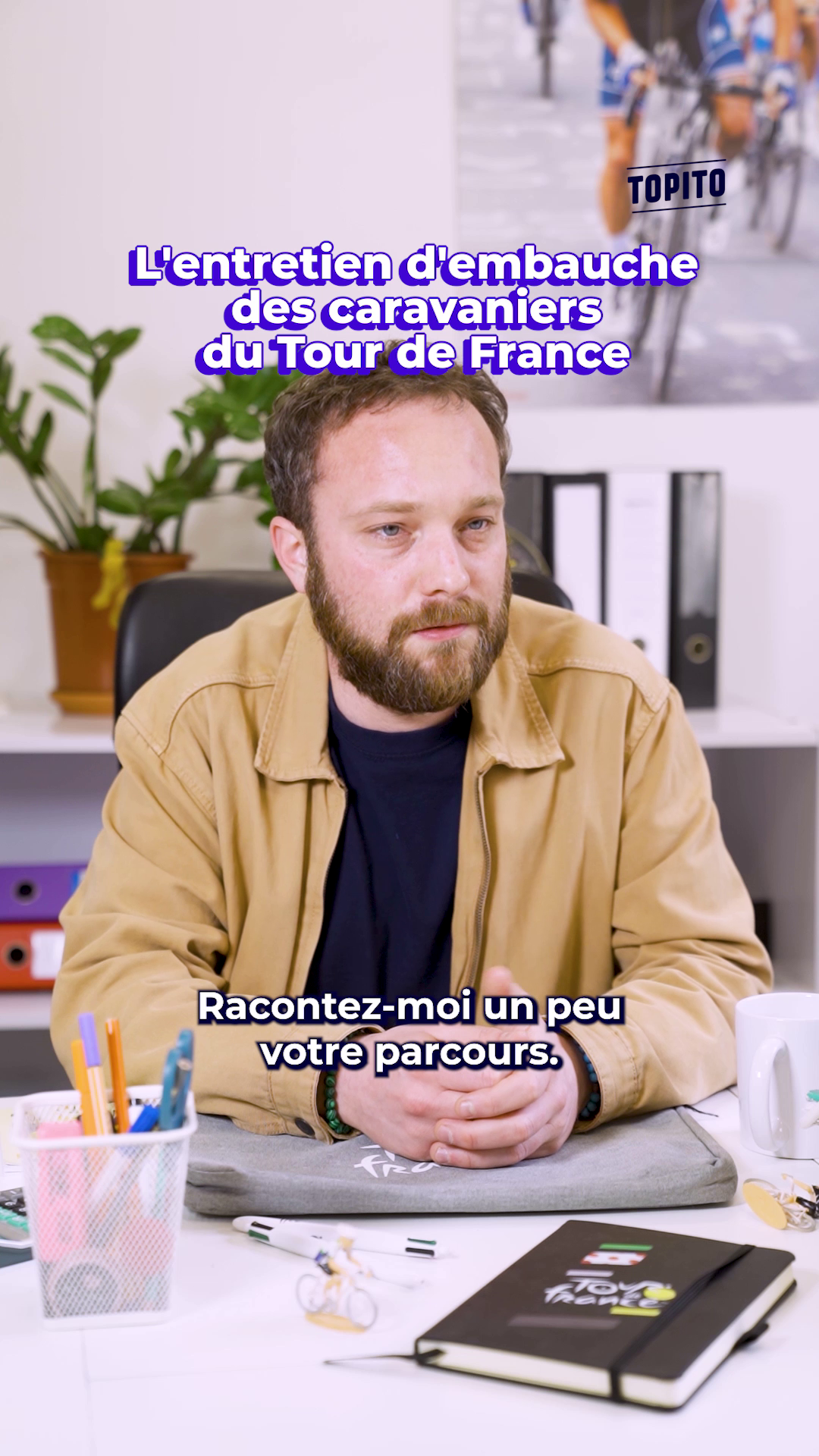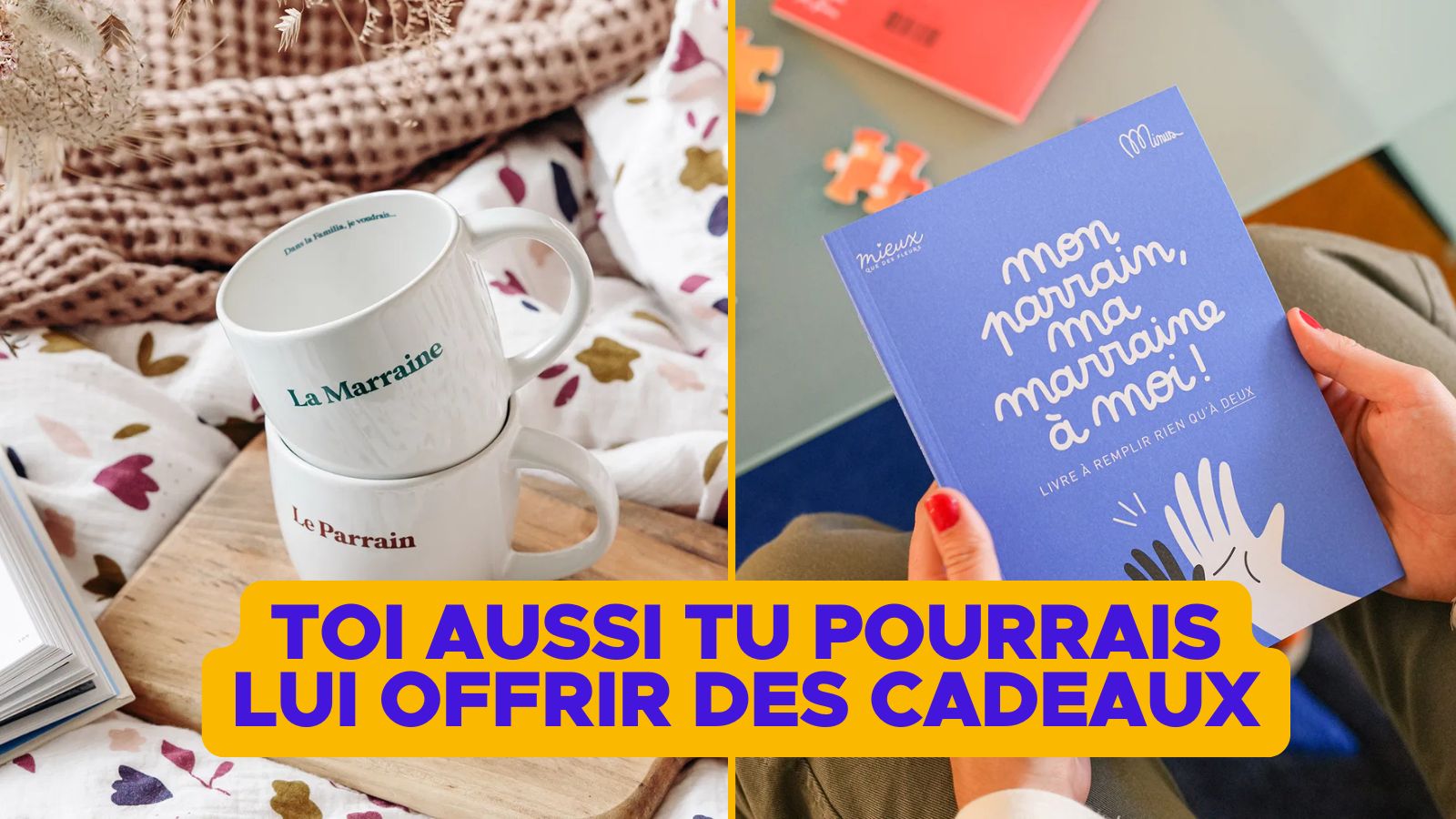Consommateurs en situation de handicap : les défis du marketing inclusif
Le marketing devrait davantage intégrer les besoins et les envies des personnes en situation de handicap. Trop souvent, elles doivent s’adapter ou renoncer à la consommation. Des solutions existent.

Le marketing devrait davantage intégrer les besoins et les envies des personnes en situation de handicap. Trop souvent, elles doivent s’adapter ou renoncer à la consommation. Des solutions existent.
En juin 2025, les pays de l’Union européenne (UE) devront avoir intégré dans leurs législations nationales la directive de 2019 sur l’accessibilité des produits et services clés, tels que les téléphones, services de communication électronique ou bancaires. L’objectif est de faciliter la vie quotidienne des 100 millions de citoyens européens en situation de handicap, soit un adulte sur quatre.
Mais que savons-nous vraiment de leurs besoins ? Que disent les recherches en marketing sur les consommateurs en situation de handicap (CSH) ? Quels conseils donner aux organisations qui veulent offrir des produits et services adaptés aux CSH ?
Deux écueils du « validisme »
Dans le cas des CSH, comme pour d’autres cibles (groupes ethniques, femmes, etc.), l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Les praticiens du marketing doivent être vigilants face à leurs propres préjugés pour éviter de promouvoir des représentations stéréotypées, misérabilistes ou tendant à l’héroïsation.
La représentation, apparemment positive, des personnes en situation de handicap par certaines enseignes ou certaines causes peut en réalité générer une forme de stigmatisation. Ainsi, le Téléthon a fait l’objet de critiques, comme en témoignent le documentaire The Kids Are Alright aux États-Unis ou la campagne du collectif handi-féministe, les Dévalideuses, en marge du Téléthon 2023 en France. Les critiques reprochent à cet évènement de diffuser une représentation misérabiliste. Ce grand rendez-vous télévisuel contribuerait en effet à perpétuer une vision du handicap fondée sur le modèle de la charité.
Dans d’autres cas, c’est l’héroïsation des personnes en situation de handicap qui pose problème. Par exemple, la campagne des Jeux paralympiques de Rio en 2016 proclamait ainsi : « We’re the superhumans. » Cette approche peut être perçue comme une injonction au dépassement, excluant les personnes avec les déficiences les plus importantes ou ayant un accès limité aux infrastructures sportives. Ces tensions autour de la représentation des athlètes en situation de handicap se sont à nouveau manifestées lors des Jeux paralympiques de Paris, notamment à travers une passe d’armes entre le judoka Teddy Riner et le joueur de basket fauteuil Sofyane Mehiaoui.
Abonnez-vous dès aujourd’hui ! Que vous soyez dirigeants en quête de stratégies ou salariés qui s'interrogent sur les choix de leur hiérarchie, recevez notre newsletter thématique « Entreprise(s) » : les clés de la recherche pour la vie professionnelle et les conseils de nos experts.
Des alternatives à la vision « validiste »
Mettre au cœur de la marchandisation des représentations stéréotypées, misérabilistes ou héroïsantes des personnes en situation de handicap fait écho au concept d’inspiration porn proposé par Stella Young et relève du « validisme ». Ce terme désigne les pratiques et normes (des) valides comme intrinsèquement supérieures. Dans cette logique, il est préférable de marcher plutôt que de rouler, de parler plutôt que de signer, etc.
Cela peut conduire à penser que toutes les personnes en situation de handicap aspirent à imiter les personnes « valides », notamment par la consommation. Face à ce système normatif, certains mouvements proposent des alternatives à cette vision validiste, tels que la « culture Sourde » et le « mouvement crip ».
À lire aussi : Handicap, emploi et inclusivité : vers un « DuoDay » réciproque ?
Le modèle social du handicap, théorisé dans les années 1980 par Michael Oliver, est à la base de la plupart des travaux sur le CSH. Il soutient que le handicap résulte des barrières structurelles de l’environnement (physiques, architecturales, sociales…) plutôt que de la personne elle-même. Ainsi, la situation de handicap peut être modifiée en adaptant l’environnement, ce qui confère une responsabilité particulière au marketing et au monde marchand dans une société dite de consommation.
Des micro-agressions
Donna Reeve, chercheuse en Disability Studies, critique le modèle social pour sa faiblesse à considérer les dimensions culturelles et expérientielles du handicap, estimant qu’il est simpliste de penser que l’accessibilité repose uniquement sur la suppression des barrières structurelles. En réalité, même lorsque ces modifications sont mises en œuvre, d’autres facteurs peuvent encore mener à des expériences négatives pour les CSH : regards insistants, pitié, condescendance, hostilité des autres clients, ou encore intrusion et questions indiscrètes des professionnels.
L’ensemble de ces micro-agressions affecte le bien-être psychoémotionnel des CSH, qui peuvent alors réduire leurs activités, y compris la consommation, pour se protéger. Bien que ces barrières soient plus difficiles à identifier et à combattre que les barrières structurelles, elles sont tout autant, sinon plus, responsables de discrimination et d’exclusion.
Face à cette diversité de barrières, les offreurs doivent dépasser une représentation du handicap trop souvent limitée au fauteuil roulant. Un espace sera fréquemment considéré comme accessible aux CSH s’il dispose d’une rampe d’accès ou d’un ascenseur. Or, le rapport au temps peut également être une source d’exclusion.
Dans une société qui accélère et qui valorise la vitesse, les temporalités des CSH peuvent être une source d’exclusion. De façon analogue, l’expérience corporelle des CSH est souvent négligée par le marketing. Pour autant, leur façon de ressentir les choses influence leurs interactions avec les produits et environnements de consommation. Par exemple, une personne souffrant de douleurs chroniques peut se sentir épuisée après avoir fait ses courses. Une meilleure compréhension de ces sensations pourrait rendre les environnements de consommation plus inclusifs, notamment grâce à des acteurs pleinement attentifs à l’inconfort physique vécu par les individus.
Des stratégies d’adaptation
Face à des environnements qui demeurent souvent peu praticables, les CSH adoptent fréquemment des stratégies pour éviter non seulement les espaces inaccessibles, mais aussi les situations où ils pourraient être stigmatisés. Au-delà d’être souvent épuisantes pour les individus, ces stratégies montrent combien les CSH doivent sans cesse négocier leur place dans la société.
S’intéresser aux stratégies d’adaptation et de résistance déployées par les CSH peut permettre de mieux comprendre comment ceux-ci peuvent être amenés à réinventer leur rapport à la consommation et à la société. Cela implique de reconnaître que les comportements de consommation ne dépendent pas seulement de leur situation personnelle, mais aussi des contextes matériels, sociaux et culturels dans lesquels ils s’inscrivent, contextes où la perception du corps, de la norme et du stigmate joue un rôle fondamental.
Reconnaître l’hétérogénéité des situations
Il n’existe pas de recettes miracles, mais plusieurs pistes peuvent être explorées. Tout d’abord, il semble nécessaire d’avoir une représentation plus précise et plus juste des CSH, en reconnaissant leur grande hétérogénéité. Il est notamment essentiel de dépasser la représentation de la personne en situation de handicap comme étant une personne en fauteuil roulant. En effet, en Europe, on considère que 80 % des handicaps seraient invisibles. Agoraphobie, troubles « dys », hyperacousie sont autant de conditions qui, bien que méconnues, peuvent être des sources de handicap majeures pour les consommateurs.
Par-delà l’hétérogénéité des sources de handicap, il faut veiller à ce que le handicap n’invisibilise pas toutes les autres facettes de ces consommateurs. En effet, ceux-ci sont avant tout des « consommateurs comme les autres », dont les aspirations sont notamment modelées par leurs trajectoires et leurs positions dans l’espace social. Il est donc important de considérer que les CSH n’ont pas tous les mêmes attentes mais des envies et des besoins variés !
La diversité des personnes
Avoir une représentation plus juste du handicap implique également d’inclure davantage cette population dans les études marketing (études de marché, tests de produits, etc.), même lorsque cela s’avère difficile. En effet, il peut être relativement aisé de collecter des données auprès de CSH bénéficiant de nombreuses relations sociales, appartenant à une CSP+, vivant en milieu urbain et ayant accès au langage. Cela devient plus complexe lorsque la personne est désocialisée, sans emploi, réside en zone rurale et n’a pas accès au langage. Toutefois, cette inclusion reste essentielle, car bien que ces individus partagent la même déficience, leurs besoins sont probablement distincts.
Une telle démarche permet d’alimenter une autre source de réflexion qui consiste à sortir d’une offre spécialisée pour les CSH en essayant de développer des offres qui conviennent à tous, CSH ou non. La convention des droits des personnes handicapées recommande ainsi le recours à la conception universelle, qui vise au développement d’offres « qui puissent être utilisées par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale ». Une telle offre peut notamment permettre de réaliser des économies d’échelle et d’éviter le caractère stigmatisant d’une offre ciblée. La ligne Includeo développée par Tefal est souvent citée comme une illustration d’une telle démarche.
Un marketing finalement plus inclusif
Malgré l’intérêt d’une telle approche, force est de constater qu’il est impossible de développer une offre répondant aux besoins spécifiques de tous les consommateurs, ceux-ci pouvant avoir des besoins très rares, opposés ou difficiles à concilier. Dans ce contexte, il semble primordial de favoriser des médiations qui s’appuient sur les savoirs expérientiels des CSH, qu’il s’agisse d’un personnel de vente sachant écouter et traduire les besoins de ces consommateurs ou d’applications qui aident à naviguer dans une offre en fonction de caractéristiques spécifiques.
La participation des personnes concernées est au cœur d’un marketing plus inclusif. C’est en associant les CSH aux différentes étapes de la conception d’une nouvelle offre que pourront être développés des produits et services réellement inclusifs. Favoriser l’emploi et l’accès à l’enseignement supérieur des personnes en situation de handicap contribuera à former des collaborateurs et des étudiants acculturés au handicap, capables d’adopter des pratiques professionnelles plus inclusives.![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.








































/2025/04/03/affiche-expo-matisse-et-marguerite-67ee916901dd4316448105.jpg?#)

/2025/04/04/063-2162603813-67f04d16a75ea861220273.jpg?#)
/2025/04/04/culture-l-histoire-de-l-indemodable-chaise-pliante-67f04440cd7c9176305715.jpg?#)
/2025/04/04/sipa-shutterstock40721796-000003-67f0323a4c4d7352140716.jpg?#)