Comment les veuves d’artistes ont façonné l’histoire de l’art abstrait
Sonia Delaunay, Nina Kandinsky, Nelly van Doesburg, Lily Klee : les veuves d’artistes ont joué un rôle crucial dans la reconnaissance de l’abstraction.


Elles forment un petit groupe soudé, quoique parfois rival. Sonia Delaunay, Nina Kandinsky, Nelly van Doesburg, Jeanne Kosnick-Kloss et Lily Klee partagent le statut de veuves, héritières d’artistes dits abstraits. Dans le Paris de l’après-guerre et jusqu’à la fin des années 1970, leurs choix ont joué un rôle primordial dans le passage à la postérité de l’œuvre de leur époux et dans la reconnaissance de l’abstraction. Ces femmes restent pourtant souvent dans l’ombre.
À partir d’archives inédites rassemblant correspondances et écrits intimes, l’historienne Julie Verlaine fait revivre leurs combats et redonne à ces femmes la place qui leur est due. Extraits de son ouvrage Les Héritières de l’art abstrait (Payot, 2025).
Paris, palais des Beaux-Arts, le vendredi 19 juillet 1946. Une foule joyeuse et dense, rassemblant plusieurs générations, se presse pour inaugurer le premier Salon des réalités nouvelles. Les grandes verrières du bâtiment construit pour l’Exposition internationale de 1937 éclairent les toiles accrochées aux cimaises le matin même, qui ont toutes en commun de ne pas représenter la réalité : art abstrait, art concret, peinture non objective ou non figurative… quelle que soit l’étiquette que chacun préfère retenir, l’art que ce nouveau rendez-vous parisien entend défendre est moderne, actuel et provocateur.
Au milieu des artistes, des critiques et des marchands, un petit groupe de femmes est au centre de l’attention : ce sont les compagnes des « grands disparus », ces pionniers de l’abstraction morts pendant la guerre, auxquels l’exposition rend un hommage appuyé. Sonia Delaunay, Nelly van Doesburg, Nina Kandinsky et Jeanne Kosnick-Kloss reçoivent tout à la fois condoléances et éloges. Elles sont remerciées pour les prêts qu’elles ont consentis pour l’accrochage du moment, sollicitées pour de futures expositions en France et à l’étranger, et assurées que la production de leur compagnon défunt trouvera au plus vite sa place au sommet de l’art du XXe siècle.
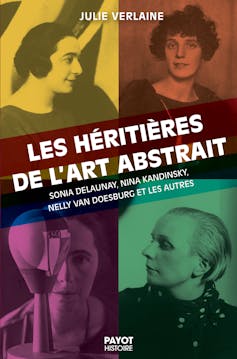
Cette soirée d’été est l’un des points d’orgue d’un travail essentiel de conservation, restauration, sélection et documentation. Les veuves des artistes ont choisi les toiles, vérifié les cartels, contrôlé les textes du catalogue, surveillé l’accrochage et discuté avec les critiques et les amateurs. Le succès de l’exposition vient couronner leur engagement constant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la promotion de l’œuvre des hommes qui ont partagé leur vie.
Elle est une occasion de manifester l’importance historique et la vigueur contemporaine de l’art abstrait, non sans exacerber tensions et rivalités autour de son caractère novateur. Les Fenêtres, de Robert Delaunay, emblématiques de son passage à la peinture non figurative en 1912, accueillent les visiteurs du salon avant qu’ils ne plongent dans une explosion de couleurs avec Jaune, rouge, bleu, de Vassily Kandinsky, un tableau de 1925 peint au Bauhaus ; déambulant dans les salles suivantes, ils admirent, ici, les sculptures monumentales d’Otto Freundlich, et là, les compositions constructivistes de Theo van Doesburg, au milieu des créations des quatre-vingt-cinq autres exposantes et exposants.
Chaque samedi, The Conversation en mode week-end : un pas de côté sur l’actu pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Ce premier Salon des réalités nouvelles est aujourd’hui unanimement considéré comme l’un des moments clés de la bataille entre art figuratif et art abstrait, l’un des rassemblements les plus notables de chefs-d’œuvre de l’abstraction et un passage décisif de relais entre deux générations d’artistes. Pourtant, le rôle crucial qu’y ont joué les veuves d’artistes est passé sous silence, et peu de cas est fait de leur participation active à l’organisation de cet événement historique, comme d’ailleurs de l’ensemble de leur entreprise, après-guerre, pour la reconnaissance de l’abstraction en général et de la production de leur conjoint défunt en particulier.
Honneur aux travailleuses de l’ombre
Or l’invisibilité presque absolue, dans l’histoire de l’art telle qu’elle est racontée, enseignée et exposée de nos jours, du travail de ces femmes est en totale contradiction avec ce que révèle le contenu des archives des salons, des galeries et des musées qui, dans les trois décennies d’après-guerre, se mêlent d’art abstrait. Les veuves d’artistes y sont partout présentes : prêteuses d’œuvres pour les grandes expositions, négociatrices et courtières sur le marché de l’art, rédactrices de monographies et de notices détaillées, mémoires vivantes de la naissance de l’abstraction, mécènes enfin des plus importants musées du monde, elles ont déployé une activité intense qui a permis la notoriété posthume de leur conjoint, entré grâce à elles dans le panthéon de l’art moderne.
Telle est l’origine de mon livre Les Héritières de l’art abstrait : le constat qu’il existe des oublis massifs dans les récits actuels en vigueur, glorifiant des artistes – Vassily Kandinsky, Robert Delaunay, Theo van Doesburg et Otto Freundlich, entre autres – connus de tous les amateurs d’art moderne et dont les chefs-d’œuvre attirent des millions de visiteurs dans les musées qui les exposent. En omettant un moment intermédiaire, entre le temps de la création et celui de la consécration, on occulte surtout des figures, elles aussi intermédiaires, dont la contribution durant cet entre-deux a pourtant été décisive.
Tirer ces actrices méconnues de l’ombre dans laquelle elles ont été plongées doit permettre d’écrire une autre histoire de l’art moderne, plus inclusive et plus collective, en identifiant dans la chaîne patrimoniale, allant de l’atelier de l’artiste aux cimaises du musée, un maillon souvent oublié. Une enquête historique, au plus près des archives, s’imposait pour restituer leur place dans la société de l’époque, évaluer la portée de leur participation et s’interroger sous un angle nouveau sur la transformation effective et progressive d’une œuvre, par l’exposition, la valorisation et l’historicisation, en un patrimoine artistique commun et précieux. […]
L’importance cruciale des intermédiaires
Centrer le regard sur ces femmes qui, par leur âge, leur statut et leurs activités, sont en décalage avec les normes convenues de la définition d’un acteur du monde de l’art permet d’élargir la gamme connue des modèles et des moyens de contribuer à la diffusion de l’art. Leur situation matrimoniale singulière et la prégnance d’une fidélité conjugale dans le deuil et à travers le devoir de mémoire confèrent des motivations atypiques à leurs actions, qui sont parfois plus efficientes que celles de dits « professionnels » – qu’il s’agisse de conservation, d’exposition, de vente, d’écriture…
C’est finalement à une redéfinition plus large, plus inclusive et plus informelle de la figure du médiateur et de la médiatrice artistiques qu’invite la prise en compte de leurs réalisations.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
L’évocation du vaste répertoire de démarches qu’elles ont mobilisé, de l’exposition à la donation, en passant par l’édition et la vente, pour asseoir la notoriété de leur compagnon, contribue elle aussi à récuser l’idée selon laquelle le talent et le génie dans l’art « s’imposent » d’eux-mêmes et selon une sorte de fatale nécessité.
Bien au contraire, lumière est faite ici sur l’importance cruciale des intermédiaires qui travaillent à cette valorisation cumulative, celle des collaborations nouées et des stratégies employées. L’ensemble restitue l’épaisseur temporelle et humaine de ce travail de promotion, de visibilisation et de légitimation, qui s’étend sur des décennies. Donner à comprendre comment telle toile de Delaunay, de Kandinsky ou de van Doesburg est devenue un des chefs-d’œuvre de l’art moderne, c’est pointer que la valeur esthétique est une construction sociale, en évolution constante, tout comme le goût artistique dominant dont elle est dépendante : c’est le succès des stratégies et des démonstrations menées notamment par leurs héritières qui impose en Occident, et dans les aires culturelles qu’il domine culturellement, la postérité de ces pionniers de l’abstraction.
Bien d’autres femmes d’artistes mériteraient que leur travail soit sorti de l’ombre dans laquelle les cantonnent les récits en vigueur aujourd’hui.
« Les Héritières de l’art abstrait, Sonia Delaunay, Nina Kandinsky, Nelly van Doesburg et les autres », Julie Verlaine, Payot, 2025, 272 pages.![]()
Julie Verlaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[LE CROC D’IXÈNE] Boualem Sansal condamné à 5 ans de prison](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/03/bv85-sansal-5-ans-vign-516x482.jpg?#)



















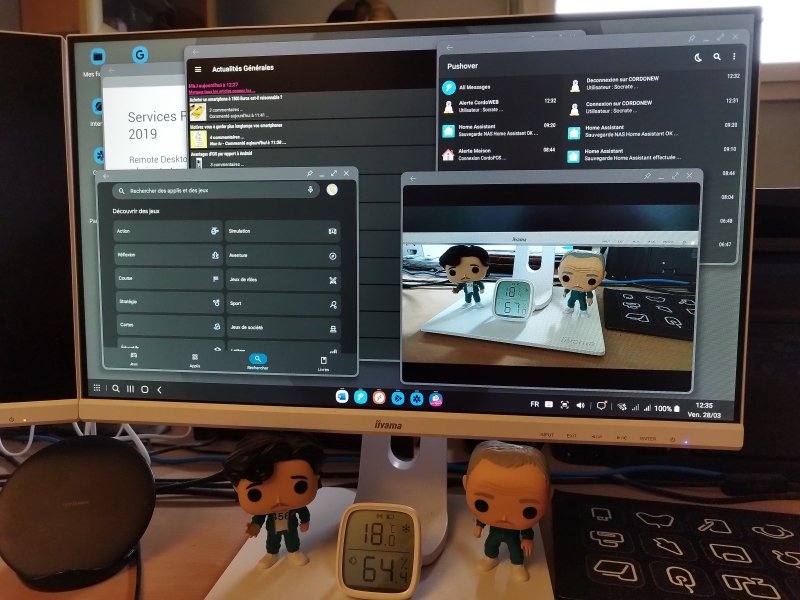



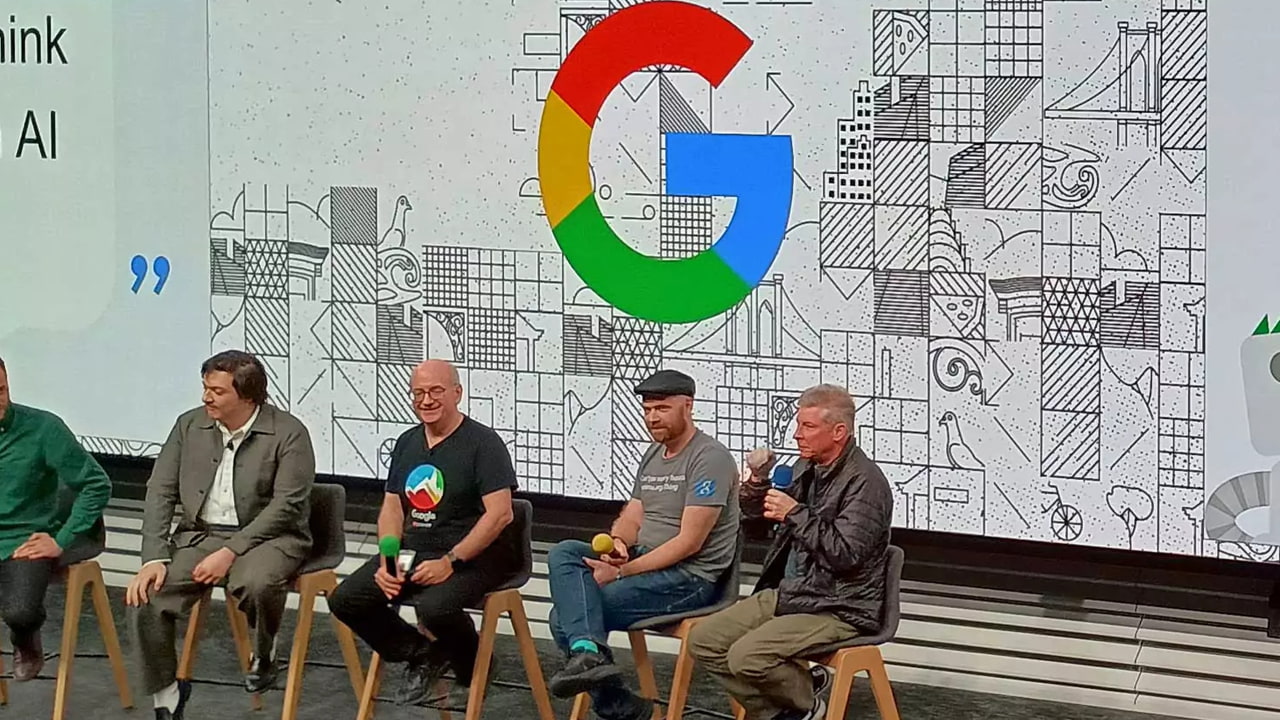





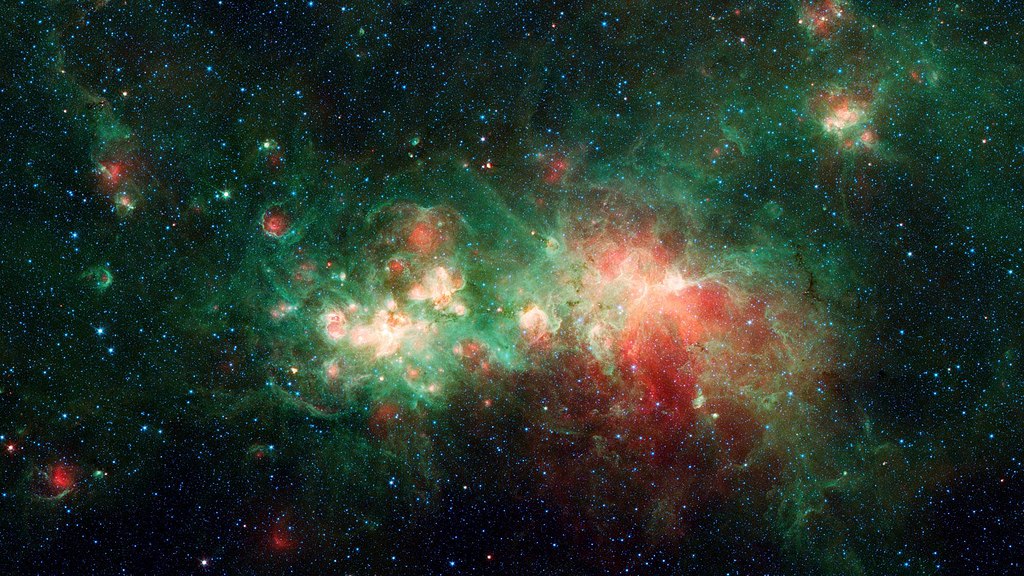


/2025/03/27/maxstockworld334610-67e5b32c7bd77272993031.jpg?#)
/2025/03/24/000-37bx9g2-67e0f36f833fb558088364.jpg?#)
/2025/03/28/184338-lire-lolita-a-te-he-ran-4-67e67a504ff86642805619.jpg?#)
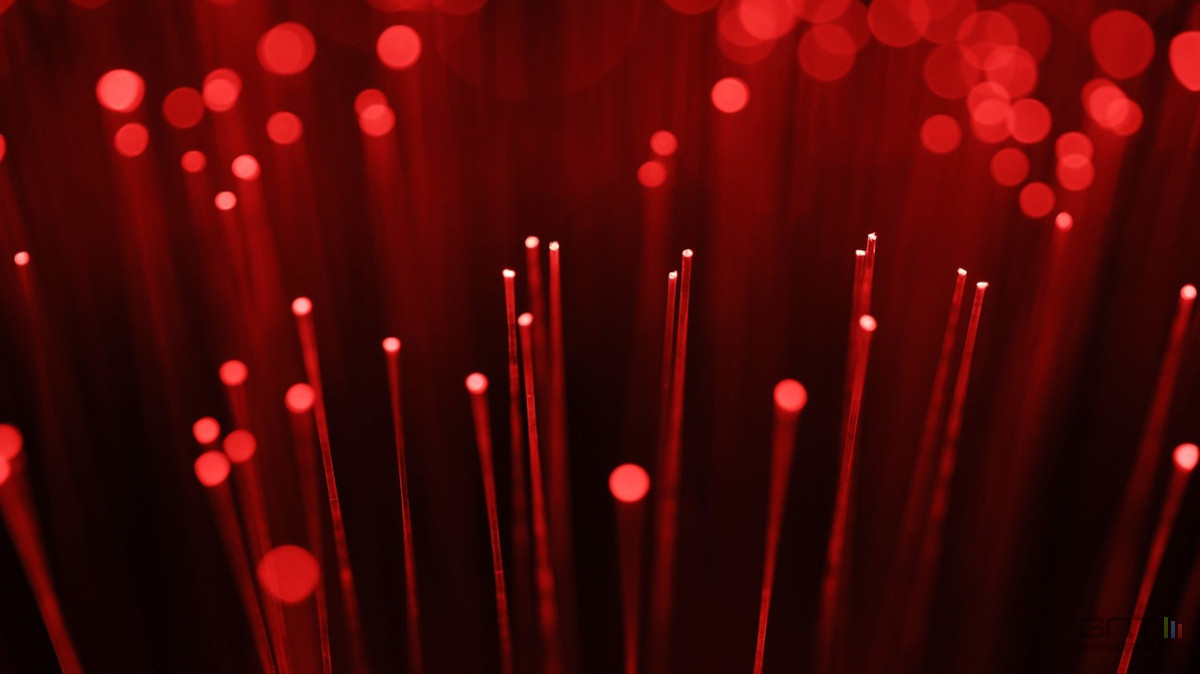


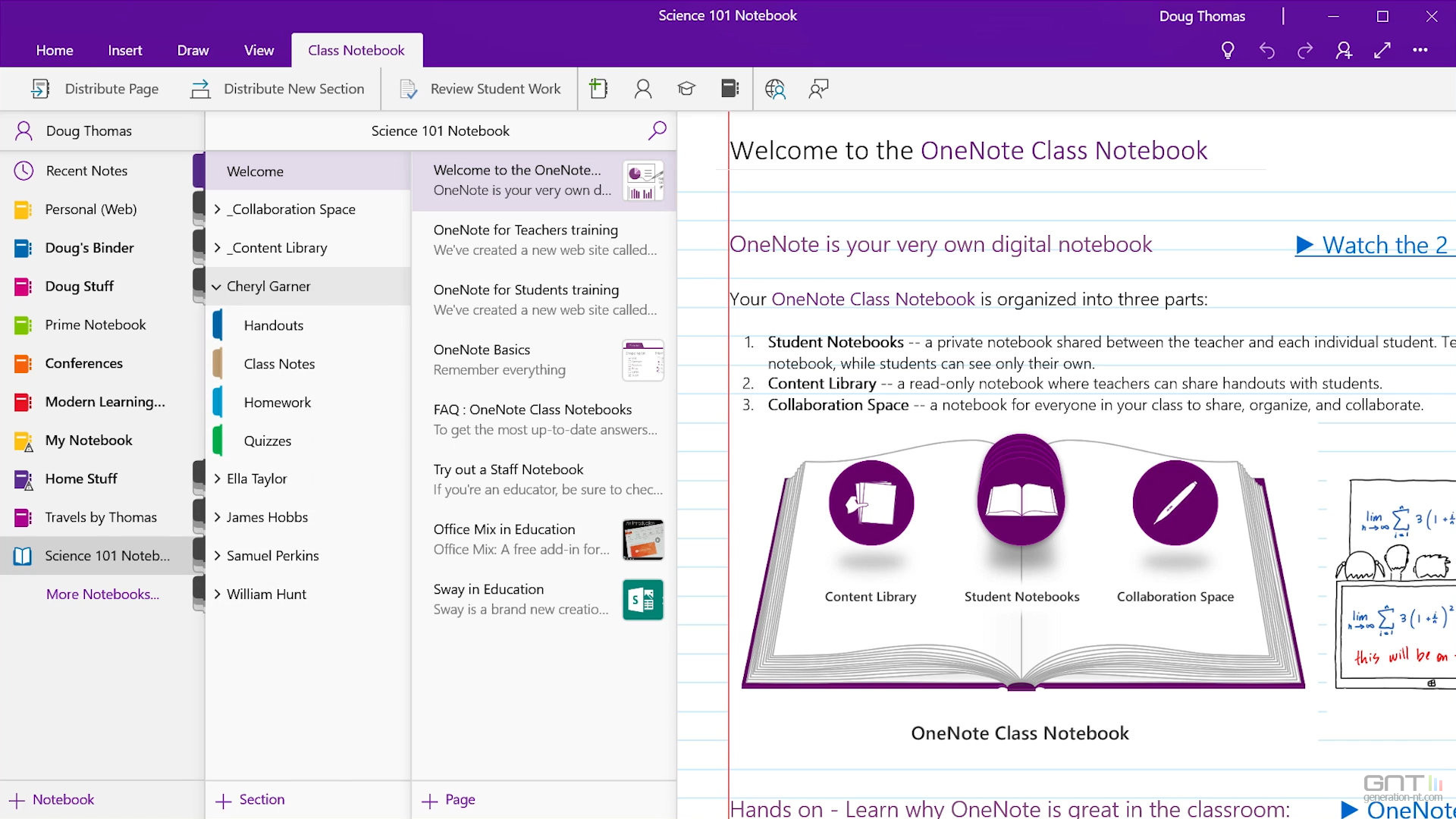


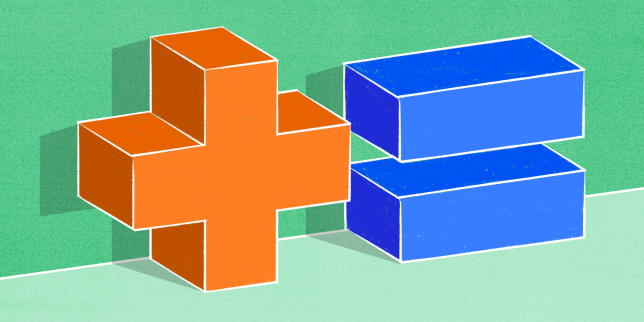








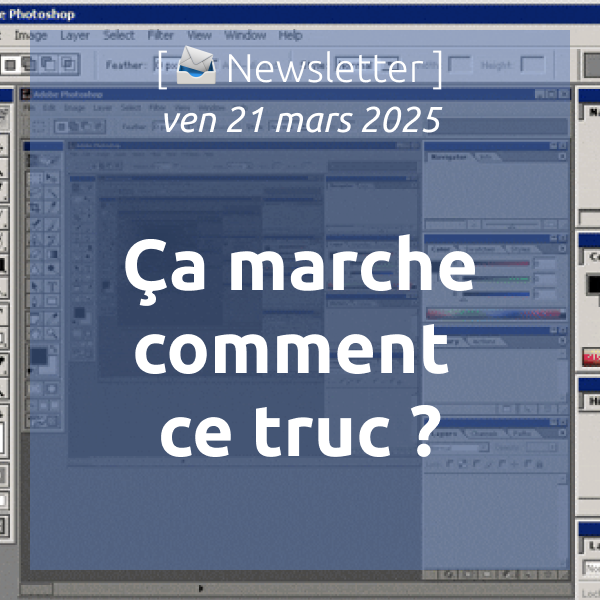



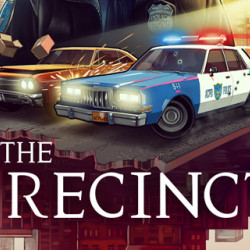






/2025/03/25/60fa922dd7a74840d2f8ed6a2d90dcde24214fcb59668bb67267dc1de26f175c-67e2540b1f263779931537.webp?#)

