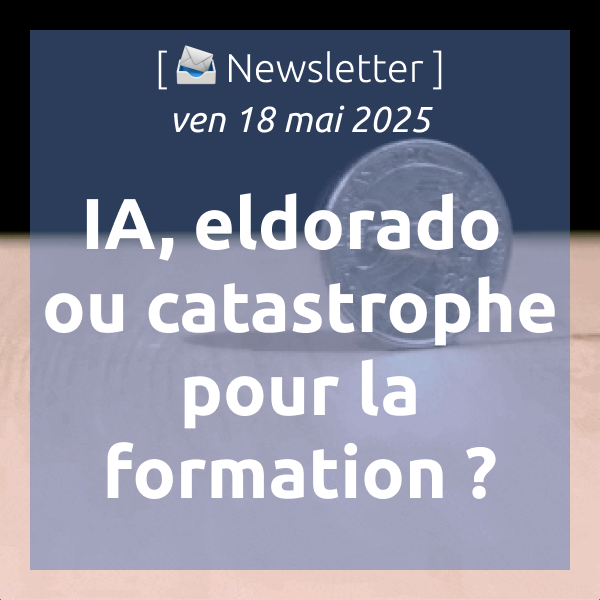Plongée dans le quotidien des humains de la Préhistoire, il y a 40 000 ans
Loin du cliché d’individus errant au hasard, les « Homo sapiens » ont constitué des sociétés complexes, faites de réseaux de relations à grandes distances, d’outils et d’art.

Ces dernières années, de fulgurantes avancées technologiques et méthodologiques ont permis de profondément renouveler la connaissance du quotidien des Homo sapiens du Paléolithique. Nomades, vivant en groupe, capables de créer outils et peintures et dotés du même cerveau que nous, les humains de l’époque étaient déjà des êtres complexes qui vivaient au sein de sociétés connectées.
Combien de visions caricaturales parsèment les représentations sur la Préhistoire ? Des groupes errant au gré du hasard, poursuivis par des hordes d’animaux tous plus dangereux les uns que les autres ; un climat hostile et des territoires inhospitaliers au sein desquels se déplaceraient des humains pas vraiment adaptés, vaguement recouverts de morceaux de peaux informes et que l’on voit parfois marcher les pieds nus dans la neige… Et que dire encore de leurs onomatopées si éloignées d’un véritable langage ? Une véritable survie en terre hostile !
Ces représentations sont à des années-lumière de ce que la communauté des sciences du passé construit patiemment depuis des décennies. Science jeune, la préhistoire s’est construite depuis la fin du XIXᵉ siècle, moment où est entérinée l’ancienneté de l’être humain, de ses outils, mais aussi, déjà ! de sa pensée puisqu’on lui attribue alors, après moult controverses, la réalisation de représentations graphiques figuratives sur les parois des cavernes.
Depuis, d’autres tournants ont eu lieu ; notamment dans les années 1950, avec la mise au point révolutionnaire de la méthode de datation par carbone 14 permettant enfin de situer dans le temps des phénomènes. Et que dire des fulgurantes avancées technologiques et méthodologiques qui scandent les sciences ce dernier quart de siècle et qui ont transformé en profondeur ma discipline ?
Aujourd’hui, le scientifique préhistorien est comme le chef d’orchestre d’une vaste enquête policière, mettant en rythme et en musique toute la gamme des spécialités, construisant instrument après instrument les savoirs sur les sociétés du passé. Car, désormais, on séquence l’ADN de Néandertal et de Sapiens et on réfléchit à la façon dont ces humains si dissemblables anatomiquement se sont métissés et ont laissé une descendance féconde ; on reconstruit les saisons de chasse et les environnements au sein desquels chasseurs et proies se rencontrent ; les instruments microscopiques ont de longue date remplacé l’œil nu pour identifier la fonction des outils en pierre, en os ou en ivoire. Enfin, car la liste est trop longue pour être énumérée ici, on utilise toutes les technologies d’imagerie 3D pour inventorier dans le moindre détail les squelettes.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Les Sapiens de la culture de l’Aurignacien
Ce que ces avancées permettent, c’est une vision profondément renouvelée du quotidien de la Préhistoire. Remontons donc le temps et installons-nous dans le sud-ouest de la France, il y a 40 000 ans.
Des groupes d’Homo sapiens initialement originaires d’Afrique, avec la peau foncée adaptée au fort rayonnement UV des milieux tropicaux et équatoriaux, sont installés là depuis quelques générations.
D’un point de vue anatomique, les Sapiens du Paléolithique récent nous ressemblent beaucoup, au point qu’ils passeraient sans doute inaperçus s’ils étaient déguisés en humains du XXIe siècle. Ils ont aussi la même conformation cérébrale que nous et sont donc pareillement intelligents. Des êtres complexes en somme.
Ce sont aussi des nomades, qui déplacent régulièrement leurs campements selon les saisons et les activités qu’ils souhaitent réaliser. En Dordogne, là où nous connaissons bien ces Sapiens de la culture de l’Aurignacien (l’Aurignacien est la première culture paneuropéenne d’Homo sapiens, elle tire son nom du petit abri d’Aurignac, en Haute-Garonne où elle a été définie pour la première fois au début du XXᵉ siècle), les groupes humains ne vivent pas en grotte, mais s’installent en plein air, souvent dans des emplacements stratégiques facilitant une bonne acuité visuelle sur les troupeaux de rennes et de chevaux progressant dans les environs.
À cette époque, la démographie est sans doute faible, les derniers modèles proposent une densité autour de 5 individus tous les 100 km2 ! Autant dire qu’il devrait être plus fréquent d’apercevoir un renne que les membres d’un groupe voisin. Nous savons pourtant que ces groupes disposent de réseaux sociaux denses et entretenus.
À lire aussi : À la découverte de la plus ancienne sépulture africaine datant de 78 000 ans
Comment le sait-on ? Eh bien, pour cela, intéressons-nous à un matériau privilégié des Aurignaciens : le silex. Nos Sapiens étaient des experts de la taille qui demande un long apprentissage pour disposer des compétences et savoir-faire indispensables à la réussite du projet. Ils taillent avec dextérité de longues lames régulières, aux bords bien parallèles, dont la forme et la taille sont conçues à l’avance en aménageant soigneusement le bloc à tailler.
Une fois l’outil obtenu – une lame tranchante pour découper, un grattoir pour épiler et dégraisser les peaux –, il est en général placé et fixé dans un manche en bois, à l’aide de colles végétales et de liens en cuir. Ces technologies demandent donc des outils en silex standardisés qui peuvent être facilement remplacés quand ils sont usés ou cassés.

Échanges d’outils
Les silex ont ceci de remarquable qu’on peut aussi identifier leur lieu d’origine. Et en observant la trousse à outil d’un Aurignacien périgourdin, occupant un abri du vallon de Castel-Merle (Dordogne), on constate aisément la pluralité des origines des silex qui la composent. On y trouve évidemment des silex disponibles localement, mais aussi en plus faible proportion des silex d’origine régionale, de la région de Bergerac à une cinquantaine de kilomètres.
Plus surprenant, on retrouve de beaux outils dans des variétés qui ne sont connues qu’à plusieurs centaines de kilomètres du site et qui ont été acquis de proche en proche, sans doute par échange, lorsque des groupes éloignés se rencontrent. Là, ce ne sont pas des blocs de silex qui s’échangent mais bel et bien des lames ou des outils prêts à l’emploi selon des réseaux qui relient la vallée de la Vézère à la région de Saintes en Charente, à quelques 150 km au nord-ouest ou à la Chalosse (Landes) au sud-ouest à plus de 250 km.
À lire aussi : Nouvelle découverte dans la vallée du Rhône : les Homo sapiens d’Europe tiraient déjà à l’arc il y a 54 000 ans
Ces observations conduisent à concevoir des groupes mobiles sur de vastes territoires, établissant des rencontres saisonnières avec d’autres clans qui exploitent des niches écologiques différentes.

Des parures qui indiquent le statut social
Ces interconnexions sociales ont conduit les Aurignaciens à concevoir et fabriquer des objets capables de diffuser des informations sur leur statut individuel et collectif. À Castel-Merle, ils ont fabriqué par milliers de toutes petites perles en ivoire, en forme de panier, qui viennent orner des coiffes, des vêtements, ou sont assemblées en colliers.
Ces parures sont ainsi un moyen d’encoder de l’information pour la transmettre à d’autres individus. Et pas n’importe lesquels ! Inutile de le faire pour les membres de votre propre groupe qui connaissent tout de votre statut social. Il en va de même pour des individus d’une autre culture qui ne comprendraient pas votre message. Non, à l’Aurignacien, les parures sont des vecteurs pour communiquer des informations d’ordre social avec des individus de votre culture mais qui ne sont pas des connaissances proches.
Cela explique aussi que selon les régions européennes où l’Aurignacien s’épanouit, des types de parures spécifiques s’individualisent et rendent compte de groupes régionaux, mettant possiblement en scène des ethnies parlant des langues différentes.
Ces sociétés s’épanouissent donc au sein de réseaux de relations à longue distance et les équipements en pierre comme les parures circulent sur de vastes territoires, suggérant des déplacements de personnes, des échanges et sans doute le développement de nouvelles règles de parentés régies par l’exogamie. Ces changements proprement anthropologiques, qui se manifestent si puissamment lors de l’Aurignacien, rendent compte du succès que connut cette culture qui accompagna le développement des Sapiens sur toute l’Eurasie occidentale, concomitamment à la dilution progressive du pool génétique néandertalien jusqu’à l’extinction totale de cette anatomie ancestrale. On peut ainsi penser que la démographie des Aurignaciens et leur organisation sociale favorisant la circulation des biens et des personnes ont nettement contribué à l’extinction de Néandertal.
Les premiers artistes
Après quelques millénaires de développement de la culture aurignacienne, ces mutations sociales vont donner lieu à l’apparition, sur le continent européen, du phénomène sans doute le plus marquant que nous ont laissé ces sociétés. Je veux ici parler de l’explosion artistique à laquelle on assiste à partir de 36 000 ans avant le présent. Ce premier art figuratif revêt des formes variées : des animaux réalistes sont sculptés dans de l’ivoire, des dessins sont tracés sur des équipements techniques et, surtout, des fresques sont peintes comme c’est le cas dans l’emblématique grotte Chauvet (Ardèche).
Cet art du dessin, réalisé à coup sûr par des spécialistes, inaugure une nouvelle manière d’appréhender le monde et de retranscrire des éléments de compréhension dans une grammaire artistique. Il s’agit là sans doute de la signature archéologique très probable d’un grand mythe d’origine au monde, originaire d’Afrique et que les Aurignaciens de Chauvet avaient en tête au moment de réaliser leurs sensationnelles peintures.
Ce tableau vivant révèle des sociétés aurignaciennes pleinement entrées dans l’Histoire. Loin des caricatures souvent proposées, il présente une vision renouvelée du quotidien de nos ancêtres il y a 40 000 ans, régi par un haut degré de technicité, des savoir-faire appris et partagés et une structure sociale évidente. Un temps où il y avait des spécialistes et sans doute des hommes et des femmes dépositaires de savoirs, et donc d’un statut, auquel tous les membres du groupe ne pouvaient prétendre.
Des groupes nomades régnant dans des steppes froides et giboyeuses, parfaitement adaptés à cet environnement glaciaire et développant des moyens de communication illustrant des réseaux de relations à grandes distances faits d’objet et d’individus circulant au sein d’immenses espaces. On le voit, on est bien loin de l’image d’individus errant au hasard puisque l’on est ici en face de sociétés complexes et pleinement modernes.
L’auteur de cet article a récemment publié Dans l’intimité de Sapiens. Vivre, il y a 40 000 ans (éditions Alisio).
Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.![]()
Nicolas Teyssandier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.



.jpeg?#)




![[CINÉMA] Doux Jésus, une comédie inoffensive mais au discours éculé](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/doux-jesus-616x308.jpg?#)
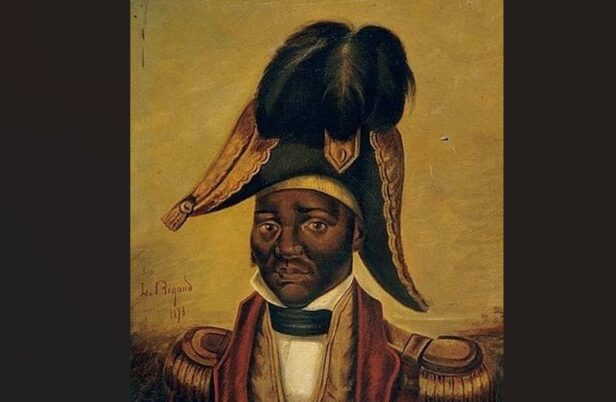
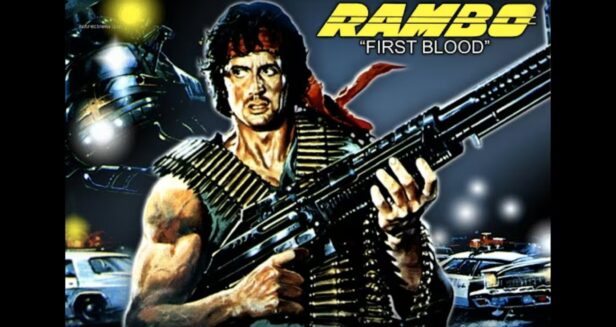
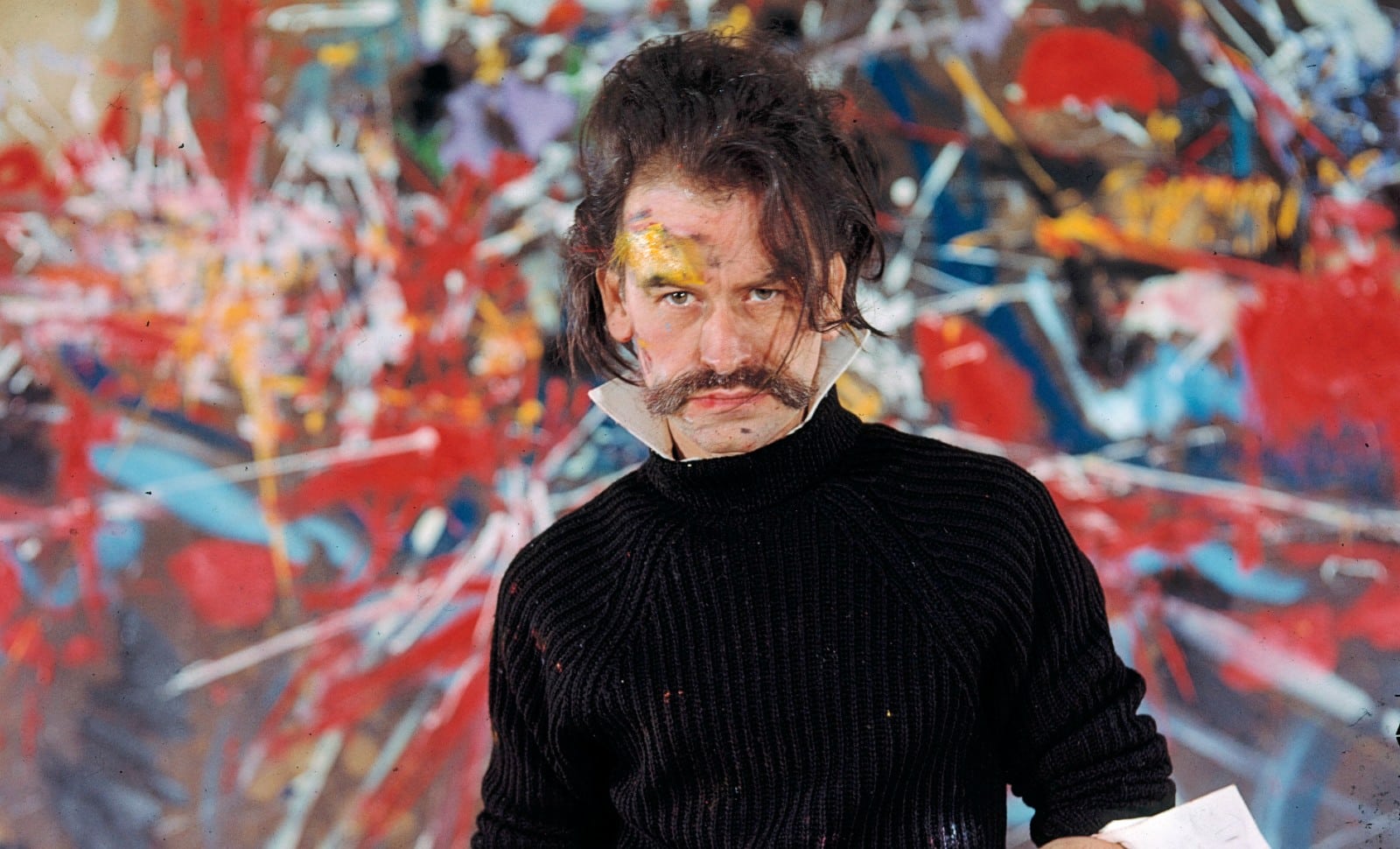






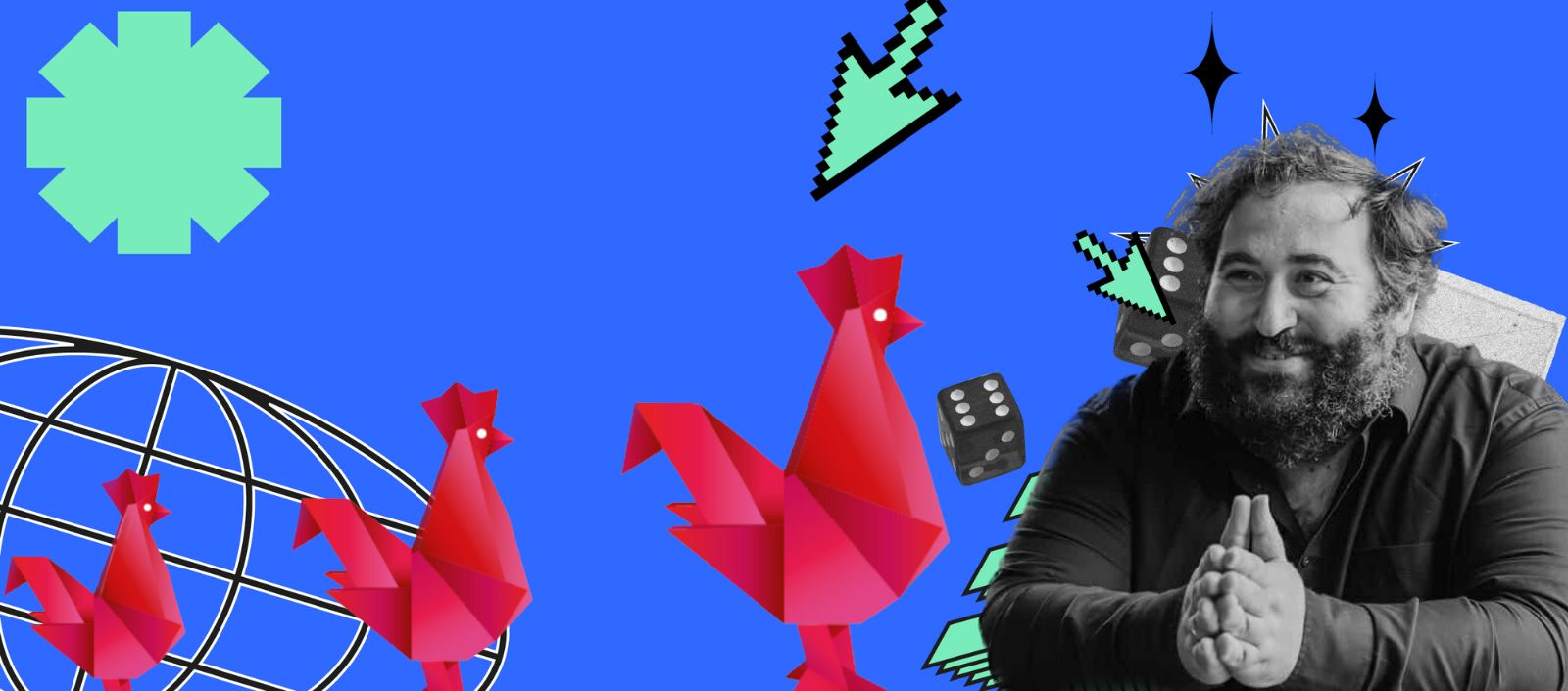





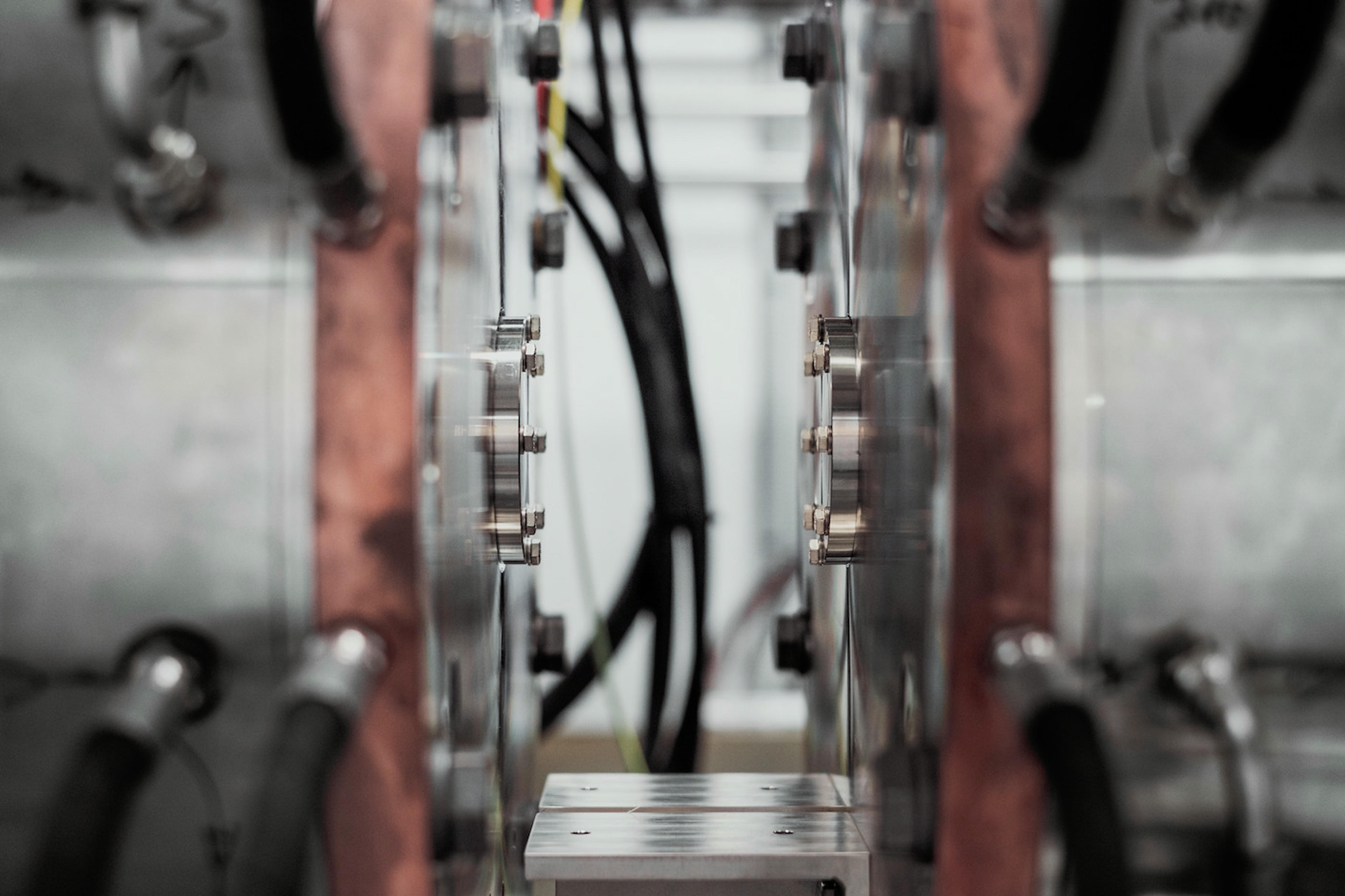
















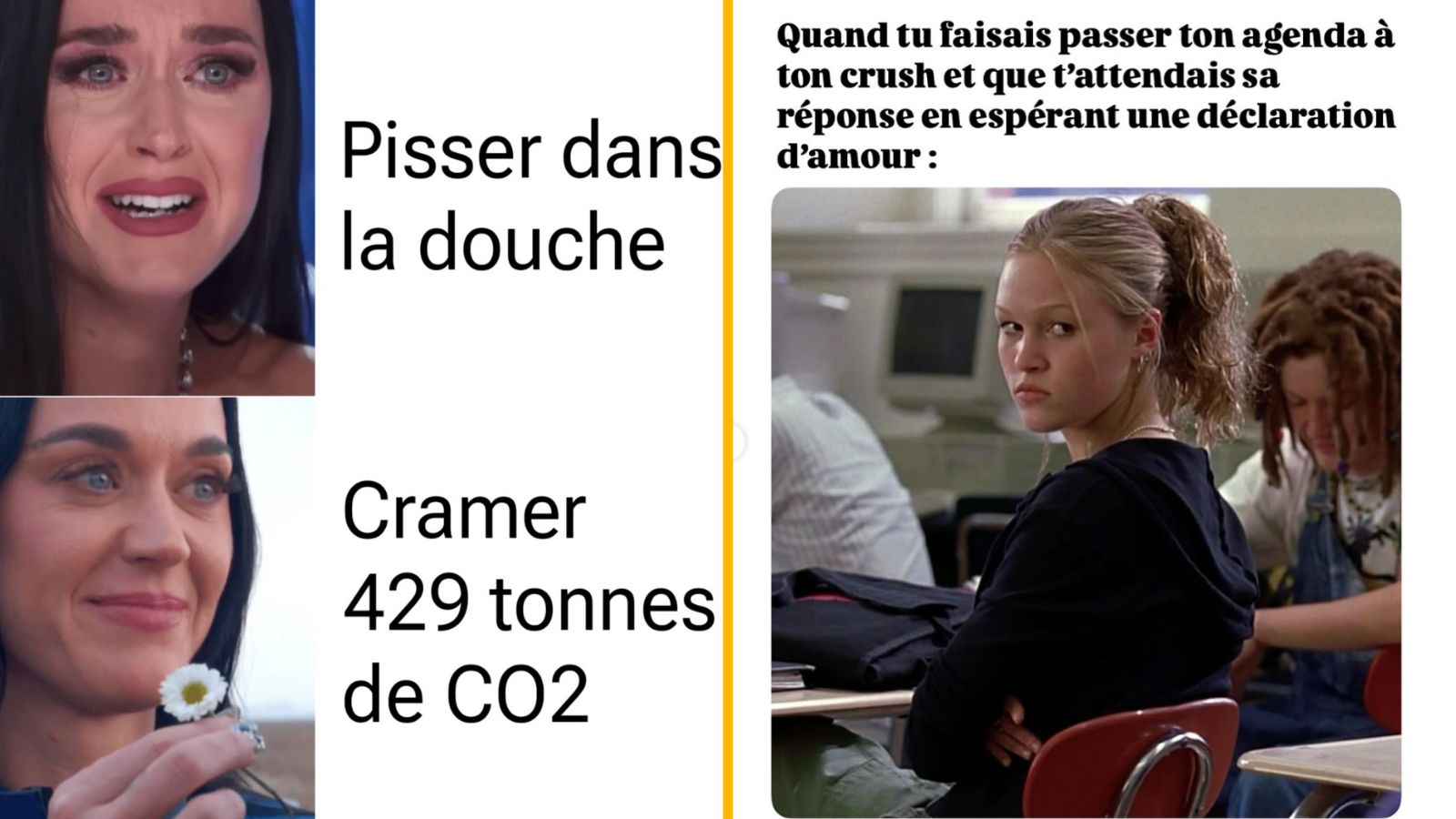

/2025/04/16/v2-photo-mougin-veronique-1-3-67ff87405785a263011726.jpg?#)
/2025/04/20/cinema-les-dents-de-la-mer-de-steven-spielberg-a-voir-depuis-une-piscine-une-chasse-aux-oeufs-geante-au-chateau-de-merville-en-haute-garonne-6804ef5932020062012918.jpg?#)