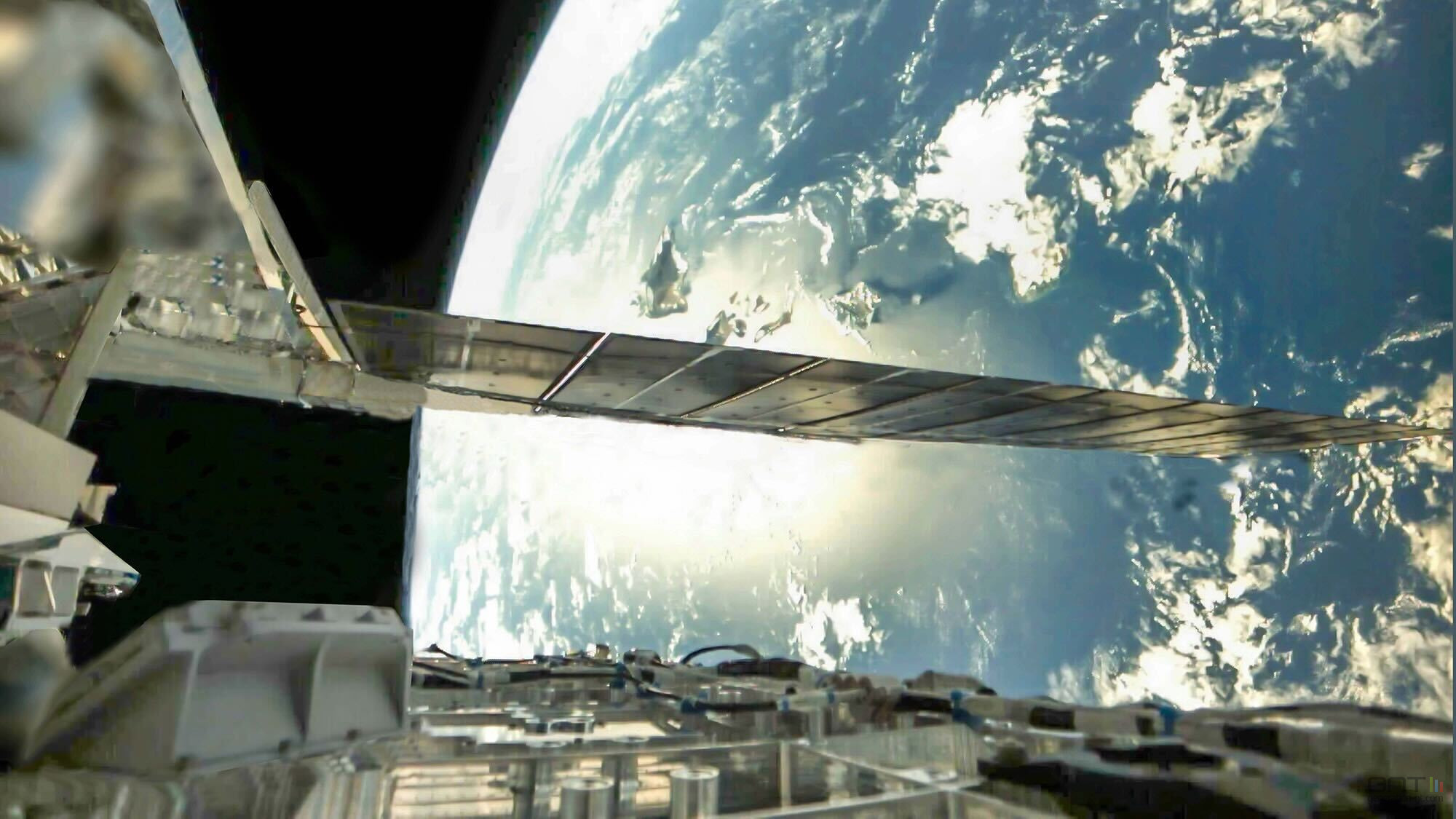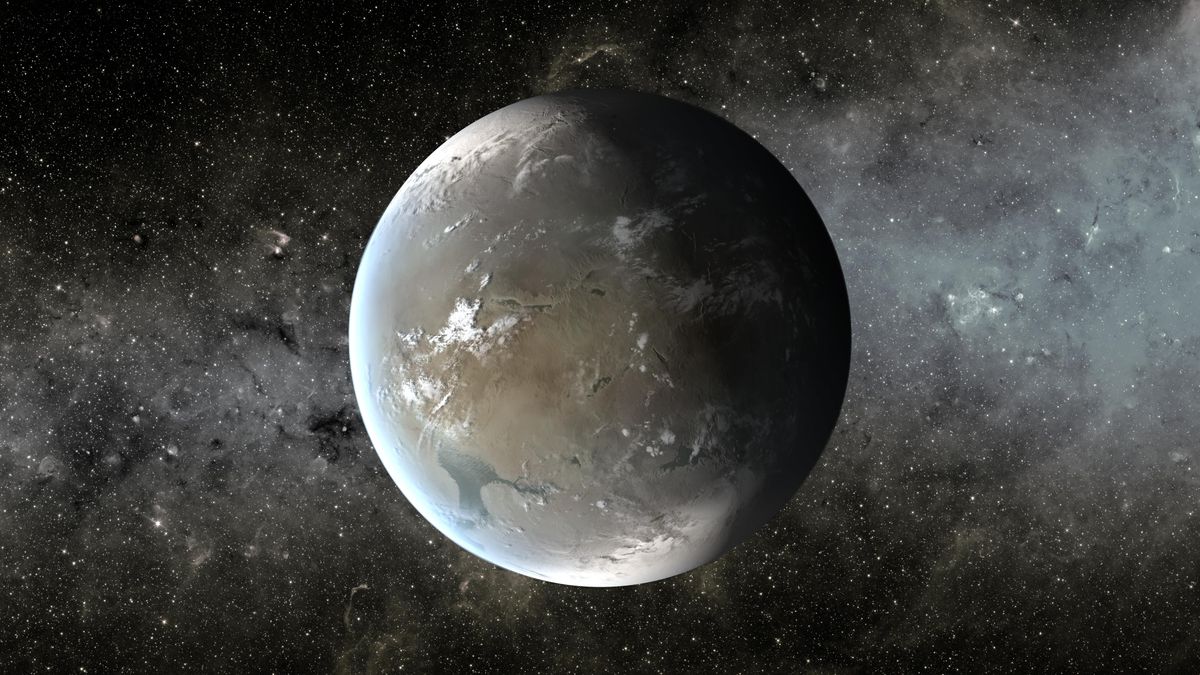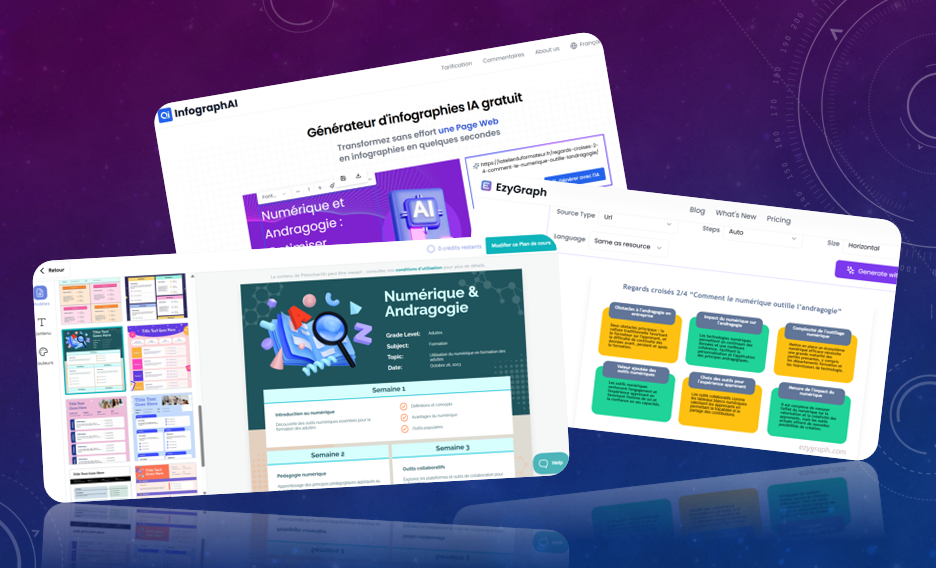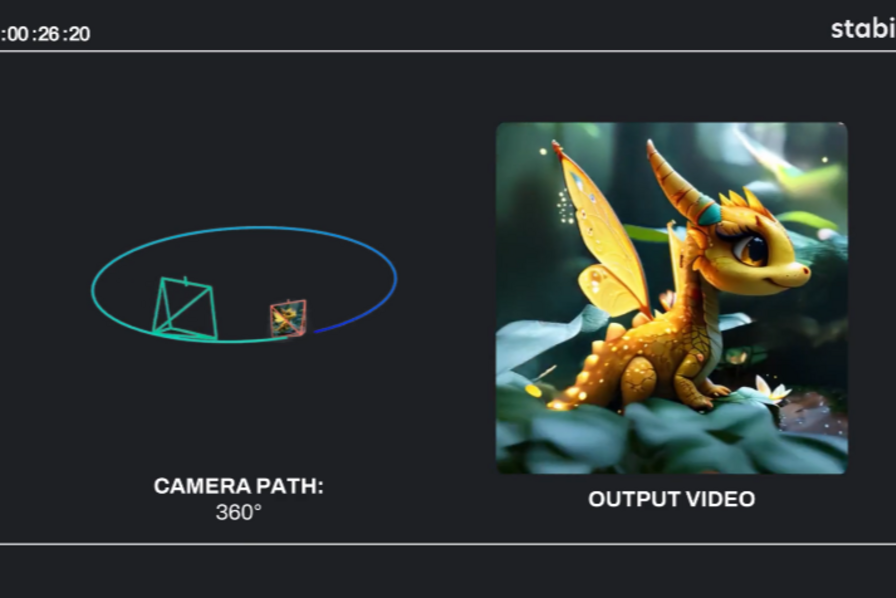Le train survivra-t-il au réchauffement climatique ?
Les conditions climatiques menacent de plus en plus les infrastructures ferroviaires, alors que le train est appelé à jouer un rôle majeur pour lutter contre le réchauffement. Et la France tarde à agir.

Alors qu’il est un allié incontournable de la lutte contre le changement climatique, le transport ferroviaire est aussi victime de ses effets. Les incidents liés aux aléas climatiques se multiplient, mais la France tarde à agir.
Ce lundi 31 mars, les voyageurs pourront de nouveau traverser en train la frontière franco-italienne. Depuis un an et demi, la ligne Paris-Milan était interrompue en raison d’un impressionnant éboulement survenu sur ses voies en août 2023. Loin d’être un événement isolé, ce type d’incidents se multiplie au fur et à mesure que les effets du réchauffement climatique s’intensifient.
Face à cette situation, il est urgent que l’ensemble des acteurs de la filière ferroviaire (entreprises, collectivités, États…) se mobilise pour adapter les infrastructures à des conditions climatiques de plus en plus imprévisibles et violentes. Et ce, à une période où le nombre de voyageurs ne cesse de croître.
Si certains pays européens se sont déjà engagés dans cette voie, la France tarde à passer à l’action.
Le train, allié majeur de la décarbonation
La situation est d’autant plus paradoxale que le train constitue un levier important dans la lutte contre le changement climatique. Un trajet en train émet en moyenne 95 % de CO₂ en moins que lorsqu’il est effectué en voiture. Le ferroviaire est donc un incontournable de la décarbonation des mobilités.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Un enjeu majeur, puisque le secteur des transports demeure le premier contributeur aux émissions françaises de gaz à effet de serre, comptant pour 30 % du total national. Il est l’un des rares domaines dont ce chiffre ne diminue pas. Plus inquiétant, sa tendance est même à la hausse depuis trois décennies.
Un moyen de transport de plus en plus plébiscité
Les voyageurs ne s’y trompent pas. Selon une étude réalisée en 2023 pour la SNCF, 63 % d’entre eux disent prendre le train par conviction écologique. Une autre enquête, ayant sondé une plus large partie de la population française, nous apprend que 83 % des répondants reconnaissent les bénéfices écologiques de ce mode de transport.
Chaque année, le trafic ferroviaire de voyageurs bat des records dans notre pays. Selon l’Autorité de régulation des transports, il a progressé de 21 % pour les trains du quotidien et de 6 % pour l’offre à grande vitesse entre 2019 et 2023.
A contrario, le transport de marchandises poursuit son inexorable chute, -17 % en un an.
Des infrastructures menacées par le changement climatique
Plusieurs raisons expliquent cette forte rétractation des services ferroviaires de fret : hausse des coûts de l’énergie, mouvements sociaux… et éboulement sur la ligne Paris-Milan.
Le trafic de voyageurs est lui aussi de plus en plus impacté par des conditions météorologiques toujours plus extrêmes. Interruption totale des circulations en janvier 2025 en raison des inondations en Ille-et-Vilaine, déraillement d’un TER à cause d’une coulée de boue en juillet 2024 dans les Pyrénées-Orientales suivi des deux accidents similaires en octobre en Lozère puis dans l’Aisne… Les exemples ne manquent pas dans l’actualité récente.
Si des aléas de ce type ont toujours existé, leur fréquence et leur intensité augmentent avec l’amplification du changement climatique. Quelle que soit la trajectoire des scénarios du GIEC empruntée, nous savons que cette tendance se poursuivra dans les décennies à venir, de façon plus ou moins marquée en fonction de la vitesse de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Les intempéries pourraient ainsi multiplier de 8 à 11 fois les perturbations ferroviaires d’ici à 2100.
Les risques portant sur le réseau sont multiples et concernent à la fois les voies, les télécommunications, les ouvrages et l’alimentation électrique. Parmi les principales menaces, citons la déformation des voies en raison de fortes chaleurs, la déstabilisation des sols provoquée par des cycles de gel-dégel ou de fortes pluies ainsi que d’importants dégâts causés par des incendies et des tempêtes.
En France, l’émergence timide d’une stratégie d’adaptation
La SNCF et ses 27 000 kilomètres de lignes se retrouvent en première ligne face à ces catastrophes. Bien que variable d’une année à l’autre, leur coût direct est estimé annuellement entre 20 millions et 30 millions d’euros.
Un document stratégique d’une trentaine de pages a été publié par SNCF Réseau l’an dernier. Il projette une adaptation à un réchauffement moyen pouvant atteindre +4 °C à l’horizon 2100. Cette feuille de route a été élaborée en collaboration avec Météo France, avec qui la SNCF se met systématiquement en lien en cas d’alertes météorologiques.
L’échange de données est également au cœur de cette stratégie. Un outil d’alerte baptisé Toutatis a par exemple été conçu pour surveiller les voies en cas de fortes pluies. Son homologue Predict anticipe quant à lui les risques de crues dès que certains seuils pluviométriques sont atteints.
Un sous-investissement chronique dans le réseau
Pas de quoi pour autant convaincre la Cour des comptes qui, en 2024, a alerté la SNCF sur l’absence d’un plan d’adaptation structuré intégrant le climat futur. Le rapport souligne également le manque d’informations sur les coûts climatiques.
La juridiction rejoint l’Autorité de régulation des transports sur le sous-investissement chronique dont est victime le réseau français, ce qui renforce mécaniquement sa vulnérabilité. Un milliard d’euros serait encore manquant pour en stabiliser l’état, et ce, alors que son âge moyen est toujours de 28,4 ans.
Déjà en 2019, une équipe de chercheurs avait mené une étude de cas à ce sujet. Leurs résultats mettaient en lumière un important décalage entre les discours de la SNCF et la faible intégration des connaissances scientifiques dans sa gestion ferroviaire. Elle se ferait encore de façon incrémentale, sans transformations profondes, et à partir d’expériences passées plutôt que des projections climatiques futures.
Des initiatives inspirantes dans les pays voisins
Les inspirations d’adaptation venues de nos voisins européens ne manquent pourtant pas. En Belgique et en Italie, les rails sont par exemple peints en blanc afin de limiter l’accumulation de chaleur et, in fine, leur dilatation.
La Suisse propose une solution alternative en refroidissant les rails avec un véhicule-citerne en cas de fortes chaleurs. La Confédération helvétique ainsi que l’Autriche (avec laquelle elle partage un relief accidenté) se sont engagées dans une démarche d’atténuation visant à davantage protéger les lignes des avalanches et des glissements de terrain tout en améliorant les systèmes de drainage. Cela passe notamment par le renforcement des forêts – un véritable bouclier protecteur – et des ouvrages existants.
Autant de choix politiques structurants qui ont été réalisés dans des pays où l’investissement en faveur du ferroviaire est de 2 à 9 fois plus important qu’en France. Il est donc plus que jamais nécessaire de s’engager dès à présent dans une stratégie d’adaptation plus systémique.
Vers une stratégie européenne d’adaptation ?
C’est tout l’objet d’un projet européen baptisé Rail4EARTH. Il fait le pari de l’innovation et de la rapidité d’action. Mais le chemin à parcourir est encore long pour que cette ambition se traduise en véritable feuille de route opérationnelle à l’échelle de notre continent.
L’application des données climatiques – actuelles comme futures – au secteur du ferroviaire demeure imparfaite. Le développement d’une gouvernance intégrant des experts en climatologie est souhaité par la SNCF, qui fait partie des partenaires de ce projet.
Il y a urgence à agir. Comme l’a démontré une étude britannique, l’adaptation des infrastructures ferroviaires aux différents scénarios du GIEC est souvent surestimée. Elles sont donc plus vulnérables que ce que les projections laissent penser.
Une raison de plus, s’il en fallait une, pour s’engager dès à présent dans un plan d’action à l’échelle européenne afin de continuer à faire du train un levier majeur de décarbonation de nos déplacements dans un monde qui ne cesse de se réchauffer.![]()
Mathis Navard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.




























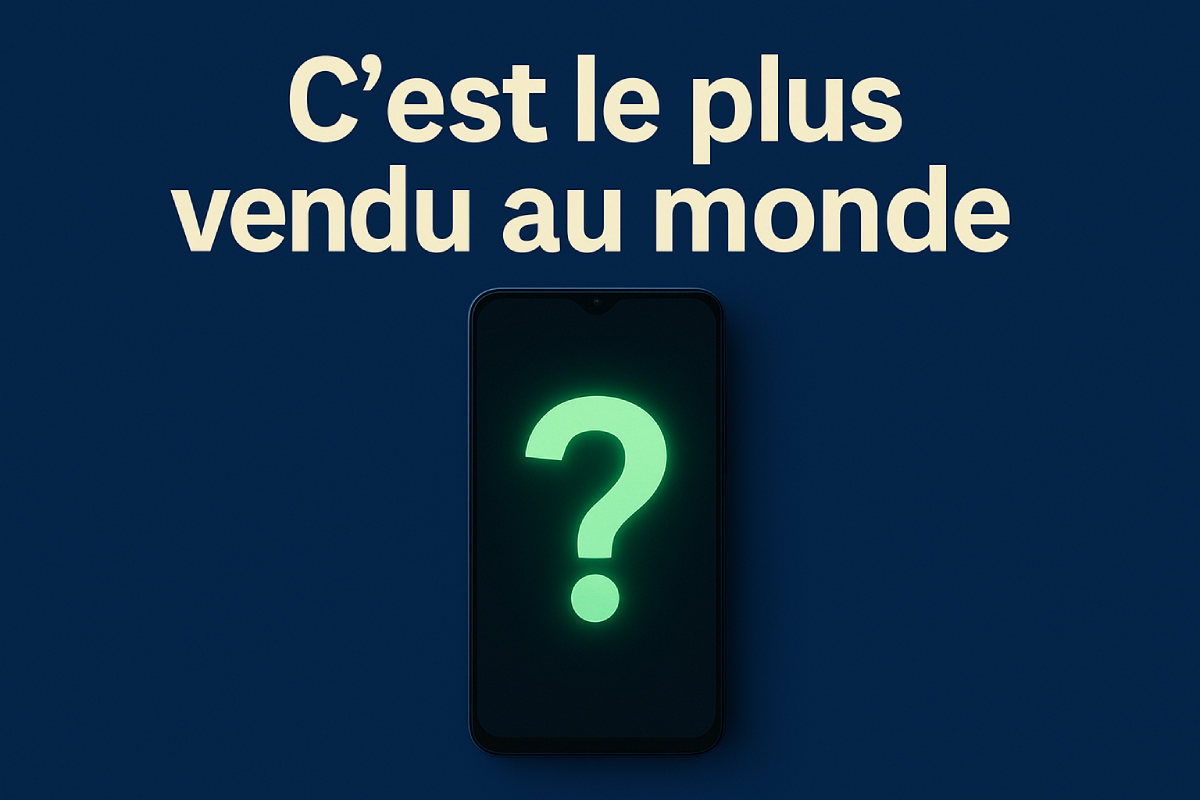






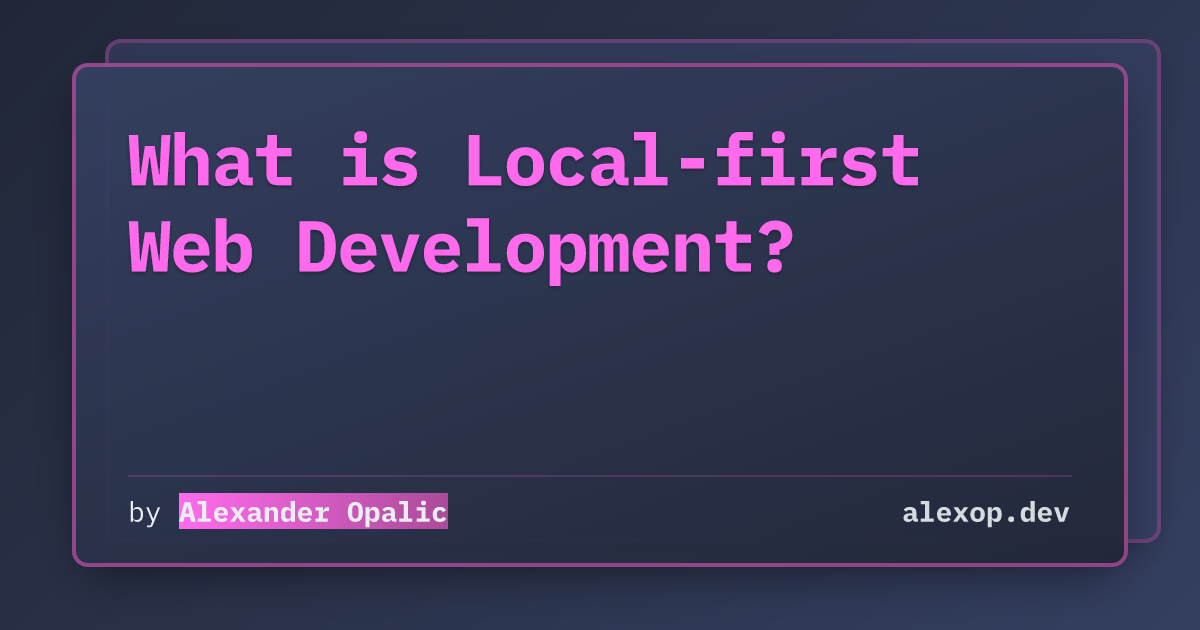









/2025/04/01/camille-kouchner-c-benedicte-roscot-01s-67eb8cd232c91205283124.jpg?#)