Conversation avec Alain Aspect : des doutes d’Einstein aux GAFAM, où s’arrêtera la physique quantique ?
Alain Aspect, Prix Nobel de physique 2022, revient sur quelques étapes marquantes de sa carrière, sur les limites du monde quantique et sur l’essor des technologies quantiques aujourd’hui.

Alain Aspect est spécialiste de physique quantique. En 2022, il a obtenu le prix Nobel de physique pour ses travaux sur le phénomène d’« intrication quantique », qui est au cœur de nombreuses technologies quantiques de nos jours.
Il a aussi plus largement contribué au domaine, souvent en explorant d’autres situations où les prédictions de la physique quantique sont très éloignées de notre intuition du monde physique. À cause de cette étrangeté, la physique quantique est souvent considérée comme inaccessible.
Dans cet entretien, sans prétendre tout expliquer de la mécanique quantique, Elsa Couderc et Benoît Tonson, chefs de rubrique Sciences et Technologies, espéraient transmettre ce qui fait le sel de la physique quantique et qui attise les passions encore aujourd’hui. Alain Aspect a bien voulu se prêter au jeu et revenir avec eux sur quelques étapes marquantes de sa carrière, les limites du monde quantique et l’essor des technologies quantiques aujourd’hui, entre recherche publique et recherche industrielle.
Tous les quinze jours, des grands noms, de nouvelles voix, des sujets inédits pour décrypter l’actualité scientifique et mieux comprendre le monde. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui !
The Conversation : Pour aborder les travaux qui vous ont valu le prix Nobel, il faut revenir un peu en arrière, aux débuts de la théorie quantique. En effet, au tout début du XXe siècle, deux pères fondateurs de la physique quantique, Albert Einstein et Nils Bohr, s’écharpaient sur l’interprétation de la nouvelle théorie. Un des points de désaccord était lié au phénomène d’« intrication quantique ». L’intrication quantique, c’est le fait que deux particules séparées dans l’espace partagent des propriétés — à un point tel que l’on ne peut pas décrire complètement l’une sans décrire l’autre : il faut les décrire comme un tout. Einstein avait un problème avec cette idée, car cela signifiait pour lui que deux particules intriquées pourraient échanger de l’information instantanément sur de très grandes distances, c’est-à-dire plus rapidement que la vitesse de la lumière.
Avec vos expériences, vous avez montré qu’Einstein avait tort de ne pas admettre cette idée — ce que dit bien le titre de votre récent livre, paru chez Odile Jacob, Si Einstein avait su. Vous avez réalisé ces travaux à la fin des années 1970 et au début des années 1980, mais votre passion pour le sujet reste intacte. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Alain Aspect : Cette expérience m’a passionné parce qu’elle met vraiment en jeu la conception du monde d’Einstein.
Pour compléter le cours de l’histoire que vous soulignez, entre le débat Einstein-Bohr et mes travaux, il y a eu, en 1964, un physicien appelé John Bell. Bell a écrit des équations qui formalisent le désaccord historique entre Einstein et Bohr. À la suite des travaux de John Bell, John Clauser puis moi, puis d’autres encore, avons travaillé expérimentalement sur leur désaccord. J’ai eu l’honneur de montrer qu’Einstein avait tort dans une certaine mesure, mais j’ai mis ainsi en relief son immense mérite d’avoir mis le doigt sur une propriété extraordinaire de la physique quantique, l’intrication, dont les gens n’avaient probablement pas réalisé toute l’importance auparavant.
Mais j’ai beau avoir démontré qu’Einstein avait eu tort sur un sujet bien particulier, il reste pour moi un héros absolu ! Je l’admire énormément pour ses contributions à la physique quantique entre 1900 et 1925 et pour son article de 1935. Il faut ajouter que la clarté de tout ce qu’il a écrit est incroyable. John Bell l’avait aussi remarqué et avait résumé les choses ainsi :
« Bohr était incohérent, peu clair, obscur à dessein, mais il avait raison. Einstein était cohérent, clair, terre-à-terre, mais il avait tort. (Bohr was inconsistent, unclear, willfully obscure, and right. Einstein was consistent, clear, down-to-earth, and wrong). » Propos de John Bell, rapportés par Graham Farmelo, le 11 juin 2010, dans le New York Times.
Vous avez fait d’autres travaux importants par la suite. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos préférés ?
A. A. : D’une part, à la fin des années 1980, j’ai travaillé avec Claude Cohen-Tannoudji au développement d’une méthode pour refroidir les atomes — qui est sa spécialité.
Comme la température est associée à la vitesse d’agitation des atomes, pour les refroidir, il faut en fait les ralentir. Notre méthode s’appelle le refroidissement « en dessous du recul du photon » parce qu’on a réussi à ralentir l’agitation thermique par de toutes petites quantités — plus petites que ce que l’on croyait possible avec les lois de la physique quantique, de l’ordre du milliardième de degré. Ainsi je suis heureux et fier d’avoir un peu contribué au prix Nobel de Claude Cohen-Tannoudji, comme mes amis Jean Dalibard et Christophe Salomon en ce qui concerne un autre volet de son travail.
Une autre première mondiale me tient à cœur. C’est un sujet dont nous avons eu l’idée avec mon collaborateur Philippe Bouyer, en sortant d’une conférence au début des années 2000. Les chercheurs en physique de la matière condensée cherchaient depuis la fin des années 1950 à observer directement un phénomène appelé « localisation d’Anderson », qui concerne des électrons dans un matériau désordonné. Le conférencier avait dit quelque chose du style « Il serait intéressant de mettre des atomes dans un milieu désordonné » (un milieu désordonné est un endroit où règne le désordre, par exemple avec des obstacles irréguliers). Avec Philippe, on s’est regardés dans la voiture et on s’est dit : « Cette expérience, que nous avons développée au laboratoire, nous pourrions la modifier pour essayer d’observer la localisation d’Anderson des atomes dans un désordre optique. » En effet, le but du groupe de recherche d’optique atomique, que j’ai monté à l’Institut d’optique, est de faire avec des atomes ce que l’on sait faire avec les photons ou les électrons. Par exemple, le groupe — dont je ne fais plus partie bien sûr, je suis à la retraite — essaye aujourd’hui de refaire mon expérience sur l’intrication quantique avec des atomes.
Pour revenir à la localisation d’Anderson, grâce au potentiel que nous créons avec des lasers, nous avons réussi à coincer des atomes ultrafroids (un milliardième de degré) dans un paysage désordonné, ce qui nous a permis d’observer directement la localisation d’Anderson. Nous avons aussi pu photographier une « fonction d’onde atomique », c’est-à-dire la « forme » d’un atome bloqué dans notre structure de lasers. Cet article est très cité par la communauté de la matière condensée qui s’intéresse à ce sujet — ils ont été tellement étonnés de voir directement une fonction d’onde photographiée ! La localisation d’Anderson est un phénomène quantique très subtil, et je suis particulièrement fier de notre travail sur ce sujet.
Vous avez beaucoup travaillé sur les propriétés de particules individuelles, sur le refroidissement par exemple, ou celles de duos de particules pour l’intrication. Que se passe-t-il quand il y a de nombreuses particules ? Plus spécifiquement, pourquoi les lois de la physique ne semblent-elles pas les mêmes à petite et grande échelle, alors que les grandes structures sont constituées de petites particules ?
A. A. : Je vais vous donner la réponse standard à cette question — mais je dois préciser qu’à mon avis, cette réponse standard ne fait que reculer le problème d’un cran.
Voici la réponse standard : il est clair que, quand on a beaucoup de particules, on n’observe plus les propriétés quantiques. Sinon, on pourrait observer le fameux chat de Schrödinger, qui est à la fois vivant et mort — et on ne l’observe pas. On dit que c’est à cause de la « décohérence ».
La décohérence, c’est le fait que quand des objets quantiques sont en interaction avec le monde extérieur, leurs propriétés quantiques disparaissent plus ou moins vite, d’une façon plus ou moins nette, mais de façon inévitable. Une partie de l’information quantique va en quelque sorte se diluer dans le monde extérieur, et donc les particules n’ont plus toutes leurs caractéristiques quantiques. Or, on peut montrer théoriquement que plus vous avez un grand nombre de particules, plus il faut que les perturbations de l’extérieur soient petites pour conserver les caractéristiques quantiques. En d’autres termes, pour pouvoir observer des propriétés quantiques avec un grand nombre de particules, il faut donc les isoler davantage du monde extérieur.
C’est l’objectif de tous les gens qui essayent aujourd’hui de construire un ordinateur quantique, dans lequel il faut avoir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de ce que l’on appelle des « bits quantiques ». Ce sont des particules quantiques que l’on arrive à intriquer sans qu’elles interagissent avec le monde extérieur.
Pour faire cet ordinateur quantique, est-ce que la difficulté est purement technologique, celle d’isoler davantage du monde extérieur, ou bien est-ce qu’il y a une limite intrinsèque, un nombre de particules que l’on ne peut plus intriquer ? Où est la limite entre le monde quantique et le monde classique ?
A. A. : Aujourd’hui, on a réussi à observer le phénomène d’intrication avec 1 000 particules, peut-être quelques milliers. Mais, de l’autre côté, dans n’importe quel objet à notre échelle, il y a 1023 particules (1 suivi de 23 zéros, soit cent mille milliards de milliards). Il y a une vingtaine d’ordres de grandeur entre les deux échelles, c’est un intervalle absolument gigantesque. D’où la question : et s’il y avait une limite absolue entre les deux mondes ? Ce serait une nouvelle loi de la physique, mais pour l’instant, on ne connaît pas cette limite.
Découvrir une telle loi serait formidable, même si, selon où cette limite se place, elle pourrait balayer nos espoirs de développer des ordinateurs quantiques.
Il se trouve que je suis cofondateur d’une start-up française, Pasqal, qui essaye de construire un ordinateur quantique qui soit une machine facile à utiliser pour les utilisateurs. Du coup, j’ai très envie que l’ordinateur quantique tienne ses promesses. Mais, d’un autre côté, si, en essayant de développer cet ordinateur quantique, on trouve qu’il y a une limite fondamentale entre monde quantique et monde macroscopique, je serais très heureux en tant que physicien ! En fait, je pense que je serais gagnant dans les deux cas : soit l’ordinateur quantique marche, et je suis gagnant parce qu’il y a une application à des phénomènes que j’ai étudiés il y a longtemps ; soit on aura trouvé une nouvelle loi de la physique, et ce serait absolument extraordinaire.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette idée de limite fondamentale entre monde quantique et monde classique ?
A. A. : Non, pour l’instant, on n’en sait pas plus que ce que je vous ai dit, c’est-à-dire que la décohérence est le fait qu’il y a une partie de l’« information quantique » qui fuite vers l’extérieur, et que cela détruit les superpositions quantiques. Et que plus le nombre de particules intriquées est grand et plus la décohérence va être nocive — donc il faut isoler les systèmes de plus en plus si on veut qu’ils restent quantiques.
Cependant, il y aurait tout de même peut-être une échappatoire à la décohérence, dont rêvent les physiciens.
En effet, on décrit les particules quantiques grâce à leur « état » — c’est-à-dire ce qui décrit tous les aspects de la particule. Quand vous avez de nombreuses particules intriquées, vous imaginez bien que décrire l’ensemble de particules peut devenir un peu long. Pour un grand nombre de particules, l’« espace des états », c’est-à-dire l’ensemble de toutes les possibilités, est d’une taille absolument extraordinaire. Il suffit d’avoir 200 ou 300 bits quantiques intriqués pour que le nombre d’états possibles soit plus grand que le nombre de particules dans l’univers. Dans cet espace des états, on n’est pas à l’abri d’un coup de chance, comme on dit, qui nous fournirait un endroit protégé de la décohérence — un petit sous-ensemble de l’espace des états qui ne souffrirait pas de la décohérence. Si cet endroit existe, quelques états particuliers dans l’immense espace des états ne seraient pas détruits par les interactions avec le monde extérieur.
Il y a des efforts sérieux en ce sens. Quand vous entendez parler de bit quantique « topologique » par exemple, c’est bien de cela qu’il s’agit. Mais jusqu’à présent, on tâtonne encore dans ce domaine.
Pourquoi parlez-vous de la décohérence comme de quelque chose qui cache le problème, qui le repousse d’un cran ?
A. A. : En physique, il y a des choses que l’on peut expliquer rigoureusement à partir des lois fondamentales. Mais il y en a d’autres, qui sont absolument fonctionnelles – on sait qu’elles décrivent correctement les phénomènes que l’on observe – mais qu'on ne sait pas encore les démontrer à partir des premiers principes. Il faut les ajouter « à la main », comme on dit. C’est le cas de la décohérence, mais c’est aussi le cas du second principe de la thermodynamique. La décohérence est une théorie fonctionnelle pour expliquer la perte des caractéristiques quantiques, mais on ne sait pas encore complètement la démontrer en toute généralité.
Quelles sont les frontières de la recherche fondamentale en mécanique quantique aujourd’hui, les grandes questions que se posent les chercheuses et les chercheurs ?
A. A. : Je vais d’abord préciser que cela fait douze ans que je ne dirige plus de groupe de recherche… Je m’intéresse à ces questionnements, mais je ne contribue plus à les formuler.
Cela étant, il me semble qu’il faut distinguer entre les problèmes à très long terme et ceux à plus court terme. Dans les problèmes à très long terme, on sait par exemple qu’il y a un problème entre la relativité générale et la physique quantique. C’est un problème de théoriciens, bien en dehors de mon domaine de compétences.
En revanche, dans les perspectives à plus court terme, et que je comprends, il y a les gens qui essayent d’observer le régime quantique avec des objets « macroscopiques », en l’occurrence une membrane extrêmement tendue, qui vibre donc à une fréquence très élevée, et sur laquelle on commence à observer la quantification du mouvement oscillatoire. On touche là au problème que l’on a évoqué précédemment, celui de la limite entre monde quantique et monde macroscopique, puisqu’on commence à pouvoir étudier un objet qui est de dimension macroscopique et qui pourtant présente des phénomènes quantiques.
C’est une voie de recherche qui a l’avantage de ne pas être à l’échelle de décennies, mais plutôt à l’échelle des années, et qui peut nous aider à mieux comprendre cette limite entre le monde quantique et le monde classique. Pour cela, plusieurs systèmes sont envisagés, pas seulement les membranes, également des micromiroirs qui interagissent avec des photons.
Quelle taille font ces membranes ?
A. A. : Ces membranes peuvent être par exemple faites de matériaux 2D, un peu comme le graphène (réseau bidimensionnel d’atomes de carbone) : elles peuvent faire quelques millimètres de diamètre quand on les regarde par le dessus, mais seulement un atome d’épaisseur.
Ceci étant, ce n’est pas tant leur taille, mais leur fréquence de vibration qui est importante ici — c’est ça qui leur permet d’exhiber des propriétés quantiques. Les fréquences de vibration sont tellement élevées, comme quand on tend une corde de guitare, que l’on atteint des gammes de millions de hertz, soit des millions de vibrations par seconde. Quand le « quantum de vibration » (défini par Einstein en 1905 comme la fréquence multipliée par la constante de Planck) devient comparable à l’énergie thermique typique, c’est-à-dire quand la membrane vibre assez haut, l’agitation thermique vous gêne moins et vous pouvez observer des effets quantiques, à condition de refroidir suffisamment le système.
Y a-t-il d’autres avancées que vous suivez particulièrement et qui repoussent les limites fondamentales de la physique quantique ?
A. A. : Il faut bien sûr parler de tous ces efforts pour réaliser l’ordinateur quantique, qui suivent des voies toutes très intéressantes d’un point de vue de la physique fondamentale.
Il y a les voies qui utilisent des atomes neutres, ou des ions, ou des photons, pour fabriquer des bits quantiques. Ce sont des objets quantiques qui nous sont donnés par la nature. Par ailleurs, en matière condensée, que je connais personnellement moins bien, il y a des bits quantiques artificiels, basés sur des circuits supraconducteurs. Les matériaux supraconducteurs sont des matériaux bien particuliers, dans lesquels l’électricité peut se propager sans résistance – encore un phénomène quantique. Certains circuits, conçus spécialement, présentent des états quantiques spécifiques que l’on peut exploiter comme bits quantiques. À l’heure actuelle, on ne sait rendre des matériaux supraconducteurs qu’à très basse température.
L’avantage des objets quantiques naturels comme les photons, les ions et les atomes, c’est qu’ils sont parfaits par définition : tous les atomes de rubidium sont les mêmes, tous les photons de même fréquence sont les mêmes. Pour un expérimentateur, c’est une bénédiction.
Dans le domaine de la matière condensée, au contraire, les scientifiques fabriquent des circuits quantiques de façon artificielle, avec des supraconducteurs. Il faut les réaliser suffisamment bien pour que les circuits soient vraiment quantiques, tous identiques et avec les mêmes performances.
Et, en fait, quand on regarde l’histoire de la physique, on s’aperçoit qu’il y a des phénomènes qui sont démontrés avec des objets quantiques naturels. À partir du moment où on trouve que le phénomène est suffisamment intéressant, en particulier pour des applications, les ingénieurs arrivent progressivement à développer des systèmes artificiels qui permettent de reproduire le phénomène d’une façon beaucoup plus simple ou contrôlée. C’est pour cela je trouve que c’est intéressant de commencer par essayer l’ordinateur quantique avec des objets quantiques naturels, comme le fait Antoine Browaeys ici, à l’Institut d’optique, ou la start-up Quandela avec des photons.
On observe un fort engouement pour les technologies quantiques, dont certaines sont déjà opérationnelles, par exemple les gravimètres quantiques ou les simulateurs quantiques : quels sont les « avantages quantiques » déjà démontrés par les technologies opérationnelles aujourd’hui ?
A. A. : En ce qui concerne les gravimètres, c’est-à-dire les appareils qui mesurent la gravitation, la performance des gravimètres quantiques n’est pas meilleure que le meilleur des gravimètres classiques… sauf qu’au lieu de peser une tonne et d’avoir besoin de le déplacer avec une grue là où vous voulez aller mesurer la gravitation, c’est un appareil qui fait quelques dizaines de kilos et on peut le déplacer facilement sur les flancs d’un volcan pour savoir si le magma a des mouvements soudains, ce qui peut être un signe précurseur d’éruption. Dans ce cas-là, les performances ultimes des gravimètres quantiques ne sont pas meilleures que les performances ultimes des meilleurs systèmes classiques, mais la miniaturisation apporte des avantages certains.
Et pour l’ordinateur quantique ?
A. A. : En ce qui concerne l’ordinateur quantique, il faut d’abord définir le terme « avantage quantique ». Lorsqu’on vous annonce un avantage quantique obtenu en résolvant un problème que personne ne s’était jamais posé, on peut douter de l’intérêt. Par exemple, si vous faites passer un faisceau laser à travers un verre de lait, la figure lumineuse qui est derrière est une figure extrêmement compliquée à calculer. Ce calcul prendrait des années avec un ordinateur classique. Est-ce que je vais dire pour autant que mon verre de lait est un calculateur extraordinaire parce qu’il me donne le résultat d’un calcul infaisable ? Bien sûr que non. Certaines annonces d’avantage quantique relèvent d’une présentation analogue.
Par contre, ici à l’Institut d’optique, Antoine Browaeys a un simulateur quantique qui a répondu à un problème posé depuis longtemps : un problème de physiciens appelé le « problème d’Ising ». Il s’agit de trouver la configuration d’énergie minimale d’un ensemble de particules disposées régulièrement sur un réseau. Avec les ordinateurs classiques, on peut répondre au problème avec 80 particules maximum, je dirais. Tandis qu’avec son simulateur quantique, Antoine Browaeys a résolu le problème avec 300 particules. Il a incontestablement l’« avantage quantique ».
Il faut bien voir cependant que les physiciens qui étudiaient le problème avec des ordinateurs classiques ont été stimulés ! Ils ont alors développé des approximations qui permettent d’approximer le résultat à 300 particules, mais ils n’étaient pas certains que leurs approximations étaient correctes. Quant à Browaeys, il avait trouvé un résultat, mais il n’avait rien pour le vérifier. Quand ils ont constaté qu’ils ont trouvé la même chose, ils étaient tous contents. C’est une compétition saine — c’est l’essence de la méthode scientifique, la comparaison de résultats obtenus par diverses méthodes.
J’en profite pour dire qu’il y a une deuxième acception du terme « avantage quantique ». Elle se situe sur le plan énergétique, c’est-à-dire qu’on a de bonnes raisons de penser qu’on pourra faire, avec des ordinateurs quantiques, des calculs accessibles aux ordinateurs classiques, mais en dépensant moins d’énergie. Dans le contexte actuel de crise de l’énergie, c’est un avantage quantique qui mérite d’être creusé. On sait ce qu’il faudrait faire en principe pour exploiter cet avantage énergétique : il faudrait augmenter la cadence des calculs : passer d’une opération toutes les secondes ou dixièmes de seconde à mille par seconde. C’est vraiment un problème technologique qui paraît surmontable.
En somme, l’avantage quantique, ça peut être soit la possibilité de faire des calculs inaccessibles aux ordinateurs classiques, soit la possibilité de répondre à des problèmes auxquels on pourrait répondre avec un ordinateur classique, mais en dépensant moins d’énergie.
Certaines technologies quantiques ne sont pas encore suffisamment matures pour être largement utilisables — par exemple l’ordinateur quantique. Pourtant, de grandes entreprises annoncent ces derniers mois des avancées notables : Google en décembre 2024 et Amazon Web Services en février 2025 sur les codes correcteurs d’erreurs, Microsoft en février aussi avec des qubits « topologiques ». Quel regard portez-vous sur cette arrivée des géants du numérique dans le domaine ?
A. A. : L’arrivée des géants du numérique, c’est tout simplement parce qu’ils ont énormément d’argent et qu’ils veulent ne pas rater une éventuelle révolution. Comme nous tous, ils ne savent pas si la révolution de l’ordinateur quantique aura lieu ou non. Mais si elle a lieu, ils veulent être dans la course.
En ce qui concerne les annonces, je veux être très clair en ce qui concerne celle de Microsoft au sujet des bits quantiques « topologiques ». Cette annonce est faite par un communiqué de presse des services de communication de Microsoft, et elle n’est vraiment pas étayée par l’article publié par les chercheurs de Microsoft dans Nature, qui est une revue scientifique avec évaluation par les pairs — c’est-à-dire des chercheurs qui savent de quoi il en retourne et qui ne laissent pas publier des affirmations non justifiées.
Le communiqué de presse prétend qu’ils ont observé les fameux « fermions de Majorana » — un candidat au poste de bit quantique « topologique », c’est-à-dire dans le fameux sous-ensemble de l’espace des états qui serait protégé de la décohérence.
De leur côté, les chercheurs, dans l’article, disent qu’ils ont observé un phénomène qui pourrait — qui pourrait ! — être interprété, peut-être, par des fermions de Majorana. C’est extrêmement différent. De plus, le communiqué de presse évoque déjà le fait qu’ils vont avoir une puce dans laquelle il y aura un million de fermions de Majorana, alors qu’on n’est même pas sûr d’en avoir un seul. Je vous laisse apprécier !
Cette implication de la recherche privée risque-t-elle de déplacer l’engouement de la recherche publique vers d’autres sujets ? Quel regard portez-vous sur l’équilibre entre recherche publique et recherche privée ?
A. A. : Il y a des choses qui sont à la mode à un moment, puis qu’on oublie. Mais c’est normal, car il y a une forme de sélection naturelle des idées dans la recherche. Par exemple, en ce qui concerne les bits quantiques, cela fait quinze ans que la Commission européenne me demande sur quel type de bit quantique focaliser les efforts — on les a répertoriés tout à l’heure : photons, atomes, ions, circuits supraconducteurs, silicium… Je leur réponds, encore aujourd’hui, que je suis incapable de le leur dire. C’est le rôle de la puissance publique de financer le long terme.
Il faut laisser les chercheurs avancer et, à un moment donné, il y aura probablement une ou deux pistes qui se révéleront meilleures que les autres. Et bien sûr, on ralentira la recherche sur les autres. C’est ça, la sélection naturelle des idées.
Les acteurs privés ont d’ailleurs tous misé sur des candidats différents pour leurs bits quantiques…
A. A. : C’est vrai, mais une des caractéristiques du privé, c’est d’être très réactif. Donc le jour où ils réaliseront que leur choix de bit quantique n’est pas le bon, ils vont instantanément arrêter et passer à un choix qui s’est révélé meilleur. D’ailleurs, sur le plan de l’ingénierie, je dois dire que ce qui se fait dans le privé est tout à fait remarquable du point de vue de la réactivité. La recherche académique est meilleure pour laisser mûrir les idées, ce qui est une phase indispensable.
Il faut reconnaître que ces acteurs privés mettent beaucoup plus d’argent que le public, en revanche, ils n’ont pas le long terme devant eux. Or, il ne suffit pas de déverser des sommes énormes d’argent pour accélérer la recherche.
La recherche demande aussi une maturation des idées ; et ce n’est pas parce que vous avez dix fois plus d’argent que vous allez dix fois plus vite. Il y a à la fois des évolutions dans les idées et, parfois aussi, des évolutions technologiques inattendues. J’ai pu observer ces effets de maturation et de paliers lors de ma longue expérience d’évaluation des systèmes de recherche en France, en Allemagne et dans d’autres pays.
De ce point de vue, il est primordial que la recherche publique conserve des financements non fléchés, qu’on appelle « blancs ». Je pense qu’il n’est pas illégitime qu’un État qui met beaucoup d’argent dans la recherche signale que, sur tel et tel sujet, il aimerait que les gens travaillent et qu’il mette de l’argent là-dedans. Le point essentiel, c’est de laisser la place à d’authentiques sujets blancs, proposés par les chercheurs alors qu’ils ne figuraient dans aucun programme. C’est grâce à un projet non fléché que nous avons pu observer la localisation d’Anderson, par exemple. On ne peut pas tout prévoir sur le long terme.
Et puis il faut aussi que l’information circule pour que d’autres chercheurs s’emparent des avancées, et puissent les adopter. D’où l’importance des publications, qui sont l’occasion de partager ses résultats avec les autres chercheurs ; et d’où les réserves que l’on doit avoir sur la confidentialité, même s’il est clair que cette confidentialité est nécessaire dans certains domaines spécifiques.![]()
Alain Aspect est co-fondateur de la start-up Pasqal.









/2025/04/04/manifestation-de-soutien-a-marine-le-pen-ils-retombent-dans-les-travers-de-ce-qu-etait-ce-parti-ce-sont-des-trumpistes-aux-petits-pieds-commente-ambroise-mejean-president-des-jeunes-avec-macron-67f04a0c6bb82933496567.jpg?#)















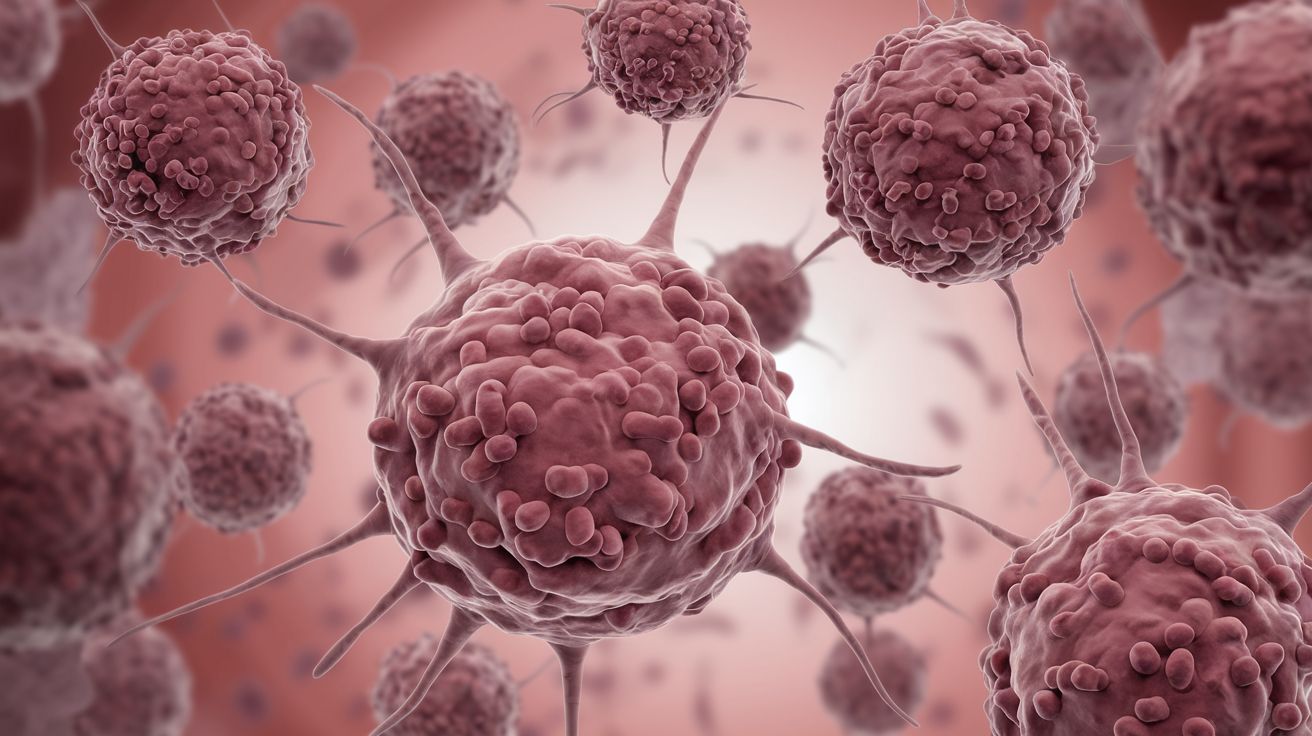
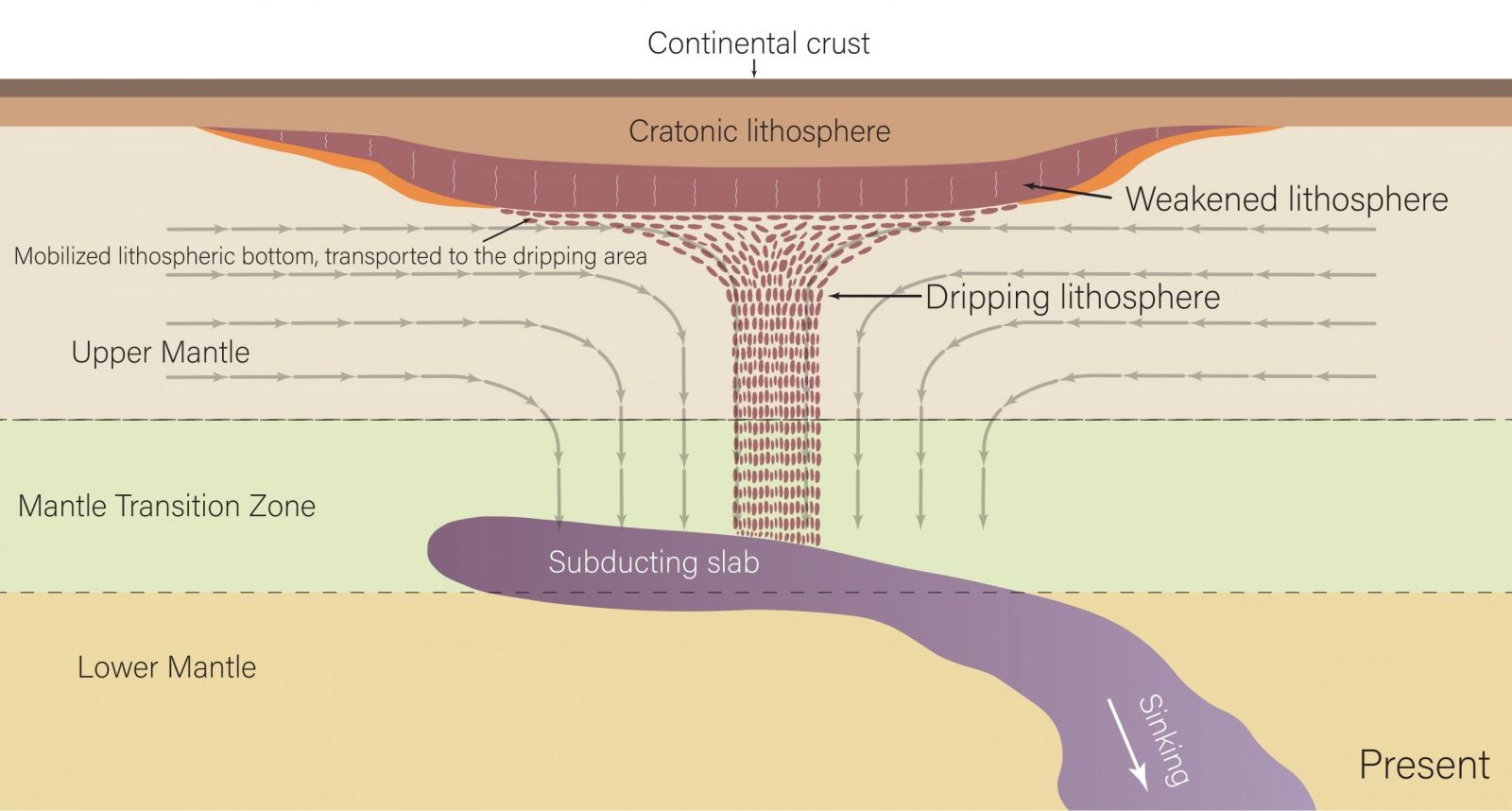






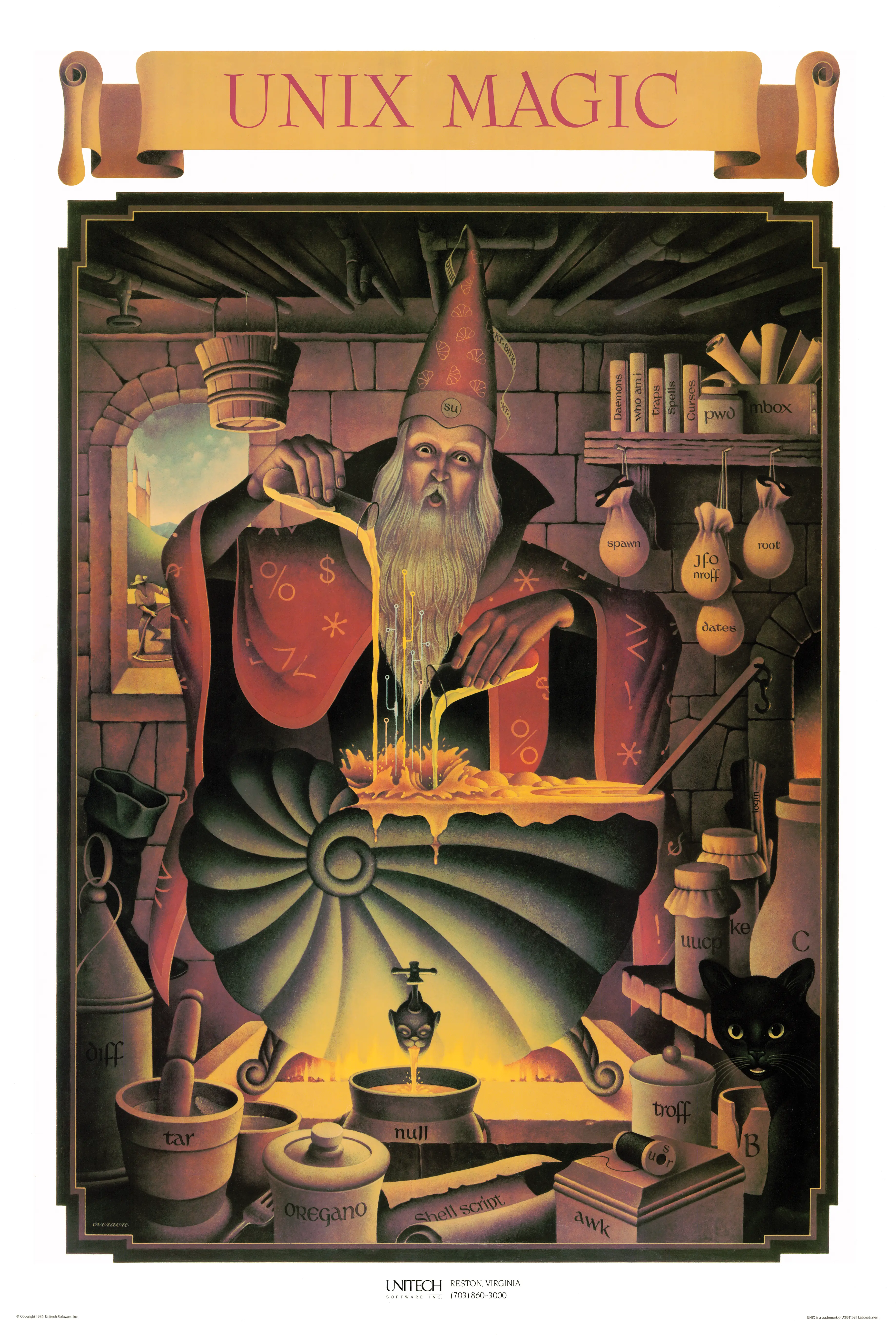





/2025/04/04/063-2162603813-67f04d16a75ea861220273.jpg?#)
/2025/04/04/culture-l-histoire-de-l-indemodable-chaise-pliante-67f04440cd7c9176305715.jpg?#)

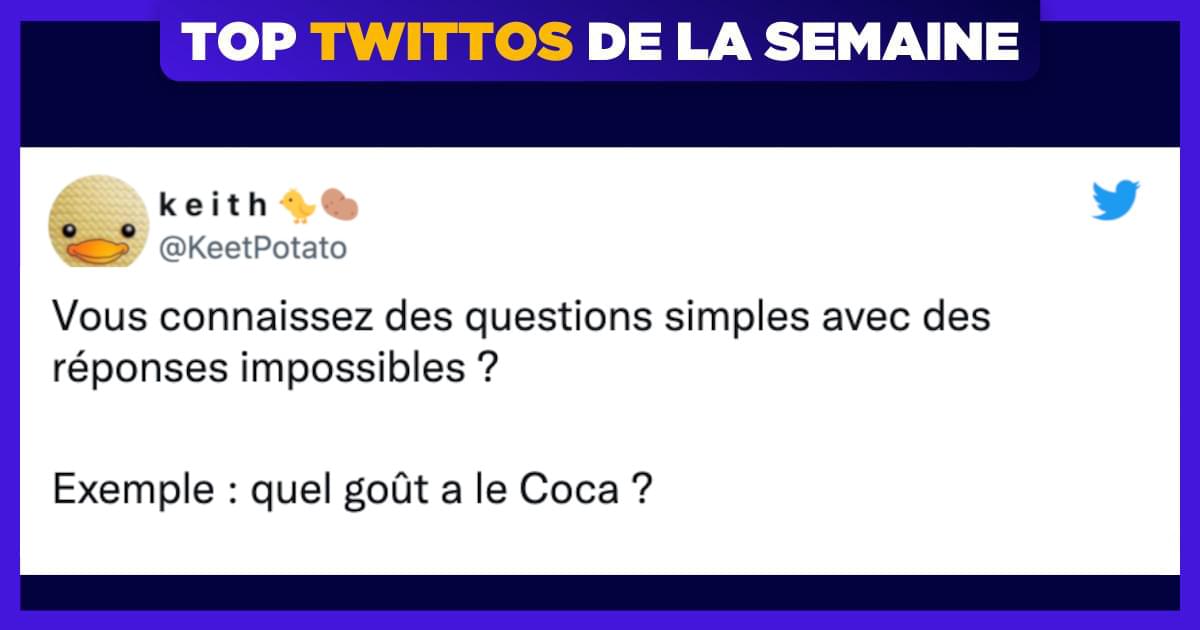
/2025/04/04/sipa-shutterstock40721796-000003-67f0323a4c4d7352140716.jpg?#)
/2025/04/04/gastronomie-le-barbecue-kamado-venu-du-japon-seduit-les-amateurs-67f03ffc4d379604062947.jpg?#)































