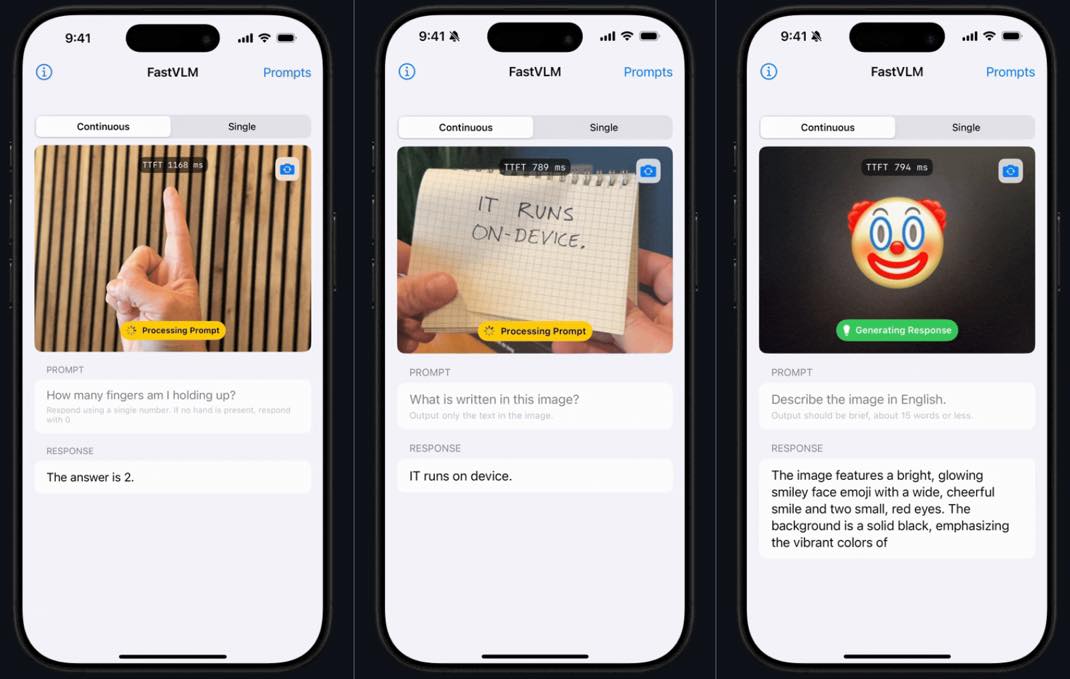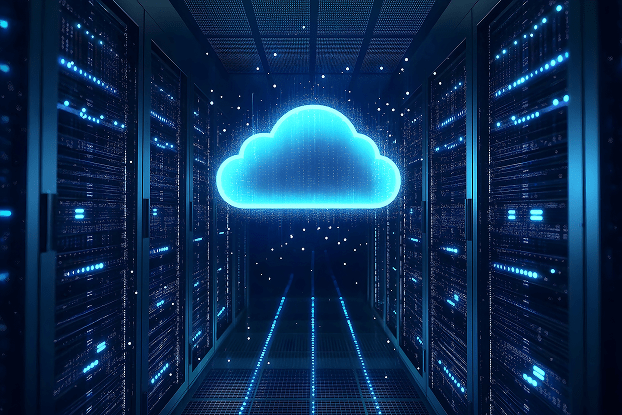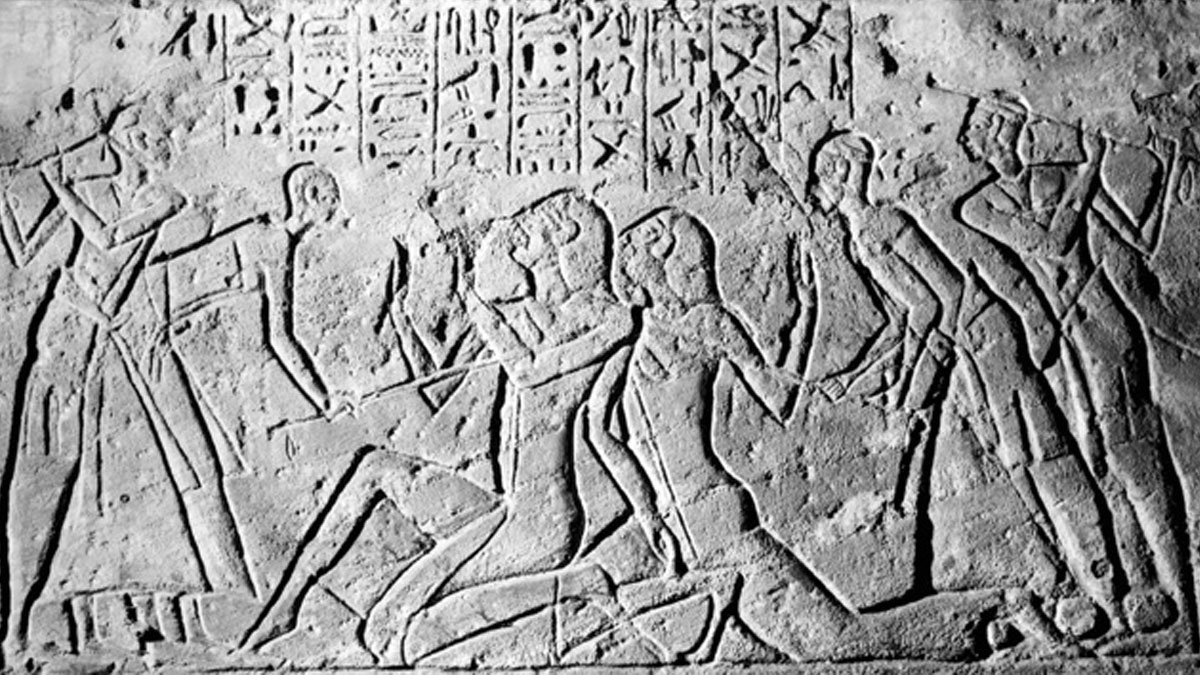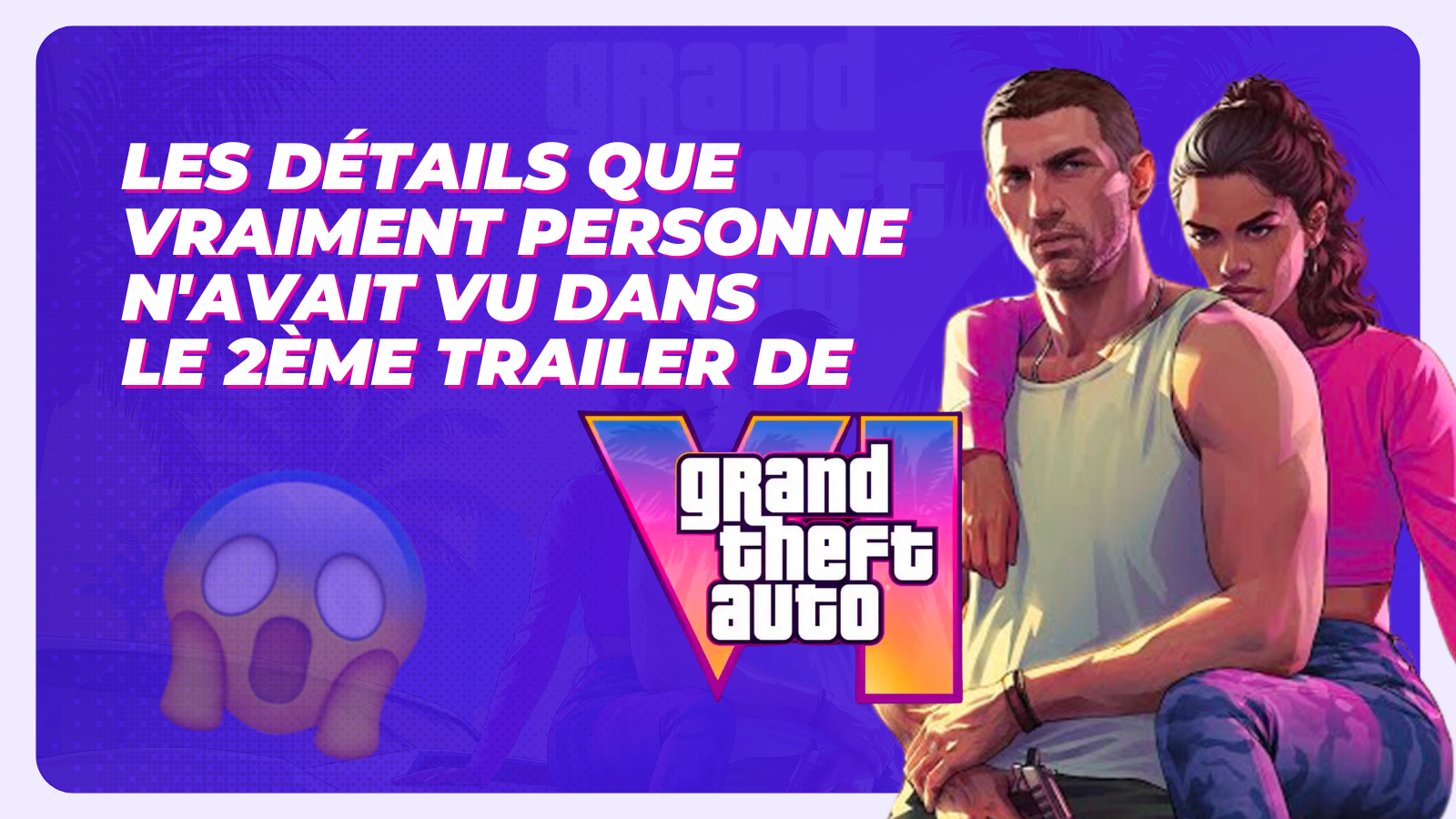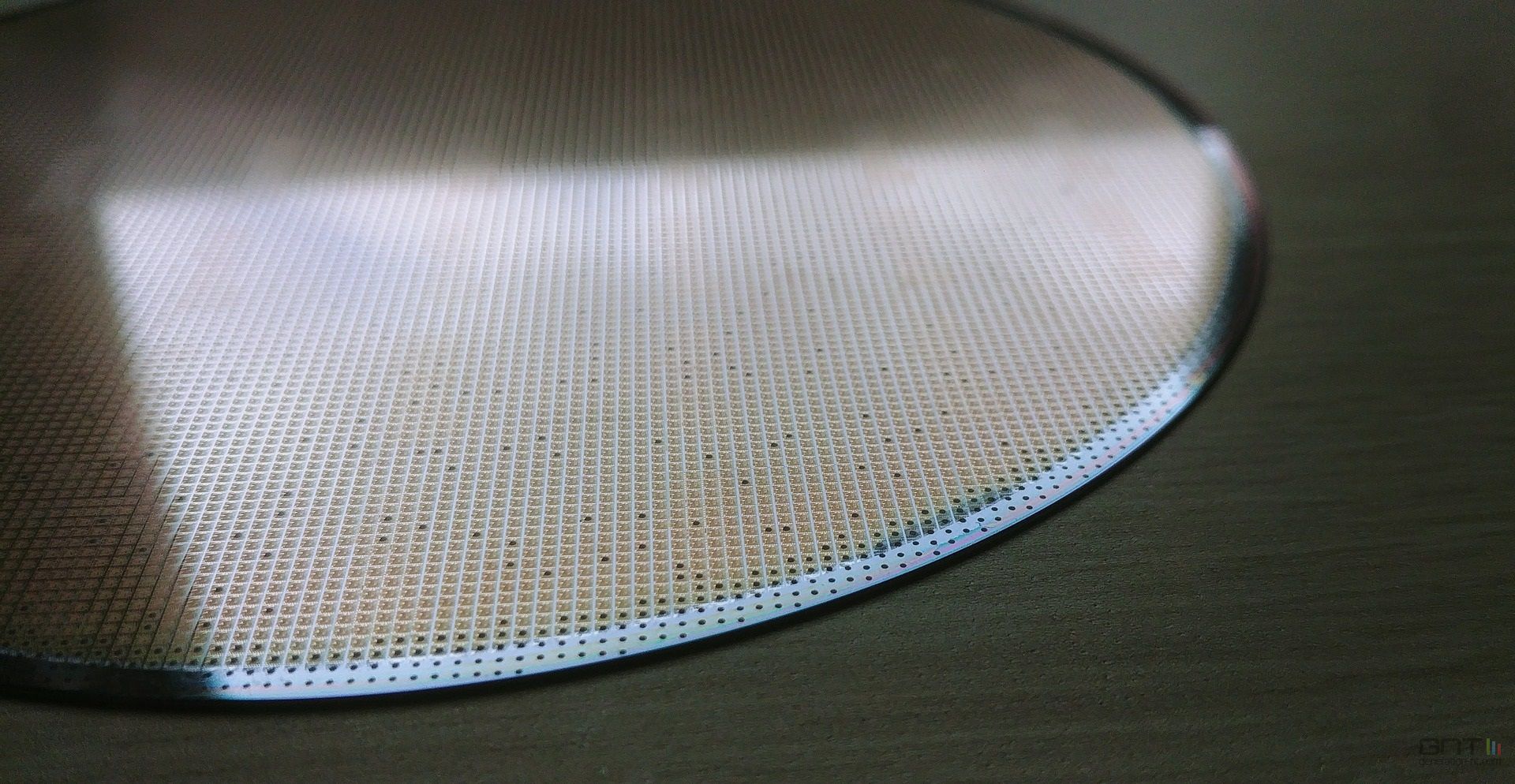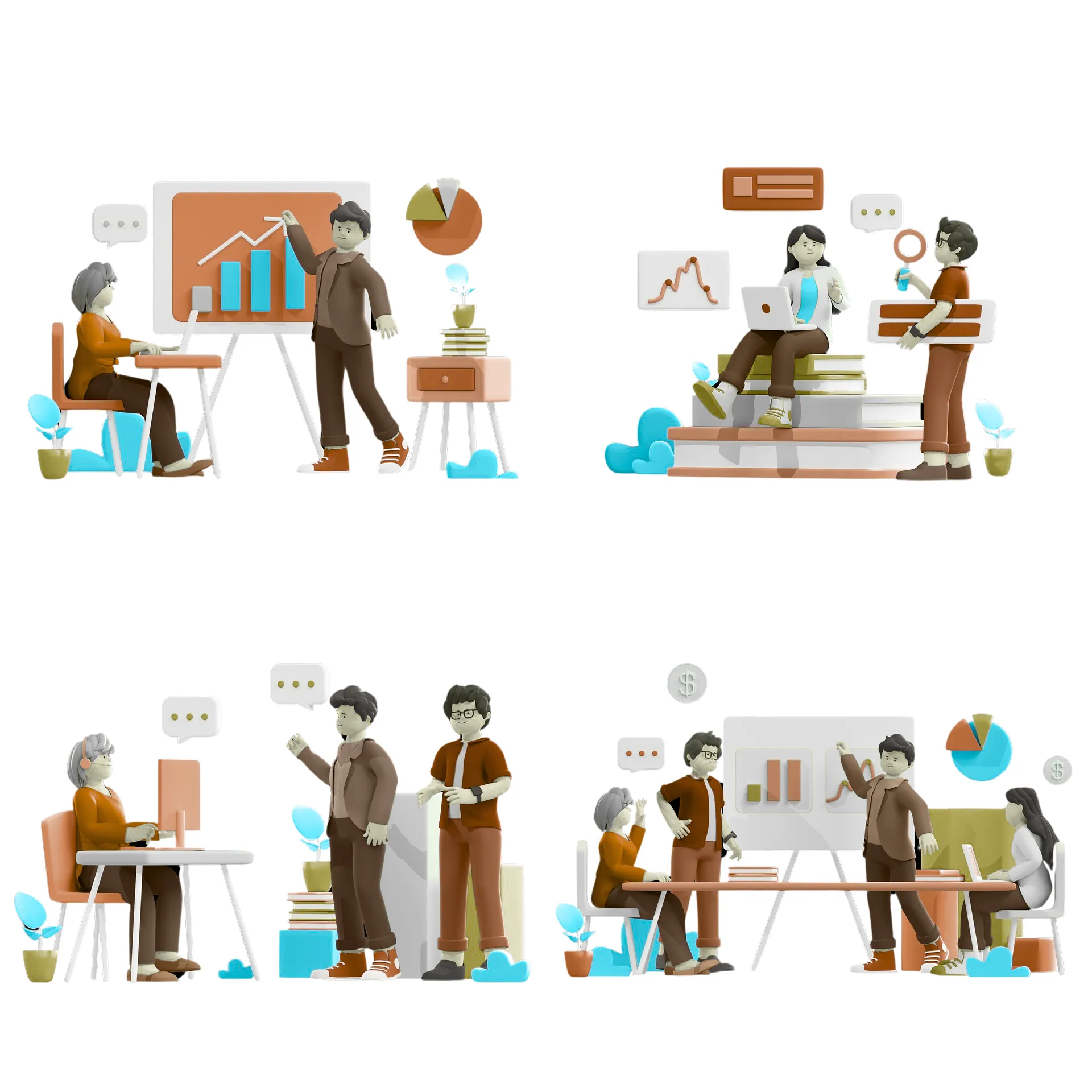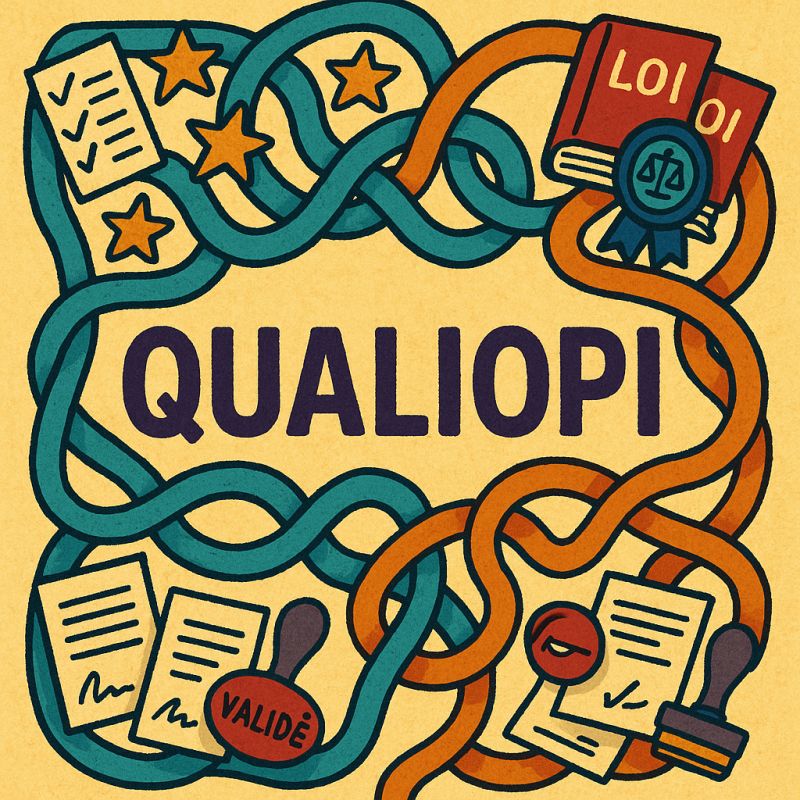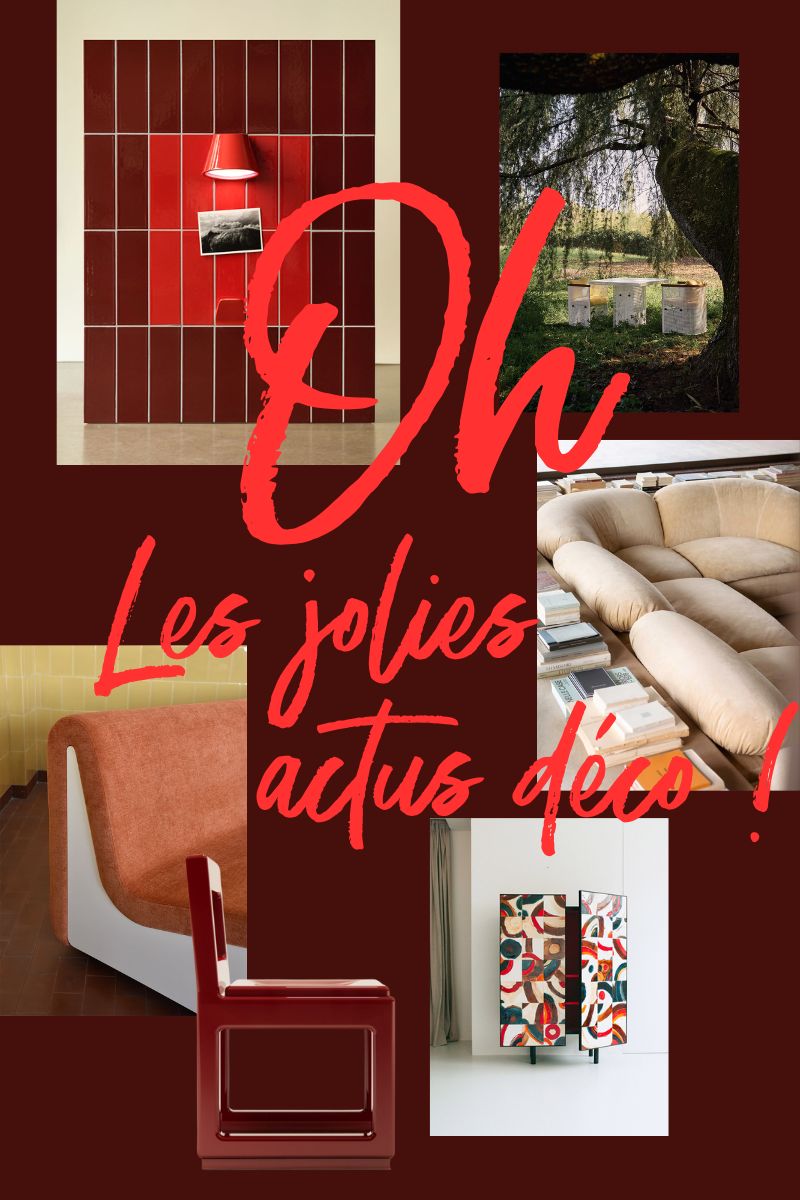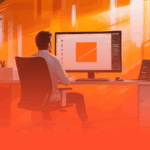B. B. King jouait « faux » – et c’est ce qui faisait son génie
B. B. King reste une légende du blues, non pas grâce à sa virtuosité (il jouait volontairement entre les notes), mais grâce à son style expressif et microtonal.

Dix ans après sa disparition, B. B. King fascine toujours. Peu technique, incapable de jouer des accords complexes ou de chanter en jouant, il a pourtant marqué l’histoire du blues. Son secret ? Une manière unique de jouer « faux » – ou plutôt, de faire vibrer chaque note dans l’espace infime entre justesse et émotion.
Certains pensent que B. B. King n’était pas un grand guitariste. Parmi eux, B. B. King lui-même. En 2012, il déclarait :
« Je me définis comme un chanteur de blues, mais vous ne m’entendrez jamais dire que je suis un guitariste de blues. Pourquoi ? Parce qu’il y a beaucoup de musiciens qui sont bien plus doués que moi, qui jouent le blues bien mieux que moi. »
Et c’est vrai, son vocabulaire musical était limité. B. B. King a un jour confié à Bono : « Je galère avec les accords alors ce qu’on fait, c’est que je prends quelqu’un d’autre pour s’en charger… Je suis nul en accords. » Il a même affirmé qu’il était incapable de jouer et de chanter en même temps.
En effet, B. B. King n’était pas un guitariste très technique. Bien qu’il ait été l’un des premiers à connaître de grands succès avec des solos de guitare électrique à une seule note, il a été suivi par une vague de musiciens plus savants et polyvalents, aux premiers rangs desquels Eric Clapton, Bonnie Raitt, Robert Cray et Stevie Ray Vaughan.
Malgré cela, il a rempli des salles jusqu’à 80 ans passés, et il demeure l’un des guitaristes les plus adulés et les plus respectés de l’histoire de la musique. Alors qu’est-ce donc qui nous a tant captivés dans le jeu de King ? Je pense que la réponse réside dans le fait qu’il ne jouait jamais parfaitement juste.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Notes bleues
Comme la plupart des musiciens de blues, B. B. King tirait une grande partie de ses phrases mélodique et de ses riffs de la gamme pentatonique mineure, une forme simple sur le manche que la plupart des guitaristes électriques apprennent en tout début de carrière. Ces positions ou « boîtes » constituent un vocabulaire musical tellement simple que les guitaristes de blues n’ont même pas besoin de connaître le nom des notes qu’ils jouent (une particularité qui laisse souvent sans voix les musiciens classiques).
La gamme pentatonique mineure – et sa proche cousine, la gamme blues – omet quelques notes de la gamme mineure complète. Cela simplifie les choix mélodiques dont dispose le soliste, limitant automatiquement le vocabulaire musical de la mélodie. Mais, à mon sens, c’est précisément cette contrainte mélodique qui a permis à B. B. King de développer son style majestueux et expressif. Il était ce que j’aime à appeler un guitariste microtonal – il intensifiait l’expressivité de ses solos en pratiquant le bend, qui consiste à tirer latéralement sur une corde afin d’altérer la note.
Lorsque B. B. King passe de la septième à l’octave dans un solo, c’est souvent un peu faux : il arrive que les cinquièmes n’atteignent que graduellement la note, car le bend commence à la note du dessous et – fait crucial – le bluesman a étudié toute sa vie la mystérieuse « tierce blues », cette note qui se cache quelque part dans les interstices entre le troisième ton de la gamme mineure et celui de la gamme majeure.
Les tierces de King pouvaient être imprévisibles, espiègles, méditatives, rebelles, querelleuses, moroses, pensives ou accusatrices.
Il n’y a qu’à écouter son live à Montreux en 1993. À [0 :29], la tierce est nette, attirant effrontément l’attention sur elle – c’est un mi bécarre presque faux sur le la bémol joué par les cuivres. À [1 :21], elle se trouve au beau milieu des interstices, commençant, furieuse, sur la tierce mineure parfaite pour que, presque aussitôt, un bend la fasse partir dans les aigus à l’instant où le « frisson » du titre disparaît, laissant derrière lui le protagoniste de la chanson, esseulé. À [1 :49], B. B. King se livre à un solo de sept notes dont chacune est légèrement « fausse », et l’oscillation de ses tierces entre les intervalles majeurs et mineurs évoque les fluctuations de la voix humaine – la phrase musicale est suivie par une dernière tierce mineure presque silencieuse… Le bend de la corde vers le haut présente une ressemblance troublante avec une inspiration.
B. B. King parle avec sa guitare
Les irrégularités de son accordage ne sont pas un simple effet de style – elles participent de sa manière de communiquer en musique. Les accords simples et les choix de notes prévisibles inhérents au blues ne sont pas l’objet de la performance ; elles définissent simplement le cadre à travers lequel se donne à voir l’art de B. B. King.
Cette « grimace blues » par laquelle il accompagne ses bends relève sans doute en partie du spectacle. Cependant, elle illustre aussi la décision subtile et difficile que doit prendre un grand musicien de blues quand vient le moment de délivrer la note « fausse » dont l’expressivité tombera à la perfection.
Si vous pensez que cette analyse relève d’élucubrations d’un fan de blues électrique en deuil, écoutez donc ces trois morceaux de B. B. King :
Dans 3 O’Clock Blues (1952), les solos sont impétueux, sonores, mais les micro-intervalles ne cherchent pas la subtilité : B. B. King, 26 ans, fait une démonstration de la technique qu’il vient de maîtriser.
Dans Sweat Little Angel (1964), on entend B. B. King en showman au sommet de sa puissance : les solos de guitare répondent énergiquement au public, et le pitch des tierces suraiguës se fait l’écho en temps réel des hurlements des fans.
Enfin, dans l’enregistrement de The Thrill Is Gone datant de 2009, on a B. B. King au crépuscule de sa carrière – il peut lui arriver de faire un pain, mais les micro-intervalles et les dynamiques sont plus variées que jamais –, c’est la maturité et la confiance d’un vieil homme qui sait que son public est suspendu à chaque note qu’il joue.
Les bends subtils de B. B. King, c’est le son d’un musicien totalement immergé dans son moyen de communication, parlant un langage musical absolument unique qu’il a passé sa vie à inventer. Le grand homme est parti, mais ses notes bleues vivront éternellement.![]()
Joe Bennett ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[PEOPLE] Patrick Sébastien, un chanteur trop « vieux », trop « blanc », trop gaulois…](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/whatsapp-image-2025-05-13-a-113204-59bd9dfc-616x346.jpg?#)

![[SATIRE A VUE] Marseille : le Manneken-Pis de la honte](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/whatsapp-image-2025-05-13-a-152505-340dd218-616x346.jpg?#)